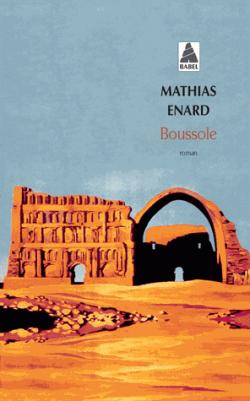>
Critique de QPerissinotto
Autant le dire tout de suite, Mathias Enard nous livre avec Boussole un monstre de littérature et de lecture. A la fois expérience de lecture car c'est un véritable défi que de comprendre le style d'Enard, de saisir ses références, de ne pas se perdre dans ses digressions, de ne pas se laisser impressionner par un livre qui nous dépasse ; et expérience de littérature car énormément de questions sont soulevées, la matière romanesque amène un réflexion constante extrêmement poussée.
Mais ce qui frappe dès les premières pages, c'est le style déroutant, magnifique, dense et très poétique. La puissance évocatrice d'Enard est impressionnante : il peut parler du désir sur une ou deux lignes mais parvient quand même à rendre la toute puissance aux mots. Sa narration est constamment enveloppée d'un mysticisme et d'un romantisme. C'est un chef-d'oeuvre stylistique. D'autant plus que cela part d'une véritable ambition littéraire : raconter la nuit d'un homme, seul dans sa chambre, souffrant, de manière introspective. Voyager de souvenir en digression, de l'Occident à l'Orient. C'est une écriture spontanée mais extrêmement travaillée ; et ce qui prodigieux c'est que ce n'est pas le narrateur-personnage principal qui prend toute la scène romanesque, ce sont les personnages issus de ses digressions qui sont projetés en premier plan. La prose d'Enard est multiple et invoque en même temps l'unicité. de part les nombreux genres textuels qu'elle utilise (poème, extrait de texte scientifique, image…), cette structure narrative semble manquer de cohérence. Elle est en réalité une structure tissée au millimètre. Boussole n'est pas une structure en deux dimensions, ni même en trois ; les différents fils narratifs forment une toile d'araignée qui se soulève, se met en mouvement, puis se repose quelque instant, en attendant la prochaine impulsion. le narrateur essaie à la fois de cerner Sarah et sa narration. Mais les deux lui échappent. Quand il a l'impression de mettre la main sur Sarah, elle disparaît en une pirouette, l'obligeant à passer à une autre réminiscence, un autre lieu.
C'est également un roman de l'altérité : à travers Sarah il cherche sa propre destinée, sa réussite. Lorsqu'il fume de l'opium, c'est dans l'unique but d'observer ses propres changements, de se considérer comme « l'Autre ». La société également est « autre ». Enard construit son image actuelle par résonnance face au passé : en invoquant Goethe, Schubert et autres, il crée des parallèles avec le quotidien. C'est une construction d'une image fictive en utilisant la conscience collective, car ce sont tous des « bases » de l'inconscient. Même chose pour l'Orient qui est doublé : Enard nous donne l'image de l'Orient lui-même, que le narrateur fréquente et décrit. Mais aussi l'image d'un Orient représenté, à travers les discours de différents protagonistes. Par exemple lorsque Sarah observe les orientalistes à Damas.
Quand on se retrouve face à la prose d'Enard, c'est comme face au bon vin. On ne peut dire qu'une chose. « C'en est ».
Mais ce qui frappe dès les premières pages, c'est le style déroutant, magnifique, dense et très poétique. La puissance évocatrice d'Enard est impressionnante : il peut parler du désir sur une ou deux lignes mais parvient quand même à rendre la toute puissance aux mots. Sa narration est constamment enveloppée d'un mysticisme et d'un romantisme. C'est un chef-d'oeuvre stylistique. D'autant plus que cela part d'une véritable ambition littéraire : raconter la nuit d'un homme, seul dans sa chambre, souffrant, de manière introspective. Voyager de souvenir en digression, de l'Occident à l'Orient. C'est une écriture spontanée mais extrêmement travaillée ; et ce qui prodigieux c'est que ce n'est pas le narrateur-personnage principal qui prend toute la scène romanesque, ce sont les personnages issus de ses digressions qui sont projetés en premier plan. La prose d'Enard est multiple et invoque en même temps l'unicité. de part les nombreux genres textuels qu'elle utilise (poème, extrait de texte scientifique, image…), cette structure narrative semble manquer de cohérence. Elle est en réalité une structure tissée au millimètre. Boussole n'est pas une structure en deux dimensions, ni même en trois ; les différents fils narratifs forment une toile d'araignée qui se soulève, se met en mouvement, puis se repose quelque instant, en attendant la prochaine impulsion. le narrateur essaie à la fois de cerner Sarah et sa narration. Mais les deux lui échappent. Quand il a l'impression de mettre la main sur Sarah, elle disparaît en une pirouette, l'obligeant à passer à une autre réminiscence, un autre lieu.
C'est également un roman de l'altérité : à travers Sarah il cherche sa propre destinée, sa réussite. Lorsqu'il fume de l'opium, c'est dans l'unique but d'observer ses propres changements, de se considérer comme « l'Autre ». La société également est « autre ». Enard construit son image actuelle par résonnance face au passé : en invoquant Goethe, Schubert et autres, il crée des parallèles avec le quotidien. C'est une construction d'une image fictive en utilisant la conscience collective, car ce sont tous des « bases » de l'inconscient. Même chose pour l'Orient qui est doublé : Enard nous donne l'image de l'Orient lui-même, que le narrateur fréquente et décrit. Mais aussi l'image d'un Orient représenté, à travers les discours de différents protagonistes. Par exemple lorsque Sarah observe les orientalistes à Damas.
Quand on se retrouve face à la prose d'Enard, c'est comme face au bon vin. On ne peut dire qu'une chose. « C'en est ».