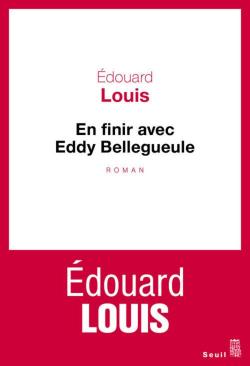>
Critique de fabienne2909
« de mon enfance, je n'ai aucun souvenir heureux. » Cette phrase définitive pourrait constituer une provocation – réussie – pour attirer le lecteur (cela me fait arbitrairement penser au « Longtemps, je me suis couché de bonne heure » de Marcel Proust. Qu'en sait-on en réalité ?). Mais dans le cas d'Edouard Louis, derrière ce constat se niche un désespoir profond, celui d'un enfant qui fait l'expérience trop jeune, trop vite, de la violence parce qu'il se démarque des autres avec ses grands gestes dramatiques, sa voix trop aigue, trop féminine, sa démarche trop chaloupée. Quand on ne trouve pas sa place et qu'on vous le fait durement sentir, que faire d'autre que d'organiser sa propre évasion ? Ce résumé fait très XIXe siècle, alors qu'il se passe dans la Picardie prolétaire des années 1990, où, à en croire l'auteur, la seule ambition, dès lors qu'il est possible de quitter légalement l'école sans voir disparaître les allocations familiales, est de rejoindre l'usine la plus proche pour un travail harassant, mal considéré, mal payé.
Dans ce roman autobiographique très cru, Edouard Louis dresse une espèce de généalogie de la violence, symptôme immédiat d'une pauvreté financière, culturelle et émotionnelle, systémique : « Au village les hommes ne disaient jamais ce mot, il n'existait pas dans leur bouche. Pour un homme la violence était quelque chose de naturel, d'évident. Comme tous les hommes du village, mon père était violent. Comme toutes les femmes, ma mère se plaignait de la violence de son mari. Elle se plaignait surtout du comportement de mon père quand il était saoul ». Cette masculinité toxique effroyable est érigée en modèle, en mode de vie à perpétuer, auquel l'auteur a tenté de se conformer, et ceux qui s'en détachent, à son instar, qui sortent de la norme, prennent le risque d'être traités de « tapette », entre autres adjectifs dévalorisants liés à l'homosexualité. Un terme toujours présent, assimilé à une faiblesse, un défaut, une honte. Et le pire, c'est que les femmes souscrivent à leur manière à ce piège déterministe : « Tout se passe comme si, dans le village, les femmes faisaient des enfants pour devenir des femmes, sinon elles n'en sont pas vraiment. Elles sont considérées comme des lesbiennes, des frigides ». Et celles qui seraient trop libres, comme des « putes ».
Eddy Bellegueule fera donc les frais de cette violence, sous toutes ses formes. A la maison d'abord, ses parents, démunis et il faut le dire, honteux de sa manière d'être, ne réussissent à lui apporter ni amour ni soutien : Jacky, le père, est un ouvrier macho, raciste et violent, bien qu'il ait toujours épargné femme et enfants, traumatisé par son propre père ; Brigitte, la mère, est une femme brisée par ses trop nombreuses grossesses, la première étant survenue à ses dix-sept ans, et qui ne sont pas tellement le résultat d'un choix : « c'était une mère presque malgré elle, ces mères qui ont été mères trop tôt. ». Une femme usée par la vie, le manque d'argent, incapable d'avoir le temps de s'occuper, et par là, d'aimer son fils ; à l'école, puisqu'il se fera harceler et frapper tous les jours par deux garçons plus âgés, qui ont identifié en lui la « tapette » ; par son village enfin, qui le trouve bizarre et se moquent de lui dans son dos, comme sa mère l'en informe un jour : « Tu sais, Eddy, tu devrais arrêter de faire des manières, les gens se moquent de toi derrière ton dos, moi je les entends […]) ».
Quelque chose dans la description de ces « gens de peu » avec des mots simples, l'emploi de l'italique, m'a fait penser à Annie Ernaux et notamment à son roman « La Place », puisqu'Edouard Louis parle lui aussi de son départ de la classe prolétaire par le biais des études. On retrouve dans « En finir avec Eddy Bellegueule » cette absence de place pour les sentiments, due au labeur de ces personnes de la classe ouvrière, qui n'ont pas de temps pour le superflu. Il y a une certaine envie sociologique, de la part d'Édouard Louis, d'expliquer les raisons de la misère (à tous les niveaux) de sa famille, de leur colère et de la violence aussi, nées dès la pauvreté, de la soumission à un ordre établi sans possibilité de se rebeller. Mais c'est là où la comparaison avec Annie Ernaux s'arrête, car Edouard Louis est bien plus punk, plus trash, plus nihiliste, dans ses descriptions au lance-flammes de ses voisins et de sa famille, dont il met surtout en avant la violence brute, la bêtise, la saleté même, tandis qu'il se décrit à l'inverse comme un « bourgeois » en devenir, au point que certains critiques l'ont taxé de prolophobie. Edouard Louis a subi la violence, mais la retourne avec ce roman en une tentative cathartique contre le lecteur, qui se retrouve à la fois voyeur et victime malgré lui.
« En finir avec Eddy Bellegueule » est ainsi une oeuvre dérangeante dans sa franchise, dans ce qu'elle exige du lecteur. Je ne sais pas si j'ai aimé ce roman, qui m'a prise aux tripes et m'a paru parfois assez insoutenable ; mais pour sûr, il s'agit d'un texte qui me sera difficile à oublier.
Dans ce roman autobiographique très cru, Edouard Louis dresse une espèce de généalogie de la violence, symptôme immédiat d'une pauvreté financière, culturelle et émotionnelle, systémique : « Au village les hommes ne disaient jamais ce mot, il n'existait pas dans leur bouche. Pour un homme la violence était quelque chose de naturel, d'évident. Comme tous les hommes du village, mon père était violent. Comme toutes les femmes, ma mère se plaignait de la violence de son mari. Elle se plaignait surtout du comportement de mon père quand il était saoul ». Cette masculinité toxique effroyable est érigée en modèle, en mode de vie à perpétuer, auquel l'auteur a tenté de se conformer, et ceux qui s'en détachent, à son instar, qui sortent de la norme, prennent le risque d'être traités de « tapette », entre autres adjectifs dévalorisants liés à l'homosexualité. Un terme toujours présent, assimilé à une faiblesse, un défaut, une honte. Et le pire, c'est que les femmes souscrivent à leur manière à ce piège déterministe : « Tout se passe comme si, dans le village, les femmes faisaient des enfants pour devenir des femmes, sinon elles n'en sont pas vraiment. Elles sont considérées comme des lesbiennes, des frigides ». Et celles qui seraient trop libres, comme des « putes ».
Eddy Bellegueule fera donc les frais de cette violence, sous toutes ses formes. A la maison d'abord, ses parents, démunis et il faut le dire, honteux de sa manière d'être, ne réussissent à lui apporter ni amour ni soutien : Jacky, le père, est un ouvrier macho, raciste et violent, bien qu'il ait toujours épargné femme et enfants, traumatisé par son propre père ; Brigitte, la mère, est une femme brisée par ses trop nombreuses grossesses, la première étant survenue à ses dix-sept ans, et qui ne sont pas tellement le résultat d'un choix : « c'était une mère presque malgré elle, ces mères qui ont été mères trop tôt. ». Une femme usée par la vie, le manque d'argent, incapable d'avoir le temps de s'occuper, et par là, d'aimer son fils ; à l'école, puisqu'il se fera harceler et frapper tous les jours par deux garçons plus âgés, qui ont identifié en lui la « tapette » ; par son village enfin, qui le trouve bizarre et se moquent de lui dans son dos, comme sa mère l'en informe un jour : « Tu sais, Eddy, tu devrais arrêter de faire des manières, les gens se moquent de toi derrière ton dos, moi je les entends […]) ».
Quelque chose dans la description de ces « gens de peu » avec des mots simples, l'emploi de l'italique, m'a fait penser à Annie Ernaux et notamment à son roman « La Place », puisqu'Edouard Louis parle lui aussi de son départ de la classe prolétaire par le biais des études. On retrouve dans « En finir avec Eddy Bellegueule » cette absence de place pour les sentiments, due au labeur de ces personnes de la classe ouvrière, qui n'ont pas de temps pour le superflu. Il y a une certaine envie sociologique, de la part d'Édouard Louis, d'expliquer les raisons de la misère (à tous les niveaux) de sa famille, de leur colère et de la violence aussi, nées dès la pauvreté, de la soumission à un ordre établi sans possibilité de se rebeller. Mais c'est là où la comparaison avec Annie Ernaux s'arrête, car Edouard Louis est bien plus punk, plus trash, plus nihiliste, dans ses descriptions au lance-flammes de ses voisins et de sa famille, dont il met surtout en avant la violence brute, la bêtise, la saleté même, tandis qu'il se décrit à l'inverse comme un « bourgeois » en devenir, au point que certains critiques l'ont taxé de prolophobie. Edouard Louis a subi la violence, mais la retourne avec ce roman en une tentative cathartique contre le lecteur, qui se retrouve à la fois voyeur et victime malgré lui.
« En finir avec Eddy Bellegueule » est ainsi une oeuvre dérangeante dans sa franchise, dans ce qu'elle exige du lecteur. Je ne sais pas si j'ai aimé ce roman, qui m'a prise aux tripes et m'a paru parfois assez insoutenable ; mais pour sûr, il s'agit d'un texte qui me sera difficile à oublier.