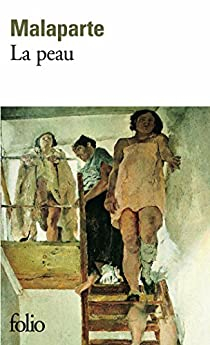>
Critique de Polomarco
J'avais introduit ma précédente critique de Kaputt du même auteur, en indiquant que l'oeuvre présentait "la seconde guerre mondiale comme on ne vous l'a jamais présentée". Pour La Peau, je pourrais reconduire cette même introduction, en y ajoutant une nuance : dans Kaputt, on était au fond de l'horreur; dans La Peau, on y est toujours, mais la guerre est finie et on a l'espoir que les choses changent. En effet, si on retrouve dans La Peau le constat qui caractérise Kaputt ("Il n'y avait plus rien à Naples, plus rien en Europe, tout en ruine, tout détruit, tout par terre, maisons, églises, hôpitaux, mères, pères, enfants, tantes, grand-mères, cousins, tout kaputt" - page 186), on assiste dans La Peau à la libération de Naples, en octobre 1943, et aux prémices de sa renaissance, renaissance dont il n'est pas question dans Kaputt ("Avant la libération, nous avions lutté et souffert pour ne pas mourir. Maintenant, nous luttions et souffrions pour vivre" - page 64). En d'autres termes, les Américains ont beau gagner la guerre, il leur reste -et surtout aux Napolitains- à gagner la paix.
Malaparte, officier de liaison italien auprès du Haut-Commandement allié, nous livre ainsi , de dîners mondains en conversations plus privées, ses réflexions sur la guerre, la paix, la victoire, la défaite, la vie, la mort, la dignité de l'homme et ses turpitudes aussi... J'y ai découvert et apprécié sa définition de l'Etat totalitaire : "un Etat où ce qui n'est pas défendu est obligatoire" (page 300).
Malaparte excelle aussi à décrire des scènes d'horreur avec détachement, froideur, humour -noir- (une main humaine trouvée dans la marmite de couscous - pages 410 à 418), voire cynisme. Ce qu'il décrit, avec un saisissant pouvoir d'évocation, frappe l'imagination du lecteur et la hante longtemps. Avec Malaparte, on reçoit la confirmation que la réalité, avec sa part de sordide (la clinique vétérinaire et les chiens opérés - pages 249 à 251), d'obscène (la prostitution des femmes et des enfants - pages 23 et 176) et de tragique (le massacre des brûlés de Hambourg - pages 158 à 161), dépasse la fiction. Même si La Peau est présentée comme un roman, on a parfois du mal à distinguer ce qui relève du roman et de l'imagination de l'auteur, de ce qui relève du récit historique. J'ai beaucoup aimé la scène du dîner offert par le Général Cork (pages 319 à 321) : en raison des mines qui empêchent les bateaux de pêche de sortir du port, les seuls poissons consommés sont désormais ceux du grand aquarium de Naples ; ce soir-là, en fait de sirène, c'est une jeune fille qui est servie à table ! Est-ce possible ? Il y a d'autres images qui interrogent le lecteur : les hommes crucifiés (page 233), la danse du bossu (page 363) ou le prix de revente des prisonniers allemands (pages 350 à 353).
Deux passages du livre expliquent son titre : le passage où Malaparte explique que les gens se battent maintenant, non pour sauver leur âme, mais pour sauver leur peau (pages 190 et 191), et celui où un homme meurt écrasé par les chenilles d'un char Sherman et devient "un tapis de peau humaine" (pages 433 à 435).
Au-delà du récit de la libération de Naples, La Peau est enfin et surtout une véritable déclaration d'amour à cette ville, qui en est finalement le personnage central, avec, comme décor, le Vésuve et le rocher de Capri. de la villa qu'il a fait construire à Capri sur la falaise, Malaparte observe et admire le paysage : "Assis dans la pièce qui donne sur le jardin, nous regardions, dans la nuit, le Vésuve et la surface argentée de la mer, où le vent soulevait les écailles dorées de la lune, les faisant scintiller comme des écailles de poisson" (pages 367-368). "La lune luisait au milieu du ciel, sur l'épaule du Vésuve comme l'amphore sur l'épaule de la porteuse d'eau" (page 357). Malaparte raconte, d'ailleurs, avoir reçu chez lui le Maréchal Rommel (pages 301-302). A celui-ci qui lui demande s'il a acheté sa maison toute faite, ou s'il l'a fait construire, Malaparte répond qu'il n'a dessiné que le paysage ! En toile de fond, pour couronner le tableau, le Vésuve entre en éruption en mars 1944.
Il importe de lire La Peau, après avoir lu Kaputt. Dans La Peau, en effet, Malaparte se met en scène lui-même et un personnage lui demande "ce qu'il y a de vrai dans ce que vous racontez dans Kaputt" (page 412). Un autre personnage répond : "Qu'importe si ce que Malaparte raconte est vrai ou faux. Ce qui importe, c'est la façon dont il le raconte". Je n'ai pas trouvé de meilleure conclusion à ma critique ! Lisez ce livre de Malaparte -à défaut, les citations que j'en ai extraites- et appréciez son merveilleux talent de conteur.
Malaparte, officier de liaison italien auprès du Haut-Commandement allié, nous livre ainsi , de dîners mondains en conversations plus privées, ses réflexions sur la guerre, la paix, la victoire, la défaite, la vie, la mort, la dignité de l'homme et ses turpitudes aussi... J'y ai découvert et apprécié sa définition de l'Etat totalitaire : "un Etat où ce qui n'est pas défendu est obligatoire" (page 300).
Malaparte excelle aussi à décrire des scènes d'horreur avec détachement, froideur, humour -noir- (une main humaine trouvée dans la marmite de couscous - pages 410 à 418), voire cynisme. Ce qu'il décrit, avec un saisissant pouvoir d'évocation, frappe l'imagination du lecteur et la hante longtemps. Avec Malaparte, on reçoit la confirmation que la réalité, avec sa part de sordide (la clinique vétérinaire et les chiens opérés - pages 249 à 251), d'obscène (la prostitution des femmes et des enfants - pages 23 et 176) et de tragique (le massacre des brûlés de Hambourg - pages 158 à 161), dépasse la fiction. Même si La Peau est présentée comme un roman, on a parfois du mal à distinguer ce qui relève du roman et de l'imagination de l'auteur, de ce qui relève du récit historique. J'ai beaucoup aimé la scène du dîner offert par le Général Cork (pages 319 à 321) : en raison des mines qui empêchent les bateaux de pêche de sortir du port, les seuls poissons consommés sont désormais ceux du grand aquarium de Naples ; ce soir-là, en fait de sirène, c'est une jeune fille qui est servie à table ! Est-ce possible ? Il y a d'autres images qui interrogent le lecteur : les hommes crucifiés (page 233), la danse du bossu (page 363) ou le prix de revente des prisonniers allemands (pages 350 à 353).
Deux passages du livre expliquent son titre : le passage où Malaparte explique que les gens se battent maintenant, non pour sauver leur âme, mais pour sauver leur peau (pages 190 et 191), et celui où un homme meurt écrasé par les chenilles d'un char Sherman et devient "un tapis de peau humaine" (pages 433 à 435).
Au-delà du récit de la libération de Naples, La Peau est enfin et surtout une véritable déclaration d'amour à cette ville, qui en est finalement le personnage central, avec, comme décor, le Vésuve et le rocher de Capri. de la villa qu'il a fait construire à Capri sur la falaise, Malaparte observe et admire le paysage : "Assis dans la pièce qui donne sur le jardin, nous regardions, dans la nuit, le Vésuve et la surface argentée de la mer, où le vent soulevait les écailles dorées de la lune, les faisant scintiller comme des écailles de poisson" (pages 367-368). "La lune luisait au milieu du ciel, sur l'épaule du Vésuve comme l'amphore sur l'épaule de la porteuse d'eau" (page 357). Malaparte raconte, d'ailleurs, avoir reçu chez lui le Maréchal Rommel (pages 301-302). A celui-ci qui lui demande s'il a acheté sa maison toute faite, ou s'il l'a fait construire, Malaparte répond qu'il n'a dessiné que le paysage ! En toile de fond, pour couronner le tableau, le Vésuve entre en éruption en mars 1944.
Il importe de lire La Peau, après avoir lu Kaputt. Dans La Peau, en effet, Malaparte se met en scène lui-même et un personnage lui demande "ce qu'il y a de vrai dans ce que vous racontez dans Kaputt" (page 412). Un autre personnage répond : "Qu'importe si ce que Malaparte raconte est vrai ou faux. Ce qui importe, c'est la façon dont il le raconte". Je n'ai pas trouvé de meilleure conclusion à ma critique ! Lisez ce livre de Malaparte -à défaut, les citations que j'en ai extraites- et appréciez son merveilleux talent de conteur.