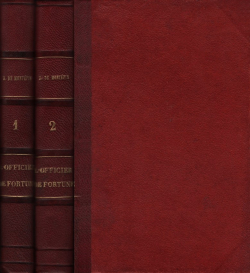>
Critique de Dorian_Brumerive
Monument incontournable de la deuxième moitié du XIXème siècle, Xavier de Montépin reste une personnalité hautement fascinante de la littérature populaire, dans laquelle il excella durant 55 ans, nous laissant plus d'une centaine de romans, généralement riches d'une imagination baroque et fertile, et marqués par une propagande monarchiste assez souvent agressive.
Car la particule, chez Xavier de Montépin, n'était nullement frelatée, contrairement aux pseudonymes faussement huppés de nombre de ses collègues. Fils d'un officier de la Garde Royale sous la Restauration et neveu d'un Pair de France, Xavier-Henry Aymon de Montépin était un comte qui aimait les contes. Sa vocation pour l'écriture se saisit de lui très tôt, et dès la révolution de 1848, il se lance à corps perdu dans la presse légitimiste, qu'il ne défendra qu'avec plus de morgue sous le Second Empire et la IIIème République.
Arrogant, sanguin, hautain et prétentieux, Xavier de Montépin ne laissa pas une image très sympathique de lui-même. C'était en plus un homme immensément riche, et qui aimait à écraser les autres avec son argent. Cette personnalité détestable fut cependant pour beaucoup dans la qualité et l'originalité de ses romans, lesquels ne cherchaient pas à plaire ni à flatter ses lecteurs, et s'arrogeaient une liberté narrative totalement inédite. Alors que tant de célèbres plumitifs de l'époque devaient écrire des romans-feuilletons au kilomètre pour pouvoir survivre, et donc, autant que possible se fier au goût du public, Xavier de Montépin n'en faisait obstinément qu'à sa tête, s'autorisant des digressions gratuites, des commentaires amers, interpellant le lecteur sur la décadence des temps modernes, changeant brutalement de sujet en cours de récit, se souciant fort peu de morale ou de manichéisme, n'hésitant même pas à sombrer dans la violence gratuite ou même dans une lubricité relativement inédite pour son temps et qui lui valut d'ailleurs quelques procès.
En effet, nonobstant son excellente éducation, Xavier de Montépin était un soudard, un écrivain qui se tenait bien loin de la morale chrétienne exemplaire, généralement défendue par les monarchistes, et qui flirtait allègrement avec l'immoralité et l'illégalité, tant dans ses romans que dans sa propre vie. Cet ogre du roman-feuilleton tenait apparemment à reconstituer parmi ses pairs la hiérarchie sociale de l'Ancien Régime, et l'un de ses travers, à la fois les plus odieux et les plus remarquables, était de plagier le roman d'un feuilletoniste républicain pour le réécrire, sous le même titre, dans une optique royaliste. Les procès, les duels, n'y changeaient rien. Monsieur le Comte sortait son épée, payait ce qu'on exigeait, mais restait le seul vrai Comte du roman-feuilleton français, et entendait bien que chacun de ses désirs soient exaucés, quel qu'en soit le prix.
Cette personnalité fantasque, impulsive et autoritaire était servie, il faut le reconnaître, par un immense talent littéraire qui, même s'il fut tardivement récompensé - Son unique best-seller, « La Porteuse de Pain » (1884), n'était rien moins que son 75ème roman –, trouva en son temps un public suffisamment complaisant, pour que chaque publication reste rentable, à défaut d'atteindre les tirages faramineux d'Eugène Sue ou d'Alexandre Dumas.
Bien qu'il ne l'ait jamais attesté, c'est bien d'Alexandre Dumas dont Xavier de Montépin s'est d'abord inspiré. Ses premières publications sont presque toutes des romans historiques fort inspirés du maître, quoique l'on doive reconnaître que Xavier de Montépin prend soin de se distinguer d'Alexandre Dumas, privilégiant des périodes de l'Ancien Régime plus volontiers liées au Moyen-Âge et à la Renaissance, et situant ses intrigues dans sa Bourgogne-Franche-Comté natale. Né en effet à Apremont, un petit village situé entre Dijon et Besançon, Xavier de Montépin y passa toute son enfance, avant de monter faire ses études à Paris, capitale qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort. Mais il semble avoir gardé, toute sa vie, une authentique nostalgie de sa région natale qui sert de décor à nombre de ses romans.
C'est notamment le cas pour « L'Officier de Fortune » (1858), un roman historique de près de 700 pages, publié en 2 tomes, d'abord, étrangement, chez un petit éditeur belge, puis l'année suivante chez Alexandre Cadot, un libraire-éditeur parisien spécialisé dans les romans historiques.
« L'Officier de Fortune » est un merveilleux exemple d'intrigue historique à la manière d'Alexandre Dumas, mais que Xavier de Montépin transpose dans un Moyen-Âge surréaliste et teinté de surnaturel; un décalage renforcé par une rédaction grandement improvisée et un récit qui part assez facilement dans tous les sens. Là aussi, le titre de ce roman est emprunté à un autre livre, plus exactement au titre français donné primitivement à un roman de Walter Scott (« A Legend Of Melrose », retraduit et réédité depuis sous le titre plus fidèle « Une Légende de Melrose »). Xavier de Montépin cherchait sans doute sciemment à attirer des lecteurs de Walter Scott, qui, commandant à leur libraire le roman de Walter Scott mais sans nécessairement se souvenir du nom de l'auteur, se verraient à la place refiler le volumineux ouvrage de Xavier de Montépin.
Cependant, à l'exception du titre, l'intrigue n'a rien à voir avec le roman de Walter Scott, et se déroule en 1473, dans les environs de Vesoul, ville appartenant alors au Duché de Bourgogne qui souhaitait rester indépendant du Royaume de France. Mais le roi Louis XI ne l'entend pas de cette oreille…
le roi envoie donc l'une de ses âmes damnées, un prêtre défroqué du nom de Saint-Jehan, afin d'organiser, depuis une cachette dans un couvent abandonné, en rase campagne, l'enlèvement de Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, lors d'une sortie sur une litière, où elle n'est protégée que par une mince escouade. Saint-Jehan et son associé Malenoir ont bien du mal à garder actifs les soldats du roi, qui ont découvert des tonneaux soigneusement dissimulés dans les caves du couvent, et qui s'enivrent d'une piquette quasi-centenaire. L'un de ces soldats, Eben Donald, un mercenaire écossais qui a fui la misère de son pays, tombe même dans un coma éthylique dont nul ne parvient à le sortir. Agacé, Malenoir ordonne qu'on l'abandonne dehors, sous la neige. Puis l'ensemble des soldats se met en route pour tendre l'embuscade qui doit leur permettre de s'emparer de Marie de Bourgogne. Une demi-heure plus tard, le couvent reçoit la visite d'un voyageur solitaire sur son cheval : Jacques de Barboyo, officier de fortune, ayant quitté l'armée suite à une trahison amoureuse de sa promise. L'homme est aussi à la poursuite de Georges Gabirac, un homme avec lequel il a été échangé dans un berceau lorsque tous deux étaient bébés, et quoi porte aujourd'hui le nom de Saint-Jehan. Apercevant Eben Donald dans la neige, il le sauve de cette mort certaine, et apprend de ses lèvres, une fois qu'il a repris conscience, que son ennemi intime, Saint-Jehan, est dans les parages, et qu'il projette d'attaquer Marie de Bourgogne. Faisant d'Eben Donald son écuyer, il court sauver la jeune fille en péril.
Véritable héros de ce roman, Jacques Barboyo est un colosse à la force herculéenne, qui ne peut s'empêcher de lancer un « Barbe-de-bouc ! » retentissant à chaque début de phrase. À l'image d'un célèbre héros de bande-dessinée, on peut dire de lui qu'il est tombé dans la potion magique quand il était petit, ce qui fait que la force de Barboyo est tout sauf réaliste. Tel un Maciste du Moyen-Âge, il arrache les arbres d'une seule main et les jette sur ses ennemis, dégonde les portes en voulant les ouvrir, soulève les rochers qui bloquent les chemins, sauve Marie de Bourgogne de l'enlèvement en la jetant sur son épaule comme un bout de tissu, et coupe proprement les soldats du roi en deux parties égales d'un seul coup d'épée. Les 132 premières pages de ce roman sont véritablement du Alexandre Dumas sous cocaïne, tant tout y est frénétique et débridé, puis, alors que l'on se prépare à un roman type course-poursuite entre Barboyo et Saint-Jehan, soudain l'action se calme, et se recentre exclusivement sur Vesoul, d'où le lecteur ne sortira plus jusqu'à la dernière partie du roman.
Récompensé pour le sauvetage de Marie de Bourgogne, Jacques de Barboyo est nommé Grand Capitaine de la Garde Ducale, et est anobli par Charles le Téméraire qui fait de lui un comte. Oubliant sa querelle avec Saint-Jehan, Barboyo remet de l'ordre dans une ville sérieusement à la dérive. Il s'y fait beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis, et tous forment une galerie cocasse de personnages burlesques et improbables : Loyson, un fou du roi nain et qui se révèle un vague cousin de Barboyo; un prisonnier philosophe nommé Picard et qui demande à être appelé Picardus car il trouve cela plus chic; Maître Fovetius, un alchimiste-apothicaire aux bocaux étranges; un espion nommé la Flamberge et qui se déguise en moine, ce qui lui vaut bien des problèmes; un aubergiste véreux obsédé par sa réputation, et un lansquenet allemand qui barle avec un vort agzent, et qui boit tellement qu'il manque d'assassiner son capitaine à la suite d'une remarque désobligeante.
Les femmes sont rares dans ce roman, mais elles y ont un rôle hautement sensuel : Marie de Bourgogne y est décrite en lolita évanescente, s'abandonnant volontiers à des câlineries saphiques avec sa camériste, et émoustillée par son beau page, Henri de Lion, lui aussi très épris, mais qui est en réalité Henri de Wurtemberg, fils du comte Ulrich de Montbéliard (mais on ne saura pas ce qu'il fait, loin de son Alsace, déguisé en page). Il y a aussi Régina, la fiancée traîtresse de Barboyo, devenue par la suite amante et complice de Saint-Jehan. Reine du déguisement et des identités multiples, Régina est d'abord présentée comme l'archétype de la "méchante", manipulatrice, catin et femme fatale, mais qui brutalement, alors qu'elle se déguise en bohémienne pour approcher Barboyo et le tuer, se sent émue à le voir retomber amoureux d'elle parce qu'il juge – fort opportunément – qu'elle ressemble à son premier amour. Régina tombe cette fois-ci réellement amoureuse de lui, se démasque et lui révèle tous les plans de Saint-Jehan, lequel tourne un peu partout dans la ville déguisé en clochard. Puis, enfin, Régina meurt de chagrin, en se jugeant trop indigne de l'amour de Barboyo. Ce sont des choses qui arrivent (surtout dans les romans de Montépin, où l'amour est toujours ce que l'on y trouve de plus dangereux et de plus mortel).
Au final, toutes les intrigues se dénoueront à Trèves, en Allemagne, où Marie de Bourgogne est attendue pour épouser le mari que lui a choisi son père, Maximilien Ier de Habsbourg (qui fut effectivement marié avec Marie de Bourgogne en 1477 jusqu'à la mort de cette dernière en 1482, à seulement 25 ans, à la suite d'une chute de cheval).
C'est à partir de là que Xavier de Montépin prend une nette distance avec l'Histoire, puisque ce mariage, refusé par Marie de Bourgogne, n'a finalement pas lieu, et la jeune femme se marie donc, dès 1473, avec celui qui joue son page, Henri de Wurtenberg, lequel fut en réalité un adversaire de Charles le Téméraire. Cependant, s'il ne l'exprime pas ouvertement, le choix de Xavier de Montépin de modifier ainsi le cours de l'Histoire impliquerait de rendre impossible une union tactique entre les Wurtemberg et Louis XI pour intégrer la Bourgogne au Royaume de France. Si Henri avait épousé Marie de Bourgogne, se dit Montépin, alors peut-être le duché de Bourgogne serait-il resté une sorte d'état indépendant, pensée sans doute naïve mais que caressait l'auteur avec rêverie...
Quant à Barboyo, qui retrouve à Trèves le fourbe Saint-Jehan, alors bombardé ambassadeur du Roi de France, il parvient enfin à lui mettre la main au collet alors qu'il tente de s'enfuir par une rivière, mais Barboyo ne mesurant pas sa force, il brise la nuque de Saint-Jehan en voulant le tirer hors de l'eau. Il n'empêche, sa vengeance est désormais accomplie...
« L'Officier de Fortune » est donc un roman historique tout à fait atypique, où pointent déjà les énormités feuilletonesques qui marqueront la Belle-Époque. C'est là que l'on réalise l'immense influence que fut Xavier de Montépin dans ce genre littéraire qui s'étala sur plusieurs générations.
Si l'intrigue tient en quelques lignes, et se résume essentiellement à la poursuite de Saint-Jehan par Barboyo, et aux amours de Marie de Bourgogne, Xavier de Montépin s'investit en parallèle dans une évocation réaliste et immersive du Vesoul de 1473, abondamment décrit par un écrivain érudit qui nous donne presque l'impression d'avoir connu la ville en ce temps-là. de très nombreux personnages, certains historiques, d'autres anonymes, parviennent à donner incroyablement vie à cette féérie médiévale, qui ne déteste pas sombrer dans la parodie ou la gauloiserie. On ne reprochera finalement au roman que de brasser trop d'éléments, trop de personnages, trop de petites scènes annexes, et de bien longs dialogues, dans un roman tellement copieux que l'on s'y perd souvent. Malgré ses presque 700 pages, « L'Officier de Fortune » semble souvent le condensé d'un roman deux fois plus long, et on regrette que de trop nombreux chemins de traverse ne mènent au final nulle part. Un lecteur moderne fera même un parallèle intéressant avec nos jeux de rôles sur ordinateur ou console, se déroulant dans un monde historique "ouvert" (c'est-à-dire vaste) et dans lesquels, où que l'on aille, on trouve des personnages avec qui dialoguer ou interagir, sans que néanmoins on ne saisisse où cela nous mènera à la fin. Cette analogie, qui peut-être reflète plus de points communs qu'on ne l'imagine, a le mérite de donner une modernité insoupçonnée à un roman médiéval intense, dans lequel on peut se sentir autant immergé pendant de longues heures dans une autre époque que s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Et l'on en redemande, Barbe-de-bouc !
Car la particule, chez Xavier de Montépin, n'était nullement frelatée, contrairement aux pseudonymes faussement huppés de nombre de ses collègues. Fils d'un officier de la Garde Royale sous la Restauration et neveu d'un Pair de France, Xavier-Henry Aymon de Montépin était un comte qui aimait les contes. Sa vocation pour l'écriture se saisit de lui très tôt, et dès la révolution de 1848, il se lance à corps perdu dans la presse légitimiste, qu'il ne défendra qu'avec plus de morgue sous le Second Empire et la IIIème République.
Arrogant, sanguin, hautain et prétentieux, Xavier de Montépin ne laissa pas une image très sympathique de lui-même. C'était en plus un homme immensément riche, et qui aimait à écraser les autres avec son argent. Cette personnalité détestable fut cependant pour beaucoup dans la qualité et l'originalité de ses romans, lesquels ne cherchaient pas à plaire ni à flatter ses lecteurs, et s'arrogeaient une liberté narrative totalement inédite. Alors que tant de célèbres plumitifs de l'époque devaient écrire des romans-feuilletons au kilomètre pour pouvoir survivre, et donc, autant que possible se fier au goût du public, Xavier de Montépin n'en faisait obstinément qu'à sa tête, s'autorisant des digressions gratuites, des commentaires amers, interpellant le lecteur sur la décadence des temps modernes, changeant brutalement de sujet en cours de récit, se souciant fort peu de morale ou de manichéisme, n'hésitant même pas à sombrer dans la violence gratuite ou même dans une lubricité relativement inédite pour son temps et qui lui valut d'ailleurs quelques procès.
En effet, nonobstant son excellente éducation, Xavier de Montépin était un soudard, un écrivain qui se tenait bien loin de la morale chrétienne exemplaire, généralement défendue par les monarchistes, et qui flirtait allègrement avec l'immoralité et l'illégalité, tant dans ses romans que dans sa propre vie. Cet ogre du roman-feuilleton tenait apparemment à reconstituer parmi ses pairs la hiérarchie sociale de l'Ancien Régime, et l'un de ses travers, à la fois les plus odieux et les plus remarquables, était de plagier le roman d'un feuilletoniste républicain pour le réécrire, sous le même titre, dans une optique royaliste. Les procès, les duels, n'y changeaient rien. Monsieur le Comte sortait son épée, payait ce qu'on exigeait, mais restait le seul vrai Comte du roman-feuilleton français, et entendait bien que chacun de ses désirs soient exaucés, quel qu'en soit le prix.
Cette personnalité fantasque, impulsive et autoritaire était servie, il faut le reconnaître, par un immense talent littéraire qui, même s'il fut tardivement récompensé - Son unique best-seller, « La Porteuse de Pain » (1884), n'était rien moins que son 75ème roman –, trouva en son temps un public suffisamment complaisant, pour que chaque publication reste rentable, à défaut d'atteindre les tirages faramineux d'Eugène Sue ou d'Alexandre Dumas.
Bien qu'il ne l'ait jamais attesté, c'est bien d'Alexandre Dumas dont Xavier de Montépin s'est d'abord inspiré. Ses premières publications sont presque toutes des romans historiques fort inspirés du maître, quoique l'on doive reconnaître que Xavier de Montépin prend soin de se distinguer d'Alexandre Dumas, privilégiant des périodes de l'Ancien Régime plus volontiers liées au Moyen-Âge et à la Renaissance, et situant ses intrigues dans sa Bourgogne-Franche-Comté natale. Né en effet à Apremont, un petit village situé entre Dijon et Besançon, Xavier de Montépin y passa toute son enfance, avant de monter faire ses études à Paris, capitale qu'il ne quittera plus jusqu'à sa mort. Mais il semble avoir gardé, toute sa vie, une authentique nostalgie de sa région natale qui sert de décor à nombre de ses romans.
C'est notamment le cas pour « L'Officier de Fortune » (1858), un roman historique de près de 700 pages, publié en 2 tomes, d'abord, étrangement, chez un petit éditeur belge, puis l'année suivante chez Alexandre Cadot, un libraire-éditeur parisien spécialisé dans les romans historiques.
« L'Officier de Fortune » est un merveilleux exemple d'intrigue historique à la manière d'Alexandre Dumas, mais que Xavier de Montépin transpose dans un Moyen-Âge surréaliste et teinté de surnaturel; un décalage renforcé par une rédaction grandement improvisée et un récit qui part assez facilement dans tous les sens. Là aussi, le titre de ce roman est emprunté à un autre livre, plus exactement au titre français donné primitivement à un roman de Walter Scott (« A Legend Of Melrose », retraduit et réédité depuis sous le titre plus fidèle « Une Légende de Melrose »). Xavier de Montépin cherchait sans doute sciemment à attirer des lecteurs de Walter Scott, qui, commandant à leur libraire le roman de Walter Scott mais sans nécessairement se souvenir du nom de l'auteur, se verraient à la place refiler le volumineux ouvrage de Xavier de Montépin.
Cependant, à l'exception du titre, l'intrigue n'a rien à voir avec le roman de Walter Scott, et se déroule en 1473, dans les environs de Vesoul, ville appartenant alors au Duché de Bourgogne qui souhaitait rester indépendant du Royaume de France. Mais le roi Louis XI ne l'entend pas de cette oreille…
le roi envoie donc l'une de ses âmes damnées, un prêtre défroqué du nom de Saint-Jehan, afin d'organiser, depuis une cachette dans un couvent abandonné, en rase campagne, l'enlèvement de Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire, lors d'une sortie sur une litière, où elle n'est protégée que par une mince escouade. Saint-Jehan et son associé Malenoir ont bien du mal à garder actifs les soldats du roi, qui ont découvert des tonneaux soigneusement dissimulés dans les caves du couvent, et qui s'enivrent d'une piquette quasi-centenaire. L'un de ces soldats, Eben Donald, un mercenaire écossais qui a fui la misère de son pays, tombe même dans un coma éthylique dont nul ne parvient à le sortir. Agacé, Malenoir ordonne qu'on l'abandonne dehors, sous la neige. Puis l'ensemble des soldats se met en route pour tendre l'embuscade qui doit leur permettre de s'emparer de Marie de Bourgogne. Une demi-heure plus tard, le couvent reçoit la visite d'un voyageur solitaire sur son cheval : Jacques de Barboyo, officier de fortune, ayant quitté l'armée suite à une trahison amoureuse de sa promise. L'homme est aussi à la poursuite de Georges Gabirac, un homme avec lequel il a été échangé dans un berceau lorsque tous deux étaient bébés, et quoi porte aujourd'hui le nom de Saint-Jehan. Apercevant Eben Donald dans la neige, il le sauve de cette mort certaine, et apprend de ses lèvres, une fois qu'il a repris conscience, que son ennemi intime, Saint-Jehan, est dans les parages, et qu'il projette d'attaquer Marie de Bourgogne. Faisant d'Eben Donald son écuyer, il court sauver la jeune fille en péril.
Véritable héros de ce roman, Jacques Barboyo est un colosse à la force herculéenne, qui ne peut s'empêcher de lancer un « Barbe-de-bouc ! » retentissant à chaque début de phrase. À l'image d'un célèbre héros de bande-dessinée, on peut dire de lui qu'il est tombé dans la potion magique quand il était petit, ce qui fait que la force de Barboyo est tout sauf réaliste. Tel un Maciste du Moyen-Âge, il arrache les arbres d'une seule main et les jette sur ses ennemis, dégonde les portes en voulant les ouvrir, soulève les rochers qui bloquent les chemins, sauve Marie de Bourgogne de l'enlèvement en la jetant sur son épaule comme un bout de tissu, et coupe proprement les soldats du roi en deux parties égales d'un seul coup d'épée. Les 132 premières pages de ce roman sont véritablement du Alexandre Dumas sous cocaïne, tant tout y est frénétique et débridé, puis, alors que l'on se prépare à un roman type course-poursuite entre Barboyo et Saint-Jehan, soudain l'action se calme, et se recentre exclusivement sur Vesoul, d'où le lecteur ne sortira plus jusqu'à la dernière partie du roman.
Récompensé pour le sauvetage de Marie de Bourgogne, Jacques de Barboyo est nommé Grand Capitaine de la Garde Ducale, et est anobli par Charles le Téméraire qui fait de lui un comte. Oubliant sa querelle avec Saint-Jehan, Barboyo remet de l'ordre dans une ville sérieusement à la dérive. Il s'y fait beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis, et tous forment une galerie cocasse de personnages burlesques et improbables : Loyson, un fou du roi nain et qui se révèle un vague cousin de Barboyo; un prisonnier philosophe nommé Picard et qui demande à être appelé Picardus car il trouve cela plus chic; Maître Fovetius, un alchimiste-apothicaire aux bocaux étranges; un espion nommé la Flamberge et qui se déguise en moine, ce qui lui vaut bien des problèmes; un aubergiste véreux obsédé par sa réputation, et un lansquenet allemand qui barle avec un vort agzent, et qui boit tellement qu'il manque d'assassiner son capitaine à la suite d'une remarque désobligeante.
Les femmes sont rares dans ce roman, mais elles y ont un rôle hautement sensuel : Marie de Bourgogne y est décrite en lolita évanescente, s'abandonnant volontiers à des câlineries saphiques avec sa camériste, et émoustillée par son beau page, Henri de Lion, lui aussi très épris, mais qui est en réalité Henri de Wurtemberg, fils du comte Ulrich de Montbéliard (mais on ne saura pas ce qu'il fait, loin de son Alsace, déguisé en page). Il y a aussi Régina, la fiancée traîtresse de Barboyo, devenue par la suite amante et complice de Saint-Jehan. Reine du déguisement et des identités multiples, Régina est d'abord présentée comme l'archétype de la "méchante", manipulatrice, catin et femme fatale, mais qui brutalement, alors qu'elle se déguise en bohémienne pour approcher Barboyo et le tuer, se sent émue à le voir retomber amoureux d'elle parce qu'il juge – fort opportunément – qu'elle ressemble à son premier amour. Régina tombe cette fois-ci réellement amoureuse de lui, se démasque et lui révèle tous les plans de Saint-Jehan, lequel tourne un peu partout dans la ville déguisé en clochard. Puis, enfin, Régina meurt de chagrin, en se jugeant trop indigne de l'amour de Barboyo. Ce sont des choses qui arrivent (surtout dans les romans de Montépin, où l'amour est toujours ce que l'on y trouve de plus dangereux et de plus mortel).
Au final, toutes les intrigues se dénoueront à Trèves, en Allemagne, où Marie de Bourgogne est attendue pour épouser le mari que lui a choisi son père, Maximilien Ier de Habsbourg (qui fut effectivement marié avec Marie de Bourgogne en 1477 jusqu'à la mort de cette dernière en 1482, à seulement 25 ans, à la suite d'une chute de cheval).
C'est à partir de là que Xavier de Montépin prend une nette distance avec l'Histoire, puisque ce mariage, refusé par Marie de Bourgogne, n'a finalement pas lieu, et la jeune femme se marie donc, dès 1473, avec celui qui joue son page, Henri de Wurtenberg, lequel fut en réalité un adversaire de Charles le Téméraire. Cependant, s'il ne l'exprime pas ouvertement, le choix de Xavier de Montépin de modifier ainsi le cours de l'Histoire impliquerait de rendre impossible une union tactique entre les Wurtemberg et Louis XI pour intégrer la Bourgogne au Royaume de France. Si Henri avait épousé Marie de Bourgogne, se dit Montépin, alors peut-être le duché de Bourgogne serait-il resté une sorte d'état indépendant, pensée sans doute naïve mais que caressait l'auteur avec rêverie...
Quant à Barboyo, qui retrouve à Trèves le fourbe Saint-Jehan, alors bombardé ambassadeur du Roi de France, il parvient enfin à lui mettre la main au collet alors qu'il tente de s'enfuir par une rivière, mais Barboyo ne mesurant pas sa force, il brise la nuque de Saint-Jehan en voulant le tirer hors de l'eau. Il n'empêche, sa vengeance est désormais accomplie...
« L'Officier de Fortune » est donc un roman historique tout à fait atypique, où pointent déjà les énormités feuilletonesques qui marqueront la Belle-Époque. C'est là que l'on réalise l'immense influence que fut Xavier de Montépin dans ce genre littéraire qui s'étala sur plusieurs générations.
Si l'intrigue tient en quelques lignes, et se résume essentiellement à la poursuite de Saint-Jehan par Barboyo, et aux amours de Marie de Bourgogne, Xavier de Montépin s'investit en parallèle dans une évocation réaliste et immersive du Vesoul de 1473, abondamment décrit par un écrivain érudit qui nous donne presque l'impression d'avoir connu la ville en ce temps-là. de très nombreux personnages, certains historiques, d'autres anonymes, parviennent à donner incroyablement vie à cette féérie médiévale, qui ne déteste pas sombrer dans la parodie ou la gauloiserie. On ne reprochera finalement au roman que de brasser trop d'éléments, trop de personnages, trop de petites scènes annexes, et de bien longs dialogues, dans un roman tellement copieux que l'on s'y perd souvent. Malgré ses presque 700 pages, « L'Officier de Fortune » semble souvent le condensé d'un roman deux fois plus long, et on regrette que de trop nombreux chemins de traverse ne mènent au final nulle part. Un lecteur moderne fera même un parallèle intéressant avec nos jeux de rôles sur ordinateur ou console, se déroulant dans un monde historique "ouvert" (c'est-à-dire vaste) et dans lesquels, où que l'on aille, on trouve des personnages avec qui dialoguer ou interagir, sans que néanmoins on ne saisisse où cela nous mènera à la fin. Cette analogie, qui peut-être reflète plus de points communs qu'on ne l'imagine, a le mérite de donner une modernité insoupçonnée à un roman médiéval intense, dans lequel on peut se sentir autant immergé pendant de longues heures dans une autre époque que s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Et l'on en redemande, Barbe-de-bouc !