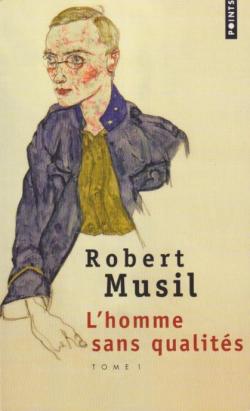>
Critique de Goldlead
L'Homme sans qualités de Robert Musil est une oeuvre (eh oui, une oeuvre… pas vraiment un roman, pas seulement un livre ; tout autant une expérience spirituelle, doublée d'une entreprise intellectuelle) insolite et intimidante. À cela contribuent bien sûr, du dehors, une réputation, des recommandations et références écrasantes (comme, ici même, celles qui l'associent à Proust et à Joyce), la caution de vingt années de travail, plus de 2000 pages bien serrées, laissant pourtant l'oeuvre inachevée, le mythe donc aussi de l'artiste-martyr, mort à la tâche. Mais surtout, toute cette aura se voit confirmée d'emblée par les premières impressions qu'on acquiert soi-même dès les premières pages : écriture magistrale (précieuse, ciselée, bien faite pour les dissections, et aussi souvent l'humour froid) ; ton et regard distanciés, et néanmoins éminemment attentifs et scrutateurs ; pensée exigeante, tatillonne même, dans un souci constant de vérité, d'exhaustivité et de sublimation ; notations stupéfiantes de justesse, de perspicacité et de précision… Pourtant, j'avais déjà déclaré forfait en cours de lecture il y a de nombreuses années. Pensant que cet abandon était imputable à un manque de temps et de disponibilité dans la durée, je viens de me donner une nouvelle chance. Et, à nouveau, expérience étrange : dix fois, vingt fois, j'ai décroché (ou été tenté de renoncer), gagné par la distraction ou l'ennui ; et, à chaque fois, une réflexion surgissait tout à coup comme une révélation (lumineuse, adéquate, profonde), pour me remettre le pied à l'étrier. Jusqu'au bout (car, paradoxalement, je suis quand même allé au bout des deux tomes, en deux ou trois semaines), j'ai vécu cette alternance d'ennui, abandons, mauvaise conscience, reprises, éblouissements… et je ne peux que m'interroger, rétrospectivement, sur cette ambivalence.
Certes, l'ouvrage est singulier. D'abord, pour un roman, il n'y a pas véritablement d'action nourrissant le récit (juste, en première partie, les interminables préparatifs d'un projet politico-culturel de commémoration officielle, dont on ne sait même pas s'il va finalement aboutir et qui sert de fil conducteur à l'ensemble du livre, et, en deuxième partie, les préliminaires et atermoiements d'une relation incestueuse entre frère et soeur, qui vient interférer avec ce fil principal), de sorte que ce récit vaut surtout, formellement, comme exercice d'écriture. Car la dizaine de personnages qui sont pris dans cette trame n'ont pas non plus de véritable identité personnelle, ils dialoguent peu et ce qu'ils font, pensent ou ressentent est le plus souvent commenté par une voix off (celle de l'écrivain lui-même, omniscient et omniprésent), aux modulations indifférenciées et au registre indéfini, qui est comme une hybridation de littérature et de philosophie. Autant dire que le livre vaut d'abord par l'écriture (l'élégante traduction de Philippe Jaccottet n'y est pas pour rien), qui est véritablement fascinante.
On dirait un style « diplomatique » (le contexte y est sans doute pour quelque chose), tout en prudence, en nuances et en compromis, fait de méandres et de circonlocutions, qui donne parfois l'impression de noyer le poisson, de jeter de la poudre aux yeux ou de sonner creux, mais qui, sous des apparences verbeuses, prend soudain de la hauteur et révèle des vues générales, une pensée englobante, et cela sans rien céder du souci scrupuleux de précision, d'exhaustivité et d'attention aux détails. Et toujours avec ça, bien entendu, beaucoup de tenue, d'élégance (un peu corsetée), de brio, de manières et de mondanités ! Mais ce style est aussi très bavard, ampoulé, alambiqué, grandiloquent, comme, j'imagine, autour de certaines tables de conférence. Il se prête aussi trop souvent à une sorte de marivaudage intellectuel et à des assauts de coquetterie entre beaux esprits, plus fumeux qu'éclairants, comme dans une soirée mondaine. On se prend alors à bailler et à s'ennuyer ferme. Mais que la langue de bois se mette soudain à prendre feu et à lancer des flammes prophétiques, et alors tout est miraculeusement sauvé ; on sait, ébloui, qu'on n'a pas perdu son temps !
Mais de quelle diplomatie peut-il bien s'agir ici ? Et pour quelle sorte de négociations ? Primo : une diplomatie qui se déploie, non pas sur le terrain politique ou géostratégique, comme il pourrait sembler au premier abord, mais sur le terrain psychologique, composant avec toutes les expressions de l'âme (états d'âme, minutieusement décrits comme autant de paysages de l'âme, ou plutôt états de l'Âme, dans l'infinité mobile et complexe de sa gamme d'expressions). Secundo : une diplomatie qui vise à rapprocher « idéal » (envolées, sublimation, liberté ; mais aussi vanité, illusions) et « réel » (ancrage, consistance, mais aussi pesanteurs, faiblesses, contraintes). Idéalisme et réalisme donc, mystique et politique, ou encore « Capital et Culture », pour reprendre les deux courants de l'Action Parallèle, (T2 § 36). Deux « mondes » ou deux « états » (celui-là et « l'autre »), deux « méthodes » (« inductive »/« déductive »), deux modalités de « développement du sentiment » (« extérieure »/« intérieure », « expression »/« impression »), deux possibilités de vivre (« profane » et « mystique », « animale » et « végétale », « appétitive » et « contemplative ») dont l'écartèlement et les interférences finissent par créer un redoutable imbroglio. Sachant de plus que, si cette remarque vaut pour le contenu thématique et narratif du livre (les tractations autour de la commémoration, les tribulations de l'amour entre les personnages, les contradictions de la morale et de la culture), elle vaut tout autant pour le livre lui-même en tant qu'objet culturel, sur le statut duquel Musil ne cesse de s'interroger en miroir. Tertio : une diplomatie qui tente d'allier tous les points de vue : celui du juriste, sur les infinies subtilités de la Loi épousant l'infinie complexité et diversité du réel comme l'infinie mobilité et plasticité de la conscience ; celui du bureaucrate, soucieux de tout inventorier, étiqueter, classer, scrupuleusement consigner ; celui du théologien, faisant le grand écart entre vision et prétentions transcendantes d'une part, et minutie de l'exégèse, casuistique de jésuite d'autre part ; celui du rationaliste (financier ?), d'une froideur et d'une précision arithmétiques… Dans les négociations longues et complexes, on parle de « ballet diplomatique » pour en rassembler tous les acteurs (qui sont surtout des parleurs), rencontres (officielles et informelles), échanges, démarches, conversations, lieux, dates, témoignages, rapports et mémos, photos et cartes, courriers, documents, chassés-croisés d'ombre et de lumière entre secrets, rumeurs, propos publics ou semi-publics, directs ou rapportés, et plus généralement tout ce qui est archivé dans le dossier. Ce mot convient assez bien ici pour désigner toute cette agitation de gens, de mouvements d'âme et surtout de mots qui, au cours des 251 épisodes, dessine une savante chorégraphie autour d'Ulrich, le premier danseur. Chorégraphie psychographique si l'on peut dire, qui dessine en tensions exaltées (Clarisse, Agathe), en charges impétueuses (Moosbrugger, Bonadea, Léone), en arabesques majestueuses (Diotime, Arnheim), en balancés patauds (Stumm), en entrechats légers (Walter, Rachel)… , du plus gracieux ou sublime au plus stéréotypé ou au plus sauvage, tous les mouvements de l'âme humaine (et qui ressort même d'autant mieux, en épure, dans les fragments, débarrassés des éléments narratifs et réalistes, de la partie inachevée).
Ulrich, c'est « l'homme sans qualités » du titre, qualificatif qui sonne mystérieusement comme un nom de code. Un intellectuel rentier et mondain, mi dandy mi play-boy, qui est tout sauf anodin ou médiocre et dont les qualités dont il est dépourvu, négatives aussi bien que positives d'ailleurs, sont à entendre au sens philosophique, comme des déterminations. C'est assurément un homme supérieur, un esprit aiguisé, une conscience exigeante, il a certes beaucoup de qualités mais il n'en est aucune, il ne s'identifie à aucune. On dirait en termes philosophiques (ou sartriens) qu'il est un « existant », dépourvu d'« essence ». Il vit toujours en spectateur, analysant et décortiquant tout ce qui lui arrive, les événements, les ressentis, les autres comme lui-même, lui comme un autre. Il semble toujours se prêter à un jeu, comédie sociale, marivaudage ou autoréflexion. Sa conscience, comme un miroir, le tenant par fonction à distance de tout ce qu'elle reflète, il est condamné à être dedans/dehors, à la fois en immersion et en surplomb. « Quoi que tu entreprennes, dit-il, tu restes hors de toi… Tu vois une voiture et, d'une certaine manière, tu vois en même temps, comme une ombre, la phrase : Je vois une voiture. Tu aimes ou tu es triste, et tu vois que tu l'es… Rien n'est plus là entièrement comme dans l'enfance. » (T2, § 25). D'où, dans l'impossibilité de coïncider, le malaise pour lui et le malentendu avec les autres, par manque d'identité ou manque d'empathie. Il paraît détaché, indifférent, dilettante, irrésolu, mais il est d'abord divisé, dédoublé, intimement décalé. Et il projette ce défaut ou ce déficit d'être sur tout ce qu'il approche. Pour son mal être et celui de ses proches. D'ailleurs, ce qui se négocie fondamentalement à travers toute cette entreprise du livre, ce n'est pas l'organisation du centenaire (qui fera fiasco dans la guerre de 14) ni la résolution (impossible) des contradictions entre les deux mondes (idéal et réel), mais c'est ce retournement éphémère qui, à travers la fusion des « jumeaux siamois » va réconcilier Ulrich avec lui-même. le véritable enjeu ou bénéficiaire de la négociation, c'est lui. Agathe en effet semble surgie de nulle part, comme son double inversé, pour unifier ce qui ne peut pourtant pas l'être, comme si (chimériquement) l'amour pouvait opérer un tel miracle. Comme si les contradictions de l'Âme ne pouvaient se résoudre que dans l'Amour. « Où trouver la possibilité d'une vie totale, d'une conviction entière, d'un amour pur ? » (T2, § 66) Dans ce qu'ils appellent « vivre essentiellement » : « comme ils ne percevaient plus aucune séparation d'aucune sorte, ni en eux ni dans les choses, ils ne formaient plus qu'un seul être » (T2, § 94 « le voyage au paradis »). Parenthèse enchanteresse et éphémère du « Paradis » qui tourne court pourtant car l'homme n'est pas fait pour « la vie dans », mais pour « la vie pour » (T2, §§ 80-81), si l'on entend par là que ce qui le fait courir est précisément ce qui le fait échouer et réciproquement.
Coincé dans une impasse, le roman dès lors paraît bel et bien déboussolé et inachevable et il n'y a plus rien à en attendre. Ça va être la guerre, Hans s'est suicidé, Moosbrugger n'échappera pas à la peine de mort, Ulrich s'apprête à partir au front, Clarisse, à bout de forces et d'illusions, (« La conscience ne cesse de déséquilibrer le système des forces naturelles. Elle est la cause de notre agitation superficielle et futile, la rédemption exige qu'on l'abolisse. » T2, § 117) s'enlise dans la folie.
RECOMMANDATION : pour lecteurs sédentaires plus que pour touristes pressés. À garder sur sa table de chevet ou à emporter sur une île déserte plutôt qu'à essayer de traverser d'une traite, en ligne droite et à marche forcée.
Certes, l'ouvrage est singulier. D'abord, pour un roman, il n'y a pas véritablement d'action nourrissant le récit (juste, en première partie, les interminables préparatifs d'un projet politico-culturel de commémoration officielle, dont on ne sait même pas s'il va finalement aboutir et qui sert de fil conducteur à l'ensemble du livre, et, en deuxième partie, les préliminaires et atermoiements d'une relation incestueuse entre frère et soeur, qui vient interférer avec ce fil principal), de sorte que ce récit vaut surtout, formellement, comme exercice d'écriture. Car la dizaine de personnages qui sont pris dans cette trame n'ont pas non plus de véritable identité personnelle, ils dialoguent peu et ce qu'ils font, pensent ou ressentent est le plus souvent commenté par une voix off (celle de l'écrivain lui-même, omniscient et omniprésent), aux modulations indifférenciées et au registre indéfini, qui est comme une hybridation de littérature et de philosophie. Autant dire que le livre vaut d'abord par l'écriture (l'élégante traduction de Philippe Jaccottet n'y est pas pour rien), qui est véritablement fascinante.
On dirait un style « diplomatique » (le contexte y est sans doute pour quelque chose), tout en prudence, en nuances et en compromis, fait de méandres et de circonlocutions, qui donne parfois l'impression de noyer le poisson, de jeter de la poudre aux yeux ou de sonner creux, mais qui, sous des apparences verbeuses, prend soudain de la hauteur et révèle des vues générales, une pensée englobante, et cela sans rien céder du souci scrupuleux de précision, d'exhaustivité et d'attention aux détails. Et toujours avec ça, bien entendu, beaucoup de tenue, d'élégance (un peu corsetée), de brio, de manières et de mondanités ! Mais ce style est aussi très bavard, ampoulé, alambiqué, grandiloquent, comme, j'imagine, autour de certaines tables de conférence. Il se prête aussi trop souvent à une sorte de marivaudage intellectuel et à des assauts de coquetterie entre beaux esprits, plus fumeux qu'éclairants, comme dans une soirée mondaine. On se prend alors à bailler et à s'ennuyer ferme. Mais que la langue de bois se mette soudain à prendre feu et à lancer des flammes prophétiques, et alors tout est miraculeusement sauvé ; on sait, ébloui, qu'on n'a pas perdu son temps !
Mais de quelle diplomatie peut-il bien s'agir ici ? Et pour quelle sorte de négociations ? Primo : une diplomatie qui se déploie, non pas sur le terrain politique ou géostratégique, comme il pourrait sembler au premier abord, mais sur le terrain psychologique, composant avec toutes les expressions de l'âme (états d'âme, minutieusement décrits comme autant de paysages de l'âme, ou plutôt états de l'Âme, dans l'infinité mobile et complexe de sa gamme d'expressions). Secundo : une diplomatie qui vise à rapprocher « idéal » (envolées, sublimation, liberté ; mais aussi vanité, illusions) et « réel » (ancrage, consistance, mais aussi pesanteurs, faiblesses, contraintes). Idéalisme et réalisme donc, mystique et politique, ou encore « Capital et Culture », pour reprendre les deux courants de l'Action Parallèle, (T2 § 36). Deux « mondes » ou deux « états » (celui-là et « l'autre »), deux « méthodes » (« inductive »/« déductive »), deux modalités de « développement du sentiment » (« extérieure »/« intérieure », « expression »/« impression »), deux possibilités de vivre (« profane » et « mystique », « animale » et « végétale », « appétitive » et « contemplative ») dont l'écartèlement et les interférences finissent par créer un redoutable imbroglio. Sachant de plus que, si cette remarque vaut pour le contenu thématique et narratif du livre (les tractations autour de la commémoration, les tribulations de l'amour entre les personnages, les contradictions de la morale et de la culture), elle vaut tout autant pour le livre lui-même en tant qu'objet culturel, sur le statut duquel Musil ne cesse de s'interroger en miroir. Tertio : une diplomatie qui tente d'allier tous les points de vue : celui du juriste, sur les infinies subtilités de la Loi épousant l'infinie complexité et diversité du réel comme l'infinie mobilité et plasticité de la conscience ; celui du bureaucrate, soucieux de tout inventorier, étiqueter, classer, scrupuleusement consigner ; celui du théologien, faisant le grand écart entre vision et prétentions transcendantes d'une part, et minutie de l'exégèse, casuistique de jésuite d'autre part ; celui du rationaliste (financier ?), d'une froideur et d'une précision arithmétiques… Dans les négociations longues et complexes, on parle de « ballet diplomatique » pour en rassembler tous les acteurs (qui sont surtout des parleurs), rencontres (officielles et informelles), échanges, démarches, conversations, lieux, dates, témoignages, rapports et mémos, photos et cartes, courriers, documents, chassés-croisés d'ombre et de lumière entre secrets, rumeurs, propos publics ou semi-publics, directs ou rapportés, et plus généralement tout ce qui est archivé dans le dossier. Ce mot convient assez bien ici pour désigner toute cette agitation de gens, de mouvements d'âme et surtout de mots qui, au cours des 251 épisodes, dessine une savante chorégraphie autour d'Ulrich, le premier danseur. Chorégraphie psychographique si l'on peut dire, qui dessine en tensions exaltées (Clarisse, Agathe), en charges impétueuses (Moosbrugger, Bonadea, Léone), en arabesques majestueuses (Diotime, Arnheim), en balancés patauds (Stumm), en entrechats légers (Walter, Rachel)… , du plus gracieux ou sublime au plus stéréotypé ou au plus sauvage, tous les mouvements de l'âme humaine (et qui ressort même d'autant mieux, en épure, dans les fragments, débarrassés des éléments narratifs et réalistes, de la partie inachevée).
Ulrich, c'est « l'homme sans qualités » du titre, qualificatif qui sonne mystérieusement comme un nom de code. Un intellectuel rentier et mondain, mi dandy mi play-boy, qui est tout sauf anodin ou médiocre et dont les qualités dont il est dépourvu, négatives aussi bien que positives d'ailleurs, sont à entendre au sens philosophique, comme des déterminations. C'est assurément un homme supérieur, un esprit aiguisé, une conscience exigeante, il a certes beaucoup de qualités mais il n'en est aucune, il ne s'identifie à aucune. On dirait en termes philosophiques (ou sartriens) qu'il est un « existant », dépourvu d'« essence ». Il vit toujours en spectateur, analysant et décortiquant tout ce qui lui arrive, les événements, les ressentis, les autres comme lui-même, lui comme un autre. Il semble toujours se prêter à un jeu, comédie sociale, marivaudage ou autoréflexion. Sa conscience, comme un miroir, le tenant par fonction à distance de tout ce qu'elle reflète, il est condamné à être dedans/dehors, à la fois en immersion et en surplomb. « Quoi que tu entreprennes, dit-il, tu restes hors de toi… Tu vois une voiture et, d'une certaine manière, tu vois en même temps, comme une ombre, la phrase : Je vois une voiture. Tu aimes ou tu es triste, et tu vois que tu l'es… Rien n'est plus là entièrement comme dans l'enfance. » (T2, § 25). D'où, dans l'impossibilité de coïncider, le malaise pour lui et le malentendu avec les autres, par manque d'identité ou manque d'empathie. Il paraît détaché, indifférent, dilettante, irrésolu, mais il est d'abord divisé, dédoublé, intimement décalé. Et il projette ce défaut ou ce déficit d'être sur tout ce qu'il approche. Pour son mal être et celui de ses proches. D'ailleurs, ce qui se négocie fondamentalement à travers toute cette entreprise du livre, ce n'est pas l'organisation du centenaire (qui fera fiasco dans la guerre de 14) ni la résolution (impossible) des contradictions entre les deux mondes (idéal et réel), mais c'est ce retournement éphémère qui, à travers la fusion des « jumeaux siamois » va réconcilier Ulrich avec lui-même. le véritable enjeu ou bénéficiaire de la négociation, c'est lui. Agathe en effet semble surgie de nulle part, comme son double inversé, pour unifier ce qui ne peut pourtant pas l'être, comme si (chimériquement) l'amour pouvait opérer un tel miracle. Comme si les contradictions de l'Âme ne pouvaient se résoudre que dans l'Amour. « Où trouver la possibilité d'une vie totale, d'une conviction entière, d'un amour pur ? » (T2, § 66) Dans ce qu'ils appellent « vivre essentiellement » : « comme ils ne percevaient plus aucune séparation d'aucune sorte, ni en eux ni dans les choses, ils ne formaient plus qu'un seul être » (T2, § 94 « le voyage au paradis »). Parenthèse enchanteresse et éphémère du « Paradis » qui tourne court pourtant car l'homme n'est pas fait pour « la vie dans », mais pour « la vie pour » (T2, §§ 80-81), si l'on entend par là que ce qui le fait courir est précisément ce qui le fait échouer et réciproquement.
Coincé dans une impasse, le roman dès lors paraît bel et bien déboussolé et inachevable et il n'y a plus rien à en attendre. Ça va être la guerre, Hans s'est suicidé, Moosbrugger n'échappera pas à la peine de mort, Ulrich s'apprête à partir au front, Clarisse, à bout de forces et d'illusions, (« La conscience ne cesse de déséquilibrer le système des forces naturelles. Elle est la cause de notre agitation superficielle et futile, la rédemption exige qu'on l'abolisse. » T2, § 117) s'enlise dans la folie.
RECOMMANDATION : pour lecteurs sédentaires plus que pour touristes pressés. À garder sur sa table de chevet ou à emporter sur une île déserte plutôt qu'à essayer de traverser d'une traite, en ligne droite et à marche forcée.