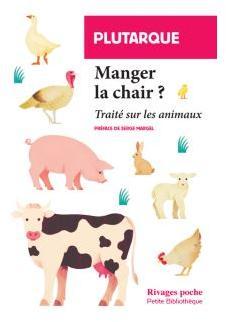>
Critique de JulienDjeuks
Il est surprenant de voir que les arguments et exemples de Plutarque sont encore presque littéralement repris par les militants végétariens : question de la souffrance animale que l'on renie alors qu'elle est évidente ; comparaison des abattoirs à des charniers et mise à distance de cette horreur du sang, de l'origine de la viande, par la préparation culinaire, la transformation, la mise en sauce ; illusion des discours de la nécessité alimentaire qui voilent la satisfaction des vices de la gourmandise et du lucre (viande comme marqueur de richesse), orgueil d'être au sommet de la chaîne alimentaire et d'asservir les autres espèces ; immensité du gâchis alimentaire ; être humain biologiquement non adapté à cette pratique…
La richesse en termes d'images (permettant de réellement confronter le lecteur à la visualisation de l'horreur de la tuerie, du ridicule de l'homme désoutillé s'attaquant à une vache), la variété des arguments, l'adresse rhétorique (retournement de l'idée, ironie, autorité des références à Pythagore, Homère), font de ce court essai un véritable manifeste végétarien, ancrant au passage cette lutte dans les débuts de l'histoire humaine (on pourrait penser à la séparation entre la branche homo omnivore et celle des paranthropes, visiblement majoritairement végétarien). le végétarianisme n'étant dès lors plus la lubie récente d'une population « bobo », victime d'une sensiblerie excessive assimilant tout animal à un chat domestique, mais au contraire l'engagement d'intellectuels, de scientifiques et penseurs (de Pythagore à Plutarque en passant par Homère), du côté de la civilisation et de la nature face à l'immoralité, le vice, la dégénérescence de l'humain.
La parole de Plutarque est ici traduite par le célèbre humaniste Amyot dont le style aurait irrigué ceux de Montaigne puis des grands prosateurs français (Chateaubriand, Plutarque ayant souvent été l'une des bases des études scolaires par ses Vies parallèles). Bien que le langage de celui-ci abuse parfois de tournures tirées du latin, forçant la syntaxe française, son style est tout de même plus proche de la sécheresse classique du XVIIe que de la luxuriance de Rabelais ou Du Bellay. Toutefois, c'est aussi par cette fidélité au modèle latin qu'on se régale d'une certaine étrangeté de la langue.
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
La richesse en termes d'images (permettant de réellement confronter le lecteur à la visualisation de l'horreur de la tuerie, du ridicule de l'homme désoutillé s'attaquant à une vache), la variété des arguments, l'adresse rhétorique (retournement de l'idée, ironie, autorité des références à Pythagore, Homère), font de ce court essai un véritable manifeste végétarien, ancrant au passage cette lutte dans les débuts de l'histoire humaine (on pourrait penser à la séparation entre la branche homo omnivore et celle des paranthropes, visiblement majoritairement végétarien). le végétarianisme n'étant dès lors plus la lubie récente d'une population « bobo », victime d'une sensiblerie excessive assimilant tout animal à un chat domestique, mais au contraire l'engagement d'intellectuels, de scientifiques et penseurs (de Pythagore à Plutarque en passant par Homère), du côté de la civilisation et de la nature face à l'immoralité, le vice, la dégénérescence de l'humain.
La parole de Plutarque est ici traduite par le célèbre humaniste Amyot dont le style aurait irrigué ceux de Montaigne puis des grands prosateurs français (Chateaubriand, Plutarque ayant souvent été l'une des bases des études scolaires par ses Vies parallèles). Bien que le langage de celui-ci abuse parfois de tournures tirées du latin, forçant la syntaxe française, son style est tout de même plus proche de la sécheresse classique du XVIIe que de la luxuriance de Rabelais ou Du Bellay. Toutefois, c'est aussi par cette fidélité au modèle latin qu'on se régale d'une certaine étrangeté de la langue.
Lien : https://leluronum.art.blog/2..