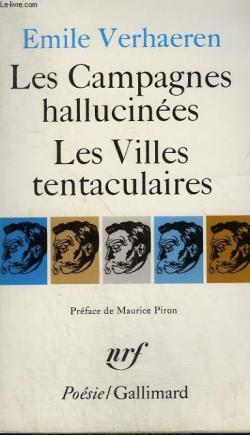>
Critique de colimasson
Ce recueil marche comme un diptyque à l'époque où la révolution industrielle vide les campagnes et traîne ses paysans fatigués, grisés par la promesse d'un avenir éblouissant, vers de nouvelles villes dont on ne remarque d'abord que l'ombre d'une usine dans la brume.
Les Campagnes hallucinées sont secouées de leurs derniers soubresauts. Déliquescence des générations précédentes, tout fout le camp dès lors qu'au loin, l'appel d'une ville glorieuse agite le dégoût des campagnards pour leur terre d'origine. Il ne reste plus rien des complaintes lestes et joyeuses des temps médiévaux, si ce ne sont les complaintes folles des fous, aussi nombreux que ceux qui ont gardés leur conscience pleine, mendiants, moralistes ou malades. Les dernières fêtes se transforment en manèges terrifiants, plus personne n'est capable de se réchauffer le coeur. Il est temps de partir, ou de mourir.
On arrive alors dans les Villes tentaculaires. Les fous se sont tus, on les a figés dans des statues. L'usine n'est plus un horizon lointain, elle happe les nouveaux-venus et les soumet à une valse où le métal remplace la terre, le whisky le lait, les éclairs la bougie, l'insomnie la paix. C'est l'hymne du déracinement, la complainte des nouveaux-venus qui, fuyant leurs campagnes sans avenir, contribuent désormais à un nouvel avenir qui ne les concerne en rien. Si on a ainsi l'impression qu'Emile Verhaeren écrit d'abord pour déplorer l'abandon des campagnes ancestrales et l'inhumanité des villes nouvelles, il semble que le passage de la Mort avec sa faucille l'exalte finalement à reléguer l'individu aux préoccupations d'un temps qui n'a plus lieu. Qu'il se sacrifie s'il le veut, sa courte vie et sa triste mort suffiront cependant à exalter le règne de la science et des idées. « On les rêve parmi les brumes, accoudées ; En des lointains, là-haut, près des soleils ». Les campagnes n'avaient plus rien à donner, les villes pas davantage, mais un horizon qu'on ne peut pas atteindre horizontalement, seulement verticalement, un surplus de rêve inatteignable qui apprend enfin à l'homme que sa destinée est d'une valeur dérisoire.
Ces poèmes séduisent et dégoûtent, parce qu'on sent la chair parsemée de moisissures se faire happer par les dents métalliques de l'usine, ses mycoses se faire brûler par la flamme du chalumeau, les cendres plus propres remplaçant les vieux cadavres qu'on oubliait dans les maisons humides ; ces poèmes ne laissent pas indifférents, même s'ils portent la trace d'un idéalisme dont nous sommes revenus.
Les Campagnes hallucinées sont secouées de leurs derniers soubresauts. Déliquescence des générations précédentes, tout fout le camp dès lors qu'au loin, l'appel d'une ville glorieuse agite le dégoût des campagnards pour leur terre d'origine. Il ne reste plus rien des complaintes lestes et joyeuses des temps médiévaux, si ce ne sont les complaintes folles des fous, aussi nombreux que ceux qui ont gardés leur conscience pleine, mendiants, moralistes ou malades. Les dernières fêtes se transforment en manèges terrifiants, plus personne n'est capable de se réchauffer le coeur. Il est temps de partir, ou de mourir.
On arrive alors dans les Villes tentaculaires. Les fous se sont tus, on les a figés dans des statues. L'usine n'est plus un horizon lointain, elle happe les nouveaux-venus et les soumet à une valse où le métal remplace la terre, le whisky le lait, les éclairs la bougie, l'insomnie la paix. C'est l'hymne du déracinement, la complainte des nouveaux-venus qui, fuyant leurs campagnes sans avenir, contribuent désormais à un nouvel avenir qui ne les concerne en rien. Si on a ainsi l'impression qu'Emile Verhaeren écrit d'abord pour déplorer l'abandon des campagnes ancestrales et l'inhumanité des villes nouvelles, il semble que le passage de la Mort avec sa faucille l'exalte finalement à reléguer l'individu aux préoccupations d'un temps qui n'a plus lieu. Qu'il se sacrifie s'il le veut, sa courte vie et sa triste mort suffiront cependant à exalter le règne de la science et des idées. « On les rêve parmi les brumes, accoudées ; En des lointains, là-haut, près des soleils ». Les campagnes n'avaient plus rien à donner, les villes pas davantage, mais un horizon qu'on ne peut pas atteindre horizontalement, seulement verticalement, un surplus de rêve inatteignable qui apprend enfin à l'homme que sa destinée est d'une valeur dérisoire.
Ces poèmes séduisent et dégoûtent, parce qu'on sent la chair parsemée de moisissures se faire happer par les dents métalliques de l'usine, ses mycoses se faire brûler par la flamme du chalumeau, les cendres plus propres remplaçant les vieux cadavres qu'on oubliait dans les maisons humides ; ces poèmes ne laissent pas indifférents, même s'ils portent la trace d'un idéalisme dont nous sommes revenus.