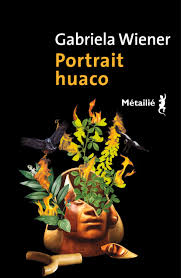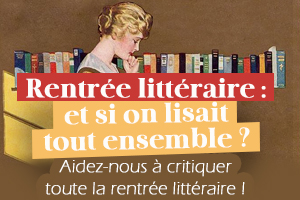Roman j'imagine très fortement inspiré de la vie de l'autrice, sans doute la forme roman est-elle là pour une certaine liberté de création et d'interprétation. Deux parties, d'abord celle au Pérou où Gabriela tente de comprendre comment Charles Wiener a pu y laisser un enfant illégitime et comment son père a pu, pendant des années mener une double vie ; puis la seconde : retour en Espagne auprès de sa fille, de son mari et de sa femme, car Gabriela vit un polyamour, et pas mal de questions autour de l'exil, de l'immigration, de l'amour, la fidélité...
Ce court roman est très dense, en à peine 160 pages, il évoque tout ces points, brosse un résumé de la vie de Charles Wiener, né juif autrichien en 1851, naturalisé français en 1878 après son exploration au Pérou pour le compte du gouvernement français, converti au catholicisme, puis diplomate en Amérique du sud. Ses collections sont aujourd'hui au musée du quai Branly. "L'Européen a laissé derrière lui un enfant péruvien qui à son tour a eu dix enfants, parmi lesquels mon grand-père, qui a eu mon père, qui m'a eue, moi, qui suis la plus amérindienne des Wiener." (p.35)
Il parle aussi du père de Gabriela, de sa double vie, de son autre femme et son autre fille. Puis l'autrice parle d'elle, de son foyer, du racisme dont elle souffre en Espagne, sa peau marron et son type péruvien ne passent pas auprès de tous les Espagnols. C'est usant et déprimant de se sentir rejetée uniquement sur ce genre de critères, il faut une grande force pour surmonter et même faire preuve d'humour : "Il [un ami péruvien] m'a dit, Gabriela, tu t'es rendu compte qu'on leur fait peur ? Et moi, qui n'avais pas fait attention, qui ne connaissais que le regard de mépris de la blanchité de mon pays, j'ai regardé pour la première fois les visages des hommes et des femmes espagnols qui étaient autour de moi, et j'ai dû reconnaître qu'il avait raison. J'ai vu qu'ils serraient discrètement leurs sacs. Que le bruit que nous faisions les dérangeait un peu. Et cette simple découverte m'a remplie d'un petit pouvoir inattendu." (p.127)
Il y a de très belles pages sur l'amour -fût-il poly-, sur le deuil, la famille. Des questions ou réflexions importantes et sur ces sujets et sur le racisme, le sexe, le désir, l'héritage colonial. Bien que cette histoire se passe dans un autre pays colonisateur, il a de fortes similitudes avec la France, son passé, ses colonies, le racisme qui ose désormais se montrer, qui a pignon sur chaîne de télé et journaux, l'homophobie, la peur de l'autre, de la différence... Gabriela Wiener écrit un roman qui remue, qui pose des questions surtout celle sur notre humanité, notre humanisme et notre envie de vivre ensemble et de découvrir autrui.
Lien : http://www.lyvres.fr/
Ce court roman est très dense, en à peine 160 pages, il évoque tout ces points, brosse un résumé de la vie de Charles Wiener, né juif autrichien en 1851, naturalisé français en 1878 après son exploration au Pérou pour le compte du gouvernement français, converti au catholicisme, puis diplomate en Amérique du sud. Ses collections sont aujourd'hui au musée du quai Branly. "L'Européen a laissé derrière lui un enfant péruvien qui à son tour a eu dix enfants, parmi lesquels mon grand-père, qui a eu mon père, qui m'a eue, moi, qui suis la plus amérindienne des Wiener." (p.35)
Il parle aussi du père de Gabriela, de sa double vie, de son autre femme et son autre fille. Puis l'autrice parle d'elle, de son foyer, du racisme dont elle souffre en Espagne, sa peau marron et son type péruvien ne passent pas auprès de tous les Espagnols. C'est usant et déprimant de se sentir rejetée uniquement sur ce genre de critères, il faut une grande force pour surmonter et même faire preuve d'humour : "Il [un ami péruvien] m'a dit, Gabriela, tu t'es rendu compte qu'on leur fait peur ? Et moi, qui n'avais pas fait attention, qui ne connaissais que le regard de mépris de la blanchité de mon pays, j'ai regardé pour la première fois les visages des hommes et des femmes espagnols qui étaient autour de moi, et j'ai dû reconnaître qu'il avait raison. J'ai vu qu'ils serraient discrètement leurs sacs. Que le bruit que nous faisions les dérangeait un peu. Et cette simple découverte m'a remplie d'un petit pouvoir inattendu." (p.127)
Il y a de très belles pages sur l'amour -fût-il poly-, sur le deuil, la famille. Des questions ou réflexions importantes et sur ces sujets et sur le racisme, le sexe, le désir, l'héritage colonial. Bien que cette histoire se passe dans un autre pays colonisateur, il a de fortes similitudes avec la France, son passé, ses colonies, le racisme qui ose désormais se montrer, qui a pignon sur chaîne de télé et journaux, l'homophobie, la peur de l'autre, de la différence... Gabriela Wiener écrit un roman qui remue, qui pose des questions surtout celle sur notre humanité, notre humanisme et notre envie de vivre ensemble et de découvrir autrui.
Lien : http://www.lyvres.fr/
Un sujet attirant : une Péruvienne au Musée du Quai Branly devant la collection Wiener. Wiener, explorateur dont elle pense être une descendante, alors que par un autre côté elle a aussi des ascendances indiennes. Wiener, son ancêtre putatif, a pillé les oeuvres incas, comme il était d'usage, hélas, au XIXe siècle et Gabriella Wiener décide d'enquêter à ce sujet. Quand on aime l'art et L Histoire, la quête identitaire, on ne peut qu'être tentée.
J'ai été déçue petit à petit même si je l'ai lu jusqu'au bout car cette quête est de plus en plus noyée par des interrogations plus narcissiques, des tiraillements entre la fidélité à son mari et à sa femme (elle vit en trouple) et d'autres tentations. Elle cherche aussi à se libérer d'un sentiment d'infériorité dû au fait que son physique "huaco" est historiquement considéré comme inférieur à une apparence plus européenne. Cette douleur, ce travail de libération sont des sujets passionnants mais sa façon d'en parler ne m'a pas intéressée malheureusement. le récit devient décousu même si le fil directeur reste sa quête identitaire. Elle n'est pas assez jeune pour que cet ouvrage soit un récit de formation et finalement il est peu question d'Histoire, d'art, de spoliations.
J'espère que d'autres que moi sauront mieux apprécier cet ouvrage.
J'ai été déçue petit à petit même si je l'ai lu jusqu'au bout car cette quête est de plus en plus noyée par des interrogations plus narcissiques, des tiraillements entre la fidélité à son mari et à sa femme (elle vit en trouple) et d'autres tentations. Elle cherche aussi à se libérer d'un sentiment d'infériorité dû au fait que son physique "huaco" est historiquement considéré comme inférieur à une apparence plus européenne. Cette douleur, ce travail de libération sont des sujets passionnants mais sa façon d'en parler ne m'a pas intéressée malheureusement. le récit devient décousu même si le fil directeur reste sa quête identitaire. Elle n'est pas assez jeune pour que cet ouvrage soit un récit de formation et finalement il est peu question d'Histoire, d'art, de spoliations.
J'espère que d'autres que moi sauront mieux apprécier cet ouvrage.
Bon, pour une fois je n'ai pas suffisamment bien lu le résumé de la quatrième de couverture. Et je me suis trompée de livre, cela arrive, je n'en ferai pas un drame.
J'avais cru choisir un livre qui me parlerait surtout d'art, de trésors archéologiques et de colonialisme... Cela m'aurait bien plu, mais ce n'est pas vraiment ce que l'on découvre au fil de la lecture.
Je n'avais pas envie de tout savoir des amours de la narratrice, ni davantage de celles de son père. Ce livre n'était pas pour moi, tant pis.
Reste que je l'ai trouvé peu construit et un peu brouillon. Ça part dans tous les sens sans arrêt. Vous voilà prévenus.
J'avais cru choisir un livre qui me parlerait surtout d'art, de trésors archéologiques et de colonialisme... Cela m'aurait bien plu, mais ce n'est pas vraiment ce que l'on découvre au fil de la lecture.
Je n'avais pas envie de tout savoir des amours de la narratrice, ni davantage de celles de son père. Ce livre n'était pas pour moi, tant pis.
Reste que je l'ai trouvé peu construit et un peu brouillon. Ça part dans tous les sens sans arrêt. Vous voilà prévenus.
Lors d'une visite au musée du Quai Branly, Gabriela Wiener tombe en arrêt devant des « Statuettes qui [lui] ressemblent. » La salle où elles sont exposées porte le nom de son aïeul, Charles Wiener, son arrière-arrière-grand-père. Gabriela Wiener tente d'en apprendre davantage sur la branche péruvienne de sa famille, branche fondée par Charles Wiener. Descendant à la fois de colonisateurs et de colonisés, comment pourrait-elle trouver sa place entre les deux cultures ?
Récit autobiographique mêlé de réflexions autour de la colonisation, de l'appropriation de biens culturels par les pays colonisateurs, de la domination des blancs sur les autres cultures, Portrait huaco montre toute l'horreur des spoliations organisées avec la bénédiction des différents états concernés, dont la France. Charles Wiener fut mandaté par la France en 1876 pour mener une expédition au Pérou, et présenter ses découvertes à l'exposition universelle de Paris de 1878. Parmi les « trophées » ramenés par Wiener des centaines d'autochtones qui furent exposés dans de véritables zoos humains. Ainsi, comme l'écrit Gabriela Wiener, « des milliers de visiteurs ont payé une entrée pour voir des êtres vivants en captivité, sous prétexte de s'instruire. » (p. 95) Gabriela Wiener est très critique envers son aïeul, mais elle nuance son propos à plusieurs reprises. C'est en partie ce qui fait la richesse et la profondeur de ce livre. Elle évoque également sa vie personnelle, le polyamour et le sentiment de n'être jamais vraiment à sa place. C'est un livre qui fourmille d'idées, de réflexions, personnelles ou d'une portée plus universelle, un livre qui peut être une source inépuisable de questionnements. Un livre qu'on referme sur un coup de poing, avec une réponse qui arrive à la dernière ligne ou presque, et qui n'est pas celle qu'on espérait. Magistral !
#Portraithuaco #NetGalleyFrance
Merci aux éditions Métailié et à Netgalley pour le service de presse.
Récit autobiographique mêlé de réflexions autour de la colonisation, de l'appropriation de biens culturels par les pays colonisateurs, de la domination des blancs sur les autres cultures, Portrait huaco montre toute l'horreur des spoliations organisées avec la bénédiction des différents états concernés, dont la France. Charles Wiener fut mandaté par la France en 1876 pour mener une expédition au Pérou, et présenter ses découvertes à l'exposition universelle de Paris de 1878. Parmi les « trophées » ramenés par Wiener des centaines d'autochtones qui furent exposés dans de véritables zoos humains. Ainsi, comme l'écrit Gabriela Wiener, « des milliers de visiteurs ont payé une entrée pour voir des êtres vivants en captivité, sous prétexte de s'instruire. » (p. 95) Gabriela Wiener est très critique envers son aïeul, mais elle nuance son propos à plusieurs reprises. C'est en partie ce qui fait la richesse et la profondeur de ce livre. Elle évoque également sa vie personnelle, le polyamour et le sentiment de n'être jamais vraiment à sa place. C'est un livre qui fourmille d'idées, de réflexions, personnelles ou d'une portée plus universelle, un livre qui peut être une source inépuisable de questionnements. Un livre qu'on referme sur un coup de poing, avec une réponse qui arrive à la dernière ligne ou presque, et qui n'est pas celle qu'on espérait. Magistral !
#Portraithuaco #NetGalleyFrance
Merci aux éditions Métailié et à Netgalley pour le service de presse.
C'est avec un ton très direct que Gabriela Wiener nous livre ses réflexions et sentiments sur son présent. Cette proximité permet très vite de rentrer dans son intimité et dans les doutes qui l'habitent.
Elle interroge progressivement tous les cercles relationnels de sa réalité. Il y a d'abord la famille dont la porte d'entrée est la visite au Musee Du quai Branly et cet « illustre » ancêtre. le regard actuel sur un colonisateur est loin des éloges et elle propose une critique plus fouillée sur cet homme et ses attentes. Arrive la question de l'autre, cet étranger qui veut être accepté dans ce qu'il considère être la société de référence. Ce rapport de forces est le fil rouge du récit qu'il s'agisse de sa relation avec son propre père qui a entretenu une vie cachée ou de son propre trouple.
Après la famille, elle parle de ses histoires d'amour, de sa sexualité, de ses choix de vie, de son image professionnelle. On se rapproche de son intimité et toutes les dimensions évoquées sont liées. Comme l'indique le titre, ce récit est un portrait d'une femme d'aujourd'hui qui a un pied entre plusieurs mondes. Elle est liée au nouveau continent et à l'ancien, à un homme et à une femme. le livre n'est jamais complaisant et est très pertinent sur ces noeuds, parfois entourés de fantasmes et de mystères, qui nous composent : la sexualité, le désir, la création de soi, la famille.
Lien : https://tourneurdepages.word..
Elle interroge progressivement tous les cercles relationnels de sa réalité. Il y a d'abord la famille dont la porte d'entrée est la visite au Musee Du quai Branly et cet « illustre » ancêtre. le regard actuel sur un colonisateur est loin des éloges et elle propose une critique plus fouillée sur cet homme et ses attentes. Arrive la question de l'autre, cet étranger qui veut être accepté dans ce qu'il considère être la société de référence. Ce rapport de forces est le fil rouge du récit qu'il s'agisse de sa relation avec son propre père qui a entretenu une vie cachée ou de son propre trouple.
Après la famille, elle parle de ses histoires d'amour, de sa sexualité, de ses choix de vie, de son image professionnelle. On se rapproche de son intimité et toutes les dimensions évoquées sont liées. Comme l'indique le titre, ce récit est un portrait d'une femme d'aujourd'hui qui a un pied entre plusieurs mondes. Elle est liée au nouveau continent et à l'ancien, à un homme et à une femme. le livre n'est jamais complaisant et est très pertinent sur ces noeuds, parfois entourés de fantasmes et de mystères, qui nous composent : la sexualité, le désir, la création de soi, la famille.
Lien : https://tourneurdepages.word..
Gabriela Wiener, dont on ne sait si elle nous livre là un récit ou une autofiction, visite le musée du quai Branly et la collection Wiener, cet explorateur qui a manqué de peu la découverte du Machu Picchu et dont elle est la descendante métisse.
Cette visite est l'occasion pour elle de questionner les thèmes de la filiation, de la loyauté à ses origines, du pillage colonial des biens culturels et religieux, plus largement du traitement des personnes non blanches dans le processus colonial et post-colonial.
Sa grande originalité est de partir d'elle-même, de son arbre généalogique sans cesse contesté, de sa vie amoureuse et sexuelle mouvementée, pour tenter de répondre à ces questions. Vivant en trouple avec un mari « huaco » comme elle, et une jeune femme blanche, elle expérimente en direct les effets de ses questionnements et de ses errances, sans pouvoir éviter les déchirures affectives qu'ils provoquent.
Passionnée par les thèmes explorés, j'ai cependant été décontenancée par l'extrême fluidité du propos, qui passe d'un sujet à l'autre comme dans une conversation à bâtons rompus. Cela donne un côté très vivant à ce livre, mais cela m'a parfois perdue. Il reste un des livres les plus originaux lu récemment sur ces questions ! Merci à Metaillié et NetGalley France pour cette lecture.
Cette visite est l'occasion pour elle de questionner les thèmes de la filiation, de la loyauté à ses origines, du pillage colonial des biens culturels et religieux, plus largement du traitement des personnes non blanches dans le processus colonial et post-colonial.
Sa grande originalité est de partir d'elle-même, de son arbre généalogique sans cesse contesté, de sa vie amoureuse et sexuelle mouvementée, pour tenter de répondre à ces questions. Vivant en trouple avec un mari « huaco » comme elle, et une jeune femme blanche, elle expérimente en direct les effets de ses questionnements et de ses errances, sans pouvoir éviter les déchirures affectives qu'ils provoquent.
Passionnée par les thèmes explorés, j'ai cependant été décontenancée par l'extrême fluidité du propos, qui passe d'un sujet à l'autre comme dans une conversation à bâtons rompus. Cela donne un côté très vivant à ce livre, mais cela m'a parfois perdue. Il reste un des livres les plus originaux lu récemment sur ces questions ! Merci à Metaillié et NetGalley France pour cette lecture.
J'entame cette fois ma rentrée des Editions Métailié avec le premier des quatre titres prévus à leur programme, comme chaque année, qui l'oeuvre d'une autrice péruvienne : Gabriela Wiener. Elle écrit depuis l'Espagne où elle habite désormais et trace ici un roman autobiographique ou autofictionnel, on ne sait pas vraiment. Enfin, si l'on se penche sur sa wiki biographie, et lisant les quelques lignes dévouées à sa vie privée, on dira que ce roman penche davantage sur le récit autobiographique. Néanmoins, par principe de précaution, je pars du fait qu'il s'agit d'une (auto?) fiction, a minima.
Son nom de famille, Wiener, qui est son nom de jeune fille, n'a rien de péruvien et si l'on consulte la page Wikimedia de toutes les célébrités portant le même nom, on s'apercevra qu'ils sont toute une foultitude de Wiener plus ou moins connu. Parmi eux, Charles Wiener, non pas le graveur belge, mais son homonyme, l'explorateur d'origine autrichienne naturalisé français. Tout part de cette homonymie entre cet explorateur et l'autrice, unis par un lointain lien de parenté, dont elle n'est pas forcément fière, ce qui relève de l'euphémisme. Ce n'est rien de le dire puisque dès ce chapitre liminaire, en visite au musée du Quai Branly, devant les antiquités rapinées par son aïeul, l'autrice attaque en force en révélant justement sa qualité de vulgaire pilleur d'antiquités incas. En remettant en cause la légitimité de cet homme, juif et viennois d'origine, largement salué par ses paires à l'époque, nous n'allons pas simuler la surprise quant à ce dernier point, Gabriela Wiener va entreprendre des fouilles archéologiques sur ses propres racines, elle fille de Chola, à la peau si brune.
Roman des origines, roman de l'identité, en se penchant sur la vie de cet ancêtre dont elle tient son nom, elle considère d'abord d'un point de vue historique, les interrogations sur ses qualités ethniques au sein du monde : femme, autrice, péruvienne, métisse, indigène, mais aussi hispanophone, bisexuelle, fille, mère, soeur, héritière, compagne, sud-américaine exilée dans une Espagne raciste. Sa première préoccupation, c'est d'abord de symboliquement restituer au Pérou tous les objets subtilisés par notre explorateur d'un autre temps, remettre les choses à leur place même si les musées français sont d'un autre avis. Puis de reconstituer sa filiation, et son identité actuelle.
Le bien-fondé de Charler Wiener, dans sa posture d'explorateur est dès le début remise en cause, sa place en tant qu'aïeul sera discutée pendant le long du roman, et passer au second plan. Il y a la dimension personnelle de Gabriela Wiener, et la dimension générale de cette féministe racisée, qui évoque sa condition de femme maltraitée par une société blanche et patriarcale, tout ce que représente Charles Wiener, voleur de patrimoine, et pire, voleur d'enfant. Un homme qui exerce une forme de violence, parfait représentant de cette violence coloniale encore perpétuée en Espagne comme en France, une violence patriarcale d'une société aux schémas simplistes et préremplis. On observe lentement que se libérer de cette ascendance dérangeante, l'homme a poursuivi son rôle du parfait, petit colonisateur en abandonnant femme et enfant au pays, est le but même de ce roman : un travail d'émancipation qu'elle a commencé avant d'arriver en Espagne, qu'elle a poursuivi sur ce ring de boxe, là où les Américains latins restent encore pris à partie.
L'écriture de Gabriela Wiener est fantastiquement éloquente et pittoresque, elle est celle d'une femme dont l'écriture est sa forme d'activisme, pour faire éclater les cadres, elle vit ainsi en trouple (couple +1), dans le pays colonisateur devenu pays d'adoption où sa couleur de peau la fait passer pour les boniches de service, celles dont les familles de moyenne catégorie employaient au noir. Son pays d'origine n'est pas en reste, la violence est celle que l'on subit, le vol, racisme. Comme elle l'a dit de sa propre mère, fille d'Indienne, Gabriela Wiener construit son propre mythe personnel, d'abord à travers son identité familiale, fille d'un couple mixte, puis à travers son identité personnelle, femme métissée au Pérou, femme noire en Espagne, artiste, bisexuelle, refusant de choisir entre deux amours, une femme ou un homme. C'est ce portrait huerta, de cette femme qui sait aussi user d'ironie, dépassant le racisme pur et dur, le renvoyant dans sa propre médiocrité, celle du nazisme. Si légalement les formes de racisme sont punissables, il n'empêche que toutes les lois du monde ne sauraient y mettre un terme ou un frein, l'auteure use aussi de son pouvoir – rabaissement, humiliation moquerie – pour le traiter à sa façon, le niveler à sa vulgarité, son inconsistance.
Avec le temps, je suis de plus en plus réceptive à ces ouvrages qui ont une dimension féministe, il faut dire que j'aime assez comme Gabriela Wiener tourne son homonyme en dérision, démontant minutieusement sa pseudo postérité, lui qui a oeuvré toute sa vie pour marquer l'histoire de sa personne, et finalement la mythologie ou mythomanie de ce parait parangon du sauveur blanc. La meilleure phrase qui le caractérise c'est encore celle-ci : « son plus grand mérite est de ne pas avoir trouvé Machu Pichu, mais d'avoir été à deux doigts de le faire« . C'est un récit qui opère une remise en place salutaire de mensonges qui ont été ténus lieu de vérité historiques, un peu comme ces légendes urbaines dont on parle comme des vérités avérées.
Lien : https://tempsdelectureblog.w..
J'ai d'abord pris ce livre pour un roman, avec une forme étonnament vivante et riche, et des détails tellement précis que j'ai été vérifier ... et l'histoire, au moins le volet historique, est en fait réel et documentaire.
J'aimais beaucoup l'idée d'une construction romanesque aussi détaillée, mais la réalité se montre pleine de rebondissements aussi.
J'ai plus accroché aux aspects coloniaux du récit qu'aux aspects romantiques/sentimentaux/sexuels, mais tout cela tourne finalement autour de l'identité, ressentie ou perçue, et propose une vision cohérente.
Les moments historiques sont hallucinants - enlèvements, zoos humains, pillages sans réflexion - et la réflexion qu'ils suscitent mérite d'être menée avec un soin approfondi.
J'aimais beaucoup l'idée d'une construction romanesque aussi détaillée, mais la réalité se montre pleine de rebondissements aussi.
J'ai plus accroché aux aspects coloniaux du récit qu'aux aspects romantiques/sentimentaux/sexuels, mais tout cela tourne finalement autour de l'identité, ressentie ou perçue, et propose une vision cohérente.
Les moments historiques sont hallucinants - enlèvements, zoos humains, pillages sans réflexion - et la réflexion qu'ils suscitent mérite d'être menée avec un soin approfondi.
« Mon visage ressemble beaucoup à celui d'un portrait "huaco". Chaque fois qu'on me le dit, j'imagine Charles en train d'agiter son pinceau sur mes paupières pour en ôter la poussière et estimer la date à laquelle j'ai été modelée. On appelle "huaco" toute pièce de céramique préhispanique modelée à la main, de formes et de styles différents, peinte avec délicatesse. Cela peut être un objet de décoration, ça peut faire partie d'un rituel ou tenir lieu d'offrande dans un sépulcre. On les appelle "huacos" car ils ont été trouvés dans les temples sacrés appelés "huacas", enterrés à côté des gens importants. Ils peuvent représenter des animaux, des armes ou des aliments. Mais parmi tous les "huacos", le portrait "huaco" est le plus intéressant. Un portrait "huaco" est comme la photo d'identité préhispanique. L'image d'un visage indigène tellement réaliste que nous pencher pour en observer un revient, pour beaucoup d'entre nous, à nous regarder dans un miroir brisé par les siècles.
Mes céramiques préférées sont les mochicas, ce sont les plus sophistiquées, capables de développer avec des sculptures un récit telle une BD en trois dimensions. Ce sont les séries télé de l'Antiquité. Les Mochicas sculptaient tout particulièrement des dieux égorgeurs et les "huacos" érotiques c'était leur cinéma porno, le kamasutra andin. Baiser et couper des têtes, il n'y a pas grand chose d'autre dans la vie. Mon grand-père Félix, le père de ma mère, est né dans la région dont les Mochicas sont originaires, au nord de la côte péruvienne. La première fois que j'ai montré à ma petite amie espagnole la série des « huacos » érotiques, elle a cru me reconnaître dans toutes les femmes en terre cuite qui avalent des pénis plus grands que leurs corps, jouissent à quatre pattes et mettent au monde des enfants.
Dans mes veines coule un mélange pervers de pilleur « huaquero » et de « huaco », voilà ce qui me scinde en deux. » (p.58)
Un roman puzzle, à l'image de ces pièces, statuettes, bustes ou têtes, de céramique craquelée ou recollée, dont il est question dans cette citation, ou, plus sûrement, une confession, la tentative, pour une auteure qui porte le même nom que la narratrice du récit, de recomposer sa propre histoire, à partir de ce qu'elle découvre du passé de son ancêtre, pour mieux comprendre ce qu'elle vit, entre désir et fureur, dans le présent ? Dans tous les cas, Gabriela Wiener nous offre, avec ce texte plein de passion, l'une des oeuvres les plus originales de cette rentrée, conjuguant héritage familial et héritage colonial, faisant résonner dans une chambre d'écho paradoxal la recherche des traces de Charles Wiener ou l'infidélité de son propre père et l'évocation des troubles qui agitent sa vie de polyamoureuse, partageant ses désirs dans un ménage à trois avec un homme et une femme, dans un équilibre rendu fragile par la jalousie.
Tout commence au Musée du Quai Branly, quand Gabriela Wiener découvre, dans la salle qui porte le nom de son ancêtre, Charles Wiener, des statuettes qui lui ressemblent, et puis plus loin, une vitrine annonçant une « Momie d'enfant », mais qui s'avère vide, comme si s'y révélait une disparition métaphorique, l'image même du vol opéré par les archéologues, ces hommes qui subtilisent le passé des peuples pour nourrir leurs collections et leur propre gloire. Cette visite du musée inaugure, dès lors, une enquête sur la personnalité de Charles Wiener, juif autrichien exilé en France, devenu explorateur en Bolivie et au Pérou, qui se vanta d'avoir été à deux doigts de découvrir le Machu Picchu, et qui rentra en France pour y exposer son énorme récolte de pièces archéologiques au cours de l'Exposition universelle de 1878, également connue pour avoir été l'une des premières manifestations à proposer un zoo humain. L'aïeul archéologue, pilleur d'un riche patrimoine préhispanique, mais aussi prétentieux et hautain, apparaît, à ce titre, exemplaire d'une époque où l'Europe traitait sans vergogne les populations de ses colonies avec un mépris et un racisme dont les traces demeurent encore si puissantes aujourd'hui, bien visibles, en particulier, dans le regard que portent toujours, ainsi que l'auteure en témoigne, les espagnols sur les « sudacas », ces femmes sud-américaines immigrées dans leur pays, à l'instar de l'auteure. Un Charles Wiener qui devait laisser également, fruit d'un amour passager, un enfant bâtard au Pérou, ouvrant dans ce pays une lignée qui porterait son nom et dont Gabriela est une des descendantes.
Rappelée au Pérou par la mort de son père, la narratrice y connaît une brève aventure avec un homme, une passade qu'elle vivra ensuite comme une trahison à l'égard de cette relation à trois, jusque-là si harmonieuse, qui la lie à son mari indien et à sa compagne européenne, nouant dans le texte l'interrogation sur son sang mêlé de « huaquero » et de « huaco », la conscience de cette identité déchirée, et l'aveu de ses angoisses, de sa peur de la solitude, lorsqu'elle n'arrive plus à partager de relations sexuelles harmonieuses avec aucun de ses deux partenaires. C'est là, la grande force de ce texte, que de proposer cette intuition que la fragilité du polyamour, l'hostilité sociale à l'égard des liens bisexuels pourraient bien se renforcer de cette peur du métissage et du retour des fantasmes coloniaux dans notre réalité. Servi par une écriture pleine d'audace et de fougue, qui s'abstient, pour notre plaisir, de toute pudeur, le récit de Gabriela Wiener stimule ainsi notre réflexion, comme une contribution intime et littéraire au questionnement sur l'intersectionnalité. le premier roman d'une journaliste, aussi précieux qu'une statuette inca… Et si un jour le nom de Gabriela Wiener, écrivaine talentueuse, surpassait dans la mémoire des hommes celui de l'archéologue Charles Wiener ?
Mes céramiques préférées sont les mochicas, ce sont les plus sophistiquées, capables de développer avec des sculptures un récit telle une BD en trois dimensions. Ce sont les séries télé de l'Antiquité. Les Mochicas sculptaient tout particulièrement des dieux égorgeurs et les "huacos" érotiques c'était leur cinéma porno, le kamasutra andin. Baiser et couper des têtes, il n'y a pas grand chose d'autre dans la vie. Mon grand-père Félix, le père de ma mère, est né dans la région dont les Mochicas sont originaires, au nord de la côte péruvienne. La première fois que j'ai montré à ma petite amie espagnole la série des « huacos » érotiques, elle a cru me reconnaître dans toutes les femmes en terre cuite qui avalent des pénis plus grands que leurs corps, jouissent à quatre pattes et mettent au monde des enfants.
Dans mes veines coule un mélange pervers de pilleur « huaquero » et de « huaco », voilà ce qui me scinde en deux. » (p.58)
Un roman puzzle, à l'image de ces pièces, statuettes, bustes ou têtes, de céramique craquelée ou recollée, dont il est question dans cette citation, ou, plus sûrement, une confession, la tentative, pour une auteure qui porte le même nom que la narratrice du récit, de recomposer sa propre histoire, à partir de ce qu'elle découvre du passé de son ancêtre, pour mieux comprendre ce qu'elle vit, entre désir et fureur, dans le présent ? Dans tous les cas, Gabriela Wiener nous offre, avec ce texte plein de passion, l'une des oeuvres les plus originales de cette rentrée, conjuguant héritage familial et héritage colonial, faisant résonner dans une chambre d'écho paradoxal la recherche des traces de Charles Wiener ou l'infidélité de son propre père et l'évocation des troubles qui agitent sa vie de polyamoureuse, partageant ses désirs dans un ménage à trois avec un homme et une femme, dans un équilibre rendu fragile par la jalousie.
Tout commence au Musée du Quai Branly, quand Gabriela Wiener découvre, dans la salle qui porte le nom de son ancêtre, Charles Wiener, des statuettes qui lui ressemblent, et puis plus loin, une vitrine annonçant une « Momie d'enfant », mais qui s'avère vide, comme si s'y révélait une disparition métaphorique, l'image même du vol opéré par les archéologues, ces hommes qui subtilisent le passé des peuples pour nourrir leurs collections et leur propre gloire. Cette visite du musée inaugure, dès lors, une enquête sur la personnalité de Charles Wiener, juif autrichien exilé en France, devenu explorateur en Bolivie et au Pérou, qui se vanta d'avoir été à deux doigts de découvrir le Machu Picchu, et qui rentra en France pour y exposer son énorme récolte de pièces archéologiques au cours de l'Exposition universelle de 1878, également connue pour avoir été l'une des premières manifestations à proposer un zoo humain. L'aïeul archéologue, pilleur d'un riche patrimoine préhispanique, mais aussi prétentieux et hautain, apparaît, à ce titre, exemplaire d'une époque où l'Europe traitait sans vergogne les populations de ses colonies avec un mépris et un racisme dont les traces demeurent encore si puissantes aujourd'hui, bien visibles, en particulier, dans le regard que portent toujours, ainsi que l'auteure en témoigne, les espagnols sur les « sudacas », ces femmes sud-américaines immigrées dans leur pays, à l'instar de l'auteure. Un Charles Wiener qui devait laisser également, fruit d'un amour passager, un enfant bâtard au Pérou, ouvrant dans ce pays une lignée qui porterait son nom et dont Gabriela est une des descendantes.
Rappelée au Pérou par la mort de son père, la narratrice y connaît une brève aventure avec un homme, une passade qu'elle vivra ensuite comme une trahison à l'égard de cette relation à trois, jusque-là si harmonieuse, qui la lie à son mari indien et à sa compagne européenne, nouant dans le texte l'interrogation sur son sang mêlé de « huaquero » et de « huaco », la conscience de cette identité déchirée, et l'aveu de ses angoisses, de sa peur de la solitude, lorsqu'elle n'arrive plus à partager de relations sexuelles harmonieuses avec aucun de ses deux partenaires. C'est là, la grande force de ce texte, que de proposer cette intuition que la fragilité du polyamour, l'hostilité sociale à l'égard des liens bisexuels pourraient bien se renforcer de cette peur du métissage et du retour des fantasmes coloniaux dans notre réalité. Servi par une écriture pleine d'audace et de fougue, qui s'abstient, pour notre plaisir, de toute pudeur, le récit de Gabriela Wiener stimule ainsi notre réflexion, comme une contribution intime et littéraire au questionnement sur l'intersectionnalité. le premier roman d'une journaliste, aussi précieux qu'une statuette inca… Et si un jour le nom de Gabriela Wiener, écrivaine talentueuse, surpassait dans la mémoire des hommes celui de l'archéologue Charles Wiener ?
Un arrière-arrière-grand père qui aurait pu découvrir le Machu Picchu, mais qui au hasard de ses vooyages andins a pillé de nombreux sites et ramené en Europe les objets 'volés' au point où son nom a été donné à la salle du Musée du Quai Branly qui abrite aujourd'hui ces trésors.
Un père qui a mené une double vie entre femme et maîtresse et leurs enfants respectifs.
Une narratrice mariée à un péruvien ET à une espagnole, polyamoureux dont les vies et les sexes se mélangent.
Une quête d'identité, une recherche de l'ancêtre : y a-t-il eu un seul Charles Wiener qui a créé cette descendance dont les membres sont liés par leur groupe Facebook, où ils échangent tant de leurs nouvelles que des redécouvertes sur la vie du fameux Charles.
D'une statuette huaco où la narratrice croit se reconnaitre, au deuil de son père adoré cette quête identitaire lui fera quitter Madrid pour Lima, entamer d'autres relations pour se retrouver (enfin?)
Comment porter aujourd'hui le nom de cet ancêtre européen quand tout le reste de la lignée est composée de métis péruviens au point où il ne semble plus y a voir de traces de sang blanc dans leurs veines, ni dans la couleur de sa peau qui contraste tant avec celle de son amante ?
Roman ou documentaire, un livre bien troublant que j'ai eu beaucoup de mal à ire et à terminer.
Roman, autofiction ou non fiction, la frontière est ténue ... mais ce roman me confirme, s'il en était besoin, que je supporte de moins en moins le nombrilisme larmoyant des autofictions !
Je remercie NetGalley et les Editions Métailié qui m'on adressé cet ouvrage, suite à ma sollicitation
#Portraithuaco #NetGalleyFrance
Lien : http://les-lectures-de-bill-..
Un père qui a mené une double vie entre femme et maîtresse et leurs enfants respectifs.
Une narratrice mariée à un péruvien ET à une espagnole, polyamoureux dont les vies et les sexes se mélangent.
Une quête d'identité, une recherche de l'ancêtre : y a-t-il eu un seul Charles Wiener qui a créé cette descendance dont les membres sont liés par leur groupe Facebook, où ils échangent tant de leurs nouvelles que des redécouvertes sur la vie du fameux Charles.
D'une statuette huaco où la narratrice croit se reconnaitre, au deuil de son père adoré cette quête identitaire lui fera quitter Madrid pour Lima, entamer d'autres relations pour se retrouver (enfin?)
Comment porter aujourd'hui le nom de cet ancêtre européen quand tout le reste de la lignée est composée de métis péruviens au point où il ne semble plus y a voir de traces de sang blanc dans leurs veines, ni dans la couleur de sa peau qui contraste tant avec celle de son amante ?
Roman ou documentaire, un livre bien troublant que j'ai eu beaucoup de mal à ire et à terminer.
Roman, autofiction ou non fiction, la frontière est ténue ... mais ce roman me confirme, s'il en était besoin, que je supporte de moins en moins le nombrilisme larmoyant des autofictions !
Je remercie NetGalley et les Editions Métailié qui m'on adressé cet ouvrage, suite à ma sollicitation
#Portraithuaco #NetGalleyFrance
Lien : http://les-lectures-de-bill-..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Amants de la Littérature
Grâce à Shakespeare, ils sont certainement les plus célèbres, les plus appréciés et les plus ancrés dans les mémoires depuis des siècles...
Hercule Poirot & Miss Marple
Pyrame & Thisbé
Roméo & Juliette
Sherlock Holmes & John Watson
10 questions
5307 lecteurs ont répondu
Thèmes :
amants
, amour
, littératureCréer un quiz sur ce livre5307 lecteurs ont répondu