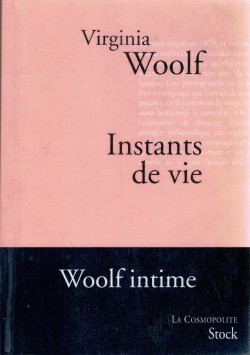>
Critique de Colchik
Le récit autobiographique est un exercice périlleux. Pour qu'il captive le lecteur, il lui faut une bonne dose de franchise, la description juste de caractères et un arrière-plan intéressant.
Je commençai le premier texte « Réminiscences » en ayant le sentiment d'être engluée dans l'hagiographie de Vanessa, la soeur tant aimée de Virginia. Et puis vint « Une esquisse du passé » : aussitôt chaque élément s'anima sous mes yeux. Tout à coup, les frères et soeurs, les parents de Virginia se détachaient les uns des autres comme des personnages s'avançant sur une scène alors que le faisceau d'un projecteur les saisissait dans leur vérité, sans complaisance. Les lieux de la mémoire se sont alors peuplés d'une galerie de visages qui prenaient chair avec un relief douloureux.
Virginia Woolf nous livre un récit pétri de sensibilité tout en pratiquant la mise à distance – une distance qui passe par un humour désenchanté – et, sans ordre apparent, elle nous expose les images de son passé. le chemin n'est pas si long à parcourir, il ne s'agit pas de remonter un fleuve plein de méandres et au cours paresseux, bien au contraire, tout est là, prêt à être saisi, frémissant. Mais nous allons vers les profondeurs de son être et, sous la surface en apparence paisible, nous voyons les courants violents qui ont brassé son existence de jeune fille de bonne famille. Virginia parle de la manière dont affleurent dans sa mémoire certaines scènes du passé : "Mais quelle qu'en soit la raison, je m'aperçois que monter des scènes est ma manière naturelle de témoigner du passé. Il y a toujours une scène qui refait surface ; tout arrangée, significative. Cela me confirme dans mon idée instinctive (elle ne supporterait pas la discussion ; elle est irrationnelle), dans le sentiment que nous sommes des vaisseaux scellés, flottant dans ce qui est commode d'appeler la réalité ; et qu'à certains moments sans aucune raison, sans le moindre effort, la matière qui les scelle cède ; - car pourquoi ces scènes survivraient-elles intactes à tant d'années qui les minent, sinon parce qu'elles sont faites de quelque chose de durable. C'est une preuve de leur "réalité". Serait-ce cette disposition aux "scènes" qui est à l'origine de mon impulsion d'écrire ?" (Une esquisse du passé)
Elle nous fait partager ce constat glacé et effrayant : au tournant du siècle, l'histoire familiale, le poids des valeurs victoriennes faisaient vivre les soeurs Stephen avec cinquante ans de retard sur leur époque. L'autobiographie demande un arrière-plan historique ou culturel, Virginia Woolf nous le donne doublement. Nous découvrons la fin de l'ère victorienne et l'avènement de la période édouardienne. Nous voyons les grandes figures intellectuelles du dix-neuvième siècle s'effacer pour permettre la venue d'une nouvelle génération. Mais ce serait méconnaître la société anglaise que de croire à une rupture radicale entre les époques, tout est continuité et changement à la fois. Ainsi le dénote ce petit fait-divers familial : Virginia vient dîner avec une robe verte dont l'étoffe – faute de moyens – se prête davantage à l'ameublement qu'à l'habillement d'une jeune femme. Son frère George y voit une sorte de provocation, un manque de bienséance et une simple allusion de sa part suffit à décomposer la pauvre Virginia tandis que son frère Gerald l'encourage dans son élégance innovante. Qui l'emporte ? Quelle opinion s'impose ? Au premier abord, c'est celle de George, le parangon des vertus victoriennes, puisque Virginia ne portera plus jamais cette robe devant lui. Mais, en réalité, la remarque de George a semé une graine de révolte et la rebéllion ne quittera plus Virginia Woolf. À partir de là, tout est dit et tout est changé. On ne parle pas encore d'émancipation féminine – les codes victoriens sont résistants dans la bonne société londonienne – , et l'on soumet encore les femmes à des brimades inutiles telle que la séance des comptes chaque mercredi chez les Stephen qui tourne le plus souvent à l'humiliation de Vanessa devant un pater familias acariâtre. Les hommes dictent un emploi du temps pointilleux à leurs épouses et filles, ce qui réduit leur journée à une course d'obstacles. Mais les faits sont là : Virginia lit et étudie, Vanessa peint et leurs frères qui ont accès à Eton et Cambridge verront un jour l'admission en ces lieux permise à leurs femmes, épouses et compagnes qui auront alors une autre utilité que celle de faire-valoir à l'heure du thé.
Il y a une charge violente dans l'écriture de Virginia Woolf. Sans appel. Son origine remonte à l'adolescence de celle-ci quand, à la mort de sa mère, elle n'a plus eu de protection contre la violence masculine. le père, Leslie Stephen, maintient ses filles dans une forme d'asservissement qui sert son tempérament égoïste et exclusif. Il est capable de sentir les capacités intellectuelles de ses filles, mais il ne peut accepter de les libérer au risque de perdre son confort domestique. George, le frère aîné issu du premier mariage de Julia Stephen, dispose d'une rente confortable, d'appuis dans la bonne société, mais exploite ses soeurs par un mélange de chantage affectif et de pulsions sexuelles incontrôlées. Il a toutes les cartes en main : l'argent, le prétexte de servir les intérêts familiaux et la défense de la mémoire de sa mère. Il traîne ses soeurs dans les soirées aristocratiques avec une perversion qui n'a d'égale que son étroitesse d'esprit. Quant à Thoby, le frère chéri, ses confidences se mêlent de condescendance et se teintent d'un sentiment de supériorité qui maintient à distance Virginia.
À la mainmise masculine sur la destinée des femmes s'ajoute le poids de la structure sociale. Si les Stephen appartiennent à la bonne société, ils n'appartiennent pas à l'aristocratie, n'en déplaise à George. Les moyens financiers de la famille sont assez modestes pour que l'économie du foyer fasse l'objet de calculs répétés. Les sept domestiques sont logés dans des chambres misérables et Virginia se demande comment payer les robes de bal commandées à Mrs. Young avec cinquante livres de rente par an. Il lui faut tenir son rang sous peine de voir encore une fois la violence des hommes de la maison se déchaîner : pas assez bonne maîtresse de maison, pas assez jolie femme, pas assez spirituelle devant les invités... le mépris des mâles achève d'empoisonner une existence tenue dans la dépendance totale du sexe fort. Virginia Woolf en a subi le poids jusqu'à la nausée.
On ne peut lire ces textes sans oublier la fin tragique de l'écrivain. Et on ne peut découvrir ces Instants de vie sans faire un parallèle entre la violence exercée sur une personnalité fragilisée par des relations familiales d'amour et de haine et la violence définitive de son suicide.
Je commençai le premier texte « Réminiscences » en ayant le sentiment d'être engluée dans l'hagiographie de Vanessa, la soeur tant aimée de Virginia. Et puis vint « Une esquisse du passé » : aussitôt chaque élément s'anima sous mes yeux. Tout à coup, les frères et soeurs, les parents de Virginia se détachaient les uns des autres comme des personnages s'avançant sur une scène alors que le faisceau d'un projecteur les saisissait dans leur vérité, sans complaisance. Les lieux de la mémoire se sont alors peuplés d'une galerie de visages qui prenaient chair avec un relief douloureux.
Virginia Woolf nous livre un récit pétri de sensibilité tout en pratiquant la mise à distance – une distance qui passe par un humour désenchanté – et, sans ordre apparent, elle nous expose les images de son passé. le chemin n'est pas si long à parcourir, il ne s'agit pas de remonter un fleuve plein de méandres et au cours paresseux, bien au contraire, tout est là, prêt à être saisi, frémissant. Mais nous allons vers les profondeurs de son être et, sous la surface en apparence paisible, nous voyons les courants violents qui ont brassé son existence de jeune fille de bonne famille. Virginia parle de la manière dont affleurent dans sa mémoire certaines scènes du passé : "Mais quelle qu'en soit la raison, je m'aperçois que monter des scènes est ma manière naturelle de témoigner du passé. Il y a toujours une scène qui refait surface ; tout arrangée, significative. Cela me confirme dans mon idée instinctive (elle ne supporterait pas la discussion ; elle est irrationnelle), dans le sentiment que nous sommes des vaisseaux scellés, flottant dans ce qui est commode d'appeler la réalité ; et qu'à certains moments sans aucune raison, sans le moindre effort, la matière qui les scelle cède ; - car pourquoi ces scènes survivraient-elles intactes à tant d'années qui les minent, sinon parce qu'elles sont faites de quelque chose de durable. C'est une preuve de leur "réalité". Serait-ce cette disposition aux "scènes" qui est à l'origine de mon impulsion d'écrire ?" (Une esquisse du passé)
Elle nous fait partager ce constat glacé et effrayant : au tournant du siècle, l'histoire familiale, le poids des valeurs victoriennes faisaient vivre les soeurs Stephen avec cinquante ans de retard sur leur époque. L'autobiographie demande un arrière-plan historique ou culturel, Virginia Woolf nous le donne doublement. Nous découvrons la fin de l'ère victorienne et l'avènement de la période édouardienne. Nous voyons les grandes figures intellectuelles du dix-neuvième siècle s'effacer pour permettre la venue d'une nouvelle génération. Mais ce serait méconnaître la société anglaise que de croire à une rupture radicale entre les époques, tout est continuité et changement à la fois. Ainsi le dénote ce petit fait-divers familial : Virginia vient dîner avec une robe verte dont l'étoffe – faute de moyens – se prête davantage à l'ameublement qu'à l'habillement d'une jeune femme. Son frère George y voit une sorte de provocation, un manque de bienséance et une simple allusion de sa part suffit à décomposer la pauvre Virginia tandis que son frère Gerald l'encourage dans son élégance innovante. Qui l'emporte ? Quelle opinion s'impose ? Au premier abord, c'est celle de George, le parangon des vertus victoriennes, puisque Virginia ne portera plus jamais cette robe devant lui. Mais, en réalité, la remarque de George a semé une graine de révolte et la rebéllion ne quittera plus Virginia Woolf. À partir de là, tout est dit et tout est changé. On ne parle pas encore d'émancipation féminine – les codes victoriens sont résistants dans la bonne société londonienne – , et l'on soumet encore les femmes à des brimades inutiles telle que la séance des comptes chaque mercredi chez les Stephen qui tourne le plus souvent à l'humiliation de Vanessa devant un pater familias acariâtre. Les hommes dictent un emploi du temps pointilleux à leurs épouses et filles, ce qui réduit leur journée à une course d'obstacles. Mais les faits sont là : Virginia lit et étudie, Vanessa peint et leurs frères qui ont accès à Eton et Cambridge verront un jour l'admission en ces lieux permise à leurs femmes, épouses et compagnes qui auront alors une autre utilité que celle de faire-valoir à l'heure du thé.
Il y a une charge violente dans l'écriture de Virginia Woolf. Sans appel. Son origine remonte à l'adolescence de celle-ci quand, à la mort de sa mère, elle n'a plus eu de protection contre la violence masculine. le père, Leslie Stephen, maintient ses filles dans une forme d'asservissement qui sert son tempérament égoïste et exclusif. Il est capable de sentir les capacités intellectuelles de ses filles, mais il ne peut accepter de les libérer au risque de perdre son confort domestique. George, le frère aîné issu du premier mariage de Julia Stephen, dispose d'une rente confortable, d'appuis dans la bonne société, mais exploite ses soeurs par un mélange de chantage affectif et de pulsions sexuelles incontrôlées. Il a toutes les cartes en main : l'argent, le prétexte de servir les intérêts familiaux et la défense de la mémoire de sa mère. Il traîne ses soeurs dans les soirées aristocratiques avec une perversion qui n'a d'égale que son étroitesse d'esprit. Quant à Thoby, le frère chéri, ses confidences se mêlent de condescendance et se teintent d'un sentiment de supériorité qui maintient à distance Virginia.
À la mainmise masculine sur la destinée des femmes s'ajoute le poids de la structure sociale. Si les Stephen appartiennent à la bonne société, ils n'appartiennent pas à l'aristocratie, n'en déplaise à George. Les moyens financiers de la famille sont assez modestes pour que l'économie du foyer fasse l'objet de calculs répétés. Les sept domestiques sont logés dans des chambres misérables et Virginia se demande comment payer les robes de bal commandées à Mrs. Young avec cinquante livres de rente par an. Il lui faut tenir son rang sous peine de voir encore une fois la violence des hommes de la maison se déchaîner : pas assez bonne maîtresse de maison, pas assez jolie femme, pas assez spirituelle devant les invités... le mépris des mâles achève d'empoisonner une existence tenue dans la dépendance totale du sexe fort. Virginia Woolf en a subi le poids jusqu'à la nausée.
On ne peut lire ces textes sans oublier la fin tragique de l'écrivain. Et on ne peut découvrir ces Instants de vie sans faire un parallèle entre la violence exercée sur une personnalité fragilisée par des relations familiales d'amour et de haine et la violence définitive de son suicide.