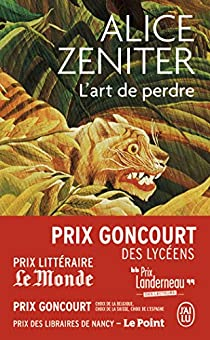>
Critique de Carolina78
L'art de perdre m'a pris un temps fou, de lecture, de recherches sur Google, d'analyse (dans les limites de mon discernement) et maintenant de rédaction.
Est-ce que j'ai aimé ? Disons qu'il m'a marquée de façon durable, non pas tant comme un roman, une oeuvre de fiction, mais surtout par les enseignements qu'il recèle, les questionnements qu'il entraine.
Harki ou moudjahid ? Droit du sol, droit du sang ? Patrie de coeur, d'existence ou de rêve ?
La démarche d'Alice Zeniter dans L'art de perdre est la même que celle d'Anne Berest dans La carte postale, un exercice périlleux à plusieurs voix, plusieurs temporalités où se mêlent la perception de la réalité, l'imagination et la documentation, et où la recherche des origines s'avère une croisade, une chimère, une mission impossible.
En tant que lectrice, je ne cesse de m'interroger sur la part d'autobiographie et de fiction dans les romans, je compulse tous les renseignements que je peux glaner sur l'auteur, or dans l'autofiction, ce plaisir de voyeurisme est gâché parce que tout est dit, et les essais de reconstitution du passé sonnent souvent faux.
Dans L'Art de Perdre, il y a Naïma, la petite-fille, double de l'autrice, qui a la gueule de bois parce qu'elle se cherche dans les non-dits, il y a le grand-père, Ali, harki, qui de patriarche dans son village en Kabylie déchoit en ouvrier spécialisé en France, il y a le père Hamid, arrivé tout petit en France, qui renie l'Algérie, et il y a aussi le « je » de la narration qui s'immisce en de rares occasions :
« A son retour (l'ellipse de ma narration, c'est aussi celle que fait Ali, c'est celle que connaîtront Hamid puis Naïma lorsqu'ils voudront remonter les souvenirs : de la guerre on ne dira jamais que ces deux mots, « la guerre », pour remplir deux années), il retrouve la misère que sa pension vient alléger. » p. 20.
Ce passage fait référence à l'engagement d'Ali dans la seconde guerre mondiale.
De la guerre d'Algérie je ne savais pas grand-chose, si ce n'est le témoignage d'une voisine amie pied noir qui m'a parlé des cadavres qu'il fallait enjamber, à Alger, à l'indépendance. Quelle boucherie sans nom !
L'Algérie, je n'y ai jamais été et je n'ai pas réussi à entrer dans l'Algérie d'Alice Zeniter.
La liste des offrandes (p. 29-30), digne de Georges Perec, qu'apporte le messager d'Ali pour le mariage arrangé avec Yema (qui signifie mère, qui n'a pas de prénom propre), quatorze ans, et Ali, qui a déjà été marié deux fois - une première fois parce qu'il a été veuf et une deuxième parce qu'il a répudié sa femme qui n'enfantait pas - trente-quatre ans, ne représente que des mots pour moi, il me manque l'écho des sens.
C'est une des nombreuses évocations des traditions kabyles que dresse Alice Zeniter. le futur mari fournit, à sa future femme, des cadeaux utiles pour la beauté, l'odeur, la santé, la vie sexuelle, les plaisirs de la bouche, pour déjouer les mauvais sorts. Cette énumération figée sur le papier m'indispose et m'oblige à consulter mon dictionnaire.
Ce qui m'a intéressée c'est le traitement d'Ali en tant qu'Harki, Rivesaltes, le Logis d'Anne, exploitation forestière, les HLM de la Cité du Pont Féron – je ne peux imaginer de telles monstruosités.
J'ai fini ma lecture il y environ quinze jours, qu'en reste-t-il ?
Les premières images qui me viennent à l'esprit sont les deux vils assassinats érigés en exemple pour signifier la cruauté des deux camps.
Un matin de janvier 1957, Ali en se rendant à L Association des anciens combattants, à Palestro, dont il est vice-président, découvre le cadavre d'Akli, le président, égorgé, nu avec sa médaille militaire dans la bouche, et la signature FLN gravé au couteau sur sa poitrine (p. 103).
En juin 1958, les soldats français recherchent Youcef Tadjer, ils vont tabasser Fatima-la-pauvre, sa mère, avant de la tuer d'une balle dans la tête, en plein village, pour marquer l'esprit des inconscients (p.124-5).
Sinon, je suis personnellement touchée par le mal être, à des degrés divers, d'Ali, d'Hamid et de Naïma, surtout de Naïma parce que je m'identifie, en quelque sorte, à elle.
Les spectres de la culpabilité, de la honte, de la violence planent sur L'art de perdre. Ils sont pesants, diffus, insaisissables, distillent un poison visqueux et collant, et pour contourner la glue, on biaise, les clichés font les lois, les hommes perdent la faculté de penser par eux-mêmes.
Alice Zeniter a une façon singulière de crever les abcès, d'impliquer des petits incidents fortuits et gênants dans la résolution de problèmes de grande envergure.
Entre Clarisse, fille unique d'une famille bourgeoise bien-pensante, et Hamid, fils d'harki, à l'enfance traumatique, un mur de silence s'est dressé. Hamid ne veut pas paraître diminué auprès de son icône de femme. La glace va être brisée le jour où Clarisse va se faire pipi dessus. Quand elle a voulu entrer dans les toilettes de la cour, elle a vu qu'un rat la devançait et n'a pas pu se retenir. Elle est restée recroquevillée, prostrée dans un coin. Hamid inquiet de son absence dans le lit est venu à sa rescousse, et là devant Clarisse honteuse et misérable, il s'est lâché et a pu se raconter (p. 331-7). Quand Hamid a fini de se délester de son passé, Clarisse s'exclame : « C'est vrai que cette histoire manque de chameaux. »
Alice Zeniter a performé une construction intellectuelle sophistiquée qui me semble, par moments, surfaite. du fait de la structure de L'art de perdre, la qualité de l'écriture (je ne parle pas d'un point de vue normatif mais dans sa capacité à rendre visible les choses avec le langage) est irrégulière. le titre L'art de perdre, inspiré d'un poème d'Elisabeth Bishop (1911-1979) p. 496 pour dire qu'elle a perdu l'Algérie, parce que l'Algérie ne lui a pas été transmise, et qu'en fait, ce n'est pas grave, me paraît grandiloquent et tiré par les cheveux.
« Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître,
Tant de choses semblent si pleines d'envie
D'être perdues que leur perte n'est pas un désastre. »
Ma critique est dure mais qui aime bien, châtie bien. C'est un livre coup de poing qui m'a assommée, c'est un livre qui a les qualités de ses défauts, trop foisonnant pour ma petite tête. C'est mon ressenti et je serais ravie d'avoir vos commentaires.
Je suis sur le point de poser le stylo et je le reprends, cette critique a un goût d'inachevé. Je regarde une des vidéos de Babelio avec une interview d'Alice Zeniter, à la librairie Forum du Livre, en décembre 2017.
Je n'ai pas parlé des clichés ethniques ou de ce qu'Alice Zeniter nomme « assignation à résidence ». Elle raconte cette anecdote de cet individu, qui à la fin d'une rencontre littéraire, lui demande en aparté : « que pensez-vous de la façon comme les media traitent de l'islamisme ?», comme si elle, athée, non musulmane, écrivaine, détenait une vérité, du simple fait d'avoir des origines magrébines.
« L'une des explications étymologiques du mot « Bougnoule » le fait remonter à l'expression : « Bou gnôle » le Père la Gnôle, Père Bouteille, un terme méprisant à l'égard des alcooliques. » (p. 40)
[…] « En faisant les Bougnoules, ils imitent en réalité les Français. » p. 41
Est-ce que j'ai aimé ? Disons qu'il m'a marquée de façon durable, non pas tant comme un roman, une oeuvre de fiction, mais surtout par les enseignements qu'il recèle, les questionnements qu'il entraine.
Harki ou moudjahid ? Droit du sol, droit du sang ? Patrie de coeur, d'existence ou de rêve ?
La démarche d'Alice Zeniter dans L'art de perdre est la même que celle d'Anne Berest dans La carte postale, un exercice périlleux à plusieurs voix, plusieurs temporalités où se mêlent la perception de la réalité, l'imagination et la documentation, et où la recherche des origines s'avère une croisade, une chimère, une mission impossible.
En tant que lectrice, je ne cesse de m'interroger sur la part d'autobiographie et de fiction dans les romans, je compulse tous les renseignements que je peux glaner sur l'auteur, or dans l'autofiction, ce plaisir de voyeurisme est gâché parce que tout est dit, et les essais de reconstitution du passé sonnent souvent faux.
Dans L'Art de Perdre, il y a Naïma, la petite-fille, double de l'autrice, qui a la gueule de bois parce qu'elle se cherche dans les non-dits, il y a le grand-père, Ali, harki, qui de patriarche dans son village en Kabylie déchoit en ouvrier spécialisé en France, il y a le père Hamid, arrivé tout petit en France, qui renie l'Algérie, et il y a aussi le « je » de la narration qui s'immisce en de rares occasions :
« A son retour (l'ellipse de ma narration, c'est aussi celle que fait Ali, c'est celle que connaîtront Hamid puis Naïma lorsqu'ils voudront remonter les souvenirs : de la guerre on ne dira jamais que ces deux mots, « la guerre », pour remplir deux années), il retrouve la misère que sa pension vient alléger. » p. 20.
Ce passage fait référence à l'engagement d'Ali dans la seconde guerre mondiale.
De la guerre d'Algérie je ne savais pas grand-chose, si ce n'est le témoignage d'une voisine amie pied noir qui m'a parlé des cadavres qu'il fallait enjamber, à Alger, à l'indépendance. Quelle boucherie sans nom !
L'Algérie, je n'y ai jamais été et je n'ai pas réussi à entrer dans l'Algérie d'Alice Zeniter.
La liste des offrandes (p. 29-30), digne de Georges Perec, qu'apporte le messager d'Ali pour le mariage arrangé avec Yema (qui signifie mère, qui n'a pas de prénom propre), quatorze ans, et Ali, qui a déjà été marié deux fois - une première fois parce qu'il a été veuf et une deuxième parce qu'il a répudié sa femme qui n'enfantait pas - trente-quatre ans, ne représente que des mots pour moi, il me manque l'écho des sens.
C'est une des nombreuses évocations des traditions kabyles que dresse Alice Zeniter. le futur mari fournit, à sa future femme, des cadeaux utiles pour la beauté, l'odeur, la santé, la vie sexuelle, les plaisirs de la bouche, pour déjouer les mauvais sorts. Cette énumération figée sur le papier m'indispose et m'oblige à consulter mon dictionnaire.
Ce qui m'a intéressée c'est le traitement d'Ali en tant qu'Harki, Rivesaltes, le Logis d'Anne, exploitation forestière, les HLM de la Cité du Pont Féron – je ne peux imaginer de telles monstruosités.
J'ai fini ma lecture il y environ quinze jours, qu'en reste-t-il ?
Les premières images qui me viennent à l'esprit sont les deux vils assassinats érigés en exemple pour signifier la cruauté des deux camps.
Un matin de janvier 1957, Ali en se rendant à L Association des anciens combattants, à Palestro, dont il est vice-président, découvre le cadavre d'Akli, le président, égorgé, nu avec sa médaille militaire dans la bouche, et la signature FLN gravé au couteau sur sa poitrine (p. 103).
En juin 1958, les soldats français recherchent Youcef Tadjer, ils vont tabasser Fatima-la-pauvre, sa mère, avant de la tuer d'une balle dans la tête, en plein village, pour marquer l'esprit des inconscients (p.124-5).
Sinon, je suis personnellement touchée par le mal être, à des degrés divers, d'Ali, d'Hamid et de Naïma, surtout de Naïma parce que je m'identifie, en quelque sorte, à elle.
Les spectres de la culpabilité, de la honte, de la violence planent sur L'art de perdre. Ils sont pesants, diffus, insaisissables, distillent un poison visqueux et collant, et pour contourner la glue, on biaise, les clichés font les lois, les hommes perdent la faculté de penser par eux-mêmes.
Alice Zeniter a une façon singulière de crever les abcès, d'impliquer des petits incidents fortuits et gênants dans la résolution de problèmes de grande envergure.
Entre Clarisse, fille unique d'une famille bourgeoise bien-pensante, et Hamid, fils d'harki, à l'enfance traumatique, un mur de silence s'est dressé. Hamid ne veut pas paraître diminué auprès de son icône de femme. La glace va être brisée le jour où Clarisse va se faire pipi dessus. Quand elle a voulu entrer dans les toilettes de la cour, elle a vu qu'un rat la devançait et n'a pas pu se retenir. Elle est restée recroquevillée, prostrée dans un coin. Hamid inquiet de son absence dans le lit est venu à sa rescousse, et là devant Clarisse honteuse et misérable, il s'est lâché et a pu se raconter (p. 331-7). Quand Hamid a fini de se délester de son passé, Clarisse s'exclame : « C'est vrai que cette histoire manque de chameaux. »
Alice Zeniter a performé une construction intellectuelle sophistiquée qui me semble, par moments, surfaite. du fait de la structure de L'art de perdre, la qualité de l'écriture (je ne parle pas d'un point de vue normatif mais dans sa capacité à rendre visible les choses avec le langage) est irrégulière. le titre L'art de perdre, inspiré d'un poème d'Elisabeth Bishop (1911-1979) p. 496 pour dire qu'elle a perdu l'Algérie, parce que l'Algérie ne lui a pas été transmise, et qu'en fait, ce n'est pas grave, me paraît grandiloquent et tiré par les cheveux.
« Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître,
Tant de choses semblent si pleines d'envie
D'être perdues que leur perte n'est pas un désastre. »
Ma critique est dure mais qui aime bien, châtie bien. C'est un livre coup de poing qui m'a assommée, c'est un livre qui a les qualités de ses défauts, trop foisonnant pour ma petite tête. C'est mon ressenti et je serais ravie d'avoir vos commentaires.
Je suis sur le point de poser le stylo et je le reprends, cette critique a un goût d'inachevé. Je regarde une des vidéos de Babelio avec une interview d'Alice Zeniter, à la librairie Forum du Livre, en décembre 2017.
Je n'ai pas parlé des clichés ethniques ou de ce qu'Alice Zeniter nomme « assignation à résidence ». Elle raconte cette anecdote de cet individu, qui à la fin d'une rencontre littéraire, lui demande en aparté : « que pensez-vous de la façon comme les media traitent de l'islamisme ?», comme si elle, athée, non musulmane, écrivaine, détenait une vérité, du simple fait d'avoir des origines magrébines.
« L'une des explications étymologiques du mot « Bougnoule » le fait remonter à l'expression : « Bou gnôle » le Père la Gnôle, Père Bouteille, un terme méprisant à l'égard des alcooliques. » (p. 40)
[…] « En faisant les Bougnoules, ils imitent en réalité les Français. » p. 41