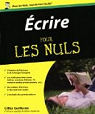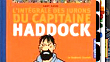Citations de Gilles Guilleron (24)
Il ne faut jamais dire : "Fontaine, je ne boirai pas de ton eau"
Nul ne sachant de quoi demain sera fait, il pourrait bien arriver qu'une chose ou une personne dont on n'a que faire aujourd'hui nous devienne dans l'avenir vitale. Telle est la signification de cette apostrophe lancée directement à la fontaine, courante à partir du XIXe siècle. C'est du côté de Cervantès, dans la bouche prolixe en proverbes populaires espagnols de Sancho Pança (Don Quichotte, I, XXVII, LV), qu'on en trouvera l'origine.
Nul ne sachant de quoi demain sera fait, il pourrait bien arriver qu'une chose ou une personne dont on n'a que faire aujourd'hui nous devienne dans l'avenir vitale. Telle est la signification de cette apostrophe lancée directement à la fontaine, courante à partir du XIXe siècle. C'est du côté de Cervantès, dans la bouche prolixe en proverbes populaires espagnols de Sancho Pança (Don Quichotte, I, XXVII, LV), qu'on en trouvera l'origine.
Frais Emoulu
Voici une curiosité! "Emoulu" participe passé du verbe latin emolere, "aiguiser", est la seule trace du verbe "émoudre", aujourd'hui disparu, qui était employé dans le domaine des armes blanches. Un combat "à fer émoulu" était dangereux car les armes venaient d'être aiguisées et n'étaient pas mouchetées. "Frais" (du francique frisk) n'a pas ici le sens de légèrement froid mais de récent : "frais émoulu" a pris un tour métaphorique au XVIe siècle pour désigner une personne récemment sortie d'une formation, donc particulièrement motivée et au fait des dernières innovations dans son domaine de compétence, en d'autres termes très affûtée!
Voici une curiosité! "Emoulu" participe passé du verbe latin emolere, "aiguiser", est la seule trace du verbe "émoudre", aujourd'hui disparu, qui était employé dans le domaine des armes blanches. Un combat "à fer émoulu" était dangereux car les armes venaient d'être aiguisées et n'étaient pas mouchetées. "Frais" (du francique frisk) n'a pas ici le sens de légèrement froid mais de récent : "frais émoulu" a pris un tour métaphorique au XVIe siècle pour désigner une personne récemment sortie d'une formation, donc particulièrement motivée et au fait des dernières innovations dans son domaine de compétence, en d'autres termes très affûtée!
Un coup de Jarnac
Cette expression rappelle un duel qui opposa sur la terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye, le 10 juillet 1547, Guy Chabot, baron de Jarnac, à François de Vivonnes, seigneur de la Châtaigneraie. Durant le combat, Guy Chabot plaça un coup d'épée derrière la jambe de son adversaire et fendit le jarret de celui-ci, cette botte inattendue mai régulière donna la victoire au baron de Jarnac. L'expression a pris très rapidement un tour négatif pour désigner une action perfide, une victoire remportée par traîtrise.
Cette expression rappelle un duel qui opposa sur la terrasse du château de Saint-Germain-en-Laye, le 10 juillet 1547, Guy Chabot, baron de Jarnac, à François de Vivonnes, seigneur de la Châtaigneraie. Durant le combat, Guy Chabot plaça un coup d'épée derrière la jambe de son adversaire et fendit le jarret de celui-ci, cette botte inattendue mai régulière donna la victoire au baron de Jarnac. L'expression a pris très rapidement un tour négatif pour désigner une action perfide, une victoire remportée par traîtrise.
1492, c'est l'année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais c'est aussi la fin de la Reconquista (la reconquête de la péninsule ibérique occupée par les Maures depuis 718), réalisée par les souverains Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille avec la prise de Grenade, dernier royaume maure en Espagne. L'Ahlambra de Grenade est ainsi le dernier château à revenir dans l'Espagne des Rois Catholiques. Durant les siècles précédents, il a fallu batailler ferme pour reprendre un à un tous les châteaux (du latin castellum, "camp") aux mains des Maures et essuyer parfois de sérieux revers. Ainsi, dès le XIIe siècle, faire "des châteaux en Espagne" évoquait de grandes difficultés, des projets ambitieux et démesurés, voire chimériques.
Autrefois, quand les trompettes et les tambours d'un régiment de soldats faisaient entendre la chamade (de l'italien chiamada, l'"appel"), cela signifiait à leurs adversaires qu'ils souhaitaient capituler; dans ces conditions, on imagine sans peine que "battre la chamade", n'était pas une partie de plaisir.
Qui a lu ou se souvient des pièces de théâtre d'Alexandre Duval (1767-1842), qui n'a pas marqué d'une empreinte indélébile le répertoire? Toutefois, la formule "du bruit dans Landerneau" prononcée par un personnage de sa pièce Les Héritiers (1796) a connu la postérité. L'action se déroule à Landerneau : un officier de marine que tout le monde a cru mort réapparaît soudainement et bouleverse les plans de ses héritiers. Son retour fait évidemment grand bruit, voire l'effet d'un coup de tonnerre.
L'amende honorable, condamnation de l'ancien droit français obligeait le condamné à aller en chemise et pieds nus reconnaître publiquement sa faute et demander pardon aux personnes lésées. L'amende était "honorable" car elle privait d'honneur le coupable. En cas de peine capitale, le condamné prononçait une formule à genoux avant d'être exécuté.
Vous êtes d'excellents passeurs. Vous transmettez proverbes et expressions populaires hérités de vos parents, à vos enfants qui, passeurs non moins excellents, les transmettront à leur tour à leurs enfants. La plupart du temps ils vous sont si familiers, qu'il ne vous vient pas à l'idée de vous interroger sur leur origine, sur leur sens premier, voire sur leur orthographe.
Soyons donc modestes, surtout avec nos amis anglais ! La littérature anglaise, bien qu’elle vienne d’îles, est un véritable continent dont ces quelques pages ne pourront donner qu’un bref aperçu. Vous trouverez ici la présentation de quelques-uns de ces chefs-d’œuvre. Ils sont là pour vous inciter à entreprendre votre propre voyage de lecture.
Le « tout petit tour littéraire »
Du Moyen Âge au XVIIe siècle
Dans la littérature naissante du Moyen Âge, nous retiendrons les Contes de Canterbury (1387-1400) de Geoffrey Chaucer (1340-1400), suite de récits peignant avec humour et parfois ironie la société anglaise dans son quotidien. Au début du XVIe siècle, L’Utopie (1515) de Thomas More pose, par le biais de la fiction, une réflexion sur l’organisation du pouvoir.
Sous le règne de la reine Elisabeth Ire (au pouvoir de 1558 à 1603), le théâtre connaît un extraordinaire développement (chaque semaine, plus de 20 000 personnes allaient au théâtre à Londres) ; Christophe Marlowe développe le genre tragique avec des pièces comme Le Grand Tamberlain (1587) et La Tragique Histoire du Docteur Faust (1589) ; mais le point d’orgue, c’est l’œuvre monumentale de William Shakespeare (voir ci-après).
En poésie, John Milton inscrit sa création dans une perspective où se mêle religion et réflexion politique, comme dans son gigantesque recueil Le Paradis perdu (1667).
Du XVIIIe siècle au XIXe siècle
La poésie d’Alexander Pope (1688-1744) marque la première moitié du XVIIIe siècle en associant philosophie, critique de la société et fonction morale de la morale, notamment dans L’Essai sur l’homme (1733-1734). Sur le plan romanesque, Les Aventures de Robinson Crusoé (1719) de Daniel Defoe et Les Voyages de Gulliver (1726) de Jonathan Swift s’imposent. La langue anglaise trouve son ancrage linguistique avec la publication du Dictionnaire de la langue anglaise (1755) de Samuel Johnson.
Du XIXe siècle au XXe siècle
Trois noms dominent la poésie de la fin du XVIIIe siècle et celle du début du XIXe siècle : Samuel Taylor Coleridge, et notamment son recueil Kubla Khan (1816), où le poète met en mots le fonctionnement de l’inspiration poétique et de l’imaginaire littéraire. Lord Byron, sorte de concurrent de Coleridge, poète du paradoxe, publie en 1819 un recueil imposant de plus 16 000 vers, Don Juan, où le mythe donjuanesque est repris sur le mode ironique. John Keats, poète romantique, complète ce trio avec ses Odes (1819), où l’acte poétique est une tentative toujours renouvelée de saisir la complexité de la trajectoire humaine exprimée dans ce vers célèbre : « Beauté est vérité et vérité beauté. Voilà tout ce que l’on sait sur terre et tout ce qu’il faut savoir ».
Le genre romanesque s’épanouit dans un premier temps avec les œuvres de Mary Shelley (Frankenstein, 1818) et de Jane Austen (Orgueil et Préjugés 1813) et la vogue du roman historique, où Walter Scott s’impose (Ivanhoé, 1819) ; puis, dans un second temps, avec les œuvres de Charles Dickens (Oliver Twist, 1837-1839 ; David Copperfield, 1850) et celles des sœurs Brontë en 1847 : Jane Eyre de Charlotte ; Les Hauts de Hurlevent par Emily. Dans un troisième temps, Lewis Carroll, Oscar Wilde et Robert Louis Stevenson explorent des univers fantastiques et psychologiques qui font évoluer le genre (voir leurs œuvres présentées ci-après).
Au début du XXe siècle, George Bernard Shaw relance le théâtre d’idées avec plusieurs pièces qui revisitent des œuvres du passé (par exemple Homme et superhomme, 1901-1903, où le mythe de Don Juan est revisité). Un peu plus tard, un théâtre engagé politiquement se développe, notamment à travers l’œuvre de Sean O’ Casey (Junon et le Paon, 1922). Après la Seconde Guerre mondiale et ses terribles leçons, le théâtre de l’absurde s’impose à travers certaines œuvres d’Harold Pinter, mais surtout de Samuel Beckett.
Le roman du XXe siècle introduit de nouvelles orientations où le héros et la chronologie sont souvent déstructurés ; les romans de Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf, Doris Lessing (voir leurs œuvres présentées ci-après) illustrent cette esthétique.
Voilà, le tout petit tour s’achève. À vous maintenant d’entrer dans le cercle et de l’élargir…
Du XVIe au XVIIIe siècle : des idées, du théatre et des aventures
Philosophie, théâtre, roman d’aventures… on peut dire que la littérature anglaise commence fort ! C’est cette diversité que vous retrouvez chez More, Shakespeare, Defoe, Swift, et bien d’autres.
Le « tout petit tour littéraire »
Du Moyen Âge au XVIIe siècle
Dans la littérature naissante du Moyen Âge, nous retiendrons les Contes de Canterbury (1387-1400) de Geoffrey Chaucer (1340-1400), suite de récits peignant avec humour et parfois ironie la société anglaise dans son quotidien. Au début du XVIe siècle, L’Utopie (1515) de Thomas More pose, par le biais de la fiction, une réflexion sur l’organisation du pouvoir.
Sous le règne de la reine Elisabeth Ire (au pouvoir de 1558 à 1603), le théâtre connaît un extraordinaire développement (chaque semaine, plus de 20 000 personnes allaient au théâtre à Londres) ; Christophe Marlowe développe le genre tragique avec des pièces comme Le Grand Tamberlain (1587) et La Tragique Histoire du Docteur Faust (1589) ; mais le point d’orgue, c’est l’œuvre monumentale de William Shakespeare (voir ci-après).
En poésie, John Milton inscrit sa création dans une perspective où se mêle religion et réflexion politique, comme dans son gigantesque recueil Le Paradis perdu (1667).
Du XVIIIe siècle au XIXe siècle
La poésie d’Alexander Pope (1688-1744) marque la première moitié du XVIIIe siècle en associant philosophie, critique de la société et fonction morale de la morale, notamment dans L’Essai sur l’homme (1733-1734). Sur le plan romanesque, Les Aventures de Robinson Crusoé (1719) de Daniel Defoe et Les Voyages de Gulliver (1726) de Jonathan Swift s’imposent. La langue anglaise trouve son ancrage linguistique avec la publication du Dictionnaire de la langue anglaise (1755) de Samuel Johnson.
Du XIXe siècle au XXe siècle
Trois noms dominent la poésie de la fin du XVIIIe siècle et celle du début du XIXe siècle : Samuel Taylor Coleridge, et notamment son recueil Kubla Khan (1816), où le poète met en mots le fonctionnement de l’inspiration poétique et de l’imaginaire littéraire. Lord Byron, sorte de concurrent de Coleridge, poète du paradoxe, publie en 1819 un recueil imposant de plus 16 000 vers, Don Juan, où le mythe donjuanesque est repris sur le mode ironique. John Keats, poète romantique, complète ce trio avec ses Odes (1819), où l’acte poétique est une tentative toujours renouvelée de saisir la complexité de la trajectoire humaine exprimée dans ce vers célèbre : « Beauté est vérité et vérité beauté. Voilà tout ce que l’on sait sur terre et tout ce qu’il faut savoir ».
Le genre romanesque s’épanouit dans un premier temps avec les œuvres de Mary Shelley (Frankenstein, 1818) et de Jane Austen (Orgueil et Préjugés 1813) et la vogue du roman historique, où Walter Scott s’impose (Ivanhoé, 1819) ; puis, dans un second temps, avec les œuvres de Charles Dickens (Oliver Twist, 1837-1839 ; David Copperfield, 1850) et celles des sœurs Brontë en 1847 : Jane Eyre de Charlotte ; Les Hauts de Hurlevent par Emily. Dans un troisième temps, Lewis Carroll, Oscar Wilde et Robert Louis Stevenson explorent des univers fantastiques et psychologiques qui font évoluer le genre (voir leurs œuvres présentées ci-après).
Au début du XXe siècle, George Bernard Shaw relance le théâtre d’idées avec plusieurs pièces qui revisitent des œuvres du passé (par exemple Homme et superhomme, 1901-1903, où le mythe de Don Juan est revisité). Un peu plus tard, un théâtre engagé politiquement se développe, notamment à travers l’œuvre de Sean O’ Casey (Junon et le Paon, 1922). Après la Seconde Guerre mondiale et ses terribles leçons, le théâtre de l’absurde s’impose à travers certaines œuvres d’Harold Pinter, mais surtout de Samuel Beckett.
Le roman du XXe siècle introduit de nouvelles orientations où le héros et la chronologie sont souvent déstructurés ; les romans de Joseph Conrad, James Joyce, Virginia Woolf, Doris Lessing (voir leurs œuvres présentées ci-après) illustrent cette esthétique.
Voilà, le tout petit tour s’achève. À vous maintenant d’entrer dans le cercle et de l’élargir…
Du XVIe au XVIIIe siècle : des idées, du théatre et des aventures
Philosophie, théâtre, roman d’aventures… on peut dire que la littérature anglaise commence fort ! C’est cette diversité que vous retrouvez chez More, Shakespeare, Defoe, Swift, et bien d’autres.
Comment les haïkus naissent dans les choux : Ou comment construire votre petite fabrique poétique
Gilles Guilleron
Gilles Guilleron
La lenteur de l'escargot
ignore
la montée et la descente
ignore
la montée et la descente
Comment les haïkus naissent dans les choux : Ou comment construire votre petite fabrique poétique
Gilles Guilleron
Gilles Guilleron
Nuit sans étoiles
l'inspiration
a éteint sa lumière
l'inspiration
a éteint sa lumière
Comment les haïkus naissent dans les choux : Ou comment construire votre petite fabrique poétique
Gilles Guilleron
Gilles Guilleron
Avant de partir
il faut oublier quelque chose
pour revenir
il faut oublier quelque chose
pour revenir
Comment les haïkus naissent dans les choux : Ou comment construire votre petite fabrique poétique
Gilles Guilleron
Gilles Guilleron
Dans les flaques de marée basse
les crevettes
attendent le grand bain
les crevettes
attendent le grand bain
Comment les haïkus naissent dans les choux : Ou comment construire votre petite fabrique poétique
Gilles Guilleron
Gilles Guilleron
Dans le gratte-ciel
l'escalier passe le temps
en comptant ses marches
l'escalier passe le temps
en comptant ses marches
Dans le train
les voyageurs regardent
passer les vaches.
les voyageurs regardent
passer les vaches.
Casser la baraque
L'histoire en quelques mots
Le verbe "casser" se situe souvent du côté de la destruction, mais, associé à la "baraque", il revêt des connotations extrêmement positives ! L'expression "casser la baraque" provient de l'argot des spectacles : "la baraque" désignait autrefois la salle où une représentation obtenait un succès triomphal. Aller au spectacle et s'y amuser, belle cassure !
L'histoire en quelques mots
Le verbe "casser" se situe souvent du côté de la destruction, mais, associé à la "baraque", il revêt des connotations extrêmement positives ! L'expression "casser la baraque" provient de l'argot des spectacles : "la baraque" désignait autrefois la salle où une représentation obtenait un succès triomphal. Aller au spectacle et s'y amuser, belle cassure !
Verba volant, scripta manent ("Les paroles s'envolent, les écrits restent")... Facile à dire, mais pas toujours facile à écrire !
Extrait de l'introduction
DIT LE PROVERBE...
Ils sont passés par ici, ils repasseront par là... Ils sont des milliers et des milliers ; on en trouve à chaque époque, dans la plupart des sociétés, transmis de génération en génération. On les appelle «la sagesse des nations», «la sagesse populaire» ; aujourd'hui, les linguistes les étudient avec précision dans une science, la parémiologie (non, ce n'est pas un gros mot !). Ils ? Ce sont les proverbes, ces formules (parfois magiques !) où l'on peut retrouver tous les moments de la vie, tragiques, tristes, imprévus, absurdes, joyeux ; les peurs, les angoisses, les expériences, les certitudes, ou les aspirations. Tournures brèves, souvent injonctives et définitives, les proverbes sont autant de réponses à autant de questionnements. Tout peut passer à la moulinette des proverbes !
C'est pourquoi les sources des proverbes sont multiples : d'abord les sources populaires liées à l'esprit ou à la morale d'une époque, et à des pratiques anciennes (aujourd'hui disparues). Ensuite leur emploi littéraire : souvent métaphoriques, les proverbes gardent leur force grâce aux images qui pérennisent leur usage ; on pense bien sûr aux fabulistes (Ésope, Phèdre, La Fontaine en ont fait grande consommation) et aux écrivains (Villon, Molière, Voltaire, Musset, et bien d'autres). Ainsi, le proverbe vit dans cet aller-retour permanent où sources populaires et littéraires s'entremêlent : les premières nourrissent les secondes qui, à leur tour, fixent et assurent la transmission du proverbe, devenu alors patrimoine partagé.
Bien sûr, nous n'ignorons pas qu'ils existent de subtils et réels distinguos entre proverbes, maximes, sentences, adages, dictons, préceptes ; mais nous avons choisi de regrouper ici toutes ces formes sous le terme générique de «proverbe» pour vous offrir en toute simplicité un florilège des plus belles formules de la langue française. On notera d'ailleurs que souvent les maximes et les sentences contiennent en filigrane un proverbe ancien dont elles sont l'expression littéraire.
Remplis de «bon sens» et de «bons conseils», les proverbes sont des sortes d'échos des expériences humaines, tout prêts à venir agrémenter notre conversation, à notre disposition pour argumenter une discussion. Mais, avec eux, il faut rester prudent, car ils témoignent aussi de la versatilité humaine et peuvent donc exprimer le tout et son contraire.
DIT LE PROVERBE...
Ils sont passés par ici, ils repasseront par là... Ils sont des milliers et des milliers ; on en trouve à chaque époque, dans la plupart des sociétés, transmis de génération en génération. On les appelle «la sagesse des nations», «la sagesse populaire» ; aujourd'hui, les linguistes les étudient avec précision dans une science, la parémiologie (non, ce n'est pas un gros mot !). Ils ? Ce sont les proverbes, ces formules (parfois magiques !) où l'on peut retrouver tous les moments de la vie, tragiques, tristes, imprévus, absurdes, joyeux ; les peurs, les angoisses, les expériences, les certitudes, ou les aspirations. Tournures brèves, souvent injonctives et définitives, les proverbes sont autant de réponses à autant de questionnements. Tout peut passer à la moulinette des proverbes !
C'est pourquoi les sources des proverbes sont multiples : d'abord les sources populaires liées à l'esprit ou à la morale d'une époque, et à des pratiques anciennes (aujourd'hui disparues). Ensuite leur emploi littéraire : souvent métaphoriques, les proverbes gardent leur force grâce aux images qui pérennisent leur usage ; on pense bien sûr aux fabulistes (Ésope, Phèdre, La Fontaine en ont fait grande consommation) et aux écrivains (Villon, Molière, Voltaire, Musset, et bien d'autres). Ainsi, le proverbe vit dans cet aller-retour permanent où sources populaires et littéraires s'entremêlent : les premières nourrissent les secondes qui, à leur tour, fixent et assurent la transmission du proverbe, devenu alors patrimoine partagé.
Bien sûr, nous n'ignorons pas qu'ils existent de subtils et réels distinguos entre proverbes, maximes, sentences, adages, dictons, préceptes ; mais nous avons choisi de regrouper ici toutes ces formes sous le terme générique de «proverbe» pour vous offrir en toute simplicité un florilège des plus belles formules de la langue française. On notera d'ailleurs que souvent les maximes et les sentences contiennent en filigrane un proverbe ancien dont elles sont l'expression littéraire.
Remplis de «bon sens» et de «bons conseils», les proverbes sont des sortes d'échos des expériences humaines, tout prêts à venir agrémenter notre conversation, à notre disposition pour argumenter une discussion. Mais, avec eux, il faut rester prudent, car ils témoignent aussi de la versatilité humaine et peuvent donc exprimer le tout et son contraire.
Travaillez l'art de suggérer et laissez l'imaginaire du lecteur se déployer dans votre histoire pour qu'elle devienne sienne : plutôt que « Paul se sent nerveux », dites « les mains de Paul tremblent ».
... Ce livre est une invitation au voyage, ne filez donc pas à l'anglaise.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Conseils d'écrivains
agnesmoisan84
27 livres
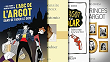
Argot à tire-larigot
Alzie
35 livres
Auteurs proches de Gilles Guilleron
Lecteurs de Gilles Guilleron (158)Voir plus
Quiz
Voir plus
Du Polar avec Jean Gabin
D'après le roman de Pierre-René Wolf, Martin Roumagnac est un film réalisé par Georges Lacombe sorti en 1946. La vie de Gabin, entrepreneur en maçonnerie, prend un mauvais tournant lorsqu'il rencontre une belle aventurière, interprétée par celle qui partagea sa vie: (Indice: L'ange bleu)
Greta Garbo
Marlene Dietrich
Arletty
12 questions
38 lecteurs ont répondu
Thèmes :
jean gabin
, polar noir
, romans policiers et polars
, acteur
, cinema
, adapté au cinéma
, adaptation
, littératureCréer un quiz sur cet auteur38 lecteurs ont répondu