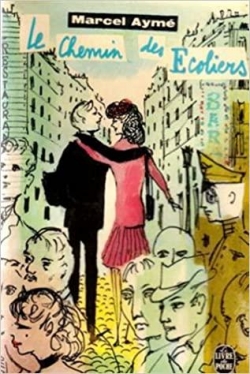>
Critique de Lamifranz
Aymé, c'est ce qu'il y a de plus beau… Vous connaissez la chanson. Plus beau peut-être, plus consensuel, plus gentil, c'est moins sûr. Marcel Aymé, c'est du brutal. J'ai connu une polonaise qui en lisait au petit déjeuner, je ne sais même pas ce qu'elle est devenue. En 1946, Marcel Aymé règle ses comptes avec la guerre et l'Occupation : le travail commencé avec « Travelingue », (1941), continué (en sourdine) avec « le Passe-muraille » (1943) prend forme avec « le Chemin des écoliers » (1946) et finit en apothéose avec « le Vin de Paris » (1947) et « Uranus » (1948). Bousculé à la Libération pour ses amitiés avec des intellectuels plus ou moins tombés dans le piège fasciste (Brasillach, surtout), et pour quelques articles parus dans des journaux de la même couleur (vert-de-gris ou caca d'oie – ou caca pas de l'oie), Marcel Aymé trace au vitriol un portrait de ses concitoyens, de leur bonne conscience laissée au vestiaire, de leur héroïsme de tripot, de leur moralité à ailes changeantes… Il a beau jeu, me direz-vous, c'est dans de telles circonstances que l'âme humaine se révèle dans toute sa noirceur, on est bien d'accord. Et il s'est passé dans cette période des choses terribles et des choses merveilleuses. Mais à la Libération, la tendance était plutôt de mettre la poussière sous le tapis. Et voyez-vous, Marcel Aymé, lui, il est plutôt du genre à épousseter le tapis sur la place de la Mairie, quitte à éclabousser les badauds.
« le chemin des écoliers » est l'histoire de Pierre Michaud, 55 ans, père de famille, tendre et attentionné, peut-être un petit peu rétro (pour l'époque), mais que les réalités de la vie vont rattraper, essentiellement par le biais de ses enfants.
Dans la famille Michaud, je demande le père : il se prénomme Pierre, mais la plupart du temps il figure sous le nom de Michaud. Il est le co-fondateur, avec Etienne Lolivier, de la Société de Gérance des Fortunes Immobilières de Paris.
Frédéric, l'aîné des enfants Michaud, distribue des tracts communistes à la sortie des usines.
Antoine, le cadet, 16 ans, doit passer le bac à la fin de l'année, mais il occupe son temps à faire du marché noir avec son ami Pierre Tiercelin. Il est aussi l'amant d'Yvette Grandmaison, une jeune femme dont le mari est au stalag, et qui grâce à Antoine peut s'assurer, à sa fille Chou et elle, un train de vie élevé.
Pierrette, la benjamine, 12 ans, solide, rieuse, et pas née de la dernière pluie.
La mère, Hélène, se remet d'une opération d'un fibrome, et n'intervient pas souvent dans l'histoire.
C'est autour de cette famille exemplaire des années 40 que s'articule l'intrigue. Sur fond d'Occupation, de marché noir, de persécutions antisémites, se greffent des thèmes éternels comme l'amour et l'amitié (même si ces valeurs sont quelque peu écornées), l'ambition, la bassesse, la compromission, ainsi que de façon très sensible, le conflit des générations, entre des parents trop en retard et des enfants trop en avance.
Les Michaud sont entourés d'une belle brochette de personnages qui couvrent d'un bout à l'autre tout l'échiquier politique : entre Courtelier, enseignant à la retraite qui refuse toute compromission avec l'occupant, et Malinier, ancien combattant, fasciste, maréchaliste, futur engagé à la LVF, la plupart des acteurs de ce drame comique (ou cette comédie dramatique, c'est comme on voudra) naviguent entre marché noir et prostitution, (le père Tiercelin restaurateur et grand ponte du « marché parallèle ») le seul mot d'ordre étant : on va s'en sortir, même s'il faut marcher sur les autres, et autant que ça nous rapporte ! Et comme nécessité fait loi, on est bien obligé d'en passer par là ! (c'est l'excuse qu'on se donne).
Ce que fustige Marcel Aymé, c'est cette absence de scrupules qui règne, et fausse toute perception saine, toute conscience. Mais ce dernier mot a déjà perdu tout sens : dans le premier chapitre, Michaud fait un rêve, et
« Il ne s'éveilla que le lendemain matin à sept heures et, après avoir hésité un moment s'il avait mal au foie ou à la conscience, se souvint tout à coup de son rêve ».
Un livre salutaire, qui montre comment une situation particulière peut faire basculer dans la veulerie, la bassesse, l'ignominie… Et qui nous met en garde contre le retour de telles horreurs. Mais notre société, encore plus matérialiste, saura-t-elle en tirer les leçons ?
« le chemin des écoliers » est l'histoire de Pierre Michaud, 55 ans, père de famille, tendre et attentionné, peut-être un petit peu rétro (pour l'époque), mais que les réalités de la vie vont rattraper, essentiellement par le biais de ses enfants.
Dans la famille Michaud, je demande le père : il se prénomme Pierre, mais la plupart du temps il figure sous le nom de Michaud. Il est le co-fondateur, avec Etienne Lolivier, de la Société de Gérance des Fortunes Immobilières de Paris.
Frédéric, l'aîné des enfants Michaud, distribue des tracts communistes à la sortie des usines.
Antoine, le cadet, 16 ans, doit passer le bac à la fin de l'année, mais il occupe son temps à faire du marché noir avec son ami Pierre Tiercelin. Il est aussi l'amant d'Yvette Grandmaison, une jeune femme dont le mari est au stalag, et qui grâce à Antoine peut s'assurer, à sa fille Chou et elle, un train de vie élevé.
Pierrette, la benjamine, 12 ans, solide, rieuse, et pas née de la dernière pluie.
La mère, Hélène, se remet d'une opération d'un fibrome, et n'intervient pas souvent dans l'histoire.
C'est autour de cette famille exemplaire des années 40 que s'articule l'intrigue. Sur fond d'Occupation, de marché noir, de persécutions antisémites, se greffent des thèmes éternels comme l'amour et l'amitié (même si ces valeurs sont quelque peu écornées), l'ambition, la bassesse, la compromission, ainsi que de façon très sensible, le conflit des générations, entre des parents trop en retard et des enfants trop en avance.
Les Michaud sont entourés d'une belle brochette de personnages qui couvrent d'un bout à l'autre tout l'échiquier politique : entre Courtelier, enseignant à la retraite qui refuse toute compromission avec l'occupant, et Malinier, ancien combattant, fasciste, maréchaliste, futur engagé à la LVF, la plupart des acteurs de ce drame comique (ou cette comédie dramatique, c'est comme on voudra) naviguent entre marché noir et prostitution, (le père Tiercelin restaurateur et grand ponte du « marché parallèle ») le seul mot d'ordre étant : on va s'en sortir, même s'il faut marcher sur les autres, et autant que ça nous rapporte ! Et comme nécessité fait loi, on est bien obligé d'en passer par là ! (c'est l'excuse qu'on se donne).
Ce que fustige Marcel Aymé, c'est cette absence de scrupules qui règne, et fausse toute perception saine, toute conscience. Mais ce dernier mot a déjà perdu tout sens : dans le premier chapitre, Michaud fait un rêve, et
« Il ne s'éveilla que le lendemain matin à sept heures et, après avoir hésité un moment s'il avait mal au foie ou à la conscience, se souvint tout à coup de son rêve ».
Un livre salutaire, qui montre comment une situation particulière peut faire basculer dans la veulerie, la bassesse, l'ignominie… Et qui nous met en garde contre le retour de telles horreurs. Mais notre société, encore plus matérialiste, saura-t-elle en tirer les leçons ?