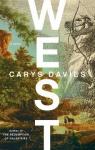Pierre Cérésole/5
1 notes
Résumé :
Les pluies de la mousson, en automne 1934, rendirent ce travail plus urgent encore. Le niveau de certaines régions ayant été abaissé par la formidable convulsion, nombre de villages encore debout furent envahis par les eaux ce qui oblige les villageois à trouver d’autres emplacements pour leurs cabanes.
L’appel de Pierre Ceresole et de C.-F. Andrews fut entendu. En deux mois, 10 000 fr. (suisses) étaient souscrits ; c’était suffisant pour commencer le travail... >Voir plus
L’appel de Pierre Ceresole et de C.-F. Andrews fut entendu. En deux mois, 10 000 fr. (suisses) étaient souscrits ; c’était suffisant pour commencer le travail... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Citations et extraits (7)
Voir plus
Ajouter une citation
Patna, mercredi 14 novembre.
Il y a eu aujourd’hui une semaine que nous sommes arrivés ici. Rajendra nous a avertis tout de suite que jusqu’aux élections législatives qui auraient lieu le 13 novembre, il ne serait pas possible de prendre les décisions finales permettant de nous mettre à l’ouvrage. Je constate avec grande satisfaction que nous n’arrivons pas trop tard et que — comme je m’y attendais un peu —, nous sommes sensiblement en avance sur les préparatifs qui ont été faits pour organiser ici notre action. C’est en m’embarquant à Londres pour rentrer en Suisse, le 4 octobre, après le service d’Oakengates, que j’ai télégraphié à Rajendra que la première unité pour le Bihar était assurée et que nous en espérions d’autres : il était assez difficile pour lui d’organiser quoi que ce soit avant d’avoir des nouvelles plus précises. Nous avons joliment bien fait de n’envisager qu’une unité pour faire les premières expériences nécessaires et de n’arriver que Joe Wilkinson et moi pour commencer cette besogne. La semaine de repos forcé et d’adaptation qui vient de nous être imposée tombait si à propos que nous n’en avons senti aucune impatience, malgré notre vif désir de commencer le travail. Cela aurait pu nous causer, à nous et à nos hôtes, un sentiment d’embarras si nous avions été un plus grand nombre à attendre ainsi.
Le premier soir, sortie au bazar de Patna dans la grande rue marchande… invraisemblablement pittoresque. C’est accablant de devoir résumer par deux mots d’une banalité aussi écrasante des impressions aussi vives. Il faudrait décrire longuement chaque groupe de femmes et d’enfants, chaque échoppe, chaque chariot de paysan — avec l’inévitable vache qui se promène au milieu de tout cela. Les impressions vives ne sont pas toutes également agréables à Joe, à ce contact No 3 avec son empire, contact encore plus profond que les précédents, est littéralement suffoqué par les odeurs multiples et compliquées — pour ne pas dire plus — qui se traînent lourdement sur ce bazar. Il passe par le moment, inévitable ici : où l’on constate avec un certain effroi que tout, ma foi, ne sera pas rose ni surtout odeur de rose et qu’avec toute la sympathie que ce peuple inspire, on aura certaines répugnances à vaincre. Joe en devient un peu silencieux pour un moment, mais il se remet pour un moment aussi en prenant une cigarette, tout en projetant d’abandonner ce grand luxe dans ce pays où on n’a souvent, pour nourrir une famille tout un jour, que la somme nécessaire à payer un petit paquet de cigarettes. En traversant la grande pelouse communale, le Maidan, pour rentrer chez nous — nous cherchons parmi les étoiles : la polaire si basse déjà sur l’horizon — et la Grande ourse, — les subterjis, les sept richis, mais ces sept sages ont disparu sous l’horizon comme jamais ils ne le font chez nous.
Dès la première nuit, nous dormons admirablement sous nos moustiquaires. Rien de plus délicieux que de narguer ainsi, bien à l’abri, ces affreux petits individus dont la musique stridente se fait entendre dans l’air. Mais cela nous met en présence de l’un des problèmes les plus graves qui ait préoccupé les philosophes hindous : si la vie du moustique doit être respectée, il est illogique de protéger ses chevilles ou ses mollets contre lui. Je ne puis pas claquer un moustique sans me demander involontairement si deux yeux hindous veloutés et profonds ne vont pas apparaître avec un air de reproche et de douleur indicibles pour cette offense à la loi du respect de toute vie. C’est ridicule, évidemment, mais certes, ce qui ne l’est pas, c’est la souffrance universelle…
À côté des moustiques — et c’est bien la vie —, nous voyons de dessous nos moustiquaires flotter mollement, s’allumer, s’éteindre, se renverser, la merveilleuse luciole égarée dans la chambre. Cette lumière qui palpite. Joe qui n’a aucune prétention à la poésie ou à la remarque shakespearienne dit avec un air « matter of fact » qui me saisit : « C’est comme si chaque battement de cœur faisait de la lumière ». Et quand on y regarde de plus près, la réalité est presque plus saisissante encore : c’est dans l’essor du vol et chaque fois que les ailes se soulèvent que la lumière apparaît.
Nous avons eu matin et soir une bonne et longue conversation avec Rajendra sur tout au monde. On nous répète ici qu’au Bihar, Rajendra est aimé et respecté plus encore que Mahatma lui-même. C’est un homme d’un charme étonnant. Une magnifique physionomie hindoue ; il est exactement aussi beau dans le sens ordinaire et régulier du mot que Mahatma est laid. Intelligent sans l’ombre de pédanterie, facile à suivre et clair dans tout ce qu’il dit, n’ayant jamais l’air de se souvenir qu’il est un personnage important, mais arrivant par je ne sais quel charme à le faire oublier à tous ceux qui l’entourent. Ami fidèle et parfait de Gandhiji, bien entendu. D’un bout de l’Inde à l’autre, et dans tous les partis, on s’accordait pour admirer son discours présidentiel au Congrès. Sur ma demande, il nous en a donné, ce matin enfin, le texte imprimé. C’est un discours admirable, parfaitement rédigé, sobre, net, cinglant sans aucune exagération en ce qui concerne la situation créée par l’administration anglaise, constamment soutenu par le souffle spirituel, le feu le plus naturel, et animé dans toutes ses critiques de la loyauté et de la bienveillance les plus évidentes. Certainement, une des choses qui parlent le plus en faveur du Congrès, — tel que l’esprit de Gandhi l’a fait, — c’est qu’il se soit donné un président de ce calibre et qui semble capable — si ça ne tenait qu’à lui, — de mener son pays sur n’importe quelle hauteur.
Je suis confondu que nous nous trouvions sans calcul et sans préméditation, amenés pour notre travail aux côtés de cet homme. Rien ne saurait nous encourager davantage. Nous sommes donc bien dans la ligne où l’on arrive naturellement aux meilleurs endroits.
… Dans la matinée du 13, j’ai pu passer une bonne heure chez M. Brett, le commissaire britannique pour la réparation au Bihar.
Mr. et Mrs. B. paraissaient tous deux très intéressés par notre projet — plus encore qu’en juin. Mr. B. suggérait que nous ferions bien de ne pas nous éloigner trop d’un centre relativement important, comme Muzaffarpur, pour que notre entreprise ait autant de publicité que possible. Le déblaiement du sable ne paraît pas aussi nécessaire qu’il paraissait au premier abord. Ce qui est maintenant arrêté, c’est que nous commencerons par déblayer des canaux de drainage dans le voisinage du village de Bakhri près Motihari où j’ai séjourné dix jours en mai, et que de là nous étudierons les possibilités qui se présenteront à d’autres endroits. Très particulièrement le déplacement des villages aujourd’hui trop exposés aux inondations et la reconstruction du village à un autre endroit sur un nouveau plan (village modèle). Nous avons en vue très spécialement le village de Sonathi, à treize kilomètres au nord de Muzaffarpur. Ce dernier projet est absolument satisfaisant. Il rallie tous les suffrages et remplit tous les « desiderata ». Il m’a été proposé indépendamment et simultanément par M. Brett et par les amis du Comité indien qui s’est réuni hier sous la direction de Rajendra Prasad. Il s’agit de reconstruire environ sept cents maisons.
Je suis enchanté de la manière dont tout se développe normalement. Cette affaire vit.
Notre séjour de neuf jours à Patna prend fin aujourd’hui. Nous partons à 13 h. 30, dans une heure, Joe et moi pour Muzaffarpur. J’y suis attendu chez le commissioner du district M. Scott, à 18 heures ce soir et je resterai chez lui jusqu’à demain. Admirable occasion de parler en détail de nos projets et de toute la situation. Demain 17 et les jours suivants, nous visiterons, Joe et moi, la région de Sonathi et le 19 nous continuerons notre route de Muzaffarpur sur Bakhri où les premiers préparatifs pour notre travail auront été faits.
Je tiens à mettre ces lignes à la poste de Patna ; dans les endroits où nous allons maintenant, il sera plus difficile d’expédier à temps notre courrier.
Il y a eu aujourd’hui une semaine que nous sommes arrivés ici. Rajendra nous a avertis tout de suite que jusqu’aux élections législatives qui auraient lieu le 13 novembre, il ne serait pas possible de prendre les décisions finales permettant de nous mettre à l’ouvrage. Je constate avec grande satisfaction que nous n’arrivons pas trop tard et que — comme je m’y attendais un peu —, nous sommes sensiblement en avance sur les préparatifs qui ont été faits pour organiser ici notre action. C’est en m’embarquant à Londres pour rentrer en Suisse, le 4 octobre, après le service d’Oakengates, que j’ai télégraphié à Rajendra que la première unité pour le Bihar était assurée et que nous en espérions d’autres : il était assez difficile pour lui d’organiser quoi que ce soit avant d’avoir des nouvelles plus précises. Nous avons joliment bien fait de n’envisager qu’une unité pour faire les premières expériences nécessaires et de n’arriver que Joe Wilkinson et moi pour commencer cette besogne. La semaine de repos forcé et d’adaptation qui vient de nous être imposée tombait si à propos que nous n’en avons senti aucune impatience, malgré notre vif désir de commencer le travail. Cela aurait pu nous causer, à nous et à nos hôtes, un sentiment d’embarras si nous avions été un plus grand nombre à attendre ainsi.
Le premier soir, sortie au bazar de Patna dans la grande rue marchande… invraisemblablement pittoresque. C’est accablant de devoir résumer par deux mots d’une banalité aussi écrasante des impressions aussi vives. Il faudrait décrire longuement chaque groupe de femmes et d’enfants, chaque échoppe, chaque chariot de paysan — avec l’inévitable vache qui se promène au milieu de tout cela. Les impressions vives ne sont pas toutes également agréables à Joe, à ce contact No 3 avec son empire, contact encore plus profond que les précédents, est littéralement suffoqué par les odeurs multiples et compliquées — pour ne pas dire plus — qui se traînent lourdement sur ce bazar. Il passe par le moment, inévitable ici : où l’on constate avec un certain effroi que tout, ma foi, ne sera pas rose ni surtout odeur de rose et qu’avec toute la sympathie que ce peuple inspire, on aura certaines répugnances à vaincre. Joe en devient un peu silencieux pour un moment, mais il se remet pour un moment aussi en prenant une cigarette, tout en projetant d’abandonner ce grand luxe dans ce pays où on n’a souvent, pour nourrir une famille tout un jour, que la somme nécessaire à payer un petit paquet de cigarettes. En traversant la grande pelouse communale, le Maidan, pour rentrer chez nous — nous cherchons parmi les étoiles : la polaire si basse déjà sur l’horizon — et la Grande ourse, — les subterjis, les sept richis, mais ces sept sages ont disparu sous l’horizon comme jamais ils ne le font chez nous.
Dès la première nuit, nous dormons admirablement sous nos moustiquaires. Rien de plus délicieux que de narguer ainsi, bien à l’abri, ces affreux petits individus dont la musique stridente se fait entendre dans l’air. Mais cela nous met en présence de l’un des problèmes les plus graves qui ait préoccupé les philosophes hindous : si la vie du moustique doit être respectée, il est illogique de protéger ses chevilles ou ses mollets contre lui. Je ne puis pas claquer un moustique sans me demander involontairement si deux yeux hindous veloutés et profonds ne vont pas apparaître avec un air de reproche et de douleur indicibles pour cette offense à la loi du respect de toute vie. C’est ridicule, évidemment, mais certes, ce qui ne l’est pas, c’est la souffrance universelle…
À côté des moustiques — et c’est bien la vie —, nous voyons de dessous nos moustiquaires flotter mollement, s’allumer, s’éteindre, se renverser, la merveilleuse luciole égarée dans la chambre. Cette lumière qui palpite. Joe qui n’a aucune prétention à la poésie ou à la remarque shakespearienne dit avec un air « matter of fact » qui me saisit : « C’est comme si chaque battement de cœur faisait de la lumière ». Et quand on y regarde de plus près, la réalité est presque plus saisissante encore : c’est dans l’essor du vol et chaque fois que les ailes se soulèvent que la lumière apparaît.
Nous avons eu matin et soir une bonne et longue conversation avec Rajendra sur tout au monde. On nous répète ici qu’au Bihar, Rajendra est aimé et respecté plus encore que Mahatma lui-même. C’est un homme d’un charme étonnant. Une magnifique physionomie hindoue ; il est exactement aussi beau dans le sens ordinaire et régulier du mot que Mahatma est laid. Intelligent sans l’ombre de pédanterie, facile à suivre et clair dans tout ce qu’il dit, n’ayant jamais l’air de se souvenir qu’il est un personnage important, mais arrivant par je ne sais quel charme à le faire oublier à tous ceux qui l’entourent. Ami fidèle et parfait de Gandhiji, bien entendu. D’un bout de l’Inde à l’autre, et dans tous les partis, on s’accordait pour admirer son discours présidentiel au Congrès. Sur ma demande, il nous en a donné, ce matin enfin, le texte imprimé. C’est un discours admirable, parfaitement rédigé, sobre, net, cinglant sans aucune exagération en ce qui concerne la situation créée par l’administration anglaise, constamment soutenu par le souffle spirituel, le feu le plus naturel, et animé dans toutes ses critiques de la loyauté et de la bienveillance les plus évidentes. Certainement, une des choses qui parlent le plus en faveur du Congrès, — tel que l’esprit de Gandhi l’a fait, — c’est qu’il se soit donné un président de ce calibre et qui semble capable — si ça ne tenait qu’à lui, — de mener son pays sur n’importe quelle hauteur.
Je suis confondu que nous nous trouvions sans calcul et sans préméditation, amenés pour notre travail aux côtés de cet homme. Rien ne saurait nous encourager davantage. Nous sommes donc bien dans la ligne où l’on arrive naturellement aux meilleurs endroits.
… Dans la matinée du 13, j’ai pu passer une bonne heure chez M. Brett, le commissaire britannique pour la réparation au Bihar.
Mr. et Mrs. B. paraissaient tous deux très intéressés par notre projet — plus encore qu’en juin. Mr. B. suggérait que nous ferions bien de ne pas nous éloigner trop d’un centre relativement important, comme Muzaffarpur, pour que notre entreprise ait autant de publicité que possible. Le déblaiement du sable ne paraît pas aussi nécessaire qu’il paraissait au premier abord. Ce qui est maintenant arrêté, c’est que nous commencerons par déblayer des canaux de drainage dans le voisinage du village de Bakhri près Motihari où j’ai séjourné dix jours en mai, et que de là nous étudierons les possibilités qui se présenteront à d’autres endroits. Très particulièrement le déplacement des villages aujourd’hui trop exposés aux inondations et la reconstruction du village à un autre endroit sur un nouveau plan (village modèle). Nous avons en vue très spécialement le village de Sonathi, à treize kilomètres au nord de Muzaffarpur. Ce dernier projet est absolument satisfaisant. Il rallie tous les suffrages et remplit tous les « desiderata ». Il m’a été proposé indépendamment et simultanément par M. Brett et par les amis du Comité indien qui s’est réuni hier sous la direction de Rajendra Prasad. Il s’agit de reconstruire environ sept cents maisons.
Je suis enchanté de la manière dont tout se développe normalement. Cette affaire vit.
Notre séjour de neuf jours à Patna prend fin aujourd’hui. Nous partons à 13 h. 30, dans une heure, Joe et moi pour Muzaffarpur. J’y suis attendu chez le commissioner du district M. Scott, à 18 heures ce soir et je resterai chez lui jusqu’à demain. Admirable occasion de parler en détail de nos projets et de toute la situation. Demain 17 et les jours suivants, nous visiterons, Joe et moi, la région de Sonathi et le 19 nous continuerons notre route de Muzaffarpur sur Bakhri où les premiers préparatifs pour notre travail auront été faits.
Je tiens à mettre ces lignes à la poste de Patna ; dans les endroits où nous allons maintenant, il sera plus difficile d’expédier à temps notre courrier.
Patna, 10 novembre 1934.
Arrivée à Bombay — Gandhi et le Congrès.
… Des coolies enturbannés, pieds nus, cordes et crochets sur l’épaule, envahissent tous les appartements de toutes les classes du « Victoria ». Je me demande au milieu de ce remue-ménage comment les amis qui probablement viendront nous chercher arriveront à nous trouver. Mais au moment où cela me paraît impossible, voici, — exactement comme le 25 avril, — le petit-neveu de Gandhi, qui m’attend à la porte de ma cabine. Après une bousculade à la douane, nous nous retrouvons, Mathuradas, Joe Wilkinson et moi, dans l’auto de M. Bulabhai Desai que son fils Dirajlal nous a très obligeamment envoyée, et nous faisons la « traversée-arrivée » de Bombay. Comme c’est la première fois que Joe sort d’Angleterre et prend contact avec son empire, je ne m’étonne pas de l’impression assez vertigineuse que lui produisent cette ville et cette foule complexe, étrange, bariolée. C’est en beaucoup plus agréable, mais tout aussi impressionnant, comme une sorte de mal de mer transcendant… on se trouve roulé, bousculé, renversé dans toutes les directions à la fois. Tous ces costumes, toutes ces physionomies, toutes ces maisons, tous ces arbres sont différents de tout ce qu’on connaît, et profondément différents les uns des autres.
Nous arrivons au palais de M. Desai au bord de l’Océan.
M. Bulabhai Desai lui-même est en tournée électorale préparant les élections à l’Assemblée législative qui doivent avoir lieu dans quelques jours. Tout le monde est encore sous l’impression du Congrès qui vient de se terminer à Bombay. 2 500 délégués y ont participé, discutant devant un public de 40 à 50 000 personnes. Les opinions les plus diverses sont exprimées sur les résultats.
Dirajlal Desai, se plaçant au point de vue pittoresque, nous dit : « Vous arrivez huit jours trop tard. C’était un spectacle extraordinaire ». Mais la remarque par laquelle Mathura Prasad (mon bon guide de ce printemps) devait nous accueillir quelques jours plus tard à Patna : « Vous arrivez juste au moment psychologique — in the nick of time — », est plus juste. La retraite de Gandhi voulue, paisible, calculée avec ses amis (qui pourtant ne le suivent pas dans cette retraite) produit un effet extraordinaire. Chacun sent qu’il ne s’agit pas de politique comme on en fait tous les jours. Rajendra Prasad, actuellement président du Congrès (et qui loge au moment où j’écris dans la chambre à côté de la nôtre) nous donnait l’explication la plus intelligible : Mahatmaji sent que, s’il restait membre du Congrès et continuait à participer à ses assemblées, sa présence seule continuerait à amener (mécaniquement et extérieurement en quelque sorte) des décisions qui ne correspondent pas à la conviction profonde, à la volonté et aux sentiments actuels réels de la majorité du Congrès. En laissant ses amis les plus intimes dans le Congrès, Gandhi peut bien espérer que l’Esprit qui lui paraît devoir régner continuera à manifester son influence et à inspirer l’assemblée mais d’une manière plus naturelle et plus saine que s’il restait là, lui-même, en chair et en os, et continuait à exercer une emprise due à une simple habitude ou à sa présence physique. Il y a, dans cette attitude sans équivalent ni explication purement politiques, quelque chose qui rappelle le mot du Christ : « Il faut que je vous quitte pour que l’Esprit puisse venir vers vous ». Tant que Gandhi serait là : on continuerait simplement à suivre Gandhi — sans le comprendre — et en se conduisant par ailleurs dans l’action politique de telle manière que le contraste ne pourrait apparaître que comme un mensonge. Il y a là quelque chose de délicat, de compliqué, mais de profondément justifié, bien que plusieurs des meilleurs amis de Gandhi aient eu d’abord beaucoup de peine à le comprendre. Quelques autres, au contraire, désiraient cette décision très vivement et très profondément avant que Gandhi l’ait prise. En se retirant, Gandhi — il n’est pas faux de le dire, — marque son sentiment que le Congrès n’accepte ses principes essentiels que du bout des lèvres et non du cœur. Mais son geste n’a pas purement ce sens négatif. En l’accomplissant, en laissant au Congrès les coudées plus franches, Gandhi estime qu’il y a plus de chances de voir le Congrès marcher réellement dans la direction voulue avec l’Esprit voulu.
Pendant la traversée déjà, nous apprenions, outre la retraite de Gandhi, une autre nouvelle plus curieuse. On savait que Gandhi demandait que les membres des conseils du Congrès, pour donner l’exemple, acceptent de s’astreindre à un certain travail manuel déterminé… Les gens à esprit politique pur (comme le journaliste Sastri) trouvaient cette proposition ridicule. « Le Congrès, disait-il, est un parti politique et non une société de culture morale ou religieuse. » Et l’impression de celui qui lisait les critiques était : « Donc on n’acceptera pas cette proposition et par conséquent Gandhi devra s’en aller ». En fait — et rien ne mesure mieux l’erreur qu’on commet en appliquant à ces choses l’échelle politique ordinaire : 1. Gandhi est parti — pour des raisons plus profondes qu’un incident de séance ou une mise en minorité, et 2. la mesure « impossible » a été acceptée.
On a beaucoup parlé de cette mesure. Pour nous, elle a une importance et une valeur particulières. Au moment où, de tous côtés, on nous dit : « Jamais vous ne pourrez travailler manuellement avec des coolies hindous… personne n’y comprendrait rien… » il se trouve que le parti représentant la vie nationale des Indes prend une décision ébouriffante, et dans une assemblée politique proclame précisément la vérité même que nous voulons, entre autres, marquer.
On précise : Gandhi se retire à Wardha et là, dans l’espace d’un mois, il espère mettre sur pied une organisation qui, en deux ans, doit transformer et reconstruire la vie économique des villages. On étudiera d’abord l’élevage du bétail et la fabrication des paniers etc.
Il est assez remarquable qu’en ignorant tout de cet effort, nous arrivions à ce moment précis en disant : « Envoyez-nous dans un village quelconque du Bihar pour y faire avec les paysans quoi que ce soit qui vous paraîtra utile », — sans la moindre notion que toute l’attention politique des Indes se trouvait, à la surprise des vieux routiers de la politique, tourner précisément autour de la même pointe. En tout cas, rien de plus facile de faire comprendre ce que nous voulons dans ce pays ; non seulement plus facile qu’en Perse ou en Égypte, mais infiniment plus facile que sur la place Saint-François à Lausanne. Tout cela est si naturel — que Joe et moi devons faire un effort pour nous étonner de nous trouver à Patna dans la chambre voisine de celle du chef du Parti national indien et d’avoir matin et soir sa gentille visite pour un moment de bavardage, comme si nous étions de très vieux amis.
J’arrête ma lettre net ici… On m’apprend subitement que la poste aérienne va partir…
Cordiales amitiés.
Votre Pierre Ceresole.
Arrivée à Bombay — Gandhi et le Congrès.
… Des coolies enturbannés, pieds nus, cordes et crochets sur l’épaule, envahissent tous les appartements de toutes les classes du « Victoria ». Je me demande au milieu de ce remue-ménage comment les amis qui probablement viendront nous chercher arriveront à nous trouver. Mais au moment où cela me paraît impossible, voici, — exactement comme le 25 avril, — le petit-neveu de Gandhi, qui m’attend à la porte de ma cabine. Après une bousculade à la douane, nous nous retrouvons, Mathuradas, Joe Wilkinson et moi, dans l’auto de M. Bulabhai Desai que son fils Dirajlal nous a très obligeamment envoyée, et nous faisons la « traversée-arrivée » de Bombay. Comme c’est la première fois que Joe sort d’Angleterre et prend contact avec son empire, je ne m’étonne pas de l’impression assez vertigineuse que lui produisent cette ville et cette foule complexe, étrange, bariolée. C’est en beaucoup plus agréable, mais tout aussi impressionnant, comme une sorte de mal de mer transcendant… on se trouve roulé, bousculé, renversé dans toutes les directions à la fois. Tous ces costumes, toutes ces physionomies, toutes ces maisons, tous ces arbres sont différents de tout ce qu’on connaît, et profondément différents les uns des autres.
Nous arrivons au palais de M. Desai au bord de l’Océan.
M. Bulabhai Desai lui-même est en tournée électorale préparant les élections à l’Assemblée législative qui doivent avoir lieu dans quelques jours. Tout le monde est encore sous l’impression du Congrès qui vient de se terminer à Bombay. 2 500 délégués y ont participé, discutant devant un public de 40 à 50 000 personnes. Les opinions les plus diverses sont exprimées sur les résultats.
Dirajlal Desai, se plaçant au point de vue pittoresque, nous dit : « Vous arrivez huit jours trop tard. C’était un spectacle extraordinaire ». Mais la remarque par laquelle Mathura Prasad (mon bon guide de ce printemps) devait nous accueillir quelques jours plus tard à Patna : « Vous arrivez juste au moment psychologique — in the nick of time — », est plus juste. La retraite de Gandhi voulue, paisible, calculée avec ses amis (qui pourtant ne le suivent pas dans cette retraite) produit un effet extraordinaire. Chacun sent qu’il ne s’agit pas de politique comme on en fait tous les jours. Rajendra Prasad, actuellement président du Congrès (et qui loge au moment où j’écris dans la chambre à côté de la nôtre) nous donnait l’explication la plus intelligible : Mahatmaji sent que, s’il restait membre du Congrès et continuait à participer à ses assemblées, sa présence seule continuerait à amener (mécaniquement et extérieurement en quelque sorte) des décisions qui ne correspondent pas à la conviction profonde, à la volonté et aux sentiments actuels réels de la majorité du Congrès. En laissant ses amis les plus intimes dans le Congrès, Gandhi peut bien espérer que l’Esprit qui lui paraît devoir régner continuera à manifester son influence et à inspirer l’assemblée mais d’une manière plus naturelle et plus saine que s’il restait là, lui-même, en chair et en os, et continuait à exercer une emprise due à une simple habitude ou à sa présence physique. Il y a, dans cette attitude sans équivalent ni explication purement politiques, quelque chose qui rappelle le mot du Christ : « Il faut que je vous quitte pour que l’Esprit puisse venir vers vous ». Tant que Gandhi serait là : on continuerait simplement à suivre Gandhi — sans le comprendre — et en se conduisant par ailleurs dans l’action politique de telle manière que le contraste ne pourrait apparaître que comme un mensonge. Il y a là quelque chose de délicat, de compliqué, mais de profondément justifié, bien que plusieurs des meilleurs amis de Gandhi aient eu d’abord beaucoup de peine à le comprendre. Quelques autres, au contraire, désiraient cette décision très vivement et très profondément avant que Gandhi l’ait prise. En se retirant, Gandhi — il n’est pas faux de le dire, — marque son sentiment que le Congrès n’accepte ses principes essentiels que du bout des lèvres et non du cœur. Mais son geste n’a pas purement ce sens négatif. En l’accomplissant, en laissant au Congrès les coudées plus franches, Gandhi estime qu’il y a plus de chances de voir le Congrès marcher réellement dans la direction voulue avec l’Esprit voulu.
Pendant la traversée déjà, nous apprenions, outre la retraite de Gandhi, une autre nouvelle plus curieuse. On savait que Gandhi demandait que les membres des conseils du Congrès, pour donner l’exemple, acceptent de s’astreindre à un certain travail manuel déterminé… Les gens à esprit politique pur (comme le journaliste Sastri) trouvaient cette proposition ridicule. « Le Congrès, disait-il, est un parti politique et non une société de culture morale ou religieuse. » Et l’impression de celui qui lisait les critiques était : « Donc on n’acceptera pas cette proposition et par conséquent Gandhi devra s’en aller ». En fait — et rien ne mesure mieux l’erreur qu’on commet en appliquant à ces choses l’échelle politique ordinaire : 1. Gandhi est parti — pour des raisons plus profondes qu’un incident de séance ou une mise en minorité, et 2. la mesure « impossible » a été acceptée.
On a beaucoup parlé de cette mesure. Pour nous, elle a une importance et une valeur particulières. Au moment où, de tous côtés, on nous dit : « Jamais vous ne pourrez travailler manuellement avec des coolies hindous… personne n’y comprendrait rien… » il se trouve que le parti représentant la vie nationale des Indes prend une décision ébouriffante, et dans une assemblée politique proclame précisément la vérité même que nous voulons, entre autres, marquer.
On précise : Gandhi se retire à Wardha et là, dans l’espace d’un mois, il espère mettre sur pied une organisation qui, en deux ans, doit transformer et reconstruire la vie économique des villages. On étudiera d’abord l’élevage du bétail et la fabrication des paniers etc.
Il est assez remarquable qu’en ignorant tout de cet effort, nous arrivions à ce moment précis en disant : « Envoyez-nous dans un village quelconque du Bihar pour y faire avec les paysans quoi que ce soit qui vous paraîtra utile », — sans la moindre notion que toute l’attention politique des Indes se trouvait, à la surprise des vieux routiers de la politique, tourner précisément autour de la même pointe. En tout cas, rien de plus facile de faire comprendre ce que nous voulons dans ce pays ; non seulement plus facile qu’en Perse ou en Égypte, mais infiniment plus facile que sur la place Saint-François à Lausanne. Tout cela est si naturel — que Joe et moi devons faire un effort pour nous étonner de nous trouver à Patna dans la chambre voisine de celle du chef du Parti national indien et d’avoir matin et soir sa gentille visite pour un moment de bavardage, comme si nous étions de très vieux amis.
J’arrête ma lettre net ici… On m’apprend subitement que la poste aérienne va partir…
Cordiales amitiés.
Votre Pierre Ceresole.
6 janvier 1935
Zeradai, dans la grande maison familiale de
Rajendra Prasad, dimanche 6 janvier.
J’écris ces lignes dans la vieille, grande maison indienne en pleine campagne, qui depuis cent cinquante ans abrite la famille de Rajendra Prasad, le président actuel du Congrès, dont je vous ai parlé bien souvent, et dont la photographie a été publiée récemment par un grand nombre de journaux européens. C’est la grande maison de campagne, typique du zamindar, — ici du bon zamindar ! Un seul étage. Les bâtiments entourent une vaste cour où se trouvent entassées les gerbes de riz fraîchement moissonné ; un chariot à bœufs, les bras en l’air, une vieille voiture à deux roues, peinte en noir, le nez dans la poussière, le puits avec le grand levier en bambou pour tirer le seau, quelques troncs d’arbres dispersés çà et là, et, sautillant au milieu de tout ça, les inévitables corbeaux ou « miner birds ». Ils piquent assidûment, près du puits, les quelques grains de riz restant dans quelques pots de terre attendant d’être lavés. Dans cette même cour, attachés le long d’un mur, des vaches et des bœufs, pas beaucoup plus gras que ceux qu’on voit dans le village.
Voilà la maison du chef actuel de la politique nationale hindoue. Simplicité « plus que romaine ». Chez Cincinnatus, le consul romain qu’on a été prendre à sa charrue, il y avait peut-être quelques ornements ; chez Rajendra, sauf quelques portraits en photo ou photo-chromo, les murs passés à la chaux ou peints en jaune clair, montent nus jusqu’au plafond élevé de cinq ou six mètres et supporté par un réseau de poutres noires. Austère simplicité. Plus que simplicité. Il faut s’y résigner,… tout est vieux, laid, fané, assez propre du reste, bien que Rajendra, trop bon, paraisse avoir autour de lui une bande de détestables serviteurs.
Le repas du soir que Rajendra nous fait avec sa bonne grâce et gentillesse souriantes, est bien la chose la plus extraordinaire que j’ai vue comme façon de servir un repas « entre amis ». À notre arrivée, Rajendra, en visite à quelques kilomètres chez une nièce malade, n’était pas encore rentré chez lui. On nous offre du thé, — très bon. J’en prends pour ne pas compliquer les affaires en demandant « mon lait » comme Mahatma les complique un peu avec son lait de chèvre. Quand R. rentre, on lui sert son repas indien spécial à cause de son régime de malade. Il le prend en ma présence. Sa maison est habituée à ce scandale. Trois quarts d’heure après, vers huit heures du soir, c’est mon tour : un repas indien terrifique par la froideur absolue de tout ce qui est servi. (Habitués à une température normalement accablante, les Hindous trouvent naturel, — et nous comprenons cela aussi en juin, — de manger froid tout ce que nous refusons d’avaler si ce n’est plus chaud.) Mais on n’apporte rien à manger pour Phanindra qui est avec moi. Cela ne m’étonne pas trop. Les serviteurs de Rajendra pensent sans doute que manger en présence d’un « hors-caste » européen — extravagance criminelle — est une spécialité de leur maître, et vont appeler P., tout à l’heure, à manger à part.
Zeradai, dans la grande maison familiale de
Rajendra Prasad, dimanche 6 janvier.
J’écris ces lignes dans la vieille, grande maison indienne en pleine campagne, qui depuis cent cinquante ans abrite la famille de Rajendra Prasad, le président actuel du Congrès, dont je vous ai parlé bien souvent, et dont la photographie a été publiée récemment par un grand nombre de journaux européens. C’est la grande maison de campagne, typique du zamindar, — ici du bon zamindar ! Un seul étage. Les bâtiments entourent une vaste cour où se trouvent entassées les gerbes de riz fraîchement moissonné ; un chariot à bœufs, les bras en l’air, une vieille voiture à deux roues, peinte en noir, le nez dans la poussière, le puits avec le grand levier en bambou pour tirer le seau, quelques troncs d’arbres dispersés çà et là, et, sautillant au milieu de tout ça, les inévitables corbeaux ou « miner birds ». Ils piquent assidûment, près du puits, les quelques grains de riz restant dans quelques pots de terre attendant d’être lavés. Dans cette même cour, attachés le long d’un mur, des vaches et des bœufs, pas beaucoup plus gras que ceux qu’on voit dans le village.
Voilà la maison du chef actuel de la politique nationale hindoue. Simplicité « plus que romaine ». Chez Cincinnatus, le consul romain qu’on a été prendre à sa charrue, il y avait peut-être quelques ornements ; chez Rajendra, sauf quelques portraits en photo ou photo-chromo, les murs passés à la chaux ou peints en jaune clair, montent nus jusqu’au plafond élevé de cinq ou six mètres et supporté par un réseau de poutres noires. Austère simplicité. Plus que simplicité. Il faut s’y résigner,… tout est vieux, laid, fané, assez propre du reste, bien que Rajendra, trop bon, paraisse avoir autour de lui une bande de détestables serviteurs.
Le repas du soir que Rajendra nous fait avec sa bonne grâce et gentillesse souriantes, est bien la chose la plus extraordinaire que j’ai vue comme façon de servir un repas « entre amis ». À notre arrivée, Rajendra, en visite à quelques kilomètres chez une nièce malade, n’était pas encore rentré chez lui. On nous offre du thé, — très bon. J’en prends pour ne pas compliquer les affaires en demandant « mon lait » comme Mahatma les complique un peu avec son lait de chèvre. Quand R. rentre, on lui sert son repas indien spécial à cause de son régime de malade. Il le prend en ma présence. Sa maison est habituée à ce scandale. Trois quarts d’heure après, vers huit heures du soir, c’est mon tour : un repas indien terrifique par la froideur absolue de tout ce qui est servi. (Habitués à une température normalement accablante, les Hindous trouvent naturel, — et nous comprenons cela aussi en juin, — de manger froid tout ce que nous refusons d’avaler si ce n’est plus chaud.) Mais on n’apporte rien à manger pour Phanindra qui est avec moi. Cela ne m’étonne pas trop. Les serviteurs de Rajendra pensent sans doute que manger en présence d’un « hors-caste » européen — extravagance criminelle — est une spécialité de leur maître, et vont appeler P., tout à l’heure, à manger à part.
Patna, Bihar et Orissa, 13 novembre.
En route pour le Bihar.
Ma lettre d’hier s’est trouvée brusquement arrêtée. Nous étions à peine débarqués à Bombay.
Après dîner, tournée d’affaires et d’emplettes en auto dans les rues affairées de Bombay, au milieu des passants en foule dense. C’est le contact No 2 de Joe avec son empire et la compression supplémentaire causée par notre Rolls-Royce (possédée par un Hindou !) parmi les sujets hindous de sa Majesté britannique, lui est manifestement très désagréable. Joe est un Anglais démocrate, et, invariable, il garde ici la même attitude et les mêmes sentiments que dans sa petite ville du Yorkshire, silencieux et bienveillant, non sans humour, mais absolument dépourvu de tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à l’orgueil nationaliste ou simplement national. C’est là — avec d’excellents autres traits — ce qui en fera un collaborateur extrêmement pré- cieux pour tout contact à prendre avec les Indiens. D’autre part, il n’y a dans son attitude rien d’amer ni d’agressif contre son gouvernement, nul désir de souligner les fautes des Anglais pour le plaisir de les souligner. Il ne vante jamais les qualités anglo-saxonnes mais les représente effectivement par sa simple manière d’être ou d’agir et semble d’ailleurs absolument inconscient de posséder ces qualités.
… L’heure du départ de Bombay approche. À la gare où l’automobile nous amène, nous trouvons encore le bon Ranchhoddas, le jeune étudiant-ingénieur hindou qui m’a si gentiment aidé lors de ma première expédition ici et qui est décidé à venir le plus tôt possible travailler avec nous. Il a fait sept heures de chemin de fer pour venir nous saluer et nous aider au passage. Je suis heureux de le trouver aussi profondément intéressé et plus résolu que jamais.
À la gare, mouvement d’hésitation du secrétaire de Bulabhai Desai lorsque, descendant de la Rolls-Royce, nous confirmons notre décision de nous embarquer en troisième classe. L’heure de la revanche pour l’humiliation subie en « seconda non economica » a sonné [1] Pour le prix de 18 fr. 70 (les prix ont leur éloquence) nous achetons, chacun, Joe et moi, le droit de parcourir 1650 kilomètres en 30 heures de voyage effectif dans le train le plus rapide des Indes — Calcutta mail, qui marche à 55 kilomètres à l’heure, vitesse commerciale, arrêts compris. Le départ est tout simplement glorieux… ! Quatre amis sont là pour nous souhaiter bon voyage. Le compartiment — très propre et agréable — dans lequel nous entrons, est à vrai dire bondé… mais deux minutes avant le départ, huit des occupants amenés par un voyageur ingénieux, sortent tous ensemble du wagon — et dans l’espace considérable qui devient libre ainsi, un des voyageurs hindous s’empresse encore, de déplacer son bagage, de manière que Joe et moi nous trouvons, chacun, en possession de plus d’espace qu’il ne nous en faut pour nous étendre absolument, à cent pour cent, sans contraction et recroquevillement d’aucune sorte sur nos matelas de voyage. De nouveau — et quoi que nous fassions — nous voilà embarqués de la manière la plus luxueuse… Jamais, il faut le dire tout de suite, je n’ai voyagé plus confortablement ni dormi mieux que pendant cette nuit du 5 au 6 novembre, et dans la nuit suivante, de 9 à 11 heures du soir, jusqu’à notre arrivée à Mughal-Sarai (10 kilomètres de Bénarès). Là, il fallait quitter le rapide de Calcutta et, après trois heures de salle d’attente, continuer de 3 h. 10 du matin à 6 h. 43, sur Patna.
Température délicieuse dans le wagon, — ni trop chaud ni trop froid — les souvenirs torrides de juin rendaient cette nouvelle expérience encore plus délicieuse.
Et le paysage normalement garni de verdure — au lieu de la terrible étendue grillée — semblait l’image du Paradis, bien que les villages continuassent, même en bonne saison, à paraître d’une pauvreté, d’une simplicité hypoparadisiaques… Nous passons par des endroits aux noms magnifiques : Itarsi, Sohagpur, Gadarvada, Jeebbulpore, Manikpur, Chheoki (à 35 milles de Allahabad), Mirzapur, Moghal Sarai… Il semble que notre troisième classe roule, tout enturbannée, le long d’un des vers ronflants de la « Légende des siècles ». Ces noms merveilleux couvrent à n’en pas douter des splendeurs extraordinaires mais il faut bien avouer que nous n’en voyons pas grand chose… Il faut laisser courir son imagination. À chacune de ces stations les crieurs et vendeurs annoncent leurs marchandises sur des notes variées. En voilà un qui crie : Gueerem Tchâ — Tchâ Gueerem, d’une voix absolument sépulcrale — comme si le : « Chaud thé — thé chaud » qu’il annonce était la liqueur la plus noire, la plus détestable, la plus funèbre qu’on puisse avoir à redouter.
Nous avons été si bien fournis par nos amis que, sans même faire encore usage de la précieuse caisse-cuisine emportée de Suisse, nous vivons entièrement sur nos provisions. Une tasse de thé suffit à les compléter. Nos compagnons de voyage sont gentils mais la conversation n’est pas très active et pour cause : le seul qui sache l’anglais profite de son voyage pour dormir positivement trente heures de suite.
Nous ne sommes plus très loin. Il s’agit de ne pas trop bien dormir et de ne pas manquer la station. Un magnifique lever de soleil sur des champs qui paraissent trempés d’eau, des villages particulièrement misérables, quelques paysans errant ça et là, une famille groupée autour d’un pauvre feu. Voici Dianpore ; plus que dix minutes ; nous plions bagages… et quelques instants plus tard, à 6 h. 45, nous voilà à Patna. Débarquement de tout notre matériel sur un quai où nous ne voyons d’abord aucun ami. Puis tout à coup apparition de nos amis du comité de secours ; Rajendra Prasad lui-même bien que très pris par l’asthme qui le gêne depuis plusieurs jours et accablé de travail par les séances du Congrès à Bombay, a tenu à venir lui-même nous attendre à la gare. Nous sommes chaleureusement reçus, et ramenés en auto au « Centre ». Plus encore que chez les amis Desai, je m’y sens chez moi. Je réoccupe mon ancienne chambre, avec Joe cette fois, à côté de celle où est descendu Gandhi en mai dernier et où demeure maintenant Rajendra Prasad.
En route pour le Bihar.
Ma lettre d’hier s’est trouvée brusquement arrêtée. Nous étions à peine débarqués à Bombay.
Après dîner, tournée d’affaires et d’emplettes en auto dans les rues affairées de Bombay, au milieu des passants en foule dense. C’est le contact No 2 de Joe avec son empire et la compression supplémentaire causée par notre Rolls-Royce (possédée par un Hindou !) parmi les sujets hindous de sa Majesté britannique, lui est manifestement très désagréable. Joe est un Anglais démocrate, et, invariable, il garde ici la même attitude et les mêmes sentiments que dans sa petite ville du Yorkshire, silencieux et bienveillant, non sans humour, mais absolument dépourvu de tout ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à l’orgueil nationaliste ou simplement national. C’est là — avec d’excellents autres traits — ce qui en fera un collaborateur extrêmement pré- cieux pour tout contact à prendre avec les Indiens. D’autre part, il n’y a dans son attitude rien d’amer ni d’agressif contre son gouvernement, nul désir de souligner les fautes des Anglais pour le plaisir de les souligner. Il ne vante jamais les qualités anglo-saxonnes mais les représente effectivement par sa simple manière d’être ou d’agir et semble d’ailleurs absolument inconscient de posséder ces qualités.
… L’heure du départ de Bombay approche. À la gare où l’automobile nous amène, nous trouvons encore le bon Ranchhoddas, le jeune étudiant-ingénieur hindou qui m’a si gentiment aidé lors de ma première expédition ici et qui est décidé à venir le plus tôt possible travailler avec nous. Il a fait sept heures de chemin de fer pour venir nous saluer et nous aider au passage. Je suis heureux de le trouver aussi profondément intéressé et plus résolu que jamais.
À la gare, mouvement d’hésitation du secrétaire de Bulabhai Desai lorsque, descendant de la Rolls-Royce, nous confirmons notre décision de nous embarquer en troisième classe. L’heure de la revanche pour l’humiliation subie en « seconda non economica » a sonné [1] Pour le prix de 18 fr. 70 (les prix ont leur éloquence) nous achetons, chacun, Joe et moi, le droit de parcourir 1650 kilomètres en 30 heures de voyage effectif dans le train le plus rapide des Indes — Calcutta mail, qui marche à 55 kilomètres à l’heure, vitesse commerciale, arrêts compris. Le départ est tout simplement glorieux… ! Quatre amis sont là pour nous souhaiter bon voyage. Le compartiment — très propre et agréable — dans lequel nous entrons, est à vrai dire bondé… mais deux minutes avant le départ, huit des occupants amenés par un voyageur ingénieux, sortent tous ensemble du wagon — et dans l’espace considérable qui devient libre ainsi, un des voyageurs hindous s’empresse encore, de déplacer son bagage, de manière que Joe et moi nous trouvons, chacun, en possession de plus d’espace qu’il ne nous en faut pour nous étendre absolument, à cent pour cent, sans contraction et recroquevillement d’aucune sorte sur nos matelas de voyage. De nouveau — et quoi que nous fassions — nous voilà embarqués de la manière la plus luxueuse… Jamais, il faut le dire tout de suite, je n’ai voyagé plus confortablement ni dormi mieux que pendant cette nuit du 5 au 6 novembre, et dans la nuit suivante, de 9 à 11 heures du soir, jusqu’à notre arrivée à Mughal-Sarai (10 kilomètres de Bénarès). Là, il fallait quitter le rapide de Calcutta et, après trois heures de salle d’attente, continuer de 3 h. 10 du matin à 6 h. 43, sur Patna.
Température délicieuse dans le wagon, — ni trop chaud ni trop froid — les souvenirs torrides de juin rendaient cette nouvelle expérience encore plus délicieuse.
Et le paysage normalement garni de verdure — au lieu de la terrible étendue grillée — semblait l’image du Paradis, bien que les villages continuassent, même en bonne saison, à paraître d’une pauvreté, d’une simplicité hypoparadisiaques… Nous passons par des endroits aux noms magnifiques : Itarsi, Sohagpur, Gadarvada, Jeebbulpore, Manikpur, Chheoki (à 35 milles de Allahabad), Mirzapur, Moghal Sarai… Il semble que notre troisième classe roule, tout enturbannée, le long d’un des vers ronflants de la « Légende des siècles ». Ces noms merveilleux couvrent à n’en pas douter des splendeurs extraordinaires mais il faut bien avouer que nous n’en voyons pas grand chose… Il faut laisser courir son imagination. À chacune de ces stations les crieurs et vendeurs annoncent leurs marchandises sur des notes variées. En voilà un qui crie : Gueerem Tchâ — Tchâ Gueerem, d’une voix absolument sépulcrale — comme si le : « Chaud thé — thé chaud » qu’il annonce était la liqueur la plus noire, la plus détestable, la plus funèbre qu’on puisse avoir à redouter.
Nous avons été si bien fournis par nos amis que, sans même faire encore usage de la précieuse caisse-cuisine emportée de Suisse, nous vivons entièrement sur nos provisions. Une tasse de thé suffit à les compléter. Nos compagnons de voyage sont gentils mais la conversation n’est pas très active et pour cause : le seul qui sache l’anglais profite de son voyage pour dormir positivement trente heures de suite.
Nous ne sommes plus très loin. Il s’agit de ne pas trop bien dormir et de ne pas manquer la station. Un magnifique lever de soleil sur des champs qui paraissent trempés d’eau, des villages particulièrement misérables, quelques paysans errant ça et là, une famille groupée autour d’un pauvre feu. Voici Dianpore ; plus que dix minutes ; nous plions bagages… et quelques instants plus tard, à 6 h. 45, nous voilà à Patna. Débarquement de tout notre matériel sur un quai où nous ne voyons d’abord aucun ami. Puis tout à coup apparition de nos amis du comité de secours ; Rajendra Prasad lui-même bien que très pris par l’asthme qui le gêne depuis plusieurs jours et accablé de travail par les séances du Congrès à Bombay, a tenu à venir lui-même nous attendre à la gare. Nous sommes chaleureusement reçus, et ramenés en auto au « Centre ». Plus encore que chez les amis Desai, je m’y sens chez moi. Je réoccupe mon ancienne chambre, avec Joe cette fois, à côté de celle où est descendu Gandhi en mai dernier et où demeure maintenant Rajendra Prasad.
Patna, mercredi 14 novembre.
Au bord du Gange.
La période électorale a été ici très pittoresque et animée, mais plus animée encore la vieille fête hindoue de « Choth » où les fidèles Hindous se rendent par petits groupes accompagnés de tambours et de trompettes sur les bords du Gange pour leur dévotion. De bonne heure le matin du 13 novembre, avant le lever du soleil, toute la ville n’était qu’un vaste ronflement de tambours avec petites phrases monotones courtes et toujours les mêmes lancées par les trompettes — et j’ai accompagné l’un des groupes sur la berge du Gange au « Ghat » qui se trouve derrière la caserne de la police militaire. Deux ou trois mille personnes se pressaient au bord de l’eau… la plupart se regardant les unes les autres plutôt qu’occupées d’un culte véritable. Un petit nombre seulement nageaient ou plongeaient. On descendait des corbeilles de fruits en offrande au Gange… mais après être descendu jusqu’au bord de l’eau elles remontaient la berge et les fruits étaient consommés, je suppose, par ceux qui les avaient apportés. Sur une sorte d’estrade un vieil Hindou à lunettes tenait un livre à la main et silencieusement paraissait bénir la foule de gestes onctueux dont les voisins semblaient se soucier assez peu. Je pensais qu’au moment du lever du soleil ce personnage hiératique prononcerait un discours ou lirait ses formules. Mais il est resté muet jusqu’au bout, jusqu’au moment où le soleil s’étant levé assez haut dans le ciel, la foule commençait à se dissiper. Quand j’ai demandé l’explication de cette attitude à un ami hindou du Centre… celui-ci a émis assez irrévérencieusement l’opinion que — peut-être bien — le personnage qui m’avait frappé ne savait pas lire et que livre et lunettes n’étaient avec les gestes bénisseurs qu’une habile manière de se donner de l’importance et de se faire remarquer. J’en ai été un peu déçu. J’ai remarqué un vieillard à cheveux et favoris blancs qui faisait les grands gestes sacrés, les bras levés vers le ciel et s’inclinant à plusieurs reprises. Les jeunes gens se tenaient plutôt au haut de la berge en spectateurs et sans prendre part active à la cérémonie. L’ensemble n’en était pas moins étonnamment pittoresque avec les saris de couleurs variées portés par les femmes. J’en ai remarque une en sari grenat portant un enfant au corps sculptural sur sa hanche ; avec les bracelets d’argent que la mère et l’enfant portaient, cela faisait un tableau parfait — la perfection des formes, grâce et couleurs — entrevue dans un éclair. Tous ces gens ont l’air si paisible et gentil, seulement trop passifs, trop résignés. Étrange émotion devant ce culte plusieurs fois millénaire qui appelle toujours cette race aux mêmes gestes. Voici une procession bizarre qui arrive avec ses trompettes et une idole légèrement construite, portée sur un plateau sur les épaules de quelques hommes. Maintenant le silence est revenu dans la ville — tambours et trompettes ont cessé.
Mais voici l’heure du départ pour Muzaffarpur et du courrier.
Affectueux messages à tous
Pierre.
Au bord du Gange.
La période électorale a été ici très pittoresque et animée, mais plus animée encore la vieille fête hindoue de « Choth » où les fidèles Hindous se rendent par petits groupes accompagnés de tambours et de trompettes sur les bords du Gange pour leur dévotion. De bonne heure le matin du 13 novembre, avant le lever du soleil, toute la ville n’était qu’un vaste ronflement de tambours avec petites phrases monotones courtes et toujours les mêmes lancées par les trompettes — et j’ai accompagné l’un des groupes sur la berge du Gange au « Ghat » qui se trouve derrière la caserne de la police militaire. Deux ou trois mille personnes se pressaient au bord de l’eau… la plupart se regardant les unes les autres plutôt qu’occupées d’un culte véritable. Un petit nombre seulement nageaient ou plongeaient. On descendait des corbeilles de fruits en offrande au Gange… mais après être descendu jusqu’au bord de l’eau elles remontaient la berge et les fruits étaient consommés, je suppose, par ceux qui les avaient apportés. Sur une sorte d’estrade un vieil Hindou à lunettes tenait un livre à la main et silencieusement paraissait bénir la foule de gestes onctueux dont les voisins semblaient se soucier assez peu. Je pensais qu’au moment du lever du soleil ce personnage hiératique prononcerait un discours ou lirait ses formules. Mais il est resté muet jusqu’au bout, jusqu’au moment où le soleil s’étant levé assez haut dans le ciel, la foule commençait à se dissiper. Quand j’ai demandé l’explication de cette attitude à un ami hindou du Centre… celui-ci a émis assez irrévérencieusement l’opinion que — peut-être bien — le personnage qui m’avait frappé ne savait pas lire et que livre et lunettes n’étaient avec les gestes bénisseurs qu’une habile manière de se donner de l’importance et de se faire remarquer. J’en ai été un peu déçu. J’ai remarqué un vieillard à cheveux et favoris blancs qui faisait les grands gestes sacrés, les bras levés vers le ciel et s’inclinant à plusieurs reprises. Les jeunes gens se tenaient plutôt au haut de la berge en spectateurs et sans prendre part active à la cérémonie. L’ensemble n’en était pas moins étonnamment pittoresque avec les saris de couleurs variées portés par les femmes. J’en ai remarque une en sari grenat portant un enfant au corps sculptural sur sa hanche ; avec les bracelets d’argent que la mère et l’enfant portaient, cela faisait un tableau parfait — la perfection des formes, grâce et couleurs — entrevue dans un éclair. Tous ces gens ont l’air si paisible et gentil, seulement trop passifs, trop résignés. Étrange émotion devant ce culte plusieurs fois millénaire qui appelle toujours cette race aux mêmes gestes. Voici une procession bizarre qui arrive avec ses trompettes et une idole légèrement construite, portée sur un plateau sur les épaules de quelques hommes. Maintenant le silence est revenu dans la ville — tambours et trompettes ont cessé.
Mais voici l’heure du départ pour Muzaffarpur et du courrier.
Affectueux messages à tous
Pierre.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Quiz
Voir plus
Stefan Zweig ou Thomas Mann
La Confusion des sentiments ?
Stefan Zweig
Thomas Mann
10 questions
60 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur ce livre60 lecteurs ont répondu