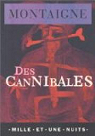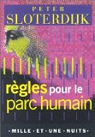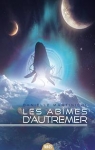Bernard GuerrienLa théorie économique néo-classique tome 2 sur 2
/5 1 notes
La place accordée aux mathématiques dans les présentations usuelles de la théorie néoclassique la rend généralement inaccessible au non initié et en masque les principaux enjeux. Ce livre rigoureux montre qu'il est possible de présenter les présupposés, les hypothèses, la démarche et la structure de la théorie néoclassique d'une façon accessible sans recourir à une formal... >Voir plus
/5 1 notes
Résumé :
La place accordée aux mathématiques dans les présentations usuelles de la théorie néoclassique la rend généralement inaccessible au non initié et en masque les principaux enjeux. Ce livre rigoureux montre qu'il est possible de présenter les présupposés, les hypothèses, la démarche et la structure de la théorie néoclassique d'une façon accessible sans recourir à une formal... >Voir plus
étiquettes
Ajouter des étiquettes
Critiques, Analyses et Avis (1)
Ajouter une critique
Présentation claire de la théorie des jeux, bien rédigée, mais un peu scolaire et peu critique sur le sens même des énoncés proposés. Il ressort que l'équilibre de Nash n'est pas un équilibre, que le dilemme des prisonniers n'est pas un dilemme et que la théorie des jeux n'a pas une théorie et ne concerne pas (plus ?) les jeux.
Citations et extraits (15)
Voir plus
Ajouter une citation
La façon dont l'équilibre de Nash est habituellement défini, notamment dans les manuels, rappelle toutefois combien le fait de parler d'équilibre peut être source d'ambiguïté. Cet "équilibre" est en effet présenté comme une combinaison de stratégies telle que chaque joueur maximise son gain 𝑒́𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒́ les stratégies des autres joueurs. Il est courant aussi de lire qu'à un équilibre de Nash, la stratégie de chaque joueur est la 𝑚𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑟𝑒́𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 aux stratégies des autres. Ces deux définitions donnent à penser que chaque joueur fait son choix 𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 - comme le suggèrent les expressions "étant donné" ou "meilleure réponse à". L'équilibre serait ainsi l'aboutissement d'u processus dans lequel les joueurs réagissent successivement aux annonces des autres Ce processus a toutefois trois inconvénients majeurs D'abord, pour qu'il s'amorce, il fut se donner des stratégies "de départ" pour tous les joueurs sauf un (celui qui choisit sa "meilleure réponse" à ces stratégies). Ensuite, il faut désigner le premier joueur, puis préciser l'ordre d’intervention des suivants. Enfin, il faut supposer qu'il converge - ce qui est loin d'aller de soi. La forme des équilibres, point d'aboutissement de ce processus (s'il converge), dépend donc de facteurs tels que les conditions initiales et l'ordre d'intervention des joueurs. Elle es, comme eux, largement arbitraire.
Chacun maximisant son gain en prévoyant le choix des autres, 𝑢𝑛 𝑒́𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑁𝑎𝑠ℎ 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒́𝑔𝑖𝑒𝑠 (𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑢𝑟) 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑐ℎ𝑎𝑐𝑢𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒́𝑔𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑖𝑠𝑖�� 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑒́𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑒𝑟𝑜𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠. Le fait que les prévisions sont correctes est essentiel dans la définition de l'équilibre de Nash ; on peut d'ailleurs considérer que celui-ci relève de 𝑙'𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑒́𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 : chacun, en choisissant une stratégie d'un équilibre de Nash en pensant que les autres en feront autant, "réalise" ainsi l'équilibre auquel il s'attend.
Reste ensuite à apprécier l'"utilité sociale" de la théorie des jeux, qui justifierait son enseignement et les moyens qui lui sont consacrés - essentiellement, en finançant le temps passé par des universitaires à propose de nouvelles histoires où à finasser les anciennes. Sur un plan pédagogique, son principal intérêt tient à sa 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒. Devant tout modèle qui cherche à représenter des choix en interaction, le théoricien des jeu commence par poser des questions. Quelles règles gouvernent les choix et leurs interactions ? Quelles sont les institutions qui les mettent en place ? De quelle information dispose chacun ? 𝑄𝑢𝑖𝑑 de ses croyances ?
Une définition très répandue est que l’équilibre de Nash est tel que chaque agent choisit sa stratégie n "prenant comme donnée la stratégie des autres". Mais cette définition est ambiguë, puisqu'elle donne à penser que le choix est fait 𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑣𝑢 𝑐𝑒 𝑞𝑢'𝑜𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠, ce qui est faux (et même un non sens), tout en pouvant faire croire à l'existence d'un processus (je vois ce qu'ont fait les autres et modifie mon choix en conséquence, ce qui entraîne de leur part une modification de leur choix, et ainsi de suite).
La frontière entre ces deux groupes [Mathématiciens et conteurs d’histoire] est toutefois floue. Les mathématiciens tombent parfois dans les travers des conteurs d’histoire, qui peuvent de leur côté traduire en symboles mathématiques plus ou moins compliqués. La confusion est alors à son comble, mathématiques et intuition faisant rarement bon ménage dans le cas de la théorie des jeux.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Bernard Guerrien (11)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Pas de sciences sans savoir (quiz complètement loufoque)
Présent - 1ère personne du pluriel :
Nous savons.
Nous savonnons (surtout à Marseille).
10 questions
414 lecteurs ont répondu
Thèmes :
science
, savoir
, conjugaison
, humourCréer un quiz sur ce livre414 lecteurs ont répondu