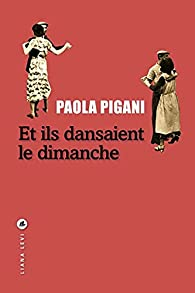Critiques filtrées sur 4 étoiles
Un jour de 1929, une jeune Hongroise, Szonja, arrive en France. C'est à Vaux-en-Velin, dans une usine de viscose qu'elle croit pouvoir échapper à sa vie de paysanne.
Au départ, elle dispose d'une chambre chez les soeurs. Doit subir les maigres repas, les longues heures de travail à l'atelier poluées par les vapeurs chimiques. Elle y rencontre des ouvriers italiens soumis au même traitement.
Tous ont un rêve mais doivent courber le dos devant les chefs et maintenir la cadence infernale. Tout cela pour un salaire de misère.
Leur plaisir est d'aller danser le dimanche au bord de la rivière. C'est là que se nouent les liens et naissent les histoires d'amour. L'alcool et les violences conjugales sont fréquentes.
La crise de 1929 apporte son lot de souffrance et les licenciements commencent. C'est ainsi que les ouvriers commencent à manifester leur colère et demandent plus de considération.
Un roman réaliste sur cette époque difficile. Paola Pigani apporte un côté romanesque et sensible à ce témoignage du passé. Les personnages sont touchants et attachants.
Au départ, elle dispose d'une chambre chez les soeurs. Doit subir les maigres repas, les longues heures de travail à l'atelier poluées par les vapeurs chimiques. Elle y rencontre des ouvriers italiens soumis au même traitement.
Tous ont un rêve mais doivent courber le dos devant les chefs et maintenir la cadence infernale. Tout cela pour un salaire de misère.
Leur plaisir est d'aller danser le dimanche au bord de la rivière. C'est là que se nouent les liens et naissent les histoires d'amour. L'alcool et les violences conjugales sont fréquentes.
La crise de 1929 apporte son lot de souffrance et les licenciements commencent. C'est ainsi que les ouvriers commencent à manifester leur colère et demandent plus de considération.
Un roman réaliste sur cette époque difficile. Paola Pigani apporte un côté romanesque et sensible à ce témoignage du passé. Les personnages sont touchants et attachants.
1929. Une fresque historique et sociale sur les émigrés polonais, italiens, hongrois venus travailler dans les usines textiles de Lyon.
C'est l'histoire de Szonja, une jeune hongroise qui fuit la vie paysanne de son pays pour les lumières de la ville, pour le travail à la chaîne.
J'ai retrouvé l'ambiance des temps modernes de Chaplin, avec la force des mots en plus.
La force de la déshumanisation.
« Tant pis, si elle n'a pas de contour, si elle flotte, si elle n'est rien, ni personne. C'est ce qu'on attend d'elle, ne pas avoir vraiment d'idée sur l'après, l'au-delà de l'usine. Elle s'en tient juste à ses besoins élémentaires comme tous ceux qui n'ont qu'une vie brute avec juste assez de bonne volonté pour se maintenir sur le fil tendu entre la faim, la soif, la peur de ne plus être à l'abri, plus aimée de personne, de n'avoir plus d'origine. »
L'auteure évoque aussi les accidents de travail :
« Ses mains ont été brulées. On évite d'évoquer cet événement. Les mots « accidents du travail » sont écartés du vocabulaire. Dans leurs rapports hebdomadaires, les chefs préfèrent écrire « maladresse », « erreur d'inattention », imprudence ». L'épouse de l'homme accidenté a été embauchée afin que le couple garde son logement. »
Seul moment de répit, où ils s'oublient dans le bal du dimanche
« Tous enchaînent la danse de l'oubli. Des corps radieux dans des corsages de misère. Leur dimanche ne sera qu'une poignée d'heures, une petite suée de gaité sous les aisselles et sur le front. »
Un récit qui rappelle des migrations actuelles et qui rappelle aussi que rien n'a changé. Autres migrants, mêmes conditions de vie.
C'est l'histoire de Szonja, une jeune hongroise qui fuit la vie paysanne de son pays pour les lumières de la ville, pour le travail à la chaîne.
J'ai retrouvé l'ambiance des temps modernes de Chaplin, avec la force des mots en plus.
La force de la déshumanisation.
« Tant pis, si elle n'a pas de contour, si elle flotte, si elle n'est rien, ni personne. C'est ce qu'on attend d'elle, ne pas avoir vraiment d'idée sur l'après, l'au-delà de l'usine. Elle s'en tient juste à ses besoins élémentaires comme tous ceux qui n'ont qu'une vie brute avec juste assez de bonne volonté pour se maintenir sur le fil tendu entre la faim, la soif, la peur de ne plus être à l'abri, plus aimée de personne, de n'avoir plus d'origine. »
L'auteure évoque aussi les accidents de travail :
« Ses mains ont été brulées. On évite d'évoquer cet événement. Les mots « accidents du travail » sont écartés du vocabulaire. Dans leurs rapports hebdomadaires, les chefs préfèrent écrire « maladresse », « erreur d'inattention », imprudence ». L'épouse de l'homme accidenté a été embauchée afin que le couple garde son logement. »
Seul moment de répit, où ils s'oublient dans le bal du dimanche
« Tous enchaînent la danse de l'oubli. Des corps radieux dans des corsages de misère. Leur dimanche ne sera qu'une poignée d'heures, une petite suée de gaité sous les aisselles et sur le front. »
Un récit qui rappelle des migrations actuelles et qui rappelle aussi que rien n'a changé. Autres migrants, mêmes conditions de vie.
Quand on est jeune et jolie, l'on rêve d'autre chose que de vivre la même vie étriquée que ses parents et grands-parents, une vie de paysans hongrois. C'est pourquoi quand des recruteurs viennent proposer aux villageois un travail dans une filature de viscose en France, Szonja et sa cousine signent immédiatement. Quel sera leur avenir au bout de ce long voyage en train ? Que vont-elles trouver à Vaulx en Vélin ? L'argent ? L'amour ?
Mais c'est une vie de labeur qui les attend au milieu d'autres immigrés. Des italiens, des polonais, des hongrois qui partagent avec elles les dures journées de travail, la vie à l'internat … Les français, eux, ne veulent pas travailler dans les vapeurs toxiques de cette usine où beaucoup tombent malades.
Vont-elles s'adapter ? Rentrer au pays ? Elle-même s'interroge :« Faudra-t-il qu'elle reste dans cette vie en noir et blanc que rien n'éclaire, ni ne réchauffe ? ».
Les amitiés se créent entre ouvriers et ouvrières de toutes nationalités, la misère rapproche. Les pique-niques à la campagne et les bals du dimanche permettent de survivre aux dures journées à l'usine. La solidarité rend plus douce la vie à l'internat ou à la cité ouvrière où certains noient leur désespoir dans l'alcool.
L'auteure nous entraine dans le monde ouvrier des années 30, dans ce pan de l'histoire que nous connaissons peu. le livre est bien documenté et c'est une photographie haute en couleur que nous livre Paola Pigani : une photographie du monde ouvrier lyonnais, de ses luttes pour une vie décente, de ses grèves jusqu'à l'avènement du front populaire. Elle s'inscrit complètement dans la lignée du courant réaliste du 19eme siècle.
J'ai eu un véritable coup de coeur pour ce roman qui nous offre une réalité brute sans fioriture et que j'imagine très bien adapté au cinéma.
Mais c'est une vie de labeur qui les attend au milieu d'autres immigrés. Des italiens, des polonais, des hongrois qui partagent avec elles les dures journées de travail, la vie à l'internat … Les français, eux, ne veulent pas travailler dans les vapeurs toxiques de cette usine où beaucoup tombent malades.
Vont-elles s'adapter ? Rentrer au pays ? Elle-même s'interroge :« Faudra-t-il qu'elle reste dans cette vie en noir et blanc que rien n'éclaire, ni ne réchauffe ? ».
Les amitiés se créent entre ouvriers et ouvrières de toutes nationalités, la misère rapproche. Les pique-niques à la campagne et les bals du dimanche permettent de survivre aux dures journées à l'usine. La solidarité rend plus douce la vie à l'internat ou à la cité ouvrière où certains noient leur désespoir dans l'alcool.
L'auteure nous entraine dans le monde ouvrier des années 30, dans ce pan de l'histoire que nous connaissons peu. le livre est bien documenté et c'est une photographie haute en couleur que nous livre Paola Pigani : une photographie du monde ouvrier lyonnais, de ses luttes pour une vie décente, de ses grèves jusqu'à l'avènement du front populaire. Elle s'inscrit complètement dans la lignée du courant réaliste du 19eme siècle.
J'ai eu un véritable coup de coeur pour ce roman qui nous offre une réalité brute sans fioriture et que j'imagine très bien adapté au cinéma.
L'histoire se passe au début des année 1930 à Vaulx en Velin dans la banlieue Lyonnaise. Des hommes et des femmes arrivent de toute l'Europe pour travailler dans des usines en France. C'est le cas de Szonja - jeune hongroise - qui débarque avec sa cousine et des compatriotes. On découvre avec elle, les conditions de travail, les contacts permanents avec l'acide, les accidents, les morts du travail, la paye de misère, les amendes pour un oui ou pour un non, le patronat, le rôle de l'église et des curés. Et puis, il y a les prises de consciences des travailleurs. les regroupements, les syndicats, le front populaire de 1936 avec les deux semaines de congés payés, la semaine de 40 heures... Il y a aussi la découverte de l'amour, les rencontres, les bals du dimanche, les joies de peu mais les joies quand même.
Il y a tout cela dans cette histoire du monde ouvrier de cette époque à côté du canal de Jonage. Une réalité que l'on imaginerait plus ancienne mais qui n'est pas si vieille que cela. Un livre fort et militant qui reste encore actuel sur certains points notamment le salaire des femmes. Il y a encore du boulot pour améliorer les conditions de travail.
Livre conseillé par Jean Marc de la librairie le cadran lunaire à Mâcon - www.cadran-lunaire.fr
Il y a tout cela dans cette histoire du monde ouvrier de cette époque à côté du canal de Jonage. Une réalité que l'on imaginerait plus ancienne mais qui n'est pas si vieille que cela. Un livre fort et militant qui reste encore actuel sur certains points notamment le salaire des femmes. Il y a encore du boulot pour améliorer les conditions de travail.
Livre conseillé par Jean Marc de la librairie le cadran lunaire à Mâcon - www.cadran-lunaire.fr
Szonja, une jeune hongroise calme et réservée ayant grandi à la ferme, et Marieka sa cousine, ont pris, un matin de 1929, un aller-simple Budapest-Lyon où les attendent désormais un nouveau destin, celui d'ouvrières d'une usine de viscose en France, à Vaulx-en-Velin. Une nouvelle vie les attend, celle de femmes immigrées dans une cité ouvrière au moment de la grande et terrible crise de 29.
Je me suis rapidement attachée à Szonja, cette jeune femme de vingt ans, taiseuse, facile à vivre, une suiveuse plutôt qu'une meneuse, qui est pourtant capable de quitter sa famille, son pays pour partir sans rien, vers un avenir inconnu et très incertain, à une époque où fermer la porte de la maison familiale signifiait souvent dire adieu aux siens pour…toujours. Pas d'internet et d'apéritifs en ligne sur zoom !
Paola Pigani a choisi comme porte d'entrée dans son récit –écrit de façon chronologique– la porte féminine. Ces héroïnes courageuses et méritantes sont bien sûr accompagnées d'hommes, mais c'est à travers leur regard de filles que l'autrice a voulu nous plonger dans l'histoire de l'industrie des années 30.
Notre héroïne se met donc consciemment en route vers un avenir qu'elle espère meilleur. Pourtant, à part cet acte de départ qu'elle a posé, elle subit plutôt qu'elle n'agit. Elle dit même « nous avons la volonté, la volonté du contentement, juste du contentement ». La hiérarchie est claire sur les attentes envers ces ouvrières : « on n'attend d'elles ni preuves d'intelligence, ni esprit d'initiative. »
Elles sont embauchées pour travailler dur dans des conditions atroces, sans aucune sécurité, ni de l'emploi, ni de salaire, ni même de protections quant à l'inhalation, aux intoxications ou aux brûlures dues aux produits chimiques, nécessaires à la transformation de la pâte de bois qui deviendra la cellulose, à partir de laquelle les femmes fabriqueront du fil.
Leurs salaires sont de loin inférieurs à ceux des hommes. Cette évidence résonne toujours à nos oreilles, comme un vieil adage, comme si nous avions réglé en un siècle nombre d'injustice mais que celle-ci restait le dernier rempart d'une société machiste. Hommes et femmes employés de la Sase, leur usine, viennent de nombreux pays et se mettent à parler entre eux une langue colorée, métissée. Szonja lie une forte amitié avec l'italienne Elsa, extravertie, gaie, chaleureuse.
Six jours sur sept, les ouvriers triment, les femmes sont logées dans un foyer tenu par des religieuses, l'office religieux est plus que conseillé, les brimades et punitions sont le menu quotidien. Mais le septième jour… leur appartient. Szonja cherchera d'abord à se ressourcer seule, mais rapidement elle partagera les moments simples et vrais avec les autres, au bord de la rivière, à piqueniquer, danser, rire et jouer. « C'est la loi du dimanche : marcher, respirer, dormir, aimer à son aise ».
Rien ne viendra entacher cette loi, pas même la terrible crise de 29 et les licenciements, qui dès 1931 toucheront d'abord les étrangers, les femmes, et feront d'eux des travailleurs en « chômage partiel », non rémunérés !
Je dirais de ce livre qu'il raconte des vies dures…oui mais ! Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. La vie ne peut être un ascenseur vers le haut ou un toboggan vers le bas.
D'une part, l'ambiance lourde, pesante, instable due au fascisme grandissant, à une guerre que l'on sent menacer, à une pauvreté du prolétariat. D'autre part, le moment présent que ces gens acceptent de vivre, sans penser en boucle à leur passé et sans spéculer sur un futur dont ils n'ont aucune idée. Ce qui les sauve est donc leur état d'esprit, leur capacité à vivre « ici et maintenant ». J'ai pris conscience à travers cette lecture que le petit nombre d'entre eux qui ne parvient pas à vivre dans l'instant présent ne fait pas de vieux os ! Aujourd'hui, nous parlons de burn-out, conséquence, entre autres, d'une incapacité à vivre le présent…
Paola Pigani nous instruit dans ce livre. Elle nous fait vivre la naissance du front populaire. Les personnages seront de cette lutte, et nous, lecteurs, avec eux.
Je m'attendais à trouver dans ce livre une forte intrigue, concernant les personnages, mais j'y ai trouvé en fait le rythme du quotidien. J'ai compris que l'histoire d'un seul ou d'une seule d'entre eux n'était pas au coeur du livre. C'est le destin des ouvriers, le destin des femmes, le destin des étrangers, le destin d'un peuple entier qu'a voulu porter Paola Pigani et non l'histoire romancée d'une femme.
Si je n'avais qu'une phrase pour résumer ce livre, elle serait : du combat pour la subsistance au combat pour la dignité, avec pour alliés la fraternité journalière, les petites joies simples et vraies, l'audace et le courage d'avancer.
Je n'ai pas eu LE coup de coeur mais l'envie d'en découvrir plus de Paola Pigani.
Je me suis rapidement attachée à Szonja, cette jeune femme de vingt ans, taiseuse, facile à vivre, une suiveuse plutôt qu'une meneuse, qui est pourtant capable de quitter sa famille, son pays pour partir sans rien, vers un avenir inconnu et très incertain, à une époque où fermer la porte de la maison familiale signifiait souvent dire adieu aux siens pour…toujours. Pas d'internet et d'apéritifs en ligne sur zoom !
Paola Pigani a choisi comme porte d'entrée dans son récit –écrit de façon chronologique– la porte féminine. Ces héroïnes courageuses et méritantes sont bien sûr accompagnées d'hommes, mais c'est à travers leur regard de filles que l'autrice a voulu nous plonger dans l'histoire de l'industrie des années 30.
Notre héroïne se met donc consciemment en route vers un avenir qu'elle espère meilleur. Pourtant, à part cet acte de départ qu'elle a posé, elle subit plutôt qu'elle n'agit. Elle dit même « nous avons la volonté, la volonté du contentement, juste du contentement ». La hiérarchie est claire sur les attentes envers ces ouvrières : « on n'attend d'elles ni preuves d'intelligence, ni esprit d'initiative. »
Elles sont embauchées pour travailler dur dans des conditions atroces, sans aucune sécurité, ni de l'emploi, ni de salaire, ni même de protections quant à l'inhalation, aux intoxications ou aux brûlures dues aux produits chimiques, nécessaires à la transformation de la pâte de bois qui deviendra la cellulose, à partir de laquelle les femmes fabriqueront du fil.
Leurs salaires sont de loin inférieurs à ceux des hommes. Cette évidence résonne toujours à nos oreilles, comme un vieil adage, comme si nous avions réglé en un siècle nombre d'injustice mais que celle-ci restait le dernier rempart d'une société machiste. Hommes et femmes employés de la Sase, leur usine, viennent de nombreux pays et se mettent à parler entre eux une langue colorée, métissée. Szonja lie une forte amitié avec l'italienne Elsa, extravertie, gaie, chaleureuse.
Six jours sur sept, les ouvriers triment, les femmes sont logées dans un foyer tenu par des religieuses, l'office religieux est plus que conseillé, les brimades et punitions sont le menu quotidien. Mais le septième jour… leur appartient. Szonja cherchera d'abord à se ressourcer seule, mais rapidement elle partagera les moments simples et vrais avec les autres, au bord de la rivière, à piqueniquer, danser, rire et jouer. « C'est la loi du dimanche : marcher, respirer, dormir, aimer à son aise ».
Rien ne viendra entacher cette loi, pas même la terrible crise de 29 et les licenciements, qui dès 1931 toucheront d'abord les étrangers, les femmes, et feront d'eux des travailleurs en « chômage partiel », non rémunérés !
Je dirais de ce livre qu'il raconte des vies dures…oui mais ! Rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. La vie ne peut être un ascenseur vers le haut ou un toboggan vers le bas.
D'une part, l'ambiance lourde, pesante, instable due au fascisme grandissant, à une guerre que l'on sent menacer, à une pauvreté du prolétariat. D'autre part, le moment présent que ces gens acceptent de vivre, sans penser en boucle à leur passé et sans spéculer sur un futur dont ils n'ont aucune idée. Ce qui les sauve est donc leur état d'esprit, leur capacité à vivre « ici et maintenant ». J'ai pris conscience à travers cette lecture que le petit nombre d'entre eux qui ne parvient pas à vivre dans l'instant présent ne fait pas de vieux os ! Aujourd'hui, nous parlons de burn-out, conséquence, entre autres, d'une incapacité à vivre le présent…
Paola Pigani nous instruit dans ce livre. Elle nous fait vivre la naissance du front populaire. Les personnages seront de cette lutte, et nous, lecteurs, avec eux.
Je m'attendais à trouver dans ce livre une forte intrigue, concernant les personnages, mais j'y ai trouvé en fait le rythme du quotidien. J'ai compris que l'histoire d'un seul ou d'une seule d'entre eux n'était pas au coeur du livre. C'est le destin des ouvriers, le destin des femmes, le destin des étrangers, le destin d'un peuple entier qu'a voulu porter Paola Pigani et non l'histoire romancée d'une femme.
Si je n'avais qu'une phrase pour résumer ce livre, elle serait : du combat pour la subsistance au combat pour la dignité, avec pour alliés la fraternité journalière, les petites joies simples et vraies, l'audace et le courage d'avancer.
Je n'ai pas eu LE coup de coeur mais l'envie d'en découvrir plus de Paola Pigani.
L'écriture est assez lourde et fatiguante mais l'intention de choisir un thème si important est louable.
La description des conditions de travail est précise et intéressante, mais presque didactique à mon avis, comme la narration des mouvements de grève qui ont précédé la signature des accords de Matignon.
L'histoire de la protagoniste reste noyée entre l'idée d'un roman et la glissade vers un descriptif d'un manuel d'histoire.
Reste touchante la sensation des ouvriers qui ont traversé ce chapitre de vie si important et malheureusement pas assez connu aujourd'hui.
La description des conditions de travail est précise et intéressante, mais presque didactique à mon avis, comme la narration des mouvements de grève qui ont précédé la signature des accords de Matignon.
L'histoire de la protagoniste reste noyée entre l'idée d'un roman et la glissade vers un descriptif d'un manuel d'histoire.
Reste touchante la sensation des ouvriers qui ont traversé ce chapitre de vie si important et malheureusement pas assez connu aujourd'hui.
Ce livre est une belle entrée dans l'univers de l'usine. On y croise des militants, des combats et des luttes collectives, Monsieur Gillet, le patron paternaliste qui loge ses ouvriers dans la cité, sous l'égide de la religion et la poigne des petits chefs. On y trouve un beau personnage de femme, Szonja, d'abord maltraitée par les religieuses puis par Jean, son époux, avant de trouver une vie meilleure dans la lutte sociale et de faire de nouvelles rencontres...
A Lyon, dans les années 30, une usine de viscose ouvre ses portes. Cette nouvelle soie chimique est le futur selon la filière du textile. Pour ouvrir cette soierie, il faut de la main d'oeuvre. Étant aux balbutiements de cette matière, le choix de recruter des étrangers et étrangères directement dans leur pays ne se fait pas attendre. Des centaines d'Italiennes, de Polonaises ou d'Hongroises comme Szonja débarquent dans la grande ville française. La confection de cette viscose n'est pas sans danger mais personne ne veut l'avouer. Nous allons suivre leur histoire ainsi que toute l' insurrection sociale qui enfle, la montée de la colère et celle du Front Populaire. Très bon roman révoltant !
Paola Pigani est la romancière de l'émigration. Dans le précédent roman, autobiographique ” Des orties et des hommes”, elle racontait son enfance et sa jeunesse en Charente dans un petit village rural, elle qui a des origines italiennes. Encore avant, dans le roman « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures », c'est l'histoire du peuple Tzigane qu'elle raconte.
Dans celui-ci, au titre léger en apparence, c'est l'émigration des populations italiennes, hongroises, polonaises qu'elle évoque, tout autant que la migration des populations agricoles pauvres vers les usines du Sud Est de la France. Elle nous raconte la vie dans les usines de textile de la banlieue de Lyon, près de Villeurbanne, là où une grande famille d'industriels lyonnais, les Gillet, ont créer une usine de viscose. La fameuse soie industrielle qui permettait aux femmes les plus modestes d'acquérir des tissus soyeux à bas prix.
Ce procédé de fabrication, né de la nécessité de compenser la faible production de soie naturelle, nécessite des conditions particulièrement dangereuses pour la santé des ouvrières et des ouvriers : l'acide, le soufre, le manque d'aération des locaux, le manque d'hygiène, les fumées nocives, le rythme implacable de la production, les salaires peu élevés, les brimades permanentes doublées des amendes pour manque de rendement. Tout concourt à ce que la révolte voit le jour.
Nous sommes en 1929 au début du roman, et peu à peu les conditions de travail vont encore se dégrader quand la crise venue d'Amérique frappera de plein fouet l'Europe. Szonja, jeune hongroise désireuse de sortir de sa modeste condition paysanne dans son pays, arrive à l'usine de soie artificielle, la Sase, près de Lyon. Elle est logée avec toutes les jeunes femmes émigrées dans un internat tenue par les soeurs ; peu à peu elle va essayer de s'installer vraiment dans son nouveau pays, elle apprend la langue, elle rencontre un fils d'agriculteur qui a quitté la ferme paternelle pour travailler lui aussi à l'usine, et le dimanche, elle danse au bord de la Rize, la rivière qui borde l'usine.
Les années passent, et la crise s'intensifiant, la politique prend de plus en plus de place dans la vie des ces travailleurs du textile. Nous vivrons ainsi grâce à ce roman les premières grèves, l'évolution de la condition des femmes dans le monde ouvrier, et surtout l'apparition d'une solidarité sans faille autour d'une colère grandissante contre le patronat qui construira la légende lyonnaise des viscosiers, avec à la clé l'arrivée du Front Populaire et ses avancées sociales.
Un roman à l'humanité prégnante, dans une langue poétique, imprégnée des parfums de cette région ouvrière, aux images subtiles et contrastées. Un grand moment ou petite et grande Histoire se répondent. Passionnant.
Lien : https://camusdiffusion.wordp..
Dans celui-ci, au titre léger en apparence, c'est l'émigration des populations italiennes, hongroises, polonaises qu'elle évoque, tout autant que la migration des populations agricoles pauvres vers les usines du Sud Est de la France. Elle nous raconte la vie dans les usines de textile de la banlieue de Lyon, près de Villeurbanne, là où une grande famille d'industriels lyonnais, les Gillet, ont créer une usine de viscose. La fameuse soie industrielle qui permettait aux femmes les plus modestes d'acquérir des tissus soyeux à bas prix.
Ce procédé de fabrication, né de la nécessité de compenser la faible production de soie naturelle, nécessite des conditions particulièrement dangereuses pour la santé des ouvrières et des ouvriers : l'acide, le soufre, le manque d'aération des locaux, le manque d'hygiène, les fumées nocives, le rythme implacable de la production, les salaires peu élevés, les brimades permanentes doublées des amendes pour manque de rendement. Tout concourt à ce que la révolte voit le jour.
Nous sommes en 1929 au début du roman, et peu à peu les conditions de travail vont encore se dégrader quand la crise venue d'Amérique frappera de plein fouet l'Europe. Szonja, jeune hongroise désireuse de sortir de sa modeste condition paysanne dans son pays, arrive à l'usine de soie artificielle, la Sase, près de Lyon. Elle est logée avec toutes les jeunes femmes émigrées dans un internat tenue par les soeurs ; peu à peu elle va essayer de s'installer vraiment dans son nouveau pays, elle apprend la langue, elle rencontre un fils d'agriculteur qui a quitté la ferme paternelle pour travailler lui aussi à l'usine, et le dimanche, elle danse au bord de la Rize, la rivière qui borde l'usine.
Les années passent, et la crise s'intensifiant, la politique prend de plus en plus de place dans la vie des ces travailleurs du textile. Nous vivrons ainsi grâce à ce roman les premières grèves, l'évolution de la condition des femmes dans le monde ouvrier, et surtout l'apparition d'une solidarité sans faille autour d'une colère grandissante contre le patronat qui construira la légende lyonnaise des viscosiers, avec à la clé l'arrivée du Front Populaire et ses avancées sociales.
Un roman à l'humanité prégnante, dans une langue poétique, imprégnée des parfums de cette région ouvrière, aux images subtiles et contrastées. Un grand moment ou petite et grande Histoire se répondent. Passionnant.
Lien : https://camusdiffusion.wordp..
Un beau témoignage sur la condition ouvrière dans les usines textiles de la banlieue lyonnaise au début du XXe siècle. Il y a du Zola dans la description de ce milieu ouvrier, de ses conditions de vie dans les logements de la cité ouvrière, de ses conditions de travail terribles au milieu des vapeurs chimiques. Des conditions de vie qui n'empêchent pas la solidarité dans les moments difficiles ou la joie de vivre lors des bals du dimanche…
L'auteur a une belle plume, qu'elle met au service d'une histoire très bien documentée. C'est à la fois instructif et très bien écrit. Bref une belle découverte.
L'auteur a une belle plume, qu'elle met au service d'une histoire très bien documentée. C'est à la fois instructif et très bien écrit. Bref une belle découverte.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Paola Pigani (10)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3231 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3231 lecteurs ont répondu