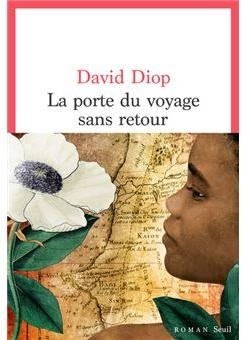Imaginer… Au fort de l'île de Saint-Louis du Sénégal, un jeune homme débarque en 1750 dans ce qui est une concession française, afin d'étudier la flore locale. Livre somme sur l'esclavage, sur l'Afrique telle qu'elle a pu être vue par les européens à cette époque, magnifiant une histoire d'amour tissée dans un environnement hostile entre un scientifique français et une jeune sénégalaise, au cours d'un périple à travers les multiples royaumes d'alors. Tissage magnifique des puissantes croyances africaines et de mythes européens. Je suis encore sous le choc de l'habileté d'écriture de David Diop, ayant réussi à mettre tout cela dans si peu de pages.
Les premiers chapitres sont consacrés à la mise en place du récit. le narrateur présente les derniers jours d'un botaniste du roi nommé Michel Adanson, de son attachement à sa fille Aglaé à qui il projette de transmettre ses cahiers secrets de voyage. Ces pages sont chargées d'informations dont on comprendra l'importance plus tard. Elles donnent toute son épaisseur au récit raconté à la première personne dans un second temps, lecture par Aglaé des cahiers de son père écrit suite au voyage effectué en 1750 alors qu'il avait vingt-trois ans. Ensuite viendront les merveilleuses pages du récit de Maram, cette jeune femme sénégalaise victime d'une tentative de viol par son oncle Baba Seck et promise à l'esclavage de l'autre côté de l'océan si elle n'avait pas pu s'échapper miraculeusement de cette porte du voyage sans retour - surnom donné à l'île de Gorée au large de Cap-Verd (nom de l'époque pour Cap-Vert).
J'ai découvert après cette lecture que Michel Adanson a réellement existé. Il a bien fait ce voyage à une époque où l'Académie royale envoyait des jeunes gens pour collecter des plantes dans le but d'alimenter le grand projet d'encyclopédie. Sa fille Aglaé a aussi existé. David Diop a rempli, avec un formidable talent, les interstices des informations disponibles et a inventé l'histoire d'amour avec la belle et mystérieuse Maram. Celle-ci illumine le roman, l'auteur élevant le récit en convoquant les mythes (Orphée, voire Roméo et Juliette, les légendes locales…).
Apparaît au fil des pages un Sénégal très précis et vraisemblable (l'auteur est un spécialiste de la littérature et des représentations européennes de l'Afrique animant un groupe de recherche sur ce sujet). Il me semble qu'on a peu l'occasion de visualiser un pays de l'Afrique de l'ouest à l'époque précoloniale, qui plus est porte de départ de millions d'esclaves africains. Ce livre est une excellente introduction à l'histoire du Sénégal, avec ces relations compliquées entre le royaume de Waloo au nord, du Kayor au centre, avec la concession française au fort Saint-Louis obligée de traiter avec les puissants représentants de ces provinces.
Ce roman porte en son coeur la transmission : entre un père et sa fille, entre une jeune femme sénégalaise en rébellion et un scientifique blanc, permettant à celui-ci de se révolter contre l'esclavage. Par le récit que David Diop nous offre, un sens est donné à la vie de Michel Adanson, une mémoire se fait jour pour la tragédie vécue par tout un peuple.
Livre sur l'esclavage sans voir d'esclaves, sauf brièvement lorsque Maram est au cachot à l'île de Gorée, voilà une manière habile de conserver toute la dignité à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants qui en ont été dépossédés. La fin, surprenante, présente un nouveau personnage, Madeleine, enlevée trop petite de son pays et dont elle a si peu de souvenirs, ayant été réduite à l'esclavage en Guadeloupe. Madeleine passée à la postérité en posant pour un tableau devenu célèbre. Madeleine dément le titre, étant par ce tableau exposé au Louvre, celle qui symboliquement est de retour.
J'ai adoré ce roman qui démarre lentement, prend toute sa mesure et fini dans une puissance d'évocation rare. Magnifique !
Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal et est maître de conférence à l'Université de Pau. Il est l'auteur de Frère d'âme, roman lauréat du prix Goncourt des lycéens 2018 et de l'International Booker Prize 2021,un roman que j'ai bien envie de lire, un auteur que je vais suivre !
******
Chronique avec illustrations : composition personnelle avec les escaliers de la maison des esclaves à l'île de Gorée, surnommée "La porte du voyage sans retour", et aussi le portrait de Madeleine évoqué dans le livre de David Diop. Lien direct ci-dessous. A bientôt !
Lien : https://clesbibliofeel.blog/..
Les premiers chapitres sont consacrés à la mise en place du récit. le narrateur présente les derniers jours d'un botaniste du roi nommé Michel Adanson, de son attachement à sa fille Aglaé à qui il projette de transmettre ses cahiers secrets de voyage. Ces pages sont chargées d'informations dont on comprendra l'importance plus tard. Elles donnent toute son épaisseur au récit raconté à la première personne dans un second temps, lecture par Aglaé des cahiers de son père écrit suite au voyage effectué en 1750 alors qu'il avait vingt-trois ans. Ensuite viendront les merveilleuses pages du récit de Maram, cette jeune femme sénégalaise victime d'une tentative de viol par son oncle Baba Seck et promise à l'esclavage de l'autre côté de l'océan si elle n'avait pas pu s'échapper miraculeusement de cette porte du voyage sans retour - surnom donné à l'île de Gorée au large de Cap-Verd (nom de l'époque pour Cap-Vert).
J'ai découvert après cette lecture que Michel Adanson a réellement existé. Il a bien fait ce voyage à une époque où l'Académie royale envoyait des jeunes gens pour collecter des plantes dans le but d'alimenter le grand projet d'encyclopédie. Sa fille Aglaé a aussi existé. David Diop a rempli, avec un formidable talent, les interstices des informations disponibles et a inventé l'histoire d'amour avec la belle et mystérieuse Maram. Celle-ci illumine le roman, l'auteur élevant le récit en convoquant les mythes (Orphée, voire Roméo et Juliette, les légendes locales…).
Apparaît au fil des pages un Sénégal très précis et vraisemblable (l'auteur est un spécialiste de la littérature et des représentations européennes de l'Afrique animant un groupe de recherche sur ce sujet). Il me semble qu'on a peu l'occasion de visualiser un pays de l'Afrique de l'ouest à l'époque précoloniale, qui plus est porte de départ de millions d'esclaves africains. Ce livre est une excellente introduction à l'histoire du Sénégal, avec ces relations compliquées entre le royaume de Waloo au nord, du Kayor au centre, avec la concession française au fort Saint-Louis obligée de traiter avec les puissants représentants de ces provinces.
Ce roman porte en son coeur la transmission : entre un père et sa fille, entre une jeune femme sénégalaise en rébellion et un scientifique blanc, permettant à celui-ci de se révolter contre l'esclavage. Par le récit que David Diop nous offre, un sens est donné à la vie de Michel Adanson, une mémoire se fait jour pour la tragédie vécue par tout un peuple.
Livre sur l'esclavage sans voir d'esclaves, sauf brièvement lorsque Maram est au cachot à l'île de Gorée, voilà une manière habile de conserver toute la dignité à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants qui en ont été dépossédés. La fin, surprenante, présente un nouveau personnage, Madeleine, enlevée trop petite de son pays et dont elle a si peu de souvenirs, ayant été réduite à l'esclavage en Guadeloupe. Madeleine passée à la postérité en posant pour un tableau devenu célèbre. Madeleine dément le titre, étant par ce tableau exposé au Louvre, celle qui symboliquement est de retour.
J'ai adoré ce roman qui démarre lentement, prend toute sa mesure et fini dans une puissance d'évocation rare. Magnifique !
Né à Paris en 1966, David Diop a grandi au Sénégal et est maître de conférence à l'Université de Pau. Il est l'auteur de Frère d'âme, roman lauréat du prix Goncourt des lycéens 2018 et de l'International Booker Prize 2021,un roman que j'ai bien envie de lire, un auteur que je vais suivre !
******
Chronique avec illustrations : composition personnelle avec les escaliers de la maison des esclaves à l'île de Gorée, surnommée "La porte du voyage sans retour", et aussi le portrait de Madeleine évoqué dans le livre de David Diop. Lien direct ci-dessous. A bientôt !
Lien : https://clesbibliofeel.blog/..
Gros coup de coeur pour ce livre découvert en version audio lu par Fédor Atkine. Sa voix profonde et nuancée sait donner vie aux principaux personnages de ce roman superbe qu'il ne faut vraiment pas manquer. Il m'a complètement embarquée, je suis sûre que j'aurais tout autant aimé le livre en version papier, mais de l'écouter avec cette voix chaleureuse lui donne une dimension supplémentaire, on a vraiment l'impression de voyager avec le héros.
Ce dernier est le botaniste Michel Adanson, dont je n'avais jamais entendu parler avant cette lecture. Il a vraiment existé mais n'a pas réalisé son rêve de célébrité, Linné l'a définitivement surpassé pour le classement des êtres vivants. Nous le retrouvons en 1806 très malade et veillé par sa fille Aglaé, il ne lui a pas consacré beaucoup de temps quand elle était petite et elle a finalement été élevée par beau-père, qui lui offre un château. Comme son père, elle est passionnée par les plantes, ce qui les rapproche à la fin de sa vie, elle lui demande des conseils pour son jardin et ses serres. Il n'a vécu que pour sa science et est finalement passé à côté de beaucoup de choses, aussi a-t'il rédigé un cahier secret pour sa fille, caché parmi les objets hétéroclites qu'il lui lègue et dans lequel il lui raconte son voyage au Sénégal, en version non expurgée, contrairement au livre qui a été réellement publié. Il veut se montrer à Aglaé tel qu'il était vraiment et révéler le grand secret de sa vie.
Il s'est rendu au Sénégal en 1749, à l'âge de vingt-trois ans pour y étudier la flore et la faune du pays. Son père a accepté qu'il n'entre pas dans les ordres à condition qu'il devienne un savant connu et membre de l'Académie royale. Il y reste jusqu'en 1754. Il a de mauvaises relations avec le gouverneur du Sénégal, dont le frère gère l'Ile de Gorée, l'ile aux esclaves. On lui adjoint Ndyak, un jeune prince de douze ans comme traducteur et assistant avec qui il se liera d'une vraie amitié. Il découvre avec émerveillement les animaux, les plantes et surtout les hommes. Lors d'une exploration, il rencontre Baba Sec, chef d'un village poche de St Louis, qui lui raconte l'histoire de sa nièce Maram, qui a disparu mystérieusement et dont on vient d'apprendre qu'elle est revenue d'Amérique vivante mais qu'elle vit dans un village du Cap Vert et qu'elle interdit à tous les habitants de son ancien village d'aller la voir. L'histoire paraît extraordinaire à Adanson et il décide de se rendre sur place pour en avoir le coeur net. Il la retrouve et en tombe éperdument amoureux, mais il ne sait pas si c'est réciproque et surtout un tel amour ne serait accepté ni par les Noirs, ni par les Blancs. C'est le grand drame de sa vie, qu'il fera tout pour oublier à son retour, se noyant dans la travail, puis se mariant avec la mère d'Aglaé. A la fin de sa vie, un évènement mondain lui rappellera sa jeunesse et le poussera à écrire sa confession.
Adanson est marqué par l'esprit des Lumières, il veut d'ailleurs écrire une encyclopédie en cent vingt tomes, que personne ne publiera jamais. Il découvre l'Afrique avec curiosité et loin des préjugés de son époque, mais s'il a ressenti toute l'horreur de l'esclavage et de la traite, ses idées sont inacceptables pour la société de son temps et il peut à peine suggérer dans son livre publié sur son voyage, que le climat convient bien à la culture de la canne à sucre. Il serait plus judicieux et rentable de la cultiver directement sur place plutôt que d'envoyer des esclaves aux Amériques, mais cette idée est inaudible. le goût du sucre était lié au commerce des esclaves, Voltaire lui reprochait d'ailleurs d'avoir un goût de sang. C'est une dimension que j'avais complètement oublié, habituée que je suis au sucre suisse issu de la betterave. C'est une nouvelle addiction qui a de beaux jours devant elle. le botaniste est pris entre sa culpabilité profonde dont il ne peut parler et les réalités économiques de son temps. Même s'il est vraiment contre ce trafic, il ne prend conscience de sa gravité que lorsque Maram est menacée.
L'auteur insiste aussi beaucoup sur la conception animiste du monde des Sénégalais. D'ailleurs il apprend le wolof pour mieux s'immerger dans leur culture. Il ne peut croire aux animaux totems, mais porte un regard plus éclairé sur le sujet à cause de son amour. Ce personnage est très moderne pour son temps, mais je ne sais à quel point c'est historique, on croirait lire un récit d'un anthropologue qui a compris comment s'immerger dans une culture et l'étudier sans jugement. C'est un récit d'aventures passionnant, mais pas que, c'est surtout la rencontre entre deux civilisations. le héros est impuissant à faire quelque chose de concret de ce qu'il a compris, aussi préfère-t'il tout oublier durant cinquante ans.
Comme avec Maram, son histoire d'amour avec sa famille est ratée. Il n'a pas pris le temps de l'aimer, malgré quelques activités faites avec Aglaé quand elle était une petite fille. Son cahier est une sorte de bouteille lancée à la mer, il ne saura pas si la rencontre aura lieu de manière posthume. Les personnages principaux sont attachants, ils ont tous des secrets qui sont des moteurs de leur vie. J'ai aussi beaucoup aimé Ndyak qui représente la sagesse africaine. Adanson voit les Africains comme ses égaux, ce qui est malheureusement utopique à cette époque. Il souligne aussi les querelles des rois locaux qui n'hésitent pas à s'emparer de leurs compatriotes pour les vendre, parfois contre un simple fusil.
Le livre est très bien écrit dans une langue fluide et assez poétique. Il sait nous faire voyager dans ces contrées lointaines. Un grand merci à Netgalley et Audiolib pour ce roman coup de coeur qu'il ne faut pas manquer.
#LaPorteduvoyagesansretour #NetGalleyFrance !
Lien : https://patpolar48361071.wor..
Ce dernier est le botaniste Michel Adanson, dont je n'avais jamais entendu parler avant cette lecture. Il a vraiment existé mais n'a pas réalisé son rêve de célébrité, Linné l'a définitivement surpassé pour le classement des êtres vivants. Nous le retrouvons en 1806 très malade et veillé par sa fille Aglaé, il ne lui a pas consacré beaucoup de temps quand elle était petite et elle a finalement été élevée par beau-père, qui lui offre un château. Comme son père, elle est passionnée par les plantes, ce qui les rapproche à la fin de sa vie, elle lui demande des conseils pour son jardin et ses serres. Il n'a vécu que pour sa science et est finalement passé à côté de beaucoup de choses, aussi a-t'il rédigé un cahier secret pour sa fille, caché parmi les objets hétéroclites qu'il lui lègue et dans lequel il lui raconte son voyage au Sénégal, en version non expurgée, contrairement au livre qui a été réellement publié. Il veut se montrer à Aglaé tel qu'il était vraiment et révéler le grand secret de sa vie.
Il s'est rendu au Sénégal en 1749, à l'âge de vingt-trois ans pour y étudier la flore et la faune du pays. Son père a accepté qu'il n'entre pas dans les ordres à condition qu'il devienne un savant connu et membre de l'Académie royale. Il y reste jusqu'en 1754. Il a de mauvaises relations avec le gouverneur du Sénégal, dont le frère gère l'Ile de Gorée, l'ile aux esclaves. On lui adjoint Ndyak, un jeune prince de douze ans comme traducteur et assistant avec qui il se liera d'une vraie amitié. Il découvre avec émerveillement les animaux, les plantes et surtout les hommes. Lors d'une exploration, il rencontre Baba Sec, chef d'un village poche de St Louis, qui lui raconte l'histoire de sa nièce Maram, qui a disparu mystérieusement et dont on vient d'apprendre qu'elle est revenue d'Amérique vivante mais qu'elle vit dans un village du Cap Vert et qu'elle interdit à tous les habitants de son ancien village d'aller la voir. L'histoire paraît extraordinaire à Adanson et il décide de se rendre sur place pour en avoir le coeur net. Il la retrouve et en tombe éperdument amoureux, mais il ne sait pas si c'est réciproque et surtout un tel amour ne serait accepté ni par les Noirs, ni par les Blancs. C'est le grand drame de sa vie, qu'il fera tout pour oublier à son retour, se noyant dans la travail, puis se mariant avec la mère d'Aglaé. A la fin de sa vie, un évènement mondain lui rappellera sa jeunesse et le poussera à écrire sa confession.
Adanson est marqué par l'esprit des Lumières, il veut d'ailleurs écrire une encyclopédie en cent vingt tomes, que personne ne publiera jamais. Il découvre l'Afrique avec curiosité et loin des préjugés de son époque, mais s'il a ressenti toute l'horreur de l'esclavage et de la traite, ses idées sont inacceptables pour la société de son temps et il peut à peine suggérer dans son livre publié sur son voyage, que le climat convient bien à la culture de la canne à sucre. Il serait plus judicieux et rentable de la cultiver directement sur place plutôt que d'envoyer des esclaves aux Amériques, mais cette idée est inaudible. le goût du sucre était lié au commerce des esclaves, Voltaire lui reprochait d'ailleurs d'avoir un goût de sang. C'est une dimension que j'avais complètement oublié, habituée que je suis au sucre suisse issu de la betterave. C'est une nouvelle addiction qui a de beaux jours devant elle. le botaniste est pris entre sa culpabilité profonde dont il ne peut parler et les réalités économiques de son temps. Même s'il est vraiment contre ce trafic, il ne prend conscience de sa gravité que lorsque Maram est menacée.
L'auteur insiste aussi beaucoup sur la conception animiste du monde des Sénégalais. D'ailleurs il apprend le wolof pour mieux s'immerger dans leur culture. Il ne peut croire aux animaux totems, mais porte un regard plus éclairé sur le sujet à cause de son amour. Ce personnage est très moderne pour son temps, mais je ne sais à quel point c'est historique, on croirait lire un récit d'un anthropologue qui a compris comment s'immerger dans une culture et l'étudier sans jugement. C'est un récit d'aventures passionnant, mais pas que, c'est surtout la rencontre entre deux civilisations. le héros est impuissant à faire quelque chose de concret de ce qu'il a compris, aussi préfère-t'il tout oublier durant cinquante ans.
Comme avec Maram, son histoire d'amour avec sa famille est ratée. Il n'a pas pris le temps de l'aimer, malgré quelques activités faites avec Aglaé quand elle était une petite fille. Son cahier est une sorte de bouteille lancée à la mer, il ne saura pas si la rencontre aura lieu de manière posthume. Les personnages principaux sont attachants, ils ont tous des secrets qui sont des moteurs de leur vie. J'ai aussi beaucoup aimé Ndyak qui représente la sagesse africaine. Adanson voit les Africains comme ses égaux, ce qui est malheureusement utopique à cette époque. Il souligne aussi les querelles des rois locaux qui n'hésitent pas à s'emparer de leurs compatriotes pour les vendre, parfois contre un simple fusil.
Le livre est très bien écrit dans une langue fluide et assez poétique. Il sait nous faire voyager dans ces contrées lointaines. Un grand merci à Netgalley et Audiolib pour ce roman coup de coeur qu'il ne faut pas manquer.
#LaPorteduvoyagesansretour #NetGalleyFrance !
Lien : https://patpolar48361071.wor..
♂ Lui c'est Michel Adanson (1727 - 1806), le grand naturaliste français, l'explorateur plein de projets et d'ambitions, l'infatigable arpenteur des terres sénégalaises dont il espère recenser plantes et arbres nouveaux, insectes et oiseaux inconnus.
♀ Elle c'est "la revenante", une mystèrieuse Vénus d'Afrique prénommée Maram, la nièce d'un chef de clan subitement disparue au coeur de la brousse...
Pour guider les pas de Michel jusqu'à la belle indigène, il fallait un entremetteur talentueux et imaginatif. C'est là qu'interviennent l'excellent David Diop et sa plume soigneusement travaillée et riche d'exotisme, empreinte à la fois d'une classissisme impeccable et d'une poésie plus débridée. L'aventure qu'il nous relate ici, sous forme de mémoires postumes adressées par le botaniste à sa fille Aglaé, est tout à fait prenante. Bien que largement romancée, elle s'appuie en grande partie sur le véritable voyage de cinq ans effectué par le savant au milieu du XVIIIème siècle. On y découvre un personnage passionné et passionnant dont le rêve de toujours, celui de passer à la postérité par la publication d'une encyclopédie monumentale en vingt-sept volumes (Ordre universel de la nature) se trouve éclipsé par la fascination soudaine que lui inspire l'envoûtante Maram.
La belle histoire d'amour qui nous est comptée, agrémentée de superbes descriptions de la faune et de la flore sénégalaises (forêts d'ébéniers, fleuves et marigots, plaines sauvages à la végétation luxuriante...) ne suffit pourtant pas à faire oublier l'atrocité des pratiques esclavagistes en vigueur à l'époque.
Le douloureux sujet de la traite des Noirs est en effet central dans le roman, et l'auteur l'aborde ici sous un angle original et saisissant.
Le parcours de son héros, pétri des préjugés racistes de son temps et qui s'initie peu à peu à une autre vision du monde, s'avère très inspirant sur le plan humain.
Lui dont l'objectif premier était la découverte de plantes, de fleurs, d'arbres et de coquillages qu'aucun autre savant européen n'avait décrit jusqu'alors, réalise peu à peu que les occidentaux ignorent tout des peuplades autochtones ("les habitants du Sénégal ne nous sont pas moins inconnus que la nature qui les environne, pourtant nous croyons les connaître assez pour prétendre qu'ils nous sont naturellement inférieurs"). Il prend vite la mesure des atrocités perpétrées par l'Homme blanc et du caractère évidemment infondé de sa prétendue suprématie ("si les Nègres sont escalves, je sais parfaitement qu'ils ne le sont pas par décret divin, mais bien parce qu'il convient de le penser pour continuer de les vendre sans remords").
Les digues de ses bêtes idées reçues, comme celles de son amour pour la science et la raison cèdent alors face aux élans du coeur et à la beauté d'un monde enchanteur, teinté de magie, où les forces de la nature, les totems mystiques, les légendes et les génies de la brousse occupent une place prépondérante.
L'éveil du naturaliste passe aussi par la langue, l'adhésion à la tradition orale et l'appropriation du wolof (dont les occurrences nombreuses accroissent joliment l'exotisme du récit) : c'est l'occasion pour David Diop de nous livrer d'intéressantes réflexions sur le pouvoir des mots et la façon dont ils modèlent notre pensée, nos émotions, notre perception du monde.
C'est au final un homme transformé, rendu sensible aux mystères de l'amour et de la nature, qui regagne Paris à l'issue du périple.
Pour moi qui ne connaissais pas encore David Diop, ce fut un plaisir de franchir avec lui avec cette Porte du voyage sans retour (publiée bien sûr aux éditions du Seuil ;-)).
Un texte dépaysant, souvent terrible et parfois flamboyant : en bref une jolie découverte.
♀ Elle c'est "la revenante", une mystèrieuse Vénus d'Afrique prénommée Maram, la nièce d'un chef de clan subitement disparue au coeur de la brousse...
Pour guider les pas de Michel jusqu'à la belle indigène, il fallait un entremetteur talentueux et imaginatif. C'est là qu'interviennent l'excellent David Diop et sa plume soigneusement travaillée et riche d'exotisme, empreinte à la fois d'une classissisme impeccable et d'une poésie plus débridée. L'aventure qu'il nous relate ici, sous forme de mémoires postumes adressées par le botaniste à sa fille Aglaé, est tout à fait prenante. Bien que largement romancée, elle s'appuie en grande partie sur le véritable voyage de cinq ans effectué par le savant au milieu du XVIIIème siècle. On y découvre un personnage passionné et passionnant dont le rêve de toujours, celui de passer à la postérité par la publication d'une encyclopédie monumentale en vingt-sept volumes (Ordre universel de la nature) se trouve éclipsé par la fascination soudaine que lui inspire l'envoûtante Maram.
La belle histoire d'amour qui nous est comptée, agrémentée de superbes descriptions de la faune et de la flore sénégalaises (forêts d'ébéniers, fleuves et marigots, plaines sauvages à la végétation luxuriante...) ne suffit pourtant pas à faire oublier l'atrocité des pratiques esclavagistes en vigueur à l'époque.
Le douloureux sujet de la traite des Noirs est en effet central dans le roman, et l'auteur l'aborde ici sous un angle original et saisissant.
Le parcours de son héros, pétri des préjugés racistes de son temps et qui s'initie peu à peu à une autre vision du monde, s'avère très inspirant sur le plan humain.
Lui dont l'objectif premier était la découverte de plantes, de fleurs, d'arbres et de coquillages qu'aucun autre savant européen n'avait décrit jusqu'alors, réalise peu à peu que les occidentaux ignorent tout des peuplades autochtones ("les habitants du Sénégal ne nous sont pas moins inconnus que la nature qui les environne, pourtant nous croyons les connaître assez pour prétendre qu'ils nous sont naturellement inférieurs"). Il prend vite la mesure des atrocités perpétrées par l'Homme blanc et du caractère évidemment infondé de sa prétendue suprématie ("si les Nègres sont escalves, je sais parfaitement qu'ils ne le sont pas par décret divin, mais bien parce qu'il convient de le penser pour continuer de les vendre sans remords").
Les digues de ses bêtes idées reçues, comme celles de son amour pour la science et la raison cèdent alors face aux élans du coeur et à la beauté d'un monde enchanteur, teinté de magie, où les forces de la nature, les totems mystiques, les légendes et les génies de la brousse occupent une place prépondérante.
L'éveil du naturaliste passe aussi par la langue, l'adhésion à la tradition orale et l'appropriation du wolof (dont les occurrences nombreuses accroissent joliment l'exotisme du récit) : c'est l'occasion pour David Diop de nous livrer d'intéressantes réflexions sur le pouvoir des mots et la façon dont ils modèlent notre pensée, nos émotions, notre perception du monde.
C'est au final un homme transformé, rendu sensible aux mystères de l'amour et de la nature, qui regagne Paris à l'issue du périple.
Pour moi qui ne connaissais pas encore David Diop, ce fut un plaisir de franchir avec lui avec cette Porte du voyage sans retour (publiée bien sûr aux éditions du Seuil ;-)).
Un texte dépaysant, souvent terrible et parfois flamboyant : en bref une jolie découverte.
A sa mort, le botaniste Michel Adanson laisse un tas d'objets hétéroclites à sa fille Aglaé. Après la découverte de cahiers qu'Adanson avait écrit pour elle, David Diop nous entraine sur l'ile de Gorée appelée aussi "La porte du voyage sans retour" donnant le titre du roman. Formidable conteur, il nous emporte dans une belle mais terrible histoire d'amour sur fond d'esclavage, ou le jeune botaniste rencontra l'amour sous les traits de la belle Maram. Destin brisé dans un Sénégal ou l'autochtone est considéré comme une marchandise. Mensonges, trahison, lâcheté, cette histoire d'amour vouée à l'échec est magnifiée par la belle écriture de David Diop (après le beau "Frère d'âme"), qui sait parfaitement alterner grande et petite histoire. David Diop qui comme tout bon conteur nous tient en haleine tout au long du récit. Une belle réussite.
Un grand merci aux éditions du Seuil et à Babelio de m'avoir permis de découvrir ce roman qui à n'en pas douter devrait connaître un joli succès.
Un grand merci aux éditions du Seuil et à Babelio de m'avoir permis de découvrir ce roman qui à n'en pas douter devrait connaître un joli succès.
C'est presqu'un coup de coeur pour ce roman subtil et fort, qui adopte le point de vue d'un botaniste français en voyage au Sénégal, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, tout du moins lorsqu'il relate son aventure sénégalaise dans les carnets secrets légués indirectement à sa fille Aglaé, qu'il n'a pas su élever, mais avec qui il a renoué des contacts sur la fin de sa vie, puisqu'ils partagent une même passion pour les plantes.
C'est un voyage époustouflant que nous relate David Diop, par le truchement de ces carnets : arrivé tout d'abord au Sénégal pour recenser les espèces du pays et collecter des échantillons, Michel Adanson a pu parcourir la côte de Saint-Louis au Cap-Vert, et se rendre sur l'île de Gorée, d'où les esclaves étaient envoyés par voie maritime aux plantations des Antilles. Il a appris le wolof et, joyeux et de caractère sociable, n'a pas eu de mal à sympathiser, d'abord avec Ndiak, fils du roi du Waalo, qui devient un ami hautement fidèle et loyal, puis avec des villageois rencontrés sur le parcours de ses expéditions. Si le scientifique rationnel est blanc, il ne se sent pas identique à ces trafiquants d'esclaves, qui achètent ou raflent femmes et enfants, et font marché de vies humaines qui ne leur appartiennent pas. le commerce triangulaire bat son plein et il n'est pas question d'exprimer la plus petite réserve quant au sort de ces populations déportées – car oui, quel autre mot employer, dans ces conditions effarantes d'inhumanité ? du reste, David Diop nous révèle qu'une croyance courante dans son pays était que les Blancs envoyaient les « Nègres » (il emploie lui-même le terme) pour être abattus et mangés dans ces lointains pays dont l'on ne revient pas.
Or, Michel et Ndiak apprennent par hasard qu'une jeune fille, Mariam Seck, aurait échappé à ce destin tragique, et serait réfugiée dans le village de Ben, au Cap-Vert. Comment cela est-il seulement possible ? Ils n'en savent pas plus, mais sous couvert d'une mission officielle dirigée par la Concession du Sénégal, représentée à Saint-Louis par le peu recommandable Estoupan de la Brüe, ils se lancent sur ses traces, pour en apprendre plus. La vérité de l'histoire de Mariam, que Michel apprendra de sa bouche même, est inouïe et sa rage de vivre n'a pas fini de faire parler d'elle. En même temps qu'il l'écoute avec respect, sans jamais l'interrompre, Michel tombe éperdument amoureux d'elle, jusqu'à tenter de la sauver, à la porte du voyage sans retour, qui connaît bien des dimensions…
« de cette porte pour un voyage sans retour ils allaient, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance » Jo Ndiaye (porte de la Maison des esclaves de l'île de Gorée)
On ne peut en dire plus, mais sachez qu'on ne revient pas indemne de ce voyage dans les images, les senteurs et la musicalité de l'Afrique : Mariam, c'est la femme aux prises avec le pouvoir de l'homme, dès son plus jeune âge, et c'est l'Afrique, le Sénégal tout entier, sa voix est celle des esclaves, du sort inhumain infligé à des hommes, des femmes, des enfants même – la voix de Michel est celle des compromissions qu'on accepte, d'une révolte impuissante qui ne fera que davantage de mal, la voix d'un monde dépassé, intoxiqué par son féroce appétit de domination, qui ne sait plus arrêter le mouvement, ni revenir de cet autre voyage sans retour, celui de l'exploitation de l'homme par l'homme. Quand avons-nous commencé ? Question plus urgente encore : comment en sortir ?
Le seul léger reproche que je formulerais est que David Diop prête à cet homme du XVIIIème siècle des pensées de notre époque post-colonialiste. Ainsi, les idées qu'il se formule sur les possibilités d'un mariage entre lui et Mariam, alors qu'il s'inquiète de l'intolérance potentielle de son environnement social, en France, et aborde le risque de vouloir « blanchir » celle qu'il aime. Ce sont des réflexions importantes, mais beaucoup plus actuelles que l'époque du récit, de même que les considérations sur la femme victime du pouvoir masculin, l'inceste… Et pourtant, il est important d'en parler, mais peut-être pas à travers un personnage de cette époque, certes des Lumières, mais pas si avancée sur ces points-là. Il faudra encore bien du temps, à supposer qu'un retour soit possible. Oui, je vous préviens, si la plume de l'auteur est envoûtante, elle ouvre des portes sur des recoins bien sombres, et n'engendre pas une vision souriante de l'humanité, même bien intentionnée et tolérante. Saurons-nous au moins écouter l'histoire des esclaves par leurs descendants, sans interférer ou nous l'approprier ? Saurons-nous nous en tenir à la question qui revient à nos cultures : qu'en reste-t-il, quelles racines sont encore à extirper, de ce mal abject qu'est le racisme ?
C'est un voyage époustouflant que nous relate David Diop, par le truchement de ces carnets : arrivé tout d'abord au Sénégal pour recenser les espèces du pays et collecter des échantillons, Michel Adanson a pu parcourir la côte de Saint-Louis au Cap-Vert, et se rendre sur l'île de Gorée, d'où les esclaves étaient envoyés par voie maritime aux plantations des Antilles. Il a appris le wolof et, joyeux et de caractère sociable, n'a pas eu de mal à sympathiser, d'abord avec Ndiak, fils du roi du Waalo, qui devient un ami hautement fidèle et loyal, puis avec des villageois rencontrés sur le parcours de ses expéditions. Si le scientifique rationnel est blanc, il ne se sent pas identique à ces trafiquants d'esclaves, qui achètent ou raflent femmes et enfants, et font marché de vies humaines qui ne leur appartiennent pas. le commerce triangulaire bat son plein et il n'est pas question d'exprimer la plus petite réserve quant au sort de ces populations déportées – car oui, quel autre mot employer, dans ces conditions effarantes d'inhumanité ? du reste, David Diop nous révèle qu'une croyance courante dans son pays était que les Blancs envoyaient les « Nègres » (il emploie lui-même le terme) pour être abattus et mangés dans ces lointains pays dont l'on ne revient pas.
Or, Michel et Ndiak apprennent par hasard qu'une jeune fille, Mariam Seck, aurait échappé à ce destin tragique, et serait réfugiée dans le village de Ben, au Cap-Vert. Comment cela est-il seulement possible ? Ils n'en savent pas plus, mais sous couvert d'une mission officielle dirigée par la Concession du Sénégal, représentée à Saint-Louis par le peu recommandable Estoupan de la Brüe, ils se lancent sur ses traces, pour en apprendre plus. La vérité de l'histoire de Mariam, que Michel apprendra de sa bouche même, est inouïe et sa rage de vivre n'a pas fini de faire parler d'elle. En même temps qu'il l'écoute avec respect, sans jamais l'interrompre, Michel tombe éperdument amoureux d'elle, jusqu'à tenter de la sauver, à la porte du voyage sans retour, qui connaît bien des dimensions…
« de cette porte pour un voyage sans retour ils allaient, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance » Jo Ndiaye (porte de la Maison des esclaves de l'île de Gorée)
On ne peut en dire plus, mais sachez qu'on ne revient pas indemne de ce voyage dans les images, les senteurs et la musicalité de l'Afrique : Mariam, c'est la femme aux prises avec le pouvoir de l'homme, dès son plus jeune âge, et c'est l'Afrique, le Sénégal tout entier, sa voix est celle des esclaves, du sort inhumain infligé à des hommes, des femmes, des enfants même – la voix de Michel est celle des compromissions qu'on accepte, d'une révolte impuissante qui ne fera que davantage de mal, la voix d'un monde dépassé, intoxiqué par son féroce appétit de domination, qui ne sait plus arrêter le mouvement, ni revenir de cet autre voyage sans retour, celui de l'exploitation de l'homme par l'homme. Quand avons-nous commencé ? Question plus urgente encore : comment en sortir ?
Le seul léger reproche que je formulerais est que David Diop prête à cet homme du XVIIIème siècle des pensées de notre époque post-colonialiste. Ainsi, les idées qu'il se formule sur les possibilités d'un mariage entre lui et Mariam, alors qu'il s'inquiète de l'intolérance potentielle de son environnement social, en France, et aborde le risque de vouloir « blanchir » celle qu'il aime. Ce sont des réflexions importantes, mais beaucoup plus actuelles que l'époque du récit, de même que les considérations sur la femme victime du pouvoir masculin, l'inceste… Et pourtant, il est important d'en parler, mais peut-être pas à travers un personnage de cette époque, certes des Lumières, mais pas si avancée sur ces points-là. Il faudra encore bien du temps, à supposer qu'un retour soit possible. Oui, je vous préviens, si la plume de l'auteur est envoûtante, elle ouvre des portes sur des recoins bien sombres, et n'engendre pas une vision souriante de l'humanité, même bien intentionnée et tolérante. Saurons-nous au moins écouter l'histoire des esclaves par leurs descendants, sans interférer ou nous l'approprier ? Saurons-nous nous en tenir à la question qui revient à nos cultures : qu'en reste-t-il, quelles racines sont encore à extirper, de ce mal abject qu'est le racisme ?
Tout d'abord je voudrais remercier les éditions du Seuil et Babelio pour ce très beau roman qui m'a été offert dans le cadre d'une opération masse critique exceptionnelle.
Exceptionnel est un terme qui va très bien à "La porte du voyage sans retour" de David Diop publié pour la rentrée littéraire de septembre 2021.
C'est un très beau titre pour un livre qui commence par la narration d'un homme en fin de vie, à l'aube de la mort, ce moment où un être se trouve à "La porte du voyage sans retour". Et pourtant j'ai souri de ma confusion pas si surprenante que ça puisque c'est le nom de l'île de Gorée, le voyage est celui des négriers voguant vers l'Amérique et la mort peut être associée à l'esclavage.
L'histoire est inspirée de la vie de Michel Adanson un naturaliste français du 16e siècle. C'est un scientifique qui a pour famille les plantes mais qui pense à sa fille Aglaé au moment de mourir.
Dans la serre du parc de son château de Balaine la jeune femme va retrouver les cahiers de son père qui lui sont adressés parce qu'il voulait qu'elle connaisse l'homme qu'il était vraiment.
En 1750, à 23 ans il a vécu plusieurs années au Sénégal.
J'aime beaucoup la phrase dans laquelle il dit qu'il y allait pour découvrir des plantes et qu'il y a rencontré des hommes. Il n'a pas conscience de l'esclavage au début parce qu'il s'intéresse uniquement à la nature. Pourtant, il va vite s'intégrer en apprenant la langue Wolof.
Un jour, accompagné de Ndiak, il se rend au village de Sor pour ses recherches. C'est là que le roi du Waalo lui apprend l'existence de sa nièce disparue trois ans auparavant, au destin improbable d'une esclave en fuite.
Fasciné par cette histoire, il va entreprendre un long voyage à pieds pour retrouver celle qui est nommée "la revenante" et découvrir ce qui s'est passé.
Il va cheminer de l'île Saint-Louis vers la presqu'île du Cap-Verd en passant par Ndiébène, Tiari, Lompoul, Meckmé du royaume du Kayor, Keur Damel, Djoff, Ben et la forêt de Krampsané pour découvrir la beauté du monde africain où la relation à soi, à la nature et à la société y est aussi féconde qu'en Occident au temps des Lumières.
J'imagine Michel Adanson plus à l'aise lorsqu'il est accroupi sur ses talons à la mode du Sénégal que dans les salons.
Pour autant, le portrait que David Diop dresse des Sénégalais est nuancé et très intéressant du point de vue historique puisqu'il montre aussi que le marché aux esclaves ne pouvait pas fonctionner sans l'aide de certains sénégalais corrompus comme c'est le cas du chef de village de Sor.
Mais surtout, il y a cette très belle histoire d'amour impossible entre le jeune homme blanc fasciné par une Afrique mystique et Maram, femme serpent noire qui va se confier à lui mais dont la force intérieure ne pourra vaincre la cruauté des esclavagistes.
J'en suis encore bouleversée d'autant plus que David Diop est un grand spécialiste de cette époque et qu'il est très convaincant.
Challenge Multi-défis 2021
Exceptionnel est un terme qui va très bien à "La porte du voyage sans retour" de David Diop publié pour la rentrée littéraire de septembre 2021.
C'est un très beau titre pour un livre qui commence par la narration d'un homme en fin de vie, à l'aube de la mort, ce moment où un être se trouve à "La porte du voyage sans retour". Et pourtant j'ai souri de ma confusion pas si surprenante que ça puisque c'est le nom de l'île de Gorée, le voyage est celui des négriers voguant vers l'Amérique et la mort peut être associée à l'esclavage.
L'histoire est inspirée de la vie de Michel Adanson un naturaliste français du 16e siècle. C'est un scientifique qui a pour famille les plantes mais qui pense à sa fille Aglaé au moment de mourir.
Dans la serre du parc de son château de Balaine la jeune femme va retrouver les cahiers de son père qui lui sont adressés parce qu'il voulait qu'elle connaisse l'homme qu'il était vraiment.
En 1750, à 23 ans il a vécu plusieurs années au Sénégal.
J'aime beaucoup la phrase dans laquelle il dit qu'il y allait pour découvrir des plantes et qu'il y a rencontré des hommes. Il n'a pas conscience de l'esclavage au début parce qu'il s'intéresse uniquement à la nature. Pourtant, il va vite s'intégrer en apprenant la langue Wolof.
Un jour, accompagné de Ndiak, il se rend au village de Sor pour ses recherches. C'est là que le roi du Waalo lui apprend l'existence de sa nièce disparue trois ans auparavant, au destin improbable d'une esclave en fuite.
Fasciné par cette histoire, il va entreprendre un long voyage à pieds pour retrouver celle qui est nommée "la revenante" et découvrir ce qui s'est passé.
Il va cheminer de l'île Saint-Louis vers la presqu'île du Cap-Verd en passant par Ndiébène, Tiari, Lompoul, Meckmé du royaume du Kayor, Keur Damel, Djoff, Ben et la forêt de Krampsané pour découvrir la beauté du monde africain où la relation à soi, à la nature et à la société y est aussi féconde qu'en Occident au temps des Lumières.
J'imagine Michel Adanson plus à l'aise lorsqu'il est accroupi sur ses talons à la mode du Sénégal que dans les salons.
Pour autant, le portrait que David Diop dresse des Sénégalais est nuancé et très intéressant du point de vue historique puisqu'il montre aussi que le marché aux esclaves ne pouvait pas fonctionner sans l'aide de certains sénégalais corrompus comme c'est le cas du chef de village de Sor.
Mais surtout, il y a cette très belle histoire d'amour impossible entre le jeune homme blanc fasciné par une Afrique mystique et Maram, femme serpent noire qui va se confier à lui mais dont la force intérieure ne pourra vaincre la cruauté des esclavagistes.
J'en suis encore bouleversée d'autant plus que David Diop est un grand spécialiste de cette époque et qu'il est très convaincant.
Challenge Multi-défis 2021
Avant tout, merci à l'opération Masse critique de Babelio et aux éditions du Seuil pour l'envoi de ce beau roman.
Dans La Porte du voyage sans retour, en 36 brefs chapitres, David Diop, grâce à des récits enchâssés, va nous entraîner à la suite d'un jeune, obscur, impécunieux et ambitieux naturaliste passionné de 23 ans. le jeune homme part herboriser au Sénégal tout en étant plus ou moins mandaté comme espion par la très puissante et richissime compagnie des Indes. Cependant, dans le premier chapitre, c'est à la veille de sa mort qu'un narrateur à la troisième personne nous donne à voir Michel Adanson (1727-1806). Perclus d'arthrose, assez fragile pour que son fémur se brise tout seul, l'homme se remémore sa jeunesse. Il veut expliquer à Aglaé, sa fille qu'il a quasiment ignorée jusqu'alors, ses aventures africaines et lui raconter, dans les cahiers qu'il écrira pendant sa brève convalescence, l'extraordinaire histoire dont il n'a pas dit un mot dans son ouvrage publié sur le Sénégal. le narrateur nous présente ensuite Aglaé, jeune femme résolue, en apparence aussi indépendante qu'on peut l'être à l'époque. Elle recueille l'héritage hétéroclite de son père, et finit par découvrir au milieu de son bric-à-brac un maroquin rouge contenant les cahiers qu'il a écrits juste avant sa mort. C'est à la première personne que David Diop nous raconte la passionnante aventure de Michel Adanson en s'adressant souvent directement à Aglaé.
***
« David Diop naît à Paris et passe une partie de sa jeunesse au Sénégal avant de revenir en France pour ses études » nous dit Wikipédia. L'auteur a assurément exploitée cette double culture tout en utilisant ses connaissances de spécialiste du XVIIIe siècle. Il a choisi de nous présenter le Sénégal par les yeux d'un jeune savant français de l'époque, qui se comporte parfois comme un Candide, mais aussi parfois comme un jeune homme infantile et capricieux. Ndiak, le jeune garçon dont on lui impose la présence, fils d'un roi, semble jouer tantôt Cacambo, tantôt Martin, et il se révèlera d'une aide précieuse pendant le voyage d'Adanson. La recherche de Maram, celle qu'on appelle « la Revenante », la seule à avoir passé dans l'autre sens la porte du voyage sans retour, se révélera pleine de surprises. En fait, cette quête sert de prétexte à la présentation du Sénégal tel qu'il était à cette époque. Adanson fait l'effort d'apprendre le wolof, et sa connaissance de la langue locale favorisera son immersion dans la culture sénégalaise. S'il garde un oeil critique, il a l'esprit assez ouvert pour respecter les coutumes et les croyances des autochtones. Les ravages de la traite des esclaves sont omniprésents, et les responsabilités des potentats locaux ne sont pas occultées. On découvre des dirigeants français particulièrement odieux, occupés à s'enrichir et à assurer leur carrière future en France, et on comprend à demi-mot que les Anglais n'ont rien à leur envier…
***
J'ai beaucoup aimé cette aventure romanesque pour ne pas dire romantique (le parallèle avec l'Orphée et Eurydice de Gluck), mais je suis malgré tout restée sur ma faim ! La langue de David Diop est un vrai régal. Si la musicalité est moins prégnante dans ce roman que dans Frère d'âme, la beauté des descriptions, la justesse des dialogues et la pertinence des aphorismes constituent de remarquables atouts.
Dans La Porte du voyage sans retour, en 36 brefs chapitres, David Diop, grâce à des récits enchâssés, va nous entraîner à la suite d'un jeune, obscur, impécunieux et ambitieux naturaliste passionné de 23 ans. le jeune homme part herboriser au Sénégal tout en étant plus ou moins mandaté comme espion par la très puissante et richissime compagnie des Indes. Cependant, dans le premier chapitre, c'est à la veille de sa mort qu'un narrateur à la troisième personne nous donne à voir Michel Adanson (1727-1806). Perclus d'arthrose, assez fragile pour que son fémur se brise tout seul, l'homme se remémore sa jeunesse. Il veut expliquer à Aglaé, sa fille qu'il a quasiment ignorée jusqu'alors, ses aventures africaines et lui raconter, dans les cahiers qu'il écrira pendant sa brève convalescence, l'extraordinaire histoire dont il n'a pas dit un mot dans son ouvrage publié sur le Sénégal. le narrateur nous présente ensuite Aglaé, jeune femme résolue, en apparence aussi indépendante qu'on peut l'être à l'époque. Elle recueille l'héritage hétéroclite de son père, et finit par découvrir au milieu de son bric-à-brac un maroquin rouge contenant les cahiers qu'il a écrits juste avant sa mort. C'est à la première personne que David Diop nous raconte la passionnante aventure de Michel Adanson en s'adressant souvent directement à Aglaé.
***
« David Diop naît à Paris et passe une partie de sa jeunesse au Sénégal avant de revenir en France pour ses études » nous dit Wikipédia. L'auteur a assurément exploitée cette double culture tout en utilisant ses connaissances de spécialiste du XVIIIe siècle. Il a choisi de nous présenter le Sénégal par les yeux d'un jeune savant français de l'époque, qui se comporte parfois comme un Candide, mais aussi parfois comme un jeune homme infantile et capricieux. Ndiak, le jeune garçon dont on lui impose la présence, fils d'un roi, semble jouer tantôt Cacambo, tantôt Martin, et il se révèlera d'une aide précieuse pendant le voyage d'Adanson. La recherche de Maram, celle qu'on appelle « la Revenante », la seule à avoir passé dans l'autre sens la porte du voyage sans retour, se révélera pleine de surprises. En fait, cette quête sert de prétexte à la présentation du Sénégal tel qu'il était à cette époque. Adanson fait l'effort d'apprendre le wolof, et sa connaissance de la langue locale favorisera son immersion dans la culture sénégalaise. S'il garde un oeil critique, il a l'esprit assez ouvert pour respecter les coutumes et les croyances des autochtones. Les ravages de la traite des esclaves sont omniprésents, et les responsabilités des potentats locaux ne sont pas occultées. On découvre des dirigeants français particulièrement odieux, occupés à s'enrichir et à assurer leur carrière future en France, et on comprend à demi-mot que les Anglais n'ont rien à leur envier…
***
J'ai beaucoup aimé cette aventure romanesque pour ne pas dire romantique (le parallèle avec l'Orphée et Eurydice de Gluck), mais je suis malgré tout restée sur ma faim ! La langue de David Diop est un vrai régal. Si la musicalité est moins prégnante dans ce roman que dans Frère d'âme, la beauté des descriptions, la justesse des dialogues et la pertinence des aphorismes constituent de remarquables atouts.
C'est avec plaisir et délectation que je me lançais dans la lecture de la porte du voyage sans retour de David Diop.
J'avais beaucoup aimé le roman précédent de David Diop Frère. d'Âme.
Le titre du roman est évocateur : La porte du voyage sans retour. Pour ceux qui connaissent Gorée au Sénégal , le titre ne peut être plus évocateur. Cette porte qui donne directement sur l'immensité de l'Océan Atlantique et sur l'inconnu. Des millions d'Africains ont passé cette porte pour le voyage de l'esclavagisme.
Pour nous emmener dans ce terrible voyage , David Diop a convoqué Michel Adanson ,botaniste dans les années 1750, sa fille Aglaé, Maram jeune africaine promise à l'esclavage.
Dans un carnet que retrouve Aglaé après la mort de son père , celui ci a consigné ses souvenirs , secrets et mystères lors de son séjour au Sénégal entre 1749 et 1754.
A la sortie de cette lecture , je n'ai pas réussi à m'attacher au livre , je suis resté à distance.
J'ai lu nombre de criques sur Babélio qui encense le livre . Je les comprends . J'ai ressenti comme ces Babéliotes l'âme et l'envoûtement que portent Maram et le Sénégal. J'ai été sensible aux rabs , aux griots et à la monstrueuse peau de boa.
J'ai été conquis par les nuits et les ciels sénégalais.
Et pourtant je n'ai pas accroché à l'histoire.
Peut être en attendais je trop , peut être étais je encore dans le souffle de Frère d'âme.
J'attendais un livre sur le départ , l'exil , l'esclavagisme au sens large , pas une histoire d'amour fût elle poignante.
Reste un livre agréable mais qui ne restera pas gravé dans ma mémoire.
Lien : https://auventdesmots.wordpr..
J'avais beaucoup aimé le roman précédent de David Diop Frère. d'Âme.
Le titre du roman est évocateur : La porte du voyage sans retour. Pour ceux qui connaissent Gorée au Sénégal , le titre ne peut être plus évocateur. Cette porte qui donne directement sur l'immensité de l'Océan Atlantique et sur l'inconnu. Des millions d'Africains ont passé cette porte pour le voyage de l'esclavagisme.
Pour nous emmener dans ce terrible voyage , David Diop a convoqué Michel Adanson ,botaniste dans les années 1750, sa fille Aglaé, Maram jeune africaine promise à l'esclavage.
Dans un carnet que retrouve Aglaé après la mort de son père , celui ci a consigné ses souvenirs , secrets et mystères lors de son séjour au Sénégal entre 1749 et 1754.
A la sortie de cette lecture , je n'ai pas réussi à m'attacher au livre , je suis resté à distance.
J'ai lu nombre de criques sur Babélio qui encense le livre . Je les comprends . J'ai ressenti comme ces Babéliotes l'âme et l'envoûtement que portent Maram et le Sénégal. J'ai été sensible aux rabs , aux griots et à la monstrueuse peau de boa.
J'ai été conquis par les nuits et les ciels sénégalais.
Et pourtant je n'ai pas accroché à l'histoire.
Peut être en attendais je trop , peut être étais je encore dans le souffle de Frère d'âme.
J'attendais un livre sur le départ , l'exil , l'esclavagisme au sens large , pas une histoire d'amour fût elle poignante.
Reste un livre agréable mais qui ne restera pas gravé dans ma mémoire.
Lien : https://auventdesmots.wordpr..
Voici un roman comme un voyage qui a bercé mon coeur d'une façon si touchante.
C'est l'histoire d'un botaniste français qui se laisse dépasser par sa passion pour la nature, passion qui lui coûte avant tout sa famille, car la distance entre lui, sa femme et sa fille Aglaé se creuse petit à petit. Après sa mort, Aglaé découvre les cahiers intimes de son père où il raconte son voyage au Sénégal, voyage qui l'a consumé à petit feu, car ce voyage cache une vérité sombre et un amour sans frontières.
Dans le pays ou le soleil brûle les peaux et les hibiscus fleurissent dans une totale indifférence au monde qui les entourent, le botaniste part a la recherche d'une jeune négresse disparue, la belle Maram, dont le fantôme revient hanter les lieux. Ce voyage presque à l'aveuglette le conduira droit dans la souffrance et dans la mort.
L'auteur nous prouve une fois de plus sa passion dévorante pour la culture de ce pays , ses croyances, pour ses traditions, ainsi que la fascination qu'il a pour ce peuple qui fut longtemps sous le joug de l'esclavage. Sa plume est remplie de poésie et de douceur, son récit prend l'allure d'un conte hors du temps, un conte africain. J'ai dégusté les phrases et je me suis laissée entourer par la nature qui m'accueille comme un berceau.
David Diop nous laisse découvrir une partie de la vie d'un naturaliste oublié, avant tout pour nous parler de ses craintes face à la réalité de l'esclavage. Lui, l'Européen qui a appris tant bien que mal le wolof pour mieux s'imprégner de la culture de ce peuple, aurait aimé surtout tel Orphée sauver son amour Eurydice des ténèbres.
C'est l'histoire d'un botaniste français qui se laisse dépasser par sa passion pour la nature, passion qui lui coûte avant tout sa famille, car la distance entre lui, sa femme et sa fille Aglaé se creuse petit à petit. Après sa mort, Aglaé découvre les cahiers intimes de son père où il raconte son voyage au Sénégal, voyage qui l'a consumé à petit feu, car ce voyage cache une vérité sombre et un amour sans frontières.
Dans le pays ou le soleil brûle les peaux et les hibiscus fleurissent dans une totale indifférence au monde qui les entourent, le botaniste part a la recherche d'une jeune négresse disparue, la belle Maram, dont le fantôme revient hanter les lieux. Ce voyage presque à l'aveuglette le conduira droit dans la souffrance et dans la mort.
L'auteur nous prouve une fois de plus sa passion dévorante pour la culture de ce pays , ses croyances, pour ses traditions, ainsi que la fascination qu'il a pour ce peuple qui fut longtemps sous le joug de l'esclavage. Sa plume est remplie de poésie et de douceur, son récit prend l'allure d'un conte hors du temps, un conte africain. J'ai dégusté les phrases et je me suis laissée entourer par la nature qui m'accueille comme un berceau.
David Diop nous laisse découvrir une partie de la vie d'un naturaliste oublié, avant tout pour nous parler de ses craintes face à la réalité de l'esclavage. Lui, l'Européen qui a appris tant bien que mal le wolof pour mieux s'imprégner de la culture de ce peuple, aurait aimé surtout tel Orphée sauver son amour Eurydice des ténèbres.
En 1806, à la mort de son père, Michel Adanson, sa fille Aglaé découvre les carnets de voyage de ce dernier. Botaniste passionné, ayant rêvé un temps de réaliser une encyclopédie universelle du vivant, Michel Adanson a dans sa jeunesse voyagé au Sénégal. Lorsqu'il y débarque en 1750, son objectif est d'étudier la flore locale, souhaitant répertorier le maximum d'espèces. Mais ce voyage à but scientifique va être bouleversé lorsqu'il apprend l'histoire d'une esclave qui se serait enfuie et réfugiée dans un petit village sénégalais. Intrigué, Michel Adanson va partir en quête de cette mystérieuse femme dont il ne sait si l'histoire est réelle ou légendaire.
En s'inspirant d'un personnage réel, Michel Adanson (1727-1806), David Diop nous entraîne aux confins des terres sénégalaises du 18e siècle. En suivant le périple du naturaliste, c'est tout un pan de l'histoire du Sénégal que nous découvrons. Economie de traite, rivalités franco-anglaises, arrangements avec les petits royaumes… le pays africain, concession française, est une manne pour le royaume de France qui tire bénéfice du commerce triangulaire. En ce siècle prometteur des Lumières, c'est une triste réalité que découvre alors Michel Adanson, qui s'émerveille en parallèle de la richesse des peuples autochtones et de la beauté de leur langue, le wolof, dont il finit par s'imprégner totalement. Ainsi, l'histoire de Maram, entre superstition et réalité, s'apparente aux contes que l'on peut entendre de la bouche des griots. Liée à celle ensuite d'Adanson, leur histoire apporte un souffle terriblement romantique et met à bas les préjugés de l'époque.
Avec « La porte du voyage sans retour », David Diop redonne vie à ces milliers d'enfants, de femmes et d'hommes déracinés et morts en esclaves. Toujours dans l'exigence de l'écriture, il rend également honneur à la langue de son pays d'origine où l'oralité est la transmission de tout savoir et mère de toute compréhension. Enfin, il restitue à merveille la transmission qui se fait entre un père et sa fille. Aglaé découvre sur le tard l'homme qu'était son père et cela en est d'autant plus poignant.
J'ai juste un regret sur la fin de l'histoire que je n'ai pas vraiment saisie...
Mais au final, voici un beau voyage qu'il ne faut pas manquer.
En s'inspirant d'un personnage réel, Michel Adanson (1727-1806), David Diop nous entraîne aux confins des terres sénégalaises du 18e siècle. En suivant le périple du naturaliste, c'est tout un pan de l'histoire du Sénégal que nous découvrons. Economie de traite, rivalités franco-anglaises, arrangements avec les petits royaumes… le pays africain, concession française, est une manne pour le royaume de France qui tire bénéfice du commerce triangulaire. En ce siècle prometteur des Lumières, c'est une triste réalité que découvre alors Michel Adanson, qui s'émerveille en parallèle de la richesse des peuples autochtones et de la beauté de leur langue, le wolof, dont il finit par s'imprégner totalement. Ainsi, l'histoire de Maram, entre superstition et réalité, s'apparente aux contes que l'on peut entendre de la bouche des griots. Liée à celle ensuite d'Adanson, leur histoire apporte un souffle terriblement romantique et met à bas les préjugés de l'époque.
Avec « La porte du voyage sans retour », David Diop redonne vie à ces milliers d'enfants, de femmes et d'hommes déracinés et morts en esclaves. Toujours dans l'exigence de l'écriture, il rend également honneur à la langue de son pays d'origine où l'oralité est la transmission de tout savoir et mère de toute compréhension. Enfin, il restitue à merveille la transmission qui se fait entre un père et sa fille. Aglaé découvre sur le tard l'homme qu'était son père et cela en est d'autant plus poignant.
J'ai juste un regret sur la fin de l'histoire que je n'ai pas vraiment saisie...
Mais au final, voici un beau voyage qu'il ne faut pas manquer.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de David Diop (3)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3248 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3248 lecteurs ont répondu