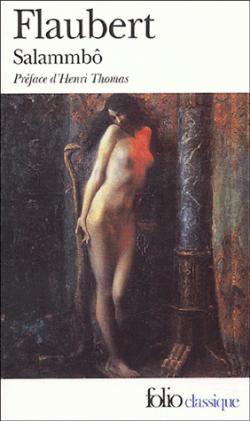>
Critique de EtienneBernardLivres
(Une des critiques littéraire de 1862)
Imaginez un modeste volume arrivant au public avec un nom obscur et un titre tel que celui-ci : « Etude d'après Polybe sur la guerre des Mercenaires, épisode de l'histoire de Carthage (-241-238 avant J.C) », l'indifférence du public était acquise d'avance à l'auteur et à son oeuvre.
Au contraire, voyez salammbô. salammbô ! Un nom rempli de mystère, associé au nom retentissant de M. Gustave Flaubert ! salammbô, cette histoire ou cette légende retrouvée dans les profondeurs des siècles ; un rêve de volupté orientale, ressaisi par une science presque magique, dans le lointain des civilisations évanouies, rendu 1000 fois plus piquant encore par la nouveauté des moeurs, des sites, des climats.
Tant d'attraits réunis : la surprise pressentie des yeux et des esprits jointe à l'étrange séduction, moins littéraire que sensuelle, du souvenir de Mme Bovary ! Voilà ce qu'on disait, ce qu'on espérait ; et même avant que le livre parût, son succès n'était pas douteux.
On sait que Carthage, cette Venise africaine, formait ses armées de mercenaires qu'elle allait recruter, avec ses flottes, au bord de toutes les mers. Dans la triple enceinte de ses murs, elle rassemblait, à certains jours où la guerre commençait, des bataillons de toutes les origines, de toutes les armes, de toutes les langues. Il y avait des milliers de Numides et de Maures, des milliers d'Ibères, de Gaulois et de Ligures, des milliers de frondeurs baléares et de Grecs (…)
Etrange et formidable rassemblement de population historiques ou fabuleuses, accourues des contrées les plus diverses et les plus lointaines. La riche Carthage achetait le sang d'une partie du monde et le versait à flots sur tous les rivages où elle avait un comptoir à établir, un commerce rival à ruiner. Ce n'était pas le sang de la patrie qui coulait sur les champs de de bataille : c'était son or.
Que lui importait ces torrents de sang barbare dont elle inondait la Sicile, pourvu que ces vaisseaux fussent maîtres des rivages et des mers ?
Mais, une fois la guerre achevée, la paix rejetait ces cohortes mercenaires sur Carthage, qui frémissait de les voir revenir affamées et avides.
De là de fréquents révoltes, dont la plus terrible est celle que nous décrit M. Flaubert et qu'on appela la guerre inexpiable. Elle éclata entre la 1er et la 2ème guerre punique, et ne fut étouffée que sous le poids des hécatombes humaines.
Mâtho et Spendius, un Africain et un esclave fugitif de Rome, furent les chefs de cette grande révolte. Un suffète (magistrat), Hannon, fut égorgé et mis en croix.
Il ne fallut rien moins que l'épée d'Hamilcar pour avoir raison des rebelles. Il les enferma dans le défilé de la Hache et en massacra 40 000 en un seul jour. Une dernière bataille lui livra Mâtho, qui périt sous les coups de la populace, dont une fête horrible où les Carthaginois vainqueurs montrèrent une barbarie égale à celle des vaincus.
Voilà la trame des événements, telle que l'histoire la livrait à la fantaisie du poète.
Il faut reconnaître que M. Flaubert, avec l'instinct d'un art élevé, s'est appliqué à ne pas trop déconcerter nos souvenirs et qu'il a su conserver les grandes lignes de l'histoire dans leur tragique simplicité. le détail est orné jusqu'à l'excès : le fond n'est pas sensiblement altéré.
Mâtho et Spendius sont restés au premier rang dans le roman, comme ils y sont dans l'histoire. La grande figure d'Hamilcar Barca les domine tous. Hannibal, enfant, se montre à ses côtés. La seule création véritable, parmi les personnages, c'est la soeur d'Hannibal, la belle salammbô. Mais, la véritable héroïne du roman, c'est l'héroïne donnée par l'histoire, Carthage elle-même, avec son luxe et ses richesses incroyables, avec ses statues en or pur, ses temples couverts de lames d'or ; avec les quatre étages de ses tours et ses trois enceintes hautes de trente coudées ; avec ses remparts gigantesques dont l'épaisseur abriterait des écuries pour 300 éléphants et 4000 chevaux, des casernes pour 80.000 soldats ; avec ses ports et ses jetées colossales dont la mer, après 2000 ans, n'a pas encore usé les dernières assises : avec ses entrepôts immenses où étaient enfouis les produits et les tributs du monde.
Voilà ce qui a tenté l'imagination de M.Flaubert, et ce n'est pas seulement dans la reconstruction de la ville que s'est déployé son talent, c'est aussi dans la peinture des mourus politiques de Carthage, des dissensions violentes de ses citoyens, de sa construction jalouse et défiante, de ses moues fastueuses et bizarres. C'est toute une renaissance matérielle et morale ; ce n'est rien moins que la résurrection d'une civilisation morte.
Cette oeuvre s'analyse sans aucune peine. C'est comme un panorama historique illustré, qui se déroule devant nos yeux en scènes parfaitement distinctes, en tableaux mobiles et détachés, comme au théâtre. On pourrait en marquer les principaux aspects, successivement déroulés devant nous, en les séparant par des titres particuliers.
- Premier tableau : Le Festin. Les mercenaires se livrent à une monstrueuse orgie dans les jardins d'Hamilcar, absent. Déjà une sourde colère agite ces âmes barbares. On pressent la perfidie de Carthage, la fureur de ces foules armées. A l'heure où l'ivresse se déchaîne et s'anime jusqu'au sacrilège, voici que du faîte de son palais descend la fille d'Hamilcar, la vierge vouée à la Vénus carthaginoise, à l'équivoque déesse, à Tanit, avec son escorte de prêtre eunuques.
Elle calme par des chants divins le grossier délire de ces brutes repues de viandes et de vins, et se retire à pas lents, laissant derrière elle comme une flamme invisible, dont deux de ces barbares vont être dévorés, Narr'Havas, le jeune roi des Numides, et le terrible Mâtho.
- 2ème tableau : L'armée des mercenaires à Sicca. le conseil des Anciens obtient, à force de promesses, que les chefs des mercenaires emmèneront à quatre journées de Carthage ses terribles hôtes qui finissaient par affamer et ruiner la ville. Nous assistons au défilé de toutes les populations connues dans ces temps-là. C'est un véritable ouragan d'hommes. L'amour de Mâtho s'exalte de plus en plus par l'absence. Spendius, le Grec, un rusé, un esclave savant et corrompu, excite, aiguillonne sa fureur et la dirige où il veut, du côté de Carthage. (…)
Pendant que les barbares prennent les armes, salammbô, comme une victime prédestinée à d'étranges sacrifices, s'agite et s'inquiète. Sa virginité est vaguement troublée par la curiosité des mystères de la déesse Tanit ; elle est impatiente des révélations du grand-prêtre, elle les sollicite et s'étonne de les trouver toujours vagues et fuyantes. Un mal inconnu l'accable. (…)
Mais déjà les mercenaires sont sous les murs. C'est ici que l'auteur place la description de Carthage, de ses remparts, de son acropole, de ses marchés. La révolte éclate. Des scènes effroyables se succèdent. Nous entendons de toutes parts les cris, le bruit des armes, le fracas de la guerre barbare. Spendius, en promettant à Mâtho de lui faire revoir salammbô, s'introduit la nuit avec lui à Carthage, par le canal du grand aqueduc, pénètre dans le temple de Tanit, où repose le Voile sacré, le Zaïmph, le palladium de la république.
Mâtho l'enlève, s'en enveloppe, apparaît un instant aux yeux épouvantés de salammbô, sur le seuil de la chambre virginale, dans la gloire sinistre de son sacrilège, et transporte dans le camp des barbares ce gage de la fortune de Carthage.
Les provinces sujettes se joignent aux mercenaires. Hannon est écrasé. Par bonheur, Hamilcar arrive. Ce ne sera pas trop du courage de ce grand homme de guerre et du dévouement de sa fille pour sauver des derniers désastres.
Tandis qu'Hamilcar tient la campagne avec des peines inouïes contre l'innombrable armée des barbares, des paroles vagues d'abord, puis précises, du grand prêtre, préparent salammbô à son rôle.
Elle sera la Judith de Carthage, Judith, moins l'assassinat.
Elle doit (les dieux le veulent) reconquérir le voile sacré en se donnant elle-même à Mâtho. Ce n'est pas à un prix moindre que Carthage peut-être sauvée.
Dès lors, le sacrifice accompli et raconté jusqu'au bout, avec une abondance extraordinaire de détails, tout change. La fortune de la patrie se relève, les mercenaires sont écrasés. On célèbre les fiançailles de salammbô avec le chef des Numides, Narr'Havas ; c'est la rançon dont Hamilcar paye la trahison du jeune roi. La mort de Matô, captif promis à la fureur et aux coups du peuple, marquera l'heure de la cérémonie. Il vient mourir aux pieds du trône où siège salammbô.
Mais elle-même n'appartient plus à la terre, elle tombe ! Tanit, la terrible déesse de la volupté et de la mort, l'a prise. Elle ne survivra pas à son barbare amant, massacré sous ses yeux.
Dans tout cela, dira-t-on, où est le roman ? (…) Ce serait un poème plutôt, ou un drame, réglé par l'implacable Nécessité. Mâtho est saisi d'une sorte de furieux délire à l'aspect et au nom de salammbô. C'est une possession plus encore qu'une passion. salammbô a horreur de ce Mâtho auquel elle vient se livrer. Quand elle cède en frémissant à ses sauvages étreintes, elle le maudit encore, mais elle obéit à l'ordre secret des dieux avec une sorte d'innocence inspirée et subjuguée ; c'est une profanation mystique qu'elle subit avec épouvante. Il n'y a, en tout cela, d'émotion que la curiosité étonnée, ou les orages des sens. Les émotions du coeur n'y sont nulle part.
Que faut-il donc chercher dans ce livre ?
- Des portraits d'abord : ceux de Spendius, de Mâtho, d'Hamilcar, d'Hannibal, qu'on aperçoit de loin en loin, et sur le front duquel tombe déjà le rayon sacré : de salammbô enfin, en qui s'agite l'inquiète et douce folie des victimes désignées par les dieux.
- Des scènes ensuite ; il y a en de fort belles. Les plus remarquables, à mon sens, sont l'invasion nocturne du temple de Tanit, dont l'horreur sacrée pénètre l'âme de Mâtho, et toutes les scènes qui suivent le retour d'Hamilcar à Carthage : la revue de ses vastes domaines, de ses richesses, de ses esclaves : l'examen qu'il fait de la gestion de ses intendants ; le dédain qui se révèle dans ses attitudes et dans ses paroles pour ses lâches concitoyens ; l'empire que prend sur eux cette âme forte ; sa lutte au milieu des Anciens contre l'envie furieuse qui veut l'accabler ; ses doutes sur la vertu de sa fille, sa colère gigantesque, sa dictature. Il y a dans toutes ces scènes qui se succèdent, je ne sais quelle grandeur et quelle simplicité qui saisissent l'imagination. (…)
M. Flaubert sait beaucoup de choses sur cet épisode de l'histoire de Carthage et sur toute cette histoire en général. Il a épuisé à peu près tout ce qui a été écrit touchant cette civilisation singulière ; il en possède à fond les détails. Tous les vocabulaires lui sont familiers. Mais il en abuse. Il a la faiblesse de ne vouloir rien perdre de ce qu'il a appris avec tant de peines et de soins. Il trouve le moyen d'utiliser aussi bien sa science du bric-à-brac carthaginois que les parties les plus élevées de son érudition. (…) le réalisme érudit n'est pas sans quelque vague parenté avec le pédantisme. N'est-ce pas toujours le même principe : ne faire grâce à ses lecteurs d'aucune preuve de son travail et de son savoir-faire ?
(…)
Après tout, sachons gré à M. Flaubert d'avoir visé haut et d'avoir souvent atteint son but ; il nous a rendu l'impression éclatante et vive de l'antique Carthage.
(Elme-Marie Caro, journal La France du 9 décembre 1862)
Imaginez un modeste volume arrivant au public avec un nom obscur et un titre tel que celui-ci : « Etude d'après Polybe sur la guerre des Mercenaires, épisode de l'histoire de Carthage (-241-238 avant J.C) », l'indifférence du public était acquise d'avance à l'auteur et à son oeuvre.
Au contraire, voyez salammbô. salammbô ! Un nom rempli de mystère, associé au nom retentissant de M. Gustave Flaubert ! salammbô, cette histoire ou cette légende retrouvée dans les profondeurs des siècles ; un rêve de volupté orientale, ressaisi par une science presque magique, dans le lointain des civilisations évanouies, rendu 1000 fois plus piquant encore par la nouveauté des moeurs, des sites, des climats.
Tant d'attraits réunis : la surprise pressentie des yeux et des esprits jointe à l'étrange séduction, moins littéraire que sensuelle, du souvenir de Mme Bovary ! Voilà ce qu'on disait, ce qu'on espérait ; et même avant que le livre parût, son succès n'était pas douteux.
On sait que Carthage, cette Venise africaine, formait ses armées de mercenaires qu'elle allait recruter, avec ses flottes, au bord de toutes les mers. Dans la triple enceinte de ses murs, elle rassemblait, à certains jours où la guerre commençait, des bataillons de toutes les origines, de toutes les armes, de toutes les langues. Il y avait des milliers de Numides et de Maures, des milliers d'Ibères, de Gaulois et de Ligures, des milliers de frondeurs baléares et de Grecs (…)
Etrange et formidable rassemblement de population historiques ou fabuleuses, accourues des contrées les plus diverses et les plus lointaines. La riche Carthage achetait le sang d'une partie du monde et le versait à flots sur tous les rivages où elle avait un comptoir à établir, un commerce rival à ruiner. Ce n'était pas le sang de la patrie qui coulait sur les champs de de bataille : c'était son or.
Que lui importait ces torrents de sang barbare dont elle inondait la Sicile, pourvu que ces vaisseaux fussent maîtres des rivages et des mers ?
Mais, une fois la guerre achevée, la paix rejetait ces cohortes mercenaires sur Carthage, qui frémissait de les voir revenir affamées et avides.
De là de fréquents révoltes, dont la plus terrible est celle que nous décrit M. Flaubert et qu'on appela la guerre inexpiable. Elle éclata entre la 1er et la 2ème guerre punique, et ne fut étouffée que sous le poids des hécatombes humaines.
Mâtho et Spendius, un Africain et un esclave fugitif de Rome, furent les chefs de cette grande révolte. Un suffète (magistrat), Hannon, fut égorgé et mis en croix.
Il ne fallut rien moins que l'épée d'Hamilcar pour avoir raison des rebelles. Il les enferma dans le défilé de la Hache et en massacra 40 000 en un seul jour. Une dernière bataille lui livra Mâtho, qui périt sous les coups de la populace, dont une fête horrible où les Carthaginois vainqueurs montrèrent une barbarie égale à celle des vaincus.
Voilà la trame des événements, telle que l'histoire la livrait à la fantaisie du poète.
Il faut reconnaître que M. Flaubert, avec l'instinct d'un art élevé, s'est appliqué à ne pas trop déconcerter nos souvenirs et qu'il a su conserver les grandes lignes de l'histoire dans leur tragique simplicité. le détail est orné jusqu'à l'excès : le fond n'est pas sensiblement altéré.
Mâtho et Spendius sont restés au premier rang dans le roman, comme ils y sont dans l'histoire. La grande figure d'Hamilcar Barca les domine tous. Hannibal, enfant, se montre à ses côtés. La seule création véritable, parmi les personnages, c'est la soeur d'Hannibal, la belle salammbô. Mais, la véritable héroïne du roman, c'est l'héroïne donnée par l'histoire, Carthage elle-même, avec son luxe et ses richesses incroyables, avec ses statues en or pur, ses temples couverts de lames d'or ; avec les quatre étages de ses tours et ses trois enceintes hautes de trente coudées ; avec ses remparts gigantesques dont l'épaisseur abriterait des écuries pour 300 éléphants et 4000 chevaux, des casernes pour 80.000 soldats ; avec ses ports et ses jetées colossales dont la mer, après 2000 ans, n'a pas encore usé les dernières assises : avec ses entrepôts immenses où étaient enfouis les produits et les tributs du monde.
Voilà ce qui a tenté l'imagination de M.Flaubert, et ce n'est pas seulement dans la reconstruction de la ville que s'est déployé son talent, c'est aussi dans la peinture des mourus politiques de Carthage, des dissensions violentes de ses citoyens, de sa construction jalouse et défiante, de ses moues fastueuses et bizarres. C'est toute une renaissance matérielle et morale ; ce n'est rien moins que la résurrection d'une civilisation morte.
Cette oeuvre s'analyse sans aucune peine. C'est comme un panorama historique illustré, qui se déroule devant nos yeux en scènes parfaitement distinctes, en tableaux mobiles et détachés, comme au théâtre. On pourrait en marquer les principaux aspects, successivement déroulés devant nous, en les séparant par des titres particuliers.
- Premier tableau : Le Festin. Les mercenaires se livrent à une monstrueuse orgie dans les jardins d'Hamilcar, absent. Déjà une sourde colère agite ces âmes barbares. On pressent la perfidie de Carthage, la fureur de ces foules armées. A l'heure où l'ivresse se déchaîne et s'anime jusqu'au sacrilège, voici que du faîte de son palais descend la fille d'Hamilcar, la vierge vouée à la Vénus carthaginoise, à l'équivoque déesse, à Tanit, avec son escorte de prêtre eunuques.
Elle calme par des chants divins le grossier délire de ces brutes repues de viandes et de vins, et se retire à pas lents, laissant derrière elle comme une flamme invisible, dont deux de ces barbares vont être dévorés, Narr'Havas, le jeune roi des Numides, et le terrible Mâtho.
- 2ème tableau : L'armée des mercenaires à Sicca. le conseil des Anciens obtient, à force de promesses, que les chefs des mercenaires emmèneront à quatre journées de Carthage ses terribles hôtes qui finissaient par affamer et ruiner la ville. Nous assistons au défilé de toutes les populations connues dans ces temps-là. C'est un véritable ouragan d'hommes. L'amour de Mâtho s'exalte de plus en plus par l'absence. Spendius, le Grec, un rusé, un esclave savant et corrompu, excite, aiguillonne sa fureur et la dirige où il veut, du côté de Carthage. (…)
Pendant que les barbares prennent les armes, salammbô, comme une victime prédestinée à d'étranges sacrifices, s'agite et s'inquiète. Sa virginité est vaguement troublée par la curiosité des mystères de la déesse Tanit ; elle est impatiente des révélations du grand-prêtre, elle les sollicite et s'étonne de les trouver toujours vagues et fuyantes. Un mal inconnu l'accable. (…)
Mais déjà les mercenaires sont sous les murs. C'est ici que l'auteur place la description de Carthage, de ses remparts, de son acropole, de ses marchés. La révolte éclate. Des scènes effroyables se succèdent. Nous entendons de toutes parts les cris, le bruit des armes, le fracas de la guerre barbare. Spendius, en promettant à Mâtho de lui faire revoir salammbô, s'introduit la nuit avec lui à Carthage, par le canal du grand aqueduc, pénètre dans le temple de Tanit, où repose le Voile sacré, le Zaïmph, le palladium de la république.
Mâtho l'enlève, s'en enveloppe, apparaît un instant aux yeux épouvantés de salammbô, sur le seuil de la chambre virginale, dans la gloire sinistre de son sacrilège, et transporte dans le camp des barbares ce gage de la fortune de Carthage.
Les provinces sujettes se joignent aux mercenaires. Hannon est écrasé. Par bonheur, Hamilcar arrive. Ce ne sera pas trop du courage de ce grand homme de guerre et du dévouement de sa fille pour sauver des derniers désastres.
Tandis qu'Hamilcar tient la campagne avec des peines inouïes contre l'innombrable armée des barbares, des paroles vagues d'abord, puis précises, du grand prêtre, préparent salammbô à son rôle.
Elle sera la Judith de Carthage, Judith, moins l'assassinat.
Elle doit (les dieux le veulent) reconquérir le voile sacré en se donnant elle-même à Mâtho. Ce n'est pas à un prix moindre que Carthage peut-être sauvée.
Dès lors, le sacrifice accompli et raconté jusqu'au bout, avec une abondance extraordinaire de détails, tout change. La fortune de la patrie se relève, les mercenaires sont écrasés. On célèbre les fiançailles de salammbô avec le chef des Numides, Narr'Havas ; c'est la rançon dont Hamilcar paye la trahison du jeune roi. La mort de Matô, captif promis à la fureur et aux coups du peuple, marquera l'heure de la cérémonie. Il vient mourir aux pieds du trône où siège salammbô.
Mais elle-même n'appartient plus à la terre, elle tombe ! Tanit, la terrible déesse de la volupté et de la mort, l'a prise. Elle ne survivra pas à son barbare amant, massacré sous ses yeux.
Dans tout cela, dira-t-on, où est le roman ? (…) Ce serait un poème plutôt, ou un drame, réglé par l'implacable Nécessité. Mâtho est saisi d'une sorte de furieux délire à l'aspect et au nom de salammbô. C'est une possession plus encore qu'une passion. salammbô a horreur de ce Mâtho auquel elle vient se livrer. Quand elle cède en frémissant à ses sauvages étreintes, elle le maudit encore, mais elle obéit à l'ordre secret des dieux avec une sorte d'innocence inspirée et subjuguée ; c'est une profanation mystique qu'elle subit avec épouvante. Il n'y a, en tout cela, d'émotion que la curiosité étonnée, ou les orages des sens. Les émotions du coeur n'y sont nulle part.
Que faut-il donc chercher dans ce livre ?
- Des portraits d'abord : ceux de Spendius, de Mâtho, d'Hamilcar, d'Hannibal, qu'on aperçoit de loin en loin, et sur le front duquel tombe déjà le rayon sacré : de salammbô enfin, en qui s'agite l'inquiète et douce folie des victimes désignées par les dieux.
- Des scènes ensuite ; il y a en de fort belles. Les plus remarquables, à mon sens, sont l'invasion nocturne du temple de Tanit, dont l'horreur sacrée pénètre l'âme de Mâtho, et toutes les scènes qui suivent le retour d'Hamilcar à Carthage : la revue de ses vastes domaines, de ses richesses, de ses esclaves : l'examen qu'il fait de la gestion de ses intendants ; le dédain qui se révèle dans ses attitudes et dans ses paroles pour ses lâches concitoyens ; l'empire que prend sur eux cette âme forte ; sa lutte au milieu des Anciens contre l'envie furieuse qui veut l'accabler ; ses doutes sur la vertu de sa fille, sa colère gigantesque, sa dictature. Il y a dans toutes ces scènes qui se succèdent, je ne sais quelle grandeur et quelle simplicité qui saisissent l'imagination. (…)
M. Flaubert sait beaucoup de choses sur cet épisode de l'histoire de Carthage et sur toute cette histoire en général. Il a épuisé à peu près tout ce qui a été écrit touchant cette civilisation singulière ; il en possède à fond les détails. Tous les vocabulaires lui sont familiers. Mais il en abuse. Il a la faiblesse de ne vouloir rien perdre de ce qu'il a appris avec tant de peines et de soins. Il trouve le moyen d'utiliser aussi bien sa science du bric-à-brac carthaginois que les parties les plus élevées de son érudition. (…) le réalisme érudit n'est pas sans quelque vague parenté avec le pédantisme. N'est-ce pas toujours le même principe : ne faire grâce à ses lecteurs d'aucune preuve de son travail et de son savoir-faire ?
(…)
Après tout, sachons gré à M. Flaubert d'avoir visé haut et d'avoir souvent atteint son but ; il nous a rendu l'impression éclatante et vive de l'antique Carthage.
(Elme-Marie Caro, journal La France du 9 décembre 1862)