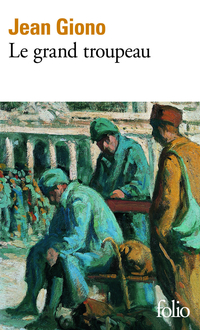>
Critique de bgbg
Roman paru en 1931, un des premiers publiés par l'auteur, consécutif à sa participation à la Grande Guerre, qui lui a permis de réaliser les atrocités subies sur le front et de consolider sa stature de pacifiste résolu.
On est en août 1914, village de Valensole, aujourd'hui dans les Alpes de Haute Provence. le roman voit au début le déferlement d'un immense troupeau d'ovins, conduit par Thomas, vieux berger, avec à leur tête un bélier blessé, saignant ; les bêtes paraissent éprouvées, beaucoup sont mortes, abandonnées au long de la route. Les bergers les plus jeunes ont été mobilisés. Thomas confie le bélier au papé pour qu'il le soigne.
Les personnages appartiennent à deux familles : autour du vieux père, Jérôme, Joseph son fils, sa femme Sylvia et sa jeune soeur Madeleine. La deuxième famille comprend le papé, Delphine et leur fils Olivier, fiancé à Madeleine. Les hommes sont des paysans, petits cultivateurs et éleveurs, les femmes remplacent les jeunes quand ils partent au front.
À part, Burle, vieux berger, révolté intégral et isolé, incarne les pensées de l'auteur par son rejet de guerre et son exaltation de la vie, source de bonheur et de plaisir par le travail qu'elle permet. Il n'a pas eu d'enfants et en souffre, même s'il accuse les autres d'envoyer les leurs au combat mortel.
L'auteur alterne les récits des hommes partis au front et de ceux - femmes et vieillards - restés dans les fermes. Joseph et Olivier d'un côté, exposés à tous les dangers du combat, Julia et Madeleine de l'autre, sous le même toit, anxieuses dans l'attente de nouvelles de leurs hommes. La guerre est dans tous les esprits, avec la crainte de la mort et le réconfort à la pensée de l'être aimé.
Au front Joseph, parti le premier, veille sur deux blessés dans l'attente d'un voiture-ambulance qui ne viendra pas. Il réconforte Jules agonisant, lui promettant de lui faire goûter la confiture de noix de sa ferme.
Au village, a lieu une veillée “à corps absent“ en l'honneur d'Arthur, mort au combat, tandis qu'Olivier s'apprête à partir. Il retrouve Joseph, blessé à un bras. Alors qu'en reconnaissance il essuie une pluie d'obus, Olivier participe à une attaque responsable de la mort de deux de ses proches : l'un a été broyé par une bombe, l'autre, Regotaz, l'amoureux des arbres, n'a plus de visage.
À la ferme, la vie se poursuit, dans l'attente d'une lettre, dans l'évocation de leur bonheur passé pour les deux femmes, dans la honte de batifoler pour Julia dont les sens s'enflamment vite et qui ne saura pas attendre le retour de son mari qu'elle trompera avec un déserteur. Elle venait d'apprendre que Joseph avait été amputé de son bras droit. Lui revient à la ferme, retrouve les siens.
Après une permission grâce à laquelle il revoit Madeleine, Olivier retourne au front : une sorte de routine qui favorise les cauchemars lui fait revoir son ami Regotaz qui lui rappelle un passé récent et heureux, tandis que son capitaine se met à parler seul.
Madeleine est enceinte et, après une tentative pour le “faire passer“ avec l'aide de Julia, elle décide de le garder.
Olivier apprend la nouvelle par une lettre de Julia, alors que se déroule la bataille du Mont Kemmel. Extenué, au milieu des balles, des morts, des attaques allemandes, lui et son camarade La Poule finissent par s'enfuir. Dans sa retraite, Olivier combat une truie qui dévorait le cadavre d'un enfant.
Olivier est de retour chez lui. Madeleine mettra au monde un garçon en présence de Thomas le berger : c'est “l'espérance“.
Qu'a voulu signifier Jean Giono avec le titre de son livre « Le grand troupeau » ? le déferlement des ovins, leur descente prématurée des alpages en ce mois d'août 14 ? Ou le départ massif des recrues, jeunes gens envoyés à l'abattoir de la guerre ? Il joue probablement sur l'analogie entre les deux phénomènes, sur une métaphore liant l'homme, chair vivante, qui a perdu sa liberté et son individualité, et l'animal, symbole de la nature, mais tout autant capable de souffrir.
Giono n'en a pas fini avec son exploration d'un côté du Mal, de la destruction, de la guerre, qu'il condamne, de l'autre de la vie à la campagne, âpre, rude, nécessaire. Son style, concis, volontiers elliptique, sa subtilité parfois opaque ou équivoque, sa poésie, sa légèreté dans la description des faits qu'il effleure, même concrets, même macabres, le caractérisent. de même que le parler des paysans, qui cumulent les expressions régionales, orales, simples, familières, avec leur langage réaliste, plein de fautes de français, leurs propos sans but défini, sans prolongement, ronds comme le temps qui se répète, les saisons, la Terre, une certaine fatalité, la vie en quelque sorte.
On est en août 1914, village de Valensole, aujourd'hui dans les Alpes de Haute Provence. le roman voit au début le déferlement d'un immense troupeau d'ovins, conduit par Thomas, vieux berger, avec à leur tête un bélier blessé, saignant ; les bêtes paraissent éprouvées, beaucoup sont mortes, abandonnées au long de la route. Les bergers les plus jeunes ont été mobilisés. Thomas confie le bélier au papé pour qu'il le soigne.
Les personnages appartiennent à deux familles : autour du vieux père, Jérôme, Joseph son fils, sa femme Sylvia et sa jeune soeur Madeleine. La deuxième famille comprend le papé, Delphine et leur fils Olivier, fiancé à Madeleine. Les hommes sont des paysans, petits cultivateurs et éleveurs, les femmes remplacent les jeunes quand ils partent au front.
À part, Burle, vieux berger, révolté intégral et isolé, incarne les pensées de l'auteur par son rejet de guerre et son exaltation de la vie, source de bonheur et de plaisir par le travail qu'elle permet. Il n'a pas eu d'enfants et en souffre, même s'il accuse les autres d'envoyer les leurs au combat mortel.
L'auteur alterne les récits des hommes partis au front et de ceux - femmes et vieillards - restés dans les fermes. Joseph et Olivier d'un côté, exposés à tous les dangers du combat, Julia et Madeleine de l'autre, sous le même toit, anxieuses dans l'attente de nouvelles de leurs hommes. La guerre est dans tous les esprits, avec la crainte de la mort et le réconfort à la pensée de l'être aimé.
Au front Joseph, parti le premier, veille sur deux blessés dans l'attente d'un voiture-ambulance qui ne viendra pas. Il réconforte Jules agonisant, lui promettant de lui faire goûter la confiture de noix de sa ferme.
Au village, a lieu une veillée “à corps absent“ en l'honneur d'Arthur, mort au combat, tandis qu'Olivier s'apprête à partir. Il retrouve Joseph, blessé à un bras. Alors qu'en reconnaissance il essuie une pluie d'obus, Olivier participe à une attaque responsable de la mort de deux de ses proches : l'un a été broyé par une bombe, l'autre, Regotaz, l'amoureux des arbres, n'a plus de visage.
À la ferme, la vie se poursuit, dans l'attente d'une lettre, dans l'évocation de leur bonheur passé pour les deux femmes, dans la honte de batifoler pour Julia dont les sens s'enflamment vite et qui ne saura pas attendre le retour de son mari qu'elle trompera avec un déserteur. Elle venait d'apprendre que Joseph avait été amputé de son bras droit. Lui revient à la ferme, retrouve les siens.
Après une permission grâce à laquelle il revoit Madeleine, Olivier retourne au front : une sorte de routine qui favorise les cauchemars lui fait revoir son ami Regotaz qui lui rappelle un passé récent et heureux, tandis que son capitaine se met à parler seul.
Madeleine est enceinte et, après une tentative pour le “faire passer“ avec l'aide de Julia, elle décide de le garder.
Olivier apprend la nouvelle par une lettre de Julia, alors que se déroule la bataille du Mont Kemmel. Extenué, au milieu des balles, des morts, des attaques allemandes, lui et son camarade La Poule finissent par s'enfuir. Dans sa retraite, Olivier combat une truie qui dévorait le cadavre d'un enfant.
Olivier est de retour chez lui. Madeleine mettra au monde un garçon en présence de Thomas le berger : c'est “l'espérance“.
Qu'a voulu signifier Jean Giono avec le titre de son livre « Le grand troupeau » ? le déferlement des ovins, leur descente prématurée des alpages en ce mois d'août 14 ? Ou le départ massif des recrues, jeunes gens envoyés à l'abattoir de la guerre ? Il joue probablement sur l'analogie entre les deux phénomènes, sur une métaphore liant l'homme, chair vivante, qui a perdu sa liberté et son individualité, et l'animal, symbole de la nature, mais tout autant capable de souffrir.
Giono n'en a pas fini avec son exploration d'un côté du Mal, de la destruction, de la guerre, qu'il condamne, de l'autre de la vie à la campagne, âpre, rude, nécessaire. Son style, concis, volontiers elliptique, sa subtilité parfois opaque ou équivoque, sa poésie, sa légèreté dans la description des faits qu'il effleure, même concrets, même macabres, le caractérisent. de même que le parler des paysans, qui cumulent les expressions régionales, orales, simples, familières, avec leur langage réaliste, plein de fautes de français, leurs propos sans but défini, sans prolongement, ronds comme le temps qui se répète, les saisons, la Terre, une certaine fatalité, la vie en quelque sorte.