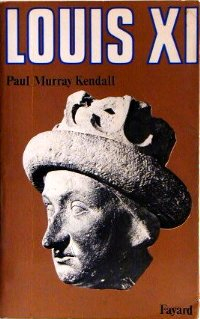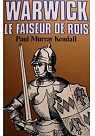Citations sur Louis XI : L'universelle araigne (45)
« Louis, les portes sont ouvertes, et si elles ne sont pas assez grandes, je vous en ferai abattre seize ou vingt toises de mur pour passer où mieux vous semblera. S’il vous plaît en aller, si vous en allez ; car au plaisir de Dieu nous trouverons aucun de notre sang qui nous aidera mieux à maintenir notre honneur et seigneurie que encore n’avez fait jusques à ci. »
Charles VII à Louis, le dauphin.
Charles VII à Louis, le dauphin.
« La chose a duré trop longtemps et en veut le toi voir la fin. Messire Guillaume, prenez congé du roi, vous êtes expédié. »
Chancelier de Charles VII à l’envoyé de Louis, futur roi.
Chancelier de Charles VII à l’envoyé de Louis, futur roi.
« Monsieur, il me semble que vous avez désir que l’on se moque de moi, dit-elle, car vous me voulez faire faire ce qui ne m’appartient pas. »
Duchesse de Bourgogne à Louis XI.
Duchesse de Bourgogne à Louis XI.
« Beaux oncles, il convient vous aller désouser [ôter vos bottes] et vous retraire en votre chambre, allons-en là-haut. »
Louis XI.
Louis XI.
« Prospero, puisque vous êtes chargé de n’offrir que douze mille florins, l’affaire semble si loin d’être conclue que la solution la meilleure et la plus rapide est, je crois, d’abandonner notre traité. »
Louis XI
Louis XI
« Le prince doit songer à la condition de son peuple et se mêler à lui souvent, comme un bon jardinier cultive son jardin. »
Louis XI
Louis XI
« Dites à votre maître que, s’il fait quoi que ce soit pour me déplaire, je ne lui en saurai aucun gré, et dites-lui que ce qu’il croit être à son profit pourrait fort bien lui nuire. »
Charles VII
Charles VII
Dans son parcours sinueux, la Loire glisse comme une flèche d’argent au centre de la France.
A l'époque de Louis XI, le comportement humain venait s'inscrire entre les extrêmes du plaisir et de la souffrance, de la jouissance et de la misère, de la colère et de la repentance, de la violence et de l'inertie. Les hommes du XVème siècle goûtaient la piquante saveur d'une vie aux contrastes violents. La richesse et le rang exhibaient leurs splendeurs ; la pauvreté étalait ses plaies sur la place du marché ; l’échafaud offrait à chacun l'édifiant et horrible spectacle du châtiment que réservait au crime la justice de l'homme ; les catins portaient à l'épaule le signe de leur infamie ; les seigneurs vivaient leur grandeur jusqu'à l'extravagance. La lumière du temps conférait à toute chose un aspect éclatant.
Des crimes atroces, que venaient sanctionner les châtiments les plus terribles, étaient commis pour une injure, pour un morceau de pain. Accablé sous le poids du péché originel, récalcitrant et brutal, l'homme ne pouvait être dompté que par la violence, et les cruels traitements que lui valaient ses fautes devaient servir d'exemple à ses semblables. Pour avoir porté atteinte aux intérêts de la couronne, les grands seigneurs jugés et condamnés pour crime de lèse-majesté étaient exécutés le jour-même où la sentence avait été rendue ; à cette occasion, l’échafaud, dressé sur l'une ou l'autre place de la ville, était orné de tentures noires ; après avoir échangé quelques paroles avec un prêtre, fait une ultime déclaration à la foule, accordé son pardon au bourreau et lancé vers le ciel une dernière prière, le condamné s'agenouillait et appuyait son cou sur le billot. Lorsque la hache était tombée, l'exécuteur des hautes œuvres saisissait par les cheveux la tête ensanglantée et la plongeait dans un seau d'eau avant de la présenter à la foule. Si le traître était de condition inférieure, un supplice plus complet venait punir son crime : pendu, il était écorché vif, éventré, châtré, puis découpé en quatre morceaux que l'on exposait ensuite tout sanglants sur les places publiques. Comme les faux-monnayeurs, ceux qui étaient convaincus de déviation sexuelle, péché abominable entre tous, étaient condamnés à périr dans l'huile bouillante. Les bûchers étaient réservés aux sorciers et aux hérétiques ; quant à la noyade et à la pendaison, elles venaient punir les crimes les plus courants. Pour les malfaiteurs à qui la peine de mort était épargnée, on leur crevait les yeux, on leur coupait une oreille ou le nez, on leur tranchait une main, ou encore, on les fouettait à travers les rues de la ville de sorte qu'il leur fût ensuite impossible de marcher.
Des crimes atroces, que venaient sanctionner les châtiments les plus terribles, étaient commis pour une injure, pour un morceau de pain. Accablé sous le poids du péché originel, récalcitrant et brutal, l'homme ne pouvait être dompté que par la violence, et les cruels traitements que lui valaient ses fautes devaient servir d'exemple à ses semblables. Pour avoir porté atteinte aux intérêts de la couronne, les grands seigneurs jugés et condamnés pour crime de lèse-majesté étaient exécutés le jour-même où la sentence avait été rendue ; à cette occasion, l’échafaud, dressé sur l'une ou l'autre place de la ville, était orné de tentures noires ; après avoir échangé quelques paroles avec un prêtre, fait une ultime déclaration à la foule, accordé son pardon au bourreau et lancé vers le ciel une dernière prière, le condamné s'agenouillait et appuyait son cou sur le billot. Lorsque la hache était tombée, l'exécuteur des hautes œuvres saisissait par les cheveux la tête ensanglantée et la plongeait dans un seau d'eau avant de la présenter à la foule. Si le traître était de condition inférieure, un supplice plus complet venait punir son crime : pendu, il était écorché vif, éventré, châtré, puis découpé en quatre morceaux que l'on exposait ensuite tout sanglants sur les places publiques. Comme les faux-monnayeurs, ceux qui étaient convaincus de déviation sexuelle, péché abominable entre tous, étaient condamnés à périr dans l'huile bouillante. Les bûchers étaient réservés aux sorciers et aux hérétiques ; quant à la noyade et à la pendaison, elles venaient punir les crimes les plus courants. Pour les malfaiteurs à qui la peine de mort était épargnée, on leur crevait les yeux, on leur coupait une oreille ou le nez, on leur tranchait une main, ou encore, on les fouettait à travers les rues de la ville de sorte qu'il leur fût ensuite impossible de marcher.
Alors que cinq siècles seulement nous séparent aujourd'hui de la France dont hérita Louis XI lorsqu'il devint roi, le 22 juillet 1461, six siècles et demi déjà séparaient celle-ci de l'époque de Charlemagne. Cependant, ce dernier se fût certainement trouvé plus à l'aise dans la France de Louis XI que nous, qui en sommes pourtant moins éloignés dans le temps.
L'accélération générale de l'évolution, le stupéfiant paradoxe que constituent la coexistence d'une société ordonnée, supérieurement organisée, avec une violence concertée d'une intensité et d'une efficacité sans précédent sont autant de nouveautés et d'aspects propres à notre temps qui nous rendent tout à fait étrangère l'époque plus simple de Louis XI.
Les hommes du temps de Louis savaient ce qui était juste, même s'ils ne s'appliquaient pas toujours à suivre la justice ; ils connaissaient l'existence d'une source de miséricorde, quoique eux-mêmes ne fussent pas toujours miséricordieux ; ils savaient que peine et châtiment sont les justes tributs du mal, même si ce n'est pas toujours en ce monde qu'il faut payer le prix de ses errements ; ils n'avaient pas le moindre doute quant à l'existence de Dieu.
La masse n'avait qu'une intelligence primitive de l'homme, de la fonction et de la force des institutions, mais sans doute appréciait-elle plus vivement que nous l'aspect tragi-comique, le caractère absurde et merveilleux de l'existence humaine. Les amusements étaient rares mais intensément savourés ; l'ennui était inexistant, ou du moins méconnu ; la précarité de la vie était admise ; largement répandues, la souffrance et la pauvreté n'étaient pas déshonorantes. L'inhumanité de l'homme face à son prochain ne constituait pas une insulte au progrès ; elle attestait tout bonnement la réalité de la chute et de l'expulsion du Paradis terrestre. La foi, l'habitude et la résignation venaient adoucir la dure existence de l'homme.
L'accélération générale de l'évolution, le stupéfiant paradoxe que constituent la coexistence d'une société ordonnée, supérieurement organisée, avec une violence concertée d'une intensité et d'une efficacité sans précédent sont autant de nouveautés et d'aspects propres à notre temps qui nous rendent tout à fait étrangère l'époque plus simple de Louis XI.
Les hommes du temps de Louis savaient ce qui était juste, même s'ils ne s'appliquaient pas toujours à suivre la justice ; ils connaissaient l'existence d'une source de miséricorde, quoique eux-mêmes ne fussent pas toujours miséricordieux ; ils savaient que peine et châtiment sont les justes tributs du mal, même si ce n'est pas toujours en ce monde qu'il faut payer le prix de ses errements ; ils n'avaient pas le moindre doute quant à l'existence de Dieu.
La masse n'avait qu'une intelligence primitive de l'homme, de la fonction et de la force des institutions, mais sans doute appréciait-elle plus vivement que nous l'aspect tragi-comique, le caractère absurde et merveilleux de l'existence humaine. Les amusements étaient rares mais intensément savourés ; l'ennui était inexistant, ou du moins méconnu ; la précarité de la vie était admise ; largement répandues, la souffrance et la pauvreté n'étaient pas déshonorantes. L'inhumanité de l'homme face à son prochain ne constituait pas une insulte au progrès ; elle attestait tout bonnement la réalité de la chute et de l'expulsion du Paradis terrestre. La foi, l'habitude et la résignation venaient adoucir la dure existence de l'homme.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Paul Murray Kendall (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3248 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3248 lecteurs ont répondu