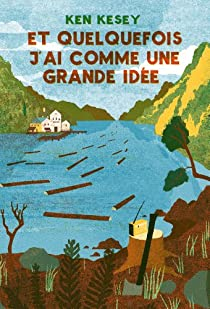>
Critique de Goldlead
Un PAVÉ. Oui, un pavé de 800 pages (mélangées et compactées comme un granit) ; « 235x160x40 mm », « 8 années de travail acharné d'une vingtaine de personnes » (précise l'achevé d'imprimer) ; un kilo cent sur la balance (ajoutera-t-on pour faire bonne mesure)… Un pavé, donc, qu'on s'est trimbalé à bout de bras pendant toute une semaine. Qu'on n'en finit pas de digérer parce qu'il vous reste forcément sur l'estomac. Qu'on s'est pris, en plus, en pleine tronche plus d'une fois, car ça cogne et ça morfle aussi là-dedans, au physique comme au moral… Et pourtant on en redemande ! Qui le croirait ? On vient à peine de tourner la dernière page qu'on reprend illico depuis le début… Pour savoir la suite, paradoxalement. Pour se redonner une chance de mieux comprendre. Pour ne pas lâcher comme cela les personnages auxquels on s'est attaché. Pour prolonger l'envoûtement. Pour ruminer ses impressions, réverbérer ses réflexions. Bref, parce qu'on n'en a pas fini — et qu'on n'est pas prêt d'en avoir fini —de ce livre qu'on a reçu comme un choc et qui va laisser des traces.
Plantons d'abord le décor (si le mot peut convenir pour qualifier ce qui est acteur ou facteur de l'histoire plus que simple toile de fond). Les pentes boisées et les forêts de conifères de l'Oregon, battues l'hiver par les vents et les pluies venues de l'océan, hantées par l'ours et le lynx. Une nature sauvage, impériale, mystérieuse… naguère encore territoire sacré des Indiens, dorénavant chantier ouvert à une industrie forestière en plein développement. Au milieu, un fleuve nourri de toutes les eaux irriguant les montagnes, qui les rejette sans cesse à la mer toute proche sans jamais se vider, qui flue et reflue comme un coeur au rythme des marées, qui, bringuebalé d'amont et d'aval, ne cesse d'éroder les rives de son lit et menace à tout instant de déborder et d'engloutir. Un fleuve, donc, comme un baromètre du temps qu'il fait (avec les crachins et les brumes toujours accrochés à la surface de ses eaux) ; comme une métaphore du temps qui passe et qui repasse (au fil et à la boucle des saisons, des générations ou des migrations d'oies sauvages) ; comme une allégorie du chemin, du tao ou de la Voie (que suivent identiquement les grumes débardées vers la scierie et les hommes projetés vers leur destin). Et sur le bord du fleuve, constamment rafistolée, consolidée et protégée contre les attaques sournoises de celui-ci, sentinelle héroïque et solitaire, une grande maison de famille en bois, qui tient encore le coup, depuis trois générations malgré tout, et qui focalise toute l'histoire.
Les protagonistes ? Une communauté de bûcherons qui fait vivre la petite ville côtière de Wakonda. Des hommes durs, frustes et têtus, pour qui vivre, au quotidien, c'est lutter. Toujours lutter. Lutter à la vie, à la mort… Contre les fûts gigantesques qui les narguent depuis le ciel et qui répliquent aux attaques de la tronçonneuse (« les salopards ! ») en s'abattant brutalement et en écrasant tout dans leur chute. Contre la pluie, la boue, le froid, le vent, ou sinon contre le cagnard, la fatigue, les éblouissements, et toujours le vent… tous ces éléments toujours ligués pour prendre le corps en faute et le lui faire payer salement. Lutte contre la déclivité des pentes et les accidents du terrain. Contre les caprices et les lâchages des machines ou des matériels vétustes et dangereux. Contre les contraintes économiques, les échéances draconiennes des contrats de production, contre les tenailles de l'exploitation sociale. Mais lutte intestine aussi, déterminée, jusqu'au-boutiste, impitoyable, dans un contexte dramatique de conflit syndical. Deux camps dressés l'un contre l'autre : les grévistes contre les jaunes, dirait-on à première vue. D'un côté, les Stamper, groupés autour de la petite entreprise familiale indépendante, de Hank le chef de clan et de Henry le vieux patriarche excentrique, qui entendent profiter de la situation de crise pour honorer un contrat juteux avec la compagnie qui achète le bois. de l'autre, la ville entière, faisant cause commune avec les syndiqués et grévistes qui font le gros de la population et la font donc vivre. Mais, derrière ces positions ostensibles, se cachent et s'affrontent en réalité deux manières d'être, deux modes et presque philosophies de vie, deux types d'hommes aussi. Voici l'alternative en effet : loi du groupe, dont l'union fait la force, ou exigence des individualités, qui les pousse sans cesse à se surmonter elles-mêmes et entre elles ? Communisme rampant, attroupement et nivellement des égaux, ou bien individualisme triomphant et sursaut des egos ? Bref, solidaires ou solitaires (comme dans l'anecdote ou l'apologue qui ouvre le dernier chapitre) ? En fait, les hommes sont ici comme les arbres : tiraillés entre la pression qui les serre les uns contre les autres, pour se protéger des éléments, et l'élan qui les dresse les uns contre les autres, pour jaillir chacun le plus droit et le plus haut possible vers le ciel. de ce point de vue, les Stamper rappellent un peu les anciens séquoias, aujourd'hui disparus de forêts dorénavant entièrement dévolues au pin industriel… Et l'affrontement final des deux frères ennemis, dans un flirt obstiné et absurde avec la mort, pour le simple prestige, pour obtenir coûte que coûte la reconnaissance, prend alors soudain comme des accents hégéliens (ni Maître ni Esclave ? Mais alors où va-t-on, nom de Dieu !?).
D'abord, de ces personnages, on ne voit que l'écorce, épaisse et rugueuse. de sombres brutes en apparence, qui bossent aussi dur qu'ils cognent, boivent sec, parlent dru et cru, jurent d'ailleurs et invectivent plus qu'ils ne parlent, et semblent marcher à l'instinct plus qu'à la pensée ou au sentiment. Mais l'auteur use d'un procédé original et déconcertant pour dépouiller progressivement cette enveloppe grossière. Moyennant en effet quelques simples conventions typographiques, il interpole constamment, dans la narration et les descriptions objectives, des fragments ou des segments de subjectivité brute, entrelaçant même indifféremment à la première personne du singulier les voix intérieures et extérieures des différents protagonistes. Ainsi perce-t-il les carapaces et découvre-t-il, à petites touches, des émotions, des impressions, des convictions, des résolutions pourtant bien masquées, et même des tendresses et des finesses insoupçonnées, soudain mises à nu, troublantes et fragiles, comme le bois écorcé.
Du coup, cette histoire de bûcherons (une histoire d'hommes, dopée à la testostérone, brutale, tendue et explosive jusque dans l'écriture), qui ressemblait assez à un western décalé dans l'espace (au nord-ouest) et le temps (en plein XXe siècle), prend bientôt — comme chez Faulkner à qui elle fait irrésistiblement penser… et comme à un pair plus que comme à un maître — une épaisseur, une profondeur, une consistance psychologiques, archétypiques et quasiment ontologiques, en même temps qu'une signification véritablement universelle. Ajoutons à cela la créativité de l'écriture, la démiurgie du style, l'habileté architecturale, l'ambition du projet, le tour de force du résultat (sans oublier le magnifique travail du traducteur tout au service de l'oeuvre)… et nous tenons assurément là un chef-d'oeuvre, à l'égal des plus grands et qui a tout pour devenir un classique.
Plantons d'abord le décor (si le mot peut convenir pour qualifier ce qui est acteur ou facteur de l'histoire plus que simple toile de fond). Les pentes boisées et les forêts de conifères de l'Oregon, battues l'hiver par les vents et les pluies venues de l'océan, hantées par l'ours et le lynx. Une nature sauvage, impériale, mystérieuse… naguère encore territoire sacré des Indiens, dorénavant chantier ouvert à une industrie forestière en plein développement. Au milieu, un fleuve nourri de toutes les eaux irriguant les montagnes, qui les rejette sans cesse à la mer toute proche sans jamais se vider, qui flue et reflue comme un coeur au rythme des marées, qui, bringuebalé d'amont et d'aval, ne cesse d'éroder les rives de son lit et menace à tout instant de déborder et d'engloutir. Un fleuve, donc, comme un baromètre du temps qu'il fait (avec les crachins et les brumes toujours accrochés à la surface de ses eaux) ; comme une métaphore du temps qui passe et qui repasse (au fil et à la boucle des saisons, des générations ou des migrations d'oies sauvages) ; comme une allégorie du chemin, du tao ou de la Voie (que suivent identiquement les grumes débardées vers la scierie et les hommes projetés vers leur destin). Et sur le bord du fleuve, constamment rafistolée, consolidée et protégée contre les attaques sournoises de celui-ci, sentinelle héroïque et solitaire, une grande maison de famille en bois, qui tient encore le coup, depuis trois générations malgré tout, et qui focalise toute l'histoire.
Les protagonistes ? Une communauté de bûcherons qui fait vivre la petite ville côtière de Wakonda. Des hommes durs, frustes et têtus, pour qui vivre, au quotidien, c'est lutter. Toujours lutter. Lutter à la vie, à la mort… Contre les fûts gigantesques qui les narguent depuis le ciel et qui répliquent aux attaques de la tronçonneuse (« les salopards ! ») en s'abattant brutalement et en écrasant tout dans leur chute. Contre la pluie, la boue, le froid, le vent, ou sinon contre le cagnard, la fatigue, les éblouissements, et toujours le vent… tous ces éléments toujours ligués pour prendre le corps en faute et le lui faire payer salement. Lutte contre la déclivité des pentes et les accidents du terrain. Contre les caprices et les lâchages des machines ou des matériels vétustes et dangereux. Contre les contraintes économiques, les échéances draconiennes des contrats de production, contre les tenailles de l'exploitation sociale. Mais lutte intestine aussi, déterminée, jusqu'au-boutiste, impitoyable, dans un contexte dramatique de conflit syndical. Deux camps dressés l'un contre l'autre : les grévistes contre les jaunes, dirait-on à première vue. D'un côté, les Stamper, groupés autour de la petite entreprise familiale indépendante, de Hank le chef de clan et de Henry le vieux patriarche excentrique, qui entendent profiter de la situation de crise pour honorer un contrat juteux avec la compagnie qui achète le bois. de l'autre, la ville entière, faisant cause commune avec les syndiqués et grévistes qui font le gros de la population et la font donc vivre. Mais, derrière ces positions ostensibles, se cachent et s'affrontent en réalité deux manières d'être, deux modes et presque philosophies de vie, deux types d'hommes aussi. Voici l'alternative en effet : loi du groupe, dont l'union fait la force, ou exigence des individualités, qui les pousse sans cesse à se surmonter elles-mêmes et entre elles ? Communisme rampant, attroupement et nivellement des égaux, ou bien individualisme triomphant et sursaut des egos ? Bref, solidaires ou solitaires (comme dans l'anecdote ou l'apologue qui ouvre le dernier chapitre) ? En fait, les hommes sont ici comme les arbres : tiraillés entre la pression qui les serre les uns contre les autres, pour se protéger des éléments, et l'élan qui les dresse les uns contre les autres, pour jaillir chacun le plus droit et le plus haut possible vers le ciel. de ce point de vue, les Stamper rappellent un peu les anciens séquoias, aujourd'hui disparus de forêts dorénavant entièrement dévolues au pin industriel… Et l'affrontement final des deux frères ennemis, dans un flirt obstiné et absurde avec la mort, pour le simple prestige, pour obtenir coûte que coûte la reconnaissance, prend alors soudain comme des accents hégéliens (ni Maître ni Esclave ? Mais alors où va-t-on, nom de Dieu !?).
D'abord, de ces personnages, on ne voit que l'écorce, épaisse et rugueuse. de sombres brutes en apparence, qui bossent aussi dur qu'ils cognent, boivent sec, parlent dru et cru, jurent d'ailleurs et invectivent plus qu'ils ne parlent, et semblent marcher à l'instinct plus qu'à la pensée ou au sentiment. Mais l'auteur use d'un procédé original et déconcertant pour dépouiller progressivement cette enveloppe grossière. Moyennant en effet quelques simples conventions typographiques, il interpole constamment, dans la narration et les descriptions objectives, des fragments ou des segments de subjectivité brute, entrelaçant même indifféremment à la première personne du singulier les voix intérieures et extérieures des différents protagonistes. Ainsi perce-t-il les carapaces et découvre-t-il, à petites touches, des émotions, des impressions, des convictions, des résolutions pourtant bien masquées, et même des tendresses et des finesses insoupçonnées, soudain mises à nu, troublantes et fragiles, comme le bois écorcé.
Du coup, cette histoire de bûcherons (une histoire d'hommes, dopée à la testostérone, brutale, tendue et explosive jusque dans l'écriture), qui ressemblait assez à un western décalé dans l'espace (au nord-ouest) et le temps (en plein XXe siècle), prend bientôt — comme chez Faulkner à qui elle fait irrésistiblement penser… et comme à un pair plus que comme à un maître — une épaisseur, une profondeur, une consistance psychologiques, archétypiques et quasiment ontologiques, en même temps qu'une signification véritablement universelle. Ajoutons à cela la créativité de l'écriture, la démiurgie du style, l'habileté architecturale, l'ambition du projet, le tour de force du résultat (sans oublier le magnifique travail du traducteur tout au service de l'oeuvre)… et nous tenons assurément là un chef-d'oeuvre, à l'égal des plus grands et qui a tout pour devenir un classique.