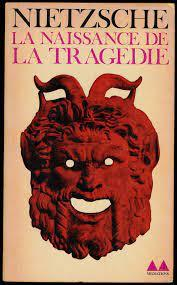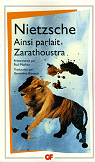Citations sur La naissance de la tragédie ou Hellénisme et pessimisme (90)
L’artiste subjectif n’est, à nos yeux, qu’un mauvais artiste, et que nous exigeons, dans toute manifestation artistique et à tous les degrés de l’art, avant tout et en premier lieu la victoire sur le subjectif, l’affranchissement de la tyrannie du « moi », l’abolition de toute volonté et de tout désir individuel ; parce que, sans objectivité, sans contemplation pure et désintéressée, nous ne pouvons même croire jamais à une activité créatrice véritablement artistique, fût-ce la plus infime. C’est pourquoi notre esthétique doit d’abord résoudre le problème de la possibilité du « lyrique » en tant qu’artiste : le « lyrique », d’après l’expérience de tous les temps, disant toujours « je » et vocalisant devant nous toute la gamme chromatique de ses passions et de ses désirs. Et justement cet Archiloque, à côté d’Homère, nous épouvante par le cri de sa haine et de son mépris insultant, par les explosions délirantes de ses appétits ; n’est-il pas, lui, le premier artiste subjectif, par cela même le véritable non-artiste ? Mais d’où vient alors la vénération que témoigne à ce poète, par des sentences mémorables, précisément aussi l’oracle de Delphes, ce foyer de l’art « objectif » ? (p. 52)
Il s'avère impossible de penser le sujet, l'individu voulant et poursuivant ses fins égoistes, autrement que comme l'adversaire - et non l'origine - de l'art.
Eh bien, l’homme doué d’une sensibilité artistique se comporte à l’égard de la réalité du rêve de la même manière que le philosophe en face de la réalité de l’existence.
De toutes les races d’hommes [les anciens Grecs], la plus accomplie, la plus belle, la plus enviée, la plus séduisante, la plus entraînante vers la Vie…
Sous la magie du dionysiaque, ce n'est pas seulement le lien d'être humain à être humain qui se renoue : même la nature aliénée, hostile ou asservie célèbre à nouveau la fête de sa réconciliation avec son fils perdu, l'homme.
7.
— Mais, cher monsieur, qu’a-t-on jamais entendu par romantisme si votre livre n’est pas romantique ? Est-il possible de pousser plus loin la haine du « temps présent », de la « réalité » et des « idées modernes » que vous ne l’avez fait dans votre métaphysique d’artiste — qui préfère croire au néant et même au diable plutôt qu’au « présent » ? Au-dessous de la polyphonie contrapuntique dont vous tentez de séduire nos oreilles ne gronde-t-il pas une basse fondamentale de colère et de destruction joyeuses ? une farouche résolution contre tout ce qui est « actuel », une volonté qui n’est certes pas très éloignée du nihilisme pratique, et qui semble dire : « Que rien ne soit vrai, plutôt que vous ayez raison, plutôt que triomphe votre vérité ! » Écoutez vous-même avec attention, monsieur le pessimiste adorateur de l’art, un seul passage, choisi dans votre livre, ce passage, nullement dénué d’éloquence, le « tueur de dragons », qui semble comme un piège insidieusement tendu aux jeunes esprits et aux jeunes cœurs. Quoi ? N’est-ce pas l’authentique et véritable profession de foi du romantisme de 1830, sous le masque du pessimisme de 1850 ? et derrière cette profession de foi n’entend-on pas préluder le finale consacré, en usage chez les romantiques, — rupture, écroulement, retour, et enfin prosternation à deux genoux devant une vieille foi, devant le Dieu ancien ?… Quoi ? votre livre de pessimiste n’est-il pas lui-même une œuvre de romantisme et d’antihellénisme, quelque chose « qui, à la fois, produit l’ivresse et obscurcit l’esprit » en tout cas, un narcotique, un morceau de musique, voire de musique allemande ? Mais qu’on en juge :
Figurons-nous une génération grandissant avec cette intrépidité du regard, avec cette impulsion héroïque vers le monstrueux, l’extraordinaire ; imaginons l’allure hardie de ce tueur de dragons, l’orgueilleuse témérité avec laquelle ces êtres tournent le dos aux enseignements débiles de l’optimisme, pour « vivre résolument » d’une vie pleine et complète : ne devait-il pas arriver nécessairement que l’expérience volontaire de l’énergie et de la terreur amenât l’homme tragique de cette civilisation à souhaiter un art nouveau, l’art de la consolation métaphysique, la tragédie, comme une Hélène à laquelle il avait droit, et à s’écrier avec Faust :
Et ne devais-je pas, avec une violence passionnée,
Faire naître à la vie la forme la plus divine ? »
« Cela ne devait-il pas arriver nécessairement ? » … Non, trois fois non ! Ô jeunes romantiques : cela ne devait pas arriver nécessairement ! Mais il est très vraisemblable que cela se termine ainsi, que vous finissez ainsi, c’est-à-dire « consolés », comme cela est écrit, en dépit de tous vos efforts pour connaître par vous-mêmes l’énergie et la terreur, « métaphysiquement consolés, » bref, ainsi que finissent les romantiques, chrétiennement… Non ! Il vous faudrait d’abord apprendre la consolation de ce côté-ci, — il vous faudrait apprendre à rire, mes jeunes amis, si toutefois vous vouliez absolument rester pessimistes ; peut-être bien qu’alors, sachant rire, vous jetteriez un jour au diable toutes les consolations métaphysiques, — et pour commencer la métaphysique elle-même ! Ou, pour employer le langage de ce monstre dionysien, qui a nom Zarathoustra :
« Élevez vos cœurs, mes frères, haut, plus haut ! Et n’oubliez pas non plus vos jambes ! Élevez aussi vos jambes, bons danseurs, et mieux que cela : vous vous tiendrez aussi sur la tête !
« Cette couronne du rieur, cette couronne de roses : c’est moi-même qui me la suis mise sur la tête, j’ai canonisé moi-même mon rire. Je n’ai trouvé personne d’assez fort pour cela aujourd’hui.
« Zarathoustra le danseur, Zarathoustra le léger, celui qui agite ses ailes, prêt au vol, faisant signe à tous les oiseaux, prêt et agile, divinement léger : —
« Zarathoustra le devin, Zarathoustra le rieur, ni impatient, ni intolérant, quelqu’un qui aime les sauts et les écarts ; je me suis moi-même placé cette couronne sur la tête !
« Cette couronne du rieur, cette couronne de roses : à vous, mes frères, je jette cette couronne ! J’ai canonisé le rire ; hommes supérieurs, apprenez donc — à rire ! »
— Mais, cher monsieur, qu’a-t-on jamais entendu par romantisme si votre livre n’est pas romantique ? Est-il possible de pousser plus loin la haine du « temps présent », de la « réalité » et des « idées modernes » que vous ne l’avez fait dans votre métaphysique d’artiste — qui préfère croire au néant et même au diable plutôt qu’au « présent » ? Au-dessous de la polyphonie contrapuntique dont vous tentez de séduire nos oreilles ne gronde-t-il pas une basse fondamentale de colère et de destruction joyeuses ? une farouche résolution contre tout ce qui est « actuel », une volonté qui n’est certes pas très éloignée du nihilisme pratique, et qui semble dire : « Que rien ne soit vrai, plutôt que vous ayez raison, plutôt que triomphe votre vérité ! » Écoutez vous-même avec attention, monsieur le pessimiste adorateur de l’art, un seul passage, choisi dans votre livre, ce passage, nullement dénué d’éloquence, le « tueur de dragons », qui semble comme un piège insidieusement tendu aux jeunes esprits et aux jeunes cœurs. Quoi ? N’est-ce pas l’authentique et véritable profession de foi du romantisme de 1830, sous le masque du pessimisme de 1850 ? et derrière cette profession de foi n’entend-on pas préluder le finale consacré, en usage chez les romantiques, — rupture, écroulement, retour, et enfin prosternation à deux genoux devant une vieille foi, devant le Dieu ancien ?… Quoi ? votre livre de pessimiste n’est-il pas lui-même une œuvre de romantisme et d’antihellénisme, quelque chose « qui, à la fois, produit l’ivresse et obscurcit l’esprit » en tout cas, un narcotique, un morceau de musique, voire de musique allemande ? Mais qu’on en juge :
Figurons-nous une génération grandissant avec cette intrépidité du regard, avec cette impulsion héroïque vers le monstrueux, l’extraordinaire ; imaginons l’allure hardie de ce tueur de dragons, l’orgueilleuse témérité avec laquelle ces êtres tournent le dos aux enseignements débiles de l’optimisme, pour « vivre résolument » d’une vie pleine et complète : ne devait-il pas arriver nécessairement que l’expérience volontaire de l’énergie et de la terreur amenât l’homme tragique de cette civilisation à souhaiter un art nouveau, l’art de la consolation métaphysique, la tragédie, comme une Hélène à laquelle il avait droit, et à s’écrier avec Faust :
Et ne devais-je pas, avec une violence passionnée,
Faire naître à la vie la forme la plus divine ? »
« Cela ne devait-il pas arriver nécessairement ? » … Non, trois fois non ! Ô jeunes romantiques : cela ne devait pas arriver nécessairement ! Mais il est très vraisemblable que cela se termine ainsi, que vous finissez ainsi, c’est-à-dire « consolés », comme cela est écrit, en dépit de tous vos efforts pour connaître par vous-mêmes l’énergie et la terreur, « métaphysiquement consolés, » bref, ainsi que finissent les romantiques, chrétiennement… Non ! Il vous faudrait d’abord apprendre la consolation de ce côté-ci, — il vous faudrait apprendre à rire, mes jeunes amis, si toutefois vous vouliez absolument rester pessimistes ; peut-être bien qu’alors, sachant rire, vous jetteriez un jour au diable toutes les consolations métaphysiques, — et pour commencer la métaphysique elle-même ! Ou, pour employer le langage de ce monstre dionysien, qui a nom Zarathoustra :
« Élevez vos cœurs, mes frères, haut, plus haut ! Et n’oubliez pas non plus vos jambes ! Élevez aussi vos jambes, bons danseurs, et mieux que cela : vous vous tiendrez aussi sur la tête !
« Cette couronne du rieur, cette couronne de roses : c’est moi-même qui me la suis mise sur la tête, j’ai canonisé moi-même mon rire. Je n’ai trouvé personne d’assez fort pour cela aujourd’hui.
« Zarathoustra le danseur, Zarathoustra le léger, celui qui agite ses ailes, prêt au vol, faisant signe à tous les oiseaux, prêt et agile, divinement léger : —
« Zarathoustra le devin, Zarathoustra le rieur, ni impatient, ni intolérant, quelqu’un qui aime les sauts et les écarts ; je me suis moi-même placé cette couronne sur la tête !
« Cette couronne du rieur, cette couronne de roses : à vous, mes frères, je jette cette couronne ! J’ai canonisé le rire ; hommes supérieurs, apprenez donc — à rire ! »
5.
Déjà, dans la préface à Richard Wagner, c’est l’art, — et non la morale, — qui est présenté comme l’activité essentiellement métaphysique de l’homme ; au cours de ce livre se reproduit à différentes reprises cette singulière proposition, que l’existence du monde ne peut se justifier que comme phénomène esthétique. En effet, ce livre ne reconnaît, au fond de tout ce qui fut, qu’une pensée et arrière-pensée d’artiste, — un « Dieu », si l’on veut, mais, à coup sûr, un Dieu purement artiste, absolument dénué de scrupule et de morale, pour qui la création ou la destruction, le bien ou le mal sont des manifestations de son caprice indifférent et de sa toute-puissance ; qui se débarrasse, en fabriquant des mondes, du tourment de sa plénitude et de sa pléthore, qui se délivre de la souffrance des contrastes accumulés en lui-même. Le monde, l’objectivation libératrice de Dieu, perpétuellement et à tout instant consommée, en tant que vision éternellement changeante, éternellement nouvelle de celui qui porte en soi les plus grandes souffrances, les plus irréductibles conflits, les plus extrêmes contrastes, et qui ne peut s’en affranchir et se libérer que dans l’apparence ; toute cette métaphysique d’artiste peut être traitée d’arbitraire, de vaine, de fantaisiste, — l’essentiel est qu’elle trahit dès l’abord un esprit qui, à tout événement, décida de se mettre en garde contre l’interprétation et la portée morales de l’existence. Ici est proclamé, pour la première fois peut-être, un pessimisme « par delà le bien et le mal » ; ici cette « perversité du sentiment », contre laquelle Schopenhauer ne se lassa pas de lancer à l’avance ses imprécations et ses foudres, trouve son langage et sa formule, — une philosophie qui ose classer la morale elle-même dans le monde des apparences, qui ose la déclasser, et cela non seulement parmi les « apparences » (dans le sens de l’idéaliste terminus technicus), mais encore parmi les « illusions », comme simulacre, conjecture, préjugé, interprétation, parure, art. Peut-être la profondeur de cette tendance anti-morale peut-elle se mesurer le mieux au silence circonspect et hostile que l’on constate dans tout ce livre à l’égard du christianisme, — du christianisme, comme la plus extravagante variation sur le thème moral qu’il ait été donné à l’humanité d’entendre jusqu’à présent. En vérité, rien n’est plus complètement opposé à l’interprétation, à la justification purement esthétique du monde exposée ici, que la doctrine chrétienne, qui n’est et ne veut être que morale, et, avec ses principes absolus, par exemple avec sa véracité de Dieu, relègue l’art, tout art, dans l’empire du mensonge, c’est-à-dire le nie, le condamne, le maudit. Derrière une semblable façon de penser et d’apprécier qui, pour peu qu’elle soit sincère et logique, doit être fatalement hostile à l’art, je perçus aussi de tout temps l’hostilité à la vie, la répugnance rageuse et vindicative pour la vie même : car toute vie repose sur apparence, art, illusion, optique, nécessité de perspective et d’erreur. Le christianisme fut, dès l’origine, essentiellement et radicalement, satiété et dégoût de la vie pour la vie, qui se dissimulent, se déguisent seulement sous le travesti de la foi en une « autre » vie, en une vie « meilleure ». La haine du « monde », l’anathème aux passions, la peur de la beauté et de la volupté, un au-delà futur inventé pour mieux dénigrer le présent, au fond un désir de néant, de mort, de repos, jusqu’au « sabbat des sabbats », — tout cela, aussi bien que la prétention absolue du christianisme à ne tenir compte que des valeurs morales, me parut toujours la forme la plus dangereuse, la plus inquiétante d’une « volonté d’anéantissement », tout au moins un signe de lassitude morbide, de découragement profond, d’épuisement, d’appauvrissement de la vie, — car, au nom de la morale (en particulier de la morale chrétienne, c’est-à-dire absolue), nous devons toujours et inéluctablement donner tort à la vie, parce que la vie est quelque chose d’essentiellement immoral, — nous devons enfin étouffer la vie sous le poids du mépris et de l’éternelle négation, comme indigne d’être désirée et dénuée en soi de la valeur d’être vécue. La morale elle-même — quoi ? la morale ne serait-elle pas une « volonté de négation de la vie », un secret instinct d’anéantissement, un principe de ruine, de déchéance, de dénigrement, un commencement de fin ? et par conséquent le danger des dangers ?… C’est contre la morale que, dans ce livre, mon instinct se reconnut comme défenseur de la vie, et qu’il se créa une doctrine et une théorie de la vie absolument contraires, une conception purement artistique, anti-chrétienne. Comment la nommer ? Comme philologue et ouvrier dans l’art d’exprimer, je la baptisai, non sans quelque liberté, — qui pourrait dire le vrai nom de l’Antéchrist ? — du nom d’un dieu grec : je la nommai dionysienne.
Déjà, dans la préface à Richard Wagner, c’est l’art, — et non la morale, — qui est présenté comme l’activité essentiellement métaphysique de l’homme ; au cours de ce livre se reproduit à différentes reprises cette singulière proposition, que l’existence du monde ne peut se justifier que comme phénomène esthétique. En effet, ce livre ne reconnaît, au fond de tout ce qui fut, qu’une pensée et arrière-pensée d’artiste, — un « Dieu », si l’on veut, mais, à coup sûr, un Dieu purement artiste, absolument dénué de scrupule et de morale, pour qui la création ou la destruction, le bien ou le mal sont des manifestations de son caprice indifférent et de sa toute-puissance ; qui se débarrasse, en fabriquant des mondes, du tourment de sa plénitude et de sa pléthore, qui se délivre de la souffrance des contrastes accumulés en lui-même. Le monde, l’objectivation libératrice de Dieu, perpétuellement et à tout instant consommée, en tant que vision éternellement changeante, éternellement nouvelle de celui qui porte en soi les plus grandes souffrances, les plus irréductibles conflits, les plus extrêmes contrastes, et qui ne peut s’en affranchir et se libérer que dans l’apparence ; toute cette métaphysique d’artiste peut être traitée d’arbitraire, de vaine, de fantaisiste, — l’essentiel est qu’elle trahit dès l’abord un esprit qui, à tout événement, décida de se mettre en garde contre l’interprétation et la portée morales de l’existence. Ici est proclamé, pour la première fois peut-être, un pessimisme « par delà le bien et le mal » ; ici cette « perversité du sentiment », contre laquelle Schopenhauer ne se lassa pas de lancer à l’avance ses imprécations et ses foudres, trouve son langage et sa formule, — une philosophie qui ose classer la morale elle-même dans le monde des apparences, qui ose la déclasser, et cela non seulement parmi les « apparences » (dans le sens de l’idéaliste terminus technicus), mais encore parmi les « illusions », comme simulacre, conjecture, préjugé, interprétation, parure, art. Peut-être la profondeur de cette tendance anti-morale peut-elle se mesurer le mieux au silence circonspect et hostile que l’on constate dans tout ce livre à l’égard du christianisme, — du christianisme, comme la plus extravagante variation sur le thème moral qu’il ait été donné à l’humanité d’entendre jusqu’à présent. En vérité, rien n’est plus complètement opposé à l’interprétation, à la justification purement esthétique du monde exposée ici, que la doctrine chrétienne, qui n’est et ne veut être que morale, et, avec ses principes absolus, par exemple avec sa véracité de Dieu, relègue l’art, tout art, dans l’empire du mensonge, c’est-à-dire le nie, le condamne, le maudit. Derrière une semblable façon de penser et d’apprécier qui, pour peu qu’elle soit sincère et logique, doit être fatalement hostile à l’art, je perçus aussi de tout temps l’hostilité à la vie, la répugnance rageuse et vindicative pour la vie même : car toute vie repose sur apparence, art, illusion, optique, nécessité de perspective et d’erreur. Le christianisme fut, dès l’origine, essentiellement et radicalement, satiété et dégoût de la vie pour la vie, qui se dissimulent, se déguisent seulement sous le travesti de la foi en une « autre » vie, en une vie « meilleure ». La haine du « monde », l’anathème aux passions, la peur de la beauté et de la volupté, un au-delà futur inventé pour mieux dénigrer le présent, au fond un désir de néant, de mort, de repos, jusqu’au « sabbat des sabbats », — tout cela, aussi bien que la prétention absolue du christianisme à ne tenir compte que des valeurs morales, me parut toujours la forme la plus dangereuse, la plus inquiétante d’une « volonté d’anéantissement », tout au moins un signe de lassitude morbide, de découragement profond, d’épuisement, d’appauvrissement de la vie, — car, au nom de la morale (en particulier de la morale chrétienne, c’est-à-dire absolue), nous devons toujours et inéluctablement donner tort à la vie, parce que la vie est quelque chose d’essentiellement immoral, — nous devons enfin étouffer la vie sous le poids du mépris et de l’éternelle négation, comme indigne d’être désirée et dénuée en soi de la valeur d’être vécue. La morale elle-même — quoi ? la morale ne serait-elle pas une « volonté de négation de la vie », un secret instinct d’anéantissement, un principe de ruine, de déchéance, de dénigrement, un commencement de fin ? et par conséquent le danger des dangers ?… C’est contre la morale que, dans ce livre, mon instinct se reconnut comme défenseur de la vie, et qu’il se créa une doctrine et une théorie de la vie absolument contraires, une conception purement artistique, anti-chrétienne. Comment la nommer ? Comme philologue et ouvrier dans l’art d’exprimer, je la baptisai, non sans quelque liberté, — qui pourrait dire le vrai nom de l’Antéchrist ? — du nom d’un dieu grec : je la nommai dionysienne.
4.
Oui, qu’est-ce que l’esprit dionysien ? — On trouvera dans ce livre une réponse à cette interrogation, — c’est un « initié » qui parle ici, l’adepte élu, l’apôtre de son dieu. Peut-être serais-je aujourd’hui plus circonspect, moins absolu en présence d’un problème psychologique aussi compliqué que la recherche des origines de la tragédie chez les Grecs. Un point fondamental est la mesure de subjectivité du Grec en face de la souffrance, son degré de sensibilité, — ce degré n’a-t-il jamais varié ? ou bien le rapport fut-il renversé ? — cette question de savoir si son toujours grandissant désir de beauté, de fêtes, de réjouissances, de cultes nouveaux, n’est pas fait de détresse, de misère, de mélancolie, de douleur ? Et en supposant que ce fût vrai — et Périclès (ou Thucydide) le donne à entendre dans la grande oraison funèbre — : d’où viendrait alors la tendance contraire et chronologiquement antérieure, le besoin de l’horrible, la sincère et âpre inclination des premiers Hellènes pour le pessimisme, le mythe tragique, la représentation de tout ce qu’il y a de terreur, de cruauté, de mystère, de néant, de fatalité au fond des choses de la vie, — d’où viendrait alors la tragédie ? Peut-être de la joie, de la force, de la santé exubérante, de l’excès de vitalité ? Et quelle signification prend alors, physiologiquement parlant, ce délire particulier, qui fut la source de l’art tragique aussi bien que de l’art comique, le délire dionysiaque ? Quoi ? Le délire ne serait-il peut-être pas inévitablement le symptôme de la dégénérescence, de la décadence, de la civilisation suravancée ? Y a-t-il peut-être — question pour les médecins aliénistes — une névrose de la santé ? de la jeunesse des peuples, de leur adolescence ? Que nous indique cette synthèse d’un dieu et d’un bouc dans le satyre ? Quelle expérience, quelle impulsion irrésistible amenèrent le Grec à représenter par un satyre le rêveur dionysien, l’homme primitif ? Et pour ce qui regarde l’origine du chœur, dans ces siècles où florissait la force physique du Grec, où l’âme grecque débordait de vie, y eut-il peut-être des enthousiasmes endémiques ? des visions et des hallucinations se manifestant à des cités entières, à des foules entières assemblées dans les temples ? Quoi ? Si pourtant les Grecs, précisément dans la splendeur première de leur jeunesse, avaient eu le besoin du tragique et avaient été pessimistes ? Si, pour employer une parole de Platon, le délire avait été justement, pour Hellas, le plus grand des bienfaits ? Et si, d’un autre côté et au contraire, les Grecs, à l’époque même de leur dissolution et de leur déclin, étaient devenus toujours plus optimistes, plus superficiels, plus cabotins, et aussi plus passionnés pour la logique, plus ardents à concevoir la vie logiquement, c’est-à-dire à la fois plus « sereins » et plus « scientifiques » ? Comment ? en dépit de toutes les « idées modernes » et des préjugés du goût démocratique, la victoire de l’optimisme, la raison, dès lors prédominante, le pratique et théorique utilitarisme, aussi bien que la démocratie elle-même, dont il est contemporain, — tout cela ne pourrait-il pas être le symptôme du déclin de la force, de l’approche de la vieillesse et de la lassitude physiologique ? Et non — le pessimisme ? L’optimiste Épicure ne fut-il pas précisément — un malade ? — On le voit, c’est d’un véritable fardeau de graves problèmes que s’est chargé ce livre, — ajoutons encore le plus grave de tous ! Que signifie, considérée au point de la vue de la Vie — la morale ?…
Oui, qu’est-ce que l’esprit dionysien ? — On trouvera dans ce livre une réponse à cette interrogation, — c’est un « initié » qui parle ici, l’adepte élu, l’apôtre de son dieu. Peut-être serais-je aujourd’hui plus circonspect, moins absolu en présence d’un problème psychologique aussi compliqué que la recherche des origines de la tragédie chez les Grecs. Un point fondamental est la mesure de subjectivité du Grec en face de la souffrance, son degré de sensibilité, — ce degré n’a-t-il jamais varié ? ou bien le rapport fut-il renversé ? — cette question de savoir si son toujours grandissant désir de beauté, de fêtes, de réjouissances, de cultes nouveaux, n’est pas fait de détresse, de misère, de mélancolie, de douleur ? Et en supposant que ce fût vrai — et Périclès (ou Thucydide) le donne à entendre dans la grande oraison funèbre — : d’où viendrait alors la tendance contraire et chronologiquement antérieure, le besoin de l’horrible, la sincère et âpre inclination des premiers Hellènes pour le pessimisme, le mythe tragique, la représentation de tout ce qu’il y a de terreur, de cruauté, de mystère, de néant, de fatalité au fond des choses de la vie, — d’où viendrait alors la tragédie ? Peut-être de la joie, de la force, de la santé exubérante, de l’excès de vitalité ? Et quelle signification prend alors, physiologiquement parlant, ce délire particulier, qui fut la source de l’art tragique aussi bien que de l’art comique, le délire dionysiaque ? Quoi ? Le délire ne serait-il peut-être pas inévitablement le symptôme de la dégénérescence, de la décadence, de la civilisation suravancée ? Y a-t-il peut-être — question pour les médecins aliénistes — une névrose de la santé ? de la jeunesse des peuples, de leur adolescence ? Que nous indique cette synthèse d’un dieu et d’un bouc dans le satyre ? Quelle expérience, quelle impulsion irrésistible amenèrent le Grec à représenter par un satyre le rêveur dionysien, l’homme primitif ? Et pour ce qui regarde l’origine du chœur, dans ces siècles où florissait la force physique du Grec, où l’âme grecque débordait de vie, y eut-il peut-être des enthousiasmes endémiques ? des visions et des hallucinations se manifestant à des cités entières, à des foules entières assemblées dans les temples ? Quoi ? Si pourtant les Grecs, précisément dans la splendeur première de leur jeunesse, avaient eu le besoin du tragique et avaient été pessimistes ? Si, pour employer une parole de Platon, le délire avait été justement, pour Hellas, le plus grand des bienfaits ? Et si, d’un autre côté et au contraire, les Grecs, à l’époque même de leur dissolution et de leur déclin, étaient devenus toujours plus optimistes, plus superficiels, plus cabotins, et aussi plus passionnés pour la logique, plus ardents à concevoir la vie logiquement, c’est-à-dire à la fois plus « sereins » et plus « scientifiques » ? Comment ? en dépit de toutes les « idées modernes » et des préjugés du goût démocratique, la victoire de l’optimisme, la raison, dès lors prédominante, le pratique et théorique utilitarisme, aussi bien que la démocratie elle-même, dont il est contemporain, — tout cela ne pourrait-il pas être le symptôme du déclin de la force, de l’approche de la vieillesse et de la lassitude physiologique ? Et non — le pessimisme ? L’optimiste Épicure ne fut-il pas précisément — un malade ? — On le voit, c’est d’un véritable fardeau de graves problèmes que s’est chargé ce livre, — ajoutons encore le plus grave de tous ! Que signifie, considérée au point de la vue de la Vie — la morale ?…
3.
Encore une fois, ce livre me paraît aujourd’hui un livre impossible, — je le trouve mal écrit, lourd, pénible, hérissé d’images forcenées et incohérentes, sentimental, édulcoré çà et là jusqu’à l’effémination, mal équilibré, dépourvu d’effort vers la pure logique, très convaincu et, à cause de cela, se dispensant de fournir des preuves, doutant même qu’il lui convienne de prouver, en tant que livre d’initiés, « musique » pour ceux-là, dont la musique fut le baptême, et qui, depuis l’origine des choses, sont unis par le lien commun des connaissances artistiques rares, bannière de ralliement pour des frères de même sang in artibus, — un livre hautain et exalté, dirigé de prime abord plus encore contre le profanum vulgus des « intellectuels » que contre le « peuple », mais qui, par son influence, a prouvé et prouve encore qu’il s’entend assez bien à découvrir ses enthousiastes et à les entraîner à travers le labyrinthe de chemins ignorés jusqu’à de joyeuses arènes. En tout cas, — on dut l’avouer avec étonnement et impatience, — ici parlait une voix étrangère, l’apôtre « d’un dieu encore inconnu », affublé provisoirement de la barrette du savant, caché sous la pesanteur et la morosité dialectique de l’Allemand aggravées du mauvais ton du wagnérien ; il y avait là un esprit rempli d’exigences nouvelles et encore innommées, une mémoire gonflée d’interrogations, d’observations, d’obscurités, auxquelles venait s’ajouter, comme un problème de plus, le nom de Dionysos ; ici parlait, — on le remarqua avec défiance, — quelque chose comme une âme mystique, presque une âme de ménade, qui, tourmentée et capricieuse, et quasi irrésolue, si elle doit se livrer ou se dérober, balbutie en quelque sorte une langue étrangère. Elle aurait dû chanter, cette « âme nouvelle », — et non parler ! Quel dommage que je n’aie pas osé exprimer en poète ce que j’avais à dire alors : peut-être bien que cela m’eût été possible ! Tout au moins aurais-je pu m’exprimer en philologue : car, pour les philologues, dans ce domaine, il reste encore aujourd’hui à peu près tout à découvrir et à mettre en lumière ! Avant tout, ce problème, qu’il y a ici un problème, — et qu’il sera toujours absolument impossible de comprendre et de se représenter les Grecs, aussi longtemps qu’on n’aura pas répondu à cette question : « Qu’est-ce que l’esprit dionysien ?… »
Encore une fois, ce livre me paraît aujourd’hui un livre impossible, — je le trouve mal écrit, lourd, pénible, hérissé d’images forcenées et incohérentes, sentimental, édulcoré çà et là jusqu’à l’effémination, mal équilibré, dépourvu d’effort vers la pure logique, très convaincu et, à cause de cela, se dispensant de fournir des preuves, doutant même qu’il lui convienne de prouver, en tant que livre d’initiés, « musique » pour ceux-là, dont la musique fut le baptême, et qui, depuis l’origine des choses, sont unis par le lien commun des connaissances artistiques rares, bannière de ralliement pour des frères de même sang in artibus, — un livre hautain et exalté, dirigé de prime abord plus encore contre le profanum vulgus des « intellectuels » que contre le « peuple », mais qui, par son influence, a prouvé et prouve encore qu’il s’entend assez bien à découvrir ses enthousiastes et à les entraîner à travers le labyrinthe de chemins ignorés jusqu’à de joyeuses arènes. En tout cas, — on dut l’avouer avec étonnement et impatience, — ici parlait une voix étrangère, l’apôtre « d’un dieu encore inconnu », affublé provisoirement de la barrette du savant, caché sous la pesanteur et la morosité dialectique de l’Allemand aggravées du mauvais ton du wagnérien ; il y avait là un esprit rempli d’exigences nouvelles et encore innommées, une mémoire gonflée d’interrogations, d’observations, d’obscurités, auxquelles venait s’ajouter, comme un problème de plus, le nom de Dionysos ; ici parlait, — on le remarqua avec défiance, — quelque chose comme une âme mystique, presque une âme de ménade, qui, tourmentée et capricieuse, et quasi irrésolue, si elle doit se livrer ou se dérober, balbutie en quelque sorte une langue étrangère. Elle aurait dû chanter, cette « âme nouvelle », — et non parler ! Quel dommage que je n’aie pas osé exprimer en poète ce que j’avais à dire alors : peut-être bien que cela m’eût été possible ! Tout au moins aurais-je pu m’exprimer en philologue : car, pour les philologues, dans ce domaine, il reste encore aujourd’hui à peu près tout à découvrir et à mettre en lumière ! Avant tout, ce problème, qu’il y a ici un problème, — et qu’il sera toujours absolument impossible de comprendre et de se représenter les Grecs, aussi longtemps qu’on n’aura pas répondu à cette question : « Qu’est-ce que l’esprit dionysien ?… »
2.
Ce qu’il me fut alors donné de concevoir, quelque chose de terrible et de périlleux, un problème aux cornes menaçantes, pas absolument un taureau sauvage, en tout cas un problème nouveau, je dirais aujourd’hui que ce fut le problème de la science elle-même — de la science considérée pour la première fois comme problématique, discutable. Mais le livre où j’épanchai alors la défiance et la fougue de ma jeunesse, — quel livre impossible dut naître d’une tâche aussi anti-juvénile ! — construit seulement à l’aide de sensations personnelles précoces et hâtives, effleurant l’extrême limite de ce qui peut s’exprimer, appuyé par ses fondations sur le terrain de l’art, — car le problème de la science ne peut être résolu sur le terrain de la science ; — un livre s’adressant peut-être à des artistes possédant par surcroît des aptitudes spéciales pour l’analyse et la comparaison (c’est-à-dire à une espèce exceptionnelle d’artistes, qu’il faut chercher et qu’on ne voudrait même pas chercher…), bourré d’innovations psychologiques et de mystérieux secrets d’artiste, avec, au fond du tableau, une métaphysique d’artiste ; une œuvre de jeunesse, pleine d’ardeur et de mélancolie juvéniles, indépendante, obstinément intransigeante, même si elle semble céder à une autorité ou à une déférence particulière, en un mot une œuvre de début, voire dans le sens fâcheux de l’expression ; entachée, en dépit des allures séniles du problème, de tous les défauts de la jeunesse, avant tout, de ses longueurs excessives, de ses élans tumultueux et de ses violences. D’autre part, en considération du succès qu’il obtint (particulièrement auprès du grand artiste auquel il s’adressait comme une manière de colloque, Richard Wagner), un vrai livre, je veux dire un livre qui, en tous cas, a donné satisfaction aux « meilleurs de son temps ». Cette seule raison lui mériterait quelque déférence et certains égards ; cependant je ne veux pas dissimuler tout à fait l’impression désagréable qu’il me produit aujourd’hui : combien, après seize années, il se présente comme un étranger — à mes yeux plus expérimentés, cent fois plus sévères, bien qu’aucunement refroidis, et nullement enclins à se détourner de cette même tâche à laquelle ce livre téméraire osa le premier se mesurer, à savoir — de considérer la science sous l’optique de l’artiste et l’art sous l’optique de la vie…
Ce qu’il me fut alors donné de concevoir, quelque chose de terrible et de périlleux, un problème aux cornes menaçantes, pas absolument un taureau sauvage, en tout cas un problème nouveau, je dirais aujourd’hui que ce fut le problème de la science elle-même — de la science considérée pour la première fois comme problématique, discutable. Mais le livre où j’épanchai alors la défiance et la fougue de ma jeunesse, — quel livre impossible dut naître d’une tâche aussi anti-juvénile ! — construit seulement à l’aide de sensations personnelles précoces et hâtives, effleurant l’extrême limite de ce qui peut s’exprimer, appuyé par ses fondations sur le terrain de l’art, — car le problème de la science ne peut être résolu sur le terrain de la science ; — un livre s’adressant peut-être à des artistes possédant par surcroît des aptitudes spéciales pour l’analyse et la comparaison (c’est-à-dire à une espèce exceptionnelle d’artistes, qu’il faut chercher et qu’on ne voudrait même pas chercher…), bourré d’innovations psychologiques et de mystérieux secrets d’artiste, avec, au fond du tableau, une métaphysique d’artiste ; une œuvre de jeunesse, pleine d’ardeur et de mélancolie juvéniles, indépendante, obstinément intransigeante, même si elle semble céder à une autorité ou à une déférence particulière, en un mot une œuvre de début, voire dans le sens fâcheux de l’expression ; entachée, en dépit des allures séniles du problème, de tous les défauts de la jeunesse, avant tout, de ses longueurs excessives, de ses élans tumultueux et de ses violences. D’autre part, en considération du succès qu’il obtint (particulièrement auprès du grand artiste auquel il s’adressait comme une manière de colloque, Richard Wagner), un vrai livre, je veux dire un livre qui, en tous cas, a donné satisfaction aux « meilleurs de son temps ». Cette seule raison lui mériterait quelque déférence et certains égards ; cependant je ne veux pas dissimuler tout à fait l’impression désagréable qu’il me produit aujourd’hui : combien, après seize années, il se présente comme un étranger — à mes yeux plus expérimentés, cent fois plus sévères, bien qu’aucunement refroidis, et nullement enclins à se détourner de cette même tâche à laquelle ce livre téméraire osa le premier se mesurer, à savoir — de considérer la science sous l’optique de l’artiste et l’art sous l’optique de la vie…
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Friedrich Nietzsche (155)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Philo pour tous
Jostein Gaarder fut au hit-parade des écrits philosophiques rendus accessibles au plus grand nombre avec un livre paru en 1995. Lequel?
Les Mystères de la patience
Le Monde de Sophie
Maya
Vita brevis
10 questions
441 lecteurs ont répondu
Thèmes :
spiritualité
, philosophieCréer un quiz sur ce livre441 lecteurs ont répondu