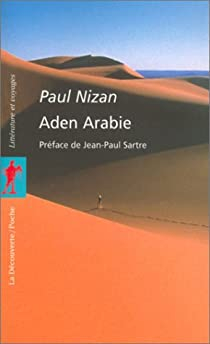>
Critique de cedratier
« Aden Arabie » ; Paul Nizan (Préf J.P. Sartre, Ed La Découverte, 160p)
Dans la rubrique « je profite de la retraite pour lire enfin ce que je n'ai pas lu à 18 ans » (!!!), j'empoigne cet opuscule, publié pour la première fois en 1931, connu d'abord pour son incipit célébrissime (« J'avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie »), et relancé par la presque aussi célèbre préface que Sartre lui offrit dans une réédition de 1960, celle-là même que je viens de lire.
Et puisque Sartre, c'est lui-même, commençons donc par ladite préface, qui fait à elle seule la moitié du récit de Nizan. En fait, c'est moins une préface au livre qu'une volonté tardive de réhabiliter celui qui, mort à 35 ans en 1940 dans la débâcle des armées anglo-françaises à Dunkerque, fut son ami de jeunesse à Normal' Sup. C'est ce qui fonda la vie et les engagements de Nizan que Sartre fait défiler, s'appuyant d'ailleurs essentiellement sur son autre roman grandement autobiographique : « Antoine Bloyé ». Nizan s'est toujours vécu comme une sorte de transfuge de classe (un thème tellement à la mode aujourd'hui, d'Edouard Louis à Annie Ernaux, celle-ci valant quand même largement mieux que celui-là), dans la suite de son père cheminot devenu ingénieur. Sartre rappelle qu'il s'est engagé au Parti Communiste, dont il claquera la porte quelques mois avant sa mort, au moment du pacte Hitler/Staline, parce que le PCF n'avait à ses yeux pas su jouer à ce moment de suffisamment de machiavélisme (sic !!!) Cette rupture lui vaudra l'anathème de toute une partie de la Gauche stalinienne ou crypto-communiste, ce qu'il paiera d'une purge de bien des bibliothèques, l'amnésie de nombre de ses anciens lecteurs, bref un quasi effacement du champs littéraire. En 1960, Sartre, dans ce texte qui a tout d'une auto-critique, analyse en quoi lui-même n'a pas su réagir à l'époque face à cet effacement, ses causes, avec des mots qui parfois ont un drôle d'écho. « Croit-on qu'elle puisse attirer les fils, la Gauche, ce grand cadavre à la renverse, où les vers se sont mis ? Elle pue, cette charogne ; les pouvoirs des militaires, la dictature et le fascisme naissent ou naitront de sa décomposition… » Il dévoile les mécanismes de la société des années 60 / 70 de manière très fine, « le temps où la bourgeoisie promet à tous le grand avenir des chances égales, où chaque ouvrier a dans son cartable un diplôme en blanc de bourgeois. » Et quelques autres sentences intéressantes, qui nous amènent à l'essentiel, cet Aden où Nizan a voulu fuir une destinée trop certaine.
Passons donc cet incipit. PN commence par une charge sévère contre l'intelligentsia et les élites universitaires de Normal' Sup : « on y dresse une partie de cette troupe orgueilleuse de magiciens que ceux qui paient pour la former nomment l'élite et qui a pour mission de maintenir le peuple dans le chemin de la complaisance et du respect, vertus qui sont le Bien. » Charge contre la bourgeoisie et ses vassaux intellectuels ; « Bouffons, complices : métiers de l'esprit. » Et quand il veut forcer le trait de la caricature, celui qui fleurta avant ses 20 ans avec le royalisme et l'extrême-droite n'échappe pas aux clichés antisémites « (…) les courts mouvements de ses doucereuses mains de marchant juif. » Ou encore : « Les bourgeois, comme il y a beau temps qu'ils ont hérité d'Israël, ils passent la vie à prêter à intérêt. »
Il cherche vainement une solidarité avec les plus humbles qu'il ne parvient pas à concrétiser, et lui comme tant d'autres « veut assurer son évasion par ses propres moyens. » Comment fuir ce monde abject ? Ni la religion ni l'art ne sont des solutions acceptables pour ce vieux jeune homme désabusé, il reste donc le voyage exotique, avec sa dose d'aventure loin de l'Europe déliquescente. Nizan à 20 ans choisit Aden. Comme d'autres, il ne se rendra compte que sur place que ces terres de rêves de pacotille ne sont que des comptoirs commerciaux, des populations à surexploiter, des sources de richesses pour les bourses occidentales. C'est d'abord le voyage, escale à Port Saïd, on se croirait (pour les ‘images', pas pour l'écriture bien sûr) dans « Tintin et les cigares du Pharaon ». Enfin, Aden ; « Je suis arrivé, il n'y a pas de quoi être fier ». L'aigreur est donc vite là. Quand il parle des marins qu'il a rencontrés, c'est pour constater qu'ils « diffèrent moins qu'on ne pourrait le croire des voyageurs de commerce qui font une région française dans une six chevaux Renault. Je vous le dis que tous les hommes s'ennuient. »
Il ne dit rien de son travail de précepteur, ne se lie à aucun groupe, à aucun clan social de ce monde colonial qu'il découvre, pas plus qu'à des autochtones d'ailleurs. Il nous offre juste un formidable portrait au vitriol de M. C., riche industriel et commerçant en peaux, ayant des agences partout dans le monde, et qui se prend pour un homme de bien, alors qu'il n'est que farce et course au mirage de la fortune qu'il possède déjà, et qu'il ne rêve que d'agrandir. Nizan, lui, est dans la quête. « Je me cherchais en vain des obligations, ces habitudes que personne ne comprend, ces dieux imaginaires dont l'ombre s'étend sur tous les coeurs. » Où est sa liberté ? « Vous pouvez uriner librement dans la mer : nommerez-vous ces actes la liberté ? » Mais « Renaitre ne va pas de soi. » « Orient, sous tes arbres à palmes des poésies, je ne trouve encore qu'une autre souffrance des hommes. »
Alors il en vient à se demander pourquoi il a fui. « Fuir signifiait qu'on renonçait à regarder de près le monde qu'on fuyait, qu'on renonçait à demander des comptes le jour où on aurait compris. » La déconvenue est totale, sur le monde comme sur lui-même. « Qu'on ne me refasse plus le tableau séduisant des voyages poétiques et sauveurs, avec leurs fonds marins, leurs monceaux de pays et leurs personnages étrangement vêtus devants des forêts (…) »
Il prend conscience qu'il a besoin de s'ancrer dans une terre, un chez soi, qu'il courrait après une illusion. Alors autant rentrer, puisque « le voyage est une suite de disparitions irréparables. » Maintenant « Je rejette les navigations et les itinéraires. » (Quelques années plus tard, de retour du Brésil, Lévi-Strauss écrira : « Je hais les voyages et les explorateurs. »)
Parfois, je me suis perdu dans son monologue sur la vie, la mort, et sur le désoeuvrement — maladie endémique des ‘expats', comme on dirait aujourd'hui, qui vivent sur l'humiliation des colonisés. Alors que la leçon qu'il tirera finalement de cette année sur la Mer d'Arabie, c'est que « Il n'y a qu'une espèce valide de voyages, qui est la marche vers les hommes. C'est le voyage d'Ulysse (…) Et il se termine naturellement par le retour. Tout le prix du voyage est dans son dernier jour. »
Il n'y a donc qu'en France, son pays dont il connait les rouages, qu'il peut faire oeuvre utile, c'est-à-dire de combat. Il arrive à Marseille ; de loin, « le château d'If (…) Notre-Dame-de-la-Garde. J'étais servi : les premiers emblèmes venus à ma rencontre étaient justement les deux objets les plus révoltants de la terre : une église, une prison. »
L'essentiel de ce récit autobiographique est donc d'abord un chemin de désillusion, un rejet viscéral d'une société dont il a retrouvé tous les rouages pervers en concentré en croyant s'en éloigner. Mais aussi un texte plein d'amertume vis-à-vis de lui-même.
A son retour, en rejet de ce monde d'injustice et d'exploitation, il adhère au Parti Communiste, à un moment où la gangrène stalinienne n'a pas encore totalement réussi à faire dégénérer le mouvement communiste international. le dernier chapitre est un tract, un manifeste, un appel à la mobilisation. C'est une bordée sévère contre les bourgeois, petits ou grands capitalistes, les intellectuels à leurs services, une charge anti-nationaliste aussi, une profession de solidarité avec les plus humbles. Là s'exprime totalement la révolte, son désir d'engagement pour plus de justice. « La grande ruse de la bourgeoisie consiste à rendre les ouvriers actionnaires ou rentiers. » Quel humour grinçant pour décrire « l'homo economicus (… qui) entretient des hommes pour lui fabriquer des illusions : des romanciers, des historiens, des poètes épiques, des philosophes. » « Il faut voir les Français défiler les jours de fête devant les héros qu'on procure sagement à leurs besoins de récréation. » Mais son appel à la guerre de classe est aussi une posture parfois pleine d'excès, qui pousse dans le provoquant « Il ne faut plus rougir d'être fanatique. »
Malgré ces quelques outrances finales, par bien des côtés ce texte n'a pas pris une ride, même si c'est un discours que l'on n'entend quasiment plus, sauf à la marge, et même très à la marge du paysage politique. Ce que Nizan dénonce reste d'une actualité difficilement contestable. Un peu d'air frais ne fait pas de mal par les temps qui courent.
L'écriture est très belle, fouillée, rigoureuse, le style est enlevé, percutant, on n'écrit plus beaucoup comme cela de nos jours, et c'est sans doute dommage. On l'aura compris, il ne faut guère chercher de descriptions concrètes de la région qu'il habite pendant un an, son récit de voyage est d'abord cérébral, tout en douloureux cheminement intérieur. J'ai regretté que lui qui parle de rencontre avec les hommes, ne nous en ait présenté aucun, ce qui donne à son texte un côté désincarné, et à son engagement une « rigidité » et un formalisme qui dessert son projet.
Au final, pas déçu du tout d'avoir fait ce « rattrapage ».
Dans la rubrique « je profite de la retraite pour lire enfin ce que je n'ai pas lu à 18 ans » (!!!), j'empoigne cet opuscule, publié pour la première fois en 1931, connu d'abord pour son incipit célébrissime (« J'avais 20 ans. Je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie »), et relancé par la presque aussi célèbre préface que Sartre lui offrit dans une réédition de 1960, celle-là même que je viens de lire.
Et puisque Sartre, c'est lui-même, commençons donc par ladite préface, qui fait à elle seule la moitié du récit de Nizan. En fait, c'est moins une préface au livre qu'une volonté tardive de réhabiliter celui qui, mort à 35 ans en 1940 dans la débâcle des armées anglo-françaises à Dunkerque, fut son ami de jeunesse à Normal' Sup. C'est ce qui fonda la vie et les engagements de Nizan que Sartre fait défiler, s'appuyant d'ailleurs essentiellement sur son autre roman grandement autobiographique : « Antoine Bloyé ». Nizan s'est toujours vécu comme une sorte de transfuge de classe (un thème tellement à la mode aujourd'hui, d'Edouard Louis à Annie Ernaux, celle-ci valant quand même largement mieux que celui-là), dans la suite de son père cheminot devenu ingénieur. Sartre rappelle qu'il s'est engagé au Parti Communiste, dont il claquera la porte quelques mois avant sa mort, au moment du pacte Hitler/Staline, parce que le PCF n'avait à ses yeux pas su jouer à ce moment de suffisamment de machiavélisme (sic !!!) Cette rupture lui vaudra l'anathème de toute une partie de la Gauche stalinienne ou crypto-communiste, ce qu'il paiera d'une purge de bien des bibliothèques, l'amnésie de nombre de ses anciens lecteurs, bref un quasi effacement du champs littéraire. En 1960, Sartre, dans ce texte qui a tout d'une auto-critique, analyse en quoi lui-même n'a pas su réagir à l'époque face à cet effacement, ses causes, avec des mots qui parfois ont un drôle d'écho. « Croit-on qu'elle puisse attirer les fils, la Gauche, ce grand cadavre à la renverse, où les vers se sont mis ? Elle pue, cette charogne ; les pouvoirs des militaires, la dictature et le fascisme naissent ou naitront de sa décomposition… » Il dévoile les mécanismes de la société des années 60 / 70 de manière très fine, « le temps où la bourgeoisie promet à tous le grand avenir des chances égales, où chaque ouvrier a dans son cartable un diplôme en blanc de bourgeois. » Et quelques autres sentences intéressantes, qui nous amènent à l'essentiel, cet Aden où Nizan a voulu fuir une destinée trop certaine.
Passons donc cet incipit. PN commence par une charge sévère contre l'intelligentsia et les élites universitaires de Normal' Sup : « on y dresse une partie de cette troupe orgueilleuse de magiciens que ceux qui paient pour la former nomment l'élite et qui a pour mission de maintenir le peuple dans le chemin de la complaisance et du respect, vertus qui sont le Bien. » Charge contre la bourgeoisie et ses vassaux intellectuels ; « Bouffons, complices : métiers de l'esprit. » Et quand il veut forcer le trait de la caricature, celui qui fleurta avant ses 20 ans avec le royalisme et l'extrême-droite n'échappe pas aux clichés antisémites « (…) les courts mouvements de ses doucereuses mains de marchant juif. » Ou encore : « Les bourgeois, comme il y a beau temps qu'ils ont hérité d'Israël, ils passent la vie à prêter à intérêt. »
Il cherche vainement une solidarité avec les plus humbles qu'il ne parvient pas à concrétiser, et lui comme tant d'autres « veut assurer son évasion par ses propres moyens. » Comment fuir ce monde abject ? Ni la religion ni l'art ne sont des solutions acceptables pour ce vieux jeune homme désabusé, il reste donc le voyage exotique, avec sa dose d'aventure loin de l'Europe déliquescente. Nizan à 20 ans choisit Aden. Comme d'autres, il ne se rendra compte que sur place que ces terres de rêves de pacotille ne sont que des comptoirs commerciaux, des populations à surexploiter, des sources de richesses pour les bourses occidentales. C'est d'abord le voyage, escale à Port Saïd, on se croirait (pour les ‘images', pas pour l'écriture bien sûr) dans « Tintin et les cigares du Pharaon ». Enfin, Aden ; « Je suis arrivé, il n'y a pas de quoi être fier ». L'aigreur est donc vite là. Quand il parle des marins qu'il a rencontrés, c'est pour constater qu'ils « diffèrent moins qu'on ne pourrait le croire des voyageurs de commerce qui font une région française dans une six chevaux Renault. Je vous le dis que tous les hommes s'ennuient. »
Il ne dit rien de son travail de précepteur, ne se lie à aucun groupe, à aucun clan social de ce monde colonial qu'il découvre, pas plus qu'à des autochtones d'ailleurs. Il nous offre juste un formidable portrait au vitriol de M. C., riche industriel et commerçant en peaux, ayant des agences partout dans le monde, et qui se prend pour un homme de bien, alors qu'il n'est que farce et course au mirage de la fortune qu'il possède déjà, et qu'il ne rêve que d'agrandir. Nizan, lui, est dans la quête. « Je me cherchais en vain des obligations, ces habitudes que personne ne comprend, ces dieux imaginaires dont l'ombre s'étend sur tous les coeurs. » Où est sa liberté ? « Vous pouvez uriner librement dans la mer : nommerez-vous ces actes la liberté ? » Mais « Renaitre ne va pas de soi. » « Orient, sous tes arbres à palmes des poésies, je ne trouve encore qu'une autre souffrance des hommes. »
Alors il en vient à se demander pourquoi il a fui. « Fuir signifiait qu'on renonçait à regarder de près le monde qu'on fuyait, qu'on renonçait à demander des comptes le jour où on aurait compris. » La déconvenue est totale, sur le monde comme sur lui-même. « Qu'on ne me refasse plus le tableau séduisant des voyages poétiques et sauveurs, avec leurs fonds marins, leurs monceaux de pays et leurs personnages étrangement vêtus devants des forêts (…) »
Il prend conscience qu'il a besoin de s'ancrer dans une terre, un chez soi, qu'il courrait après une illusion. Alors autant rentrer, puisque « le voyage est une suite de disparitions irréparables. » Maintenant « Je rejette les navigations et les itinéraires. » (Quelques années plus tard, de retour du Brésil, Lévi-Strauss écrira : « Je hais les voyages et les explorateurs. »)
Parfois, je me suis perdu dans son monologue sur la vie, la mort, et sur le désoeuvrement — maladie endémique des ‘expats', comme on dirait aujourd'hui, qui vivent sur l'humiliation des colonisés. Alors que la leçon qu'il tirera finalement de cette année sur la Mer d'Arabie, c'est que « Il n'y a qu'une espèce valide de voyages, qui est la marche vers les hommes. C'est le voyage d'Ulysse (…) Et il se termine naturellement par le retour. Tout le prix du voyage est dans son dernier jour. »
Il n'y a donc qu'en France, son pays dont il connait les rouages, qu'il peut faire oeuvre utile, c'est-à-dire de combat. Il arrive à Marseille ; de loin, « le château d'If (…) Notre-Dame-de-la-Garde. J'étais servi : les premiers emblèmes venus à ma rencontre étaient justement les deux objets les plus révoltants de la terre : une église, une prison. »
L'essentiel de ce récit autobiographique est donc d'abord un chemin de désillusion, un rejet viscéral d'une société dont il a retrouvé tous les rouages pervers en concentré en croyant s'en éloigner. Mais aussi un texte plein d'amertume vis-à-vis de lui-même.
A son retour, en rejet de ce monde d'injustice et d'exploitation, il adhère au Parti Communiste, à un moment où la gangrène stalinienne n'a pas encore totalement réussi à faire dégénérer le mouvement communiste international. le dernier chapitre est un tract, un manifeste, un appel à la mobilisation. C'est une bordée sévère contre les bourgeois, petits ou grands capitalistes, les intellectuels à leurs services, une charge anti-nationaliste aussi, une profession de solidarité avec les plus humbles. Là s'exprime totalement la révolte, son désir d'engagement pour plus de justice. « La grande ruse de la bourgeoisie consiste à rendre les ouvriers actionnaires ou rentiers. » Quel humour grinçant pour décrire « l'homo economicus (… qui) entretient des hommes pour lui fabriquer des illusions : des romanciers, des historiens, des poètes épiques, des philosophes. » « Il faut voir les Français défiler les jours de fête devant les héros qu'on procure sagement à leurs besoins de récréation. » Mais son appel à la guerre de classe est aussi une posture parfois pleine d'excès, qui pousse dans le provoquant « Il ne faut plus rougir d'être fanatique. »
Malgré ces quelques outrances finales, par bien des côtés ce texte n'a pas pris une ride, même si c'est un discours que l'on n'entend quasiment plus, sauf à la marge, et même très à la marge du paysage politique. Ce que Nizan dénonce reste d'une actualité difficilement contestable. Un peu d'air frais ne fait pas de mal par les temps qui courent.
L'écriture est très belle, fouillée, rigoureuse, le style est enlevé, percutant, on n'écrit plus beaucoup comme cela de nos jours, et c'est sans doute dommage. On l'aura compris, il ne faut guère chercher de descriptions concrètes de la région qu'il habite pendant un an, son récit de voyage est d'abord cérébral, tout en douloureux cheminement intérieur. J'ai regretté que lui qui parle de rencontre avec les hommes, ne nous en ait présenté aucun, ce qui donne à son texte un côté désincarné, et à son engagement une « rigidité » et un formalisme qui dessert son projet.
Au final, pas déçu du tout d'avoir fait ce « rattrapage ».