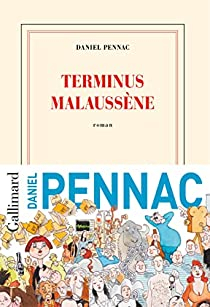>
Critique de AnneVacquant
Livre reçu dans le cadre de l'opération « Masse Critique » (privilégiée) de Babelio dont je remercie les organisateurs et les organisatrices ainsi que les éditions mentionnées.
Portée par la verve de l'auteur, je me suis replongée facilement dans l'histoire après une interruption de plusieurs années.
Rien n'a changé ou presque : ce dernier opus – en date – de la saga Malaussène rassemble les enfants et petits-enfants de « Maman » chacun né d'un père différent et souvent anonyme, qui se regroupent dans leur Q .G. parisien, une ancienne quincaillerie dans le quartier de Belleville, sous l'oeil bienveillant du fils aîné, Benjamin, père idéal dans une famille élective, bouc émissaire de profession, et autour desquels les amis, les collègues, les conjoints et les rencontres qui savent apporter chaque fois des péripéties supplémentaires à l'épopée familiale. le chien Julius (n°3) est toujours là avec ses effluves malodorants.
Le cas Malaussène tome 2 : Terminus Malaussène est la suite de le cas Malaussène, tome 1 : Ils m'ont menti. L'homme d'affaires, Georges Lapietà, kidnappé précédemment pour un « happening » inoffensif se retrouve une seconde fois kidnappé par une bande armée en vue d'une rançon. L'intrigue facétieuse de ce nouveau pseudopolar ne s'écarte pas de ce qui a fait le succès de la saga. Il consiste à reprendre, simultanément avec la police mais sans coordination, les victimes aux seconds kidnappeurs. L'action prime et les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné.
La fantaisie et l'ironie dédramatisent les aspects absurdes, injustes et violents d'une société somme toute désorientée. À travers une famille sous forme de tribu déjantée, Daniel Pennac semble proposer une sorte de parade au sentiment de peur devant le « devenir » des jeunes. En effet, la peur du chômage, de la délinquance, de l'échec et de la pauvreté expliquée dans Chagrin d'école par exemple, est ici déverrouillée dans la joie, l'humour et la liberté. L'auteur confesse (également dans Chagrin d'école) : « [le] cosmopolitisme, chez moi, c'est presque génétique ! ». On retrouve ce cosmopolitisme dans le mélange des genres et des langues opéré par « Pépère », le chef de la bande d'escrocs. Mais Pennac argue qu'il « ne parlerai[t] pas de métissage », car si le personnage de Pépère ajoute la soie au faubourg, il ne les mixe pas pour en faire une nouvelle identité composite : il efface leurs particularités (ethnie, religion…) en les neutralisant. Dans le milieu multiculturel de Belleville où l'auteur et ses personnages habitent, les différences culturelles semblent s'abolir.
Le temps qui s'écoule fait que la liste des personnages s'allonge, que les participants à l'histoire grandissent/vieillissent et que les noms changent parfois au gré des mariages ou des diminutifs. Un répertoire et un arbre généalogique viennent alors aider à s'y reconnaître tout en ajoutant une note d'authenticité à cette famille disparate. Les générations se rassemblent toujours autour d'une maman qui cette fois ne rentre pas avec un nouveau bébé puis repart. Dans cet ultime épisode, la mère vieillit auprès d'un mari officiel et vivant, avec lequel elle n'a pas fait d'enfant. Maman donc, qui était jusqu'alors une femme belle, égoïste et volage, « qui ne se réveill[ait] que pour faire des conneries » (p 75) revient amoureuse sans le savoir d'un grand patron du banditisme. le fils astrophysicien, futur prix Nobel, dit « le Petit » (1m98 !), développe alors une comparaison avec un « trou noir supermassif » (p 385. Nous n'appuierons pas sur l'éventuelle connotation sarcastiquement sexuelle qu'on pourrait déceler). Elle serait une matrice originelle dont la présence attire à elle ses rejetons et dont l'absence les disperse ensuite (p 383), un maelström spatio-temporel qui unirait l'ensemble par un lien de l'ordre de la métaphysique… La mère serait un « aimant » dans les deux sens du terme : un objet magnétique et un être plein d'amour. Mais le trou noir en physique, si j'en ai bien compris la définition, avale ce qu'il attire (et ce serait la raison pour laquelle les hommes auraient fui « Maman », p 386). Cette comparaison pourrait rejoindre le cliché de la mère juive étouffante ? L'image d'Épinal de la famille est quelque peu malmenée par une autodérision digne d'« un de ces romans filiaux où les mères ont rarement le beau rôle » (p 233). Et pourtant, le Petit dit qu'il n'aurait pu « rêver meilleure mère » (p 386)…
La critique de la société et de ses vicissitudes est toujours bien présente dans cet opus : du capitalisme au consumérisme, du football à ses malversations, de la littérature vraie (les Vévés) à la cupidité des éditeurs, de la cause des enfants (abusés, désocialisés, orphelins) à celle du troisième âge et à la mort exhibée (le cimetière du Père Lachaise glissant dans les airs au-dessus des vivants, p 150), de la réflexion dans la pensée jusqu'au mensonge, etc., les chevaux de bataille de l'auteur mènent un train d'enfer à la pietà (pitié), un jeu de mots qui ridiculise tous les Lapietà et leurs anagrammes partielles (p 329).
Dans un style simple mais pertinent et grâce à des dialogues au ton enlevé et percutant, ce feuilleton dont l'auteur nous assure qu'il sera le dernier, garde un souffle qui ne s'est pas épuisé. Les portraits que dessinent les réparties et les apartés sous forme de parenthèses jubilatoires nous procurent des moments de pause dans l'action et de réflexion pour l'esprit. L'imagination de Daniel Pennac est toujours prête à des effets papillon inopinés et spirituels.
Une bombe et des kidnappings débutent la saga. Un kidnapping et une bombe la terminent. La boucle est bouclée. Est-ce la raison pour laquelle le romancier met un méchant vraiment méchant à l'honneur et que « Tout le présent volume lui est consacré » ? (répertoire p 439). Ce n'est ni un héros ni un antihéros. Jamais gentil (à part pour sa femme et son gratin dauphinois (sorte de madeleine de Proust autant que d'indice révélateur (p 325, 371)), il prémédite une explosion suicidaire, collective et vengeresse. Si Daniel Pennac lui attribue une certaine classe, une éducation et des principes qui ont pu faire dire à un lecteur que le protagoniste « ressemblait » à son auteur (« il appert que Pépère est un peu l'incarnation de Daniel Pennac lui-même, désormais vieillissant mais toujours alerte et espiègle »), si je suis d'accord avec « alerte » et « espiègle » ainsi qu'avec « vieillissant » – il ne m'en voudra pas –, je pense savoir que Daniel Pennac n'est pas un malfaiteur. Ce qui semble avoir été perçu serait-il alors de l'ordre d'une certaine projection de son côté affabulateur « sincère et joyeusement suicidaire » ? (cf. Chagrin d'école, p 65). Ou bien l'ambiguïté du personnage de « grand-père » pourrait-il trahir une sorte de parodie du gendarme de l'ombre (p 331-2), du justicier vengeur et « privatisé » pour une délégation des tâches ? Dans Chagrin d'école de nouveau, l'auteur demande à Minne : « Et que fait- tu du bandit ? le 0,4 %, le petit bandit, qu'est-ce que tu en fais ? / Elle sourit : / – le gendarme, bien sûr. » (p 168, v. num). Pépère ferait-il partie des 0, 4% des méchants pas si méchants ou bien du pourcentage résiduel irrécupérable ? (Ibid., p 169)
En effet, on a du mal à penser que la pirouette langagière de Terminus Malaussène se termine sur une fin dramatique. le dénouement reste ouvert, car l'acte définitif est laissé en suspens. Pépère (qui cache bien son jeu, il faut le dire) après l'implosion de son équipe couve des desseins explosifs, mais ouvre-t-il sa sacoche pour déclencher ou bien pour désamorcer ce qu'elle contient ? Les points de suspension sont-ils le reflet de l'impossibilité de finir pour l'auteur qui rechigne devant le point final ou une dernière taquinerie vis-à-vis d'un besoin de complaire à la demande ? (bien qu'il avoue par ailleurs qu'il s'est «laissé aller au plaisir des retrouvailles»). Et la « bombe » ne serait en définitive que l'annonce de Maman faite à Pépère concernant Benjamin (p 430) ?
À plusieurs reprises, les personnages du présent tome rappellent ou font allusion à un épisode vécu dans l'un des tomes précédents. On perçoit le recul de Benjamin en « être social » fidèle et fiable (p 233) dans une mise en abîme (p 46, 271, 391, 415, 427) qui laisse poindre sous le personnage l'auteur (sans doute une autre facette de D. Pennac). Lorsque la reine Zabo reproche à Alceste : « Quand on capture un si nombreux lectorat avec un premier roman, on ne le déstabilise pas dès le deuxième. On attend au moins dix bouquins pour changer de ton » (p 79), on peut se demander si le camion bibliothèque, pris pour véhicule (p 88) et donc pour cible des balles, n'illustre pas cette légère mélancolie qui affleure ? Si le « réalisme magique » dont Alceste se défend : « Je risque ma peau pour révéler cette monstruosité, je l'apporte sous la forme d'un roman à mon éditeur, et pour quel résultat ? » pourrait bien être un excès de réel, imputable à l'auteur lui-même ?
Quoi qu'il en soit selon Daniel Pennac, l'écrivain a toujours le dernier mot : « Il a tiré sur le fil jusqu'à ce que nous nous retrouvions tous à poil. Un romancier, bon sang, un romancier tout seul » (p 376). Sa foi dans l'humanité et le pouvoir de l'écrit paraissent intacts.
Lien : http://anne.vacquant.free.fr..
Portée par la verve de l'auteur, je me suis replongée facilement dans l'histoire après une interruption de plusieurs années.
Rien n'a changé ou presque : ce dernier opus – en date – de la saga Malaussène rassemble les enfants et petits-enfants de « Maman » chacun né d'un père différent et souvent anonyme, qui se regroupent dans leur Q .G. parisien, une ancienne quincaillerie dans le quartier de Belleville, sous l'oeil bienveillant du fils aîné, Benjamin, père idéal dans une famille élective, bouc émissaire de profession, et autour desquels les amis, les collègues, les conjoints et les rencontres qui savent apporter chaque fois des péripéties supplémentaires à l'épopée familiale. le chien Julius (n°3) est toujours là avec ses effluves malodorants.
Le cas Malaussène tome 2 : Terminus Malaussène est la suite de le cas Malaussène, tome 1 : Ils m'ont menti. L'homme d'affaires, Georges Lapietà, kidnappé précédemment pour un « happening » inoffensif se retrouve une seconde fois kidnappé par une bande armée en vue d'une rançon. L'intrigue facétieuse de ce nouveau pseudopolar ne s'écarte pas de ce qui a fait le succès de la saga. Il consiste à reprendre, simultanément avec la police mais sans coordination, les victimes aux seconds kidnappeurs. L'action prime et les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné.
La fantaisie et l'ironie dédramatisent les aspects absurdes, injustes et violents d'une société somme toute désorientée. À travers une famille sous forme de tribu déjantée, Daniel Pennac semble proposer une sorte de parade au sentiment de peur devant le « devenir » des jeunes. En effet, la peur du chômage, de la délinquance, de l'échec et de la pauvreté expliquée dans Chagrin d'école par exemple, est ici déverrouillée dans la joie, l'humour et la liberté. L'auteur confesse (également dans Chagrin d'école) : « [le] cosmopolitisme, chez moi, c'est presque génétique ! ». On retrouve ce cosmopolitisme dans le mélange des genres et des langues opéré par « Pépère », le chef de la bande d'escrocs. Mais Pennac argue qu'il « ne parlerai[t] pas de métissage », car si le personnage de Pépère ajoute la soie au faubourg, il ne les mixe pas pour en faire une nouvelle identité composite : il efface leurs particularités (ethnie, religion…) en les neutralisant. Dans le milieu multiculturel de Belleville où l'auteur et ses personnages habitent, les différences culturelles semblent s'abolir.
Le temps qui s'écoule fait que la liste des personnages s'allonge, que les participants à l'histoire grandissent/vieillissent et que les noms changent parfois au gré des mariages ou des diminutifs. Un répertoire et un arbre généalogique viennent alors aider à s'y reconnaître tout en ajoutant une note d'authenticité à cette famille disparate. Les générations se rassemblent toujours autour d'une maman qui cette fois ne rentre pas avec un nouveau bébé puis repart. Dans cet ultime épisode, la mère vieillit auprès d'un mari officiel et vivant, avec lequel elle n'a pas fait d'enfant. Maman donc, qui était jusqu'alors une femme belle, égoïste et volage, « qui ne se réveill[ait] que pour faire des conneries » (p 75) revient amoureuse sans le savoir d'un grand patron du banditisme. le fils astrophysicien, futur prix Nobel, dit « le Petit » (1m98 !), développe alors une comparaison avec un « trou noir supermassif » (p 385. Nous n'appuierons pas sur l'éventuelle connotation sarcastiquement sexuelle qu'on pourrait déceler). Elle serait une matrice originelle dont la présence attire à elle ses rejetons et dont l'absence les disperse ensuite (p 383), un maelström spatio-temporel qui unirait l'ensemble par un lien de l'ordre de la métaphysique… La mère serait un « aimant » dans les deux sens du terme : un objet magnétique et un être plein d'amour. Mais le trou noir en physique, si j'en ai bien compris la définition, avale ce qu'il attire (et ce serait la raison pour laquelle les hommes auraient fui « Maman », p 386). Cette comparaison pourrait rejoindre le cliché de la mère juive étouffante ? L'image d'Épinal de la famille est quelque peu malmenée par une autodérision digne d'« un de ces romans filiaux où les mères ont rarement le beau rôle » (p 233). Et pourtant, le Petit dit qu'il n'aurait pu « rêver meilleure mère » (p 386)…
La critique de la société et de ses vicissitudes est toujours bien présente dans cet opus : du capitalisme au consumérisme, du football à ses malversations, de la littérature vraie (les Vévés) à la cupidité des éditeurs, de la cause des enfants (abusés, désocialisés, orphelins) à celle du troisième âge et à la mort exhibée (le cimetière du Père Lachaise glissant dans les airs au-dessus des vivants, p 150), de la réflexion dans la pensée jusqu'au mensonge, etc., les chevaux de bataille de l'auteur mènent un train d'enfer à la pietà (pitié), un jeu de mots qui ridiculise tous les Lapietà et leurs anagrammes partielles (p 329).
Dans un style simple mais pertinent et grâce à des dialogues au ton enlevé et percutant, ce feuilleton dont l'auteur nous assure qu'il sera le dernier, garde un souffle qui ne s'est pas épuisé. Les portraits que dessinent les réparties et les apartés sous forme de parenthèses jubilatoires nous procurent des moments de pause dans l'action et de réflexion pour l'esprit. L'imagination de Daniel Pennac est toujours prête à des effets papillon inopinés et spirituels.
Une bombe et des kidnappings débutent la saga. Un kidnapping et une bombe la terminent. La boucle est bouclée. Est-ce la raison pour laquelle le romancier met un méchant vraiment méchant à l'honneur et que « Tout le présent volume lui est consacré » ? (répertoire p 439). Ce n'est ni un héros ni un antihéros. Jamais gentil (à part pour sa femme et son gratin dauphinois (sorte de madeleine de Proust autant que d'indice révélateur (p 325, 371)), il prémédite une explosion suicidaire, collective et vengeresse. Si Daniel Pennac lui attribue une certaine classe, une éducation et des principes qui ont pu faire dire à un lecteur que le protagoniste « ressemblait » à son auteur (« il appert que Pépère est un peu l'incarnation de Daniel Pennac lui-même, désormais vieillissant mais toujours alerte et espiègle »), si je suis d'accord avec « alerte » et « espiègle » ainsi qu'avec « vieillissant » – il ne m'en voudra pas –, je pense savoir que Daniel Pennac n'est pas un malfaiteur. Ce qui semble avoir été perçu serait-il alors de l'ordre d'une certaine projection de son côté affabulateur « sincère et joyeusement suicidaire » ? (cf. Chagrin d'école, p 65). Ou bien l'ambiguïté du personnage de « grand-père » pourrait-il trahir une sorte de parodie du gendarme de l'ombre (p 331-2), du justicier vengeur et « privatisé » pour une délégation des tâches ? Dans Chagrin d'école de nouveau, l'auteur demande à Minne : « Et que fait- tu du bandit ? le 0,4 %, le petit bandit, qu'est-ce que tu en fais ? / Elle sourit : / – le gendarme, bien sûr. » (p 168, v. num). Pépère ferait-il partie des 0, 4% des méchants pas si méchants ou bien du pourcentage résiduel irrécupérable ? (Ibid., p 169)
En effet, on a du mal à penser que la pirouette langagière de Terminus Malaussène se termine sur une fin dramatique. le dénouement reste ouvert, car l'acte définitif est laissé en suspens. Pépère (qui cache bien son jeu, il faut le dire) après l'implosion de son équipe couve des desseins explosifs, mais ouvre-t-il sa sacoche pour déclencher ou bien pour désamorcer ce qu'elle contient ? Les points de suspension sont-ils le reflet de l'impossibilité de finir pour l'auteur qui rechigne devant le point final ou une dernière taquinerie vis-à-vis d'un besoin de complaire à la demande ? (bien qu'il avoue par ailleurs qu'il s'est «laissé aller au plaisir des retrouvailles»). Et la « bombe » ne serait en définitive que l'annonce de Maman faite à Pépère concernant Benjamin (p 430) ?
À plusieurs reprises, les personnages du présent tome rappellent ou font allusion à un épisode vécu dans l'un des tomes précédents. On perçoit le recul de Benjamin en « être social » fidèle et fiable (p 233) dans une mise en abîme (p 46, 271, 391, 415, 427) qui laisse poindre sous le personnage l'auteur (sans doute une autre facette de D. Pennac). Lorsque la reine Zabo reproche à Alceste : « Quand on capture un si nombreux lectorat avec un premier roman, on ne le déstabilise pas dès le deuxième. On attend au moins dix bouquins pour changer de ton » (p 79), on peut se demander si le camion bibliothèque, pris pour véhicule (p 88) et donc pour cible des balles, n'illustre pas cette légère mélancolie qui affleure ? Si le « réalisme magique » dont Alceste se défend : « Je risque ma peau pour révéler cette monstruosité, je l'apporte sous la forme d'un roman à mon éditeur, et pour quel résultat ? » pourrait bien être un excès de réel, imputable à l'auteur lui-même ?
Quoi qu'il en soit selon Daniel Pennac, l'écrivain a toujours le dernier mot : « Il a tiré sur le fil jusqu'à ce que nous nous retrouvions tous à poil. Un romancier, bon sang, un romancier tout seul » (p 376). Sa foi dans l'humanité et le pouvoir de l'écrit paraissent intacts.
Lien : http://anne.vacquant.free.fr..