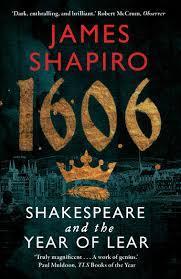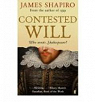Citations sur 1606 : Shakespeare and the Year of Lear (11)
Les beuveries et la promiscuité à la maison Theobald étaient sans doute prodigieuses. Le portrait du roi de Danemark donné par Harington était loin d'une simple parodie d'ivrogne lubrique. Christian était connu pour avoir tenu un journal dans lequel il marquait d'une croix les jours où il était tellement ivre qu'on devait le porter au lit (et ajoutait des croix supplémentaires s'il avait perdu connaissance).
Il pouvait assumer "30 ou 40 gobelets de vin" dans une soirée, et était sans doute enchanté quand, en honneur de sa visite à Londres, les autorités civiques ont donné l'ordre que "dans les conduits de Cornhill... coule le vin de claret". L'un de ses principaux ministres a noté comment, après une séance de beuverie, Christian se renseignait auprès de lui sur la disponibilité des jeunes filles dans la taverne locale. Le roi danois a engendré au moins vingt enfants avec ses deux femmes et diverses maîtresses. Il est peu probable que Jacques se soit hasardé à rivaliser avec son beau-frère alcoolique, même pas en l'accueillant les derniers jours de sa visite sur le bord de deux navires anglais reliés par une passerelle (où deux nobles anglais étaient tellement ivres qu'ils sont tombés dans la Tamise, et que l'un d'eux est remonté nu à partir de la taille). Les scènes de la beuverie sauvage à bord d'un bateau dans "Antoine et Cléopâtre", où Lepidus doit être emporté ivre mort, ne viennent pas de Plutarque, et pourraient bien devoir beaucoup aux rumeurs sur cette grande débauche pendant la visite de Christian.
Il pouvait assumer "30 ou 40 gobelets de vin" dans une soirée, et était sans doute enchanté quand, en honneur de sa visite à Londres, les autorités civiques ont donné l'ordre que "dans les conduits de Cornhill... coule le vin de claret". L'un de ses principaux ministres a noté comment, après une séance de beuverie, Christian se renseignait auprès de lui sur la disponibilité des jeunes filles dans la taverne locale. Le roi danois a engendré au moins vingt enfants avec ses deux femmes et diverses maîtresses. Il est peu probable que Jacques se soit hasardé à rivaliser avec son beau-frère alcoolique, même pas en l'accueillant les derniers jours de sa visite sur le bord de deux navires anglais reliés par une passerelle (où deux nobles anglais étaient tellement ivres qu'ils sont tombés dans la Tamise, et que l'un d'eux est remonté nu à partir de la taille). Les scènes de la beuverie sauvage à bord d'un bateau dans "Antoine et Cléopâtre", où Lepidus doit être emporté ivre mort, ne viennent pas de Plutarque, et pourraient bien devoir beaucoup aux rumeurs sur cette grande débauche pendant la visite de Christian.
L'un des bouts de terrain que Shakespeare loue en juillet dernier contourne Clopton House, domaine appartenant à lady et lord Carew. Carew, qui aida à écraser la révolte irlandaise, fut ensuite attaché au conseil de la reine Anne. Lui et sa femme vivent maintenant près de la cour, au Savoy à Londres. Sachant que les Carew resteront probablement loin du domaine pour un certain temps, Ambrose Rockwood visite Clopton House le samedi avant la St. Michel 1605, accompagné de deux amis, John Grant et Robert Winter de Huddington, une bourgade voisine. Les trois approchent l'intendant de Carew, Robert Wilson, et Rockwood l'informe froidement qu'il désire louer la maison pour les quatre prochaines années. Wilson répond que d'aucune façon il ne se permettrait de faire cela sans avoir reçu au préalable le consentement de son maître. Rockwood insiste, disant qu'il est "un gentleman connu de lord Carew, et pourrait facilement obtenir son accord". Peu après, selon le témoignage de Wilson, "sans trop de bruit", et pendant que Wilson est absent de la propriété, Rockwood apporte effrontément "ses affaires", rassurant la femme de Wilson qui se trouvait sur place que "tout était parfaitement convenu avec son mari". Une fois aménagé, Rockwood invita beaucoup de monde à Clopton, y compris Winter et Grant, le beau-frère de Grant Mr. Bosse, Edward Bushell et Robert Catesby avec son serviteur Thomas Bates. Wilson évoqua en particulier "un grand dîner et beaucoup d'inconnus" (1) à Clopton "le dimanche après la St. Michel", et d'autres "inconnus" venus en "berline" le 4 novembre (venir en berline était très inhabituel, car ces véhicules n'étaient en usage que depuis très récemment, et majoritairement à Londres). Que Wilson ait opté pour le mot "inconnus" est tout aussi inhabituel; ce terme, comme "étrangers" (2) était habituellement réservé à ceux qu'on désigne aujourd'hui comme des gens d'un autre pays (3). Ses propos suggèrent que les autochtones observaient de près at avec suspicion tous ceux qui n'avaient rien à faire dans les parages. Dans ce cas précis, Wilson avait une bonne raison, car Clopton House est devenu l'épicentre même de la conspiration des Poudres.
(1) strangers, (2) aliens, (3) foreigners en VO
(1) strangers, (2) aliens, (3) foreigners en VO
Cette ancienne tendance d'exagérer le pouvoir des forces diaboliques avait été renforcée par la tradition théâtrale qui affirme que "Macbeth", le seul parmi les travaux de Shakespeare, est accompagné d'une malédiction : un désastre frappera tout un chacun qui prononcerait négligemment "Macbeth" dans un théâtre ; les acteurs qui oublient de l'appeler "la pièce écossaise" ou par un autre titre sécurisant doivent dire un charme pour conjurer cette malédiction. Malgré un effort ardu pour retracer cette malédiction en remontant aux premières représentations de la pièce, elle ne date pas plus tardivement que de la fin du 19ème siècle, quand l'humoriste Max Beerbohm révisait les épreuves pour la "Saturday Review" et avait fabriqué une histoire - en l'attribuant faussement à un biographe du 17ème siècle John Aubrey - que Hall Berridge, le jeune homme qui devait jouer le rôle de Lady Macbeth, "est soudainement tombé malade de la pleurésie, si bien que le Maître Shakespeare lui-même a dû jouer à sa place".
Ce que Beerbohm a inventé - et son orthographe d'époque lui a prêté une touche d'authenticité - fût rapidement accepté en tant que fait. Les acteurs ont bientôt ajouté des exemples supplémentaires sur des accidents arrivés à ceux qui jouaient dans "Macbeth" (pas vraiment surprenant dans une pièce où les combats à l'épée et les glissants couteaux tachés de sang font force apparitions), et à notre âge d'internet il est maintenant impossible de se défaire ce vieux mythe victorien.
Ce que Beerbohm a inventé - et son orthographe d'époque lui a prêté une touche d'authenticité - fût rapidement accepté en tant que fait. Les acteurs ont bientôt ajouté des exemples supplémentaires sur des accidents arrivés à ceux qui jouaient dans "Macbeth" (pas vraiment surprenant dans une pièce où les combats à l'épée et les glissants couteaux tachés de sang font force apparitions), et à notre âge d'internet il est maintenant impossible de se défaire ce vieux mythe victorien.
On oublie facilement que ce qui distingue la Conspiration des Poudres des autres complots terroristes (surtout ceux qui furent assez meurtriers pour figurer dans les annales), c'est qu'il ne se passa rien. Comme l'un de ces grands drames jacobéens, sa puissance et ses lendemains ne reposaient pas sur une violence réelle, mais donnaient à imaginer au peuple une tragédie inoubliable, qui semble aussi réaliste que Lear ou Macbeth. Le moment de la catharsis était reporté à l'arrestation, à la torture et à l'exécution spectaculaire des responsables.
Les dramaturges anglais, à qui il était interdit d'évoquer les événements de l'actualité, sauf indirectement, durent considérer cela avec une admiration mêlée d'envie. Les plus intelligents d'entre eux durent aussi sentir que, même si rien n'avait été détruit physiquement, quelque chose avait été radicalement changé dans leur monde. Ce complot prouvait que les esprits bouillonnaient - pressions, ressentiments, utopies - ce qu'un gouvernement doté d'un réseau d'espions n'avait pas su voir. C'était moins un échec de la surveillance des esprits, qu'une incapacité à imaginer, à concevoir ce qui, trente mois seulement après l'avènement de Jacques I°, était devenu insupportable pour certains de ses sujets. Malgré les explications rituelles par l'oeuvre du diable, c'était aussi l'incapacité de concevoir qu'une personne, possédée ou non, puisse être assez mauvaise pour commettre pareille aveugle atrocité. Il incomberait aux écrivains anglais des années suivantes d'explorer plus profondément et de rechercher ce qui était à l'oeuvre dans cet événement.
pp. 119-120
Les dramaturges anglais, à qui il était interdit d'évoquer les événements de l'actualité, sauf indirectement, durent considérer cela avec une admiration mêlée d'envie. Les plus intelligents d'entre eux durent aussi sentir que, même si rien n'avait été détruit physiquement, quelque chose avait été radicalement changé dans leur monde. Ce complot prouvait que les esprits bouillonnaient - pressions, ressentiments, utopies - ce qu'un gouvernement doté d'un réseau d'espions n'avait pas su voir. C'était moins un échec de la surveillance des esprits, qu'une incapacité à imaginer, à concevoir ce qui, trente mois seulement après l'avènement de Jacques I°, était devenu insupportable pour certains de ses sujets. Malgré les explications rituelles par l'oeuvre du diable, c'était aussi l'incapacité de concevoir qu'une personne, possédée ou non, puisse être assez mauvaise pour commettre pareille aveugle atrocité. Il incomberait aux écrivains anglais des années suivantes d'explorer plus profondément et de rechercher ce qui était à l'oeuvre dans cet événement.
pp. 119-120
[Jacques VI d'Ecosse, devenu Jacques I° d'Angleterre, milite pour une union des deux pays : Le Roi Lear de Shakespeare évoque les controverses liées à cette question.]
On sait que la pièce commence avec la fatale décision de Lear de diviser ses royaumes. Malgré tout, les implications n'en sont pas claires. C'est peut-être la raison pour laquelle aucun autre auteur abordant le problème de l'union ne prit le règne de Lear pour exemple, même après la représentation de la pièce de Shakespeare. Lear aurait-il été plus sage de léguer l'intégralité de son royaume à Goneril, la méchante aînée, plutôt que de répartir l'héritage entre ses trois filles ? L'erreur de Lear fut-elle de répartir la portion de Cordelia entre ses deux soeurs, et donc, de diviser le pays en deux et non en trois ? Ou encore, son échec à agir selon les principes absolutistes (selon lesquels l'autorité, et pas seulement le nom, de Roi, lui appartiennent en propre tant qu'il est en vie), ne fut-il pas sa plus grande erreur politique ? Et même si Lear retrouve le trône à la fin, l'absence d'héritier mâle ne reporte-t-elle pas à plus tard l'inévitable guerre civile ? Enfin, à la réflexion, de quelles leçons politiques ce récit légendaire anglais est-il porteur pour le présent ? Les contemporains étaient de plus en plus persuadés que cette histoire venait de récits tendancieux des origines, fabriqués par Geoffrey de Monmouth, dont l'oeuvre semblait plus mythologique que factuelle.
Shakespeare semble avoir maintenu la balance égale dans le débat pour ou contre l'union. Ceux qui cherchent une prise de position nette dans "Le Roi Lear" seront déçus (ce qui n'empêche pas les uns d'affirmer que la pièce est pour l'union, les autres de déclarer avec la même assurance qu'elle conteste et détruit la rhétorique unioniste). Pour obscurcir encore la question, avec l'évolution des débats sur l'union, les spectateurs de février 1606 et ceux de novembre comprenaient tout autrement la séparation des royaumes et les problèmes d'allégeance de la pièce. Face à la rhétorique royale qui exprimait la politique en termes familiaux, Shakespeare relève le défi avec un talent remarquable, dévoilant de profondes failles culturelles dans cette controverse, et écrit sa plus sombre tragédie, où chaque décision politique conduit au désastre.
pp. 53-54
On sait que la pièce commence avec la fatale décision de Lear de diviser ses royaumes. Malgré tout, les implications n'en sont pas claires. C'est peut-être la raison pour laquelle aucun autre auteur abordant le problème de l'union ne prit le règne de Lear pour exemple, même après la représentation de la pièce de Shakespeare. Lear aurait-il été plus sage de léguer l'intégralité de son royaume à Goneril, la méchante aînée, plutôt que de répartir l'héritage entre ses trois filles ? L'erreur de Lear fut-elle de répartir la portion de Cordelia entre ses deux soeurs, et donc, de diviser le pays en deux et non en trois ? Ou encore, son échec à agir selon les principes absolutistes (selon lesquels l'autorité, et pas seulement le nom, de Roi, lui appartiennent en propre tant qu'il est en vie), ne fut-il pas sa plus grande erreur politique ? Et même si Lear retrouve le trône à la fin, l'absence d'héritier mâle ne reporte-t-elle pas à plus tard l'inévitable guerre civile ? Enfin, à la réflexion, de quelles leçons politiques ce récit légendaire anglais est-il porteur pour le présent ? Les contemporains étaient de plus en plus persuadés que cette histoire venait de récits tendancieux des origines, fabriqués par Geoffrey de Monmouth, dont l'oeuvre semblait plus mythologique que factuelle.
Shakespeare semble avoir maintenu la balance égale dans le débat pour ou contre l'union. Ceux qui cherchent une prise de position nette dans "Le Roi Lear" seront déçus (ce qui n'empêche pas les uns d'affirmer que la pièce est pour l'union, les autres de déclarer avec la même assurance qu'elle conteste et détruit la rhétorique unioniste). Pour obscurcir encore la question, avec l'évolution des débats sur l'union, les spectateurs de février 1606 et ceux de novembre comprenaient tout autrement la séparation des royaumes et les problèmes d'allégeance de la pièce. Face à la rhétorique royale qui exprimait la politique en termes familiaux, Shakespeare relève le défi avec un talent remarquable, dévoilant de profondes failles culturelles dans cette controverse, et écrit sa plus sombre tragédie, où chaque décision politique conduit au désastre.
pp. 53-54
[Documentation et méthode]
Les historiens, romanciers et cinéastes modernes ne nous aident pas, eux qui se sont consacrés avec enthousiasme à la période Tudor, en méprisant celle du roi Jacques Stuart, malgré son importance historique. Que l'on admire Jacques, qui fut de tous les dirigeants anglais le plus intellectuel, ou qu'on le rejette (comme fit Antony Weldon en 1650) parce qu'il fut "l'imbécile le plus sage de toute la Chrétienté", il reste difficile de comprendre les oeuvres du Shakespeare jacobéen sans une connaissance approfondie de ce qu'était la vie pendant son règne. Pour aggraver la chose, les biographes de Shakespeare ont lourdement insisté sur sa vie sous Elisabeth, par intérêt pour ses années de formation. Que l'on ouvre n'importe quelle biographie, on verra qu'il reste peu de pages à lire sur les années suivant la prise de pouvoir de Jacques I° en 1603. Ce que vivait le Shakespeare jacobéen à l'un des sommets de sa carrière d'écrivain, - et qui devrait avoir une immense importance pour ceux qui étudient sa vie -, est vite bâclé, et les biographes qui s'arrêtent à l'année 1606 se dispersent stérilement à enquêter sur des rumeurs apparues des décennies plus tard, à propos d'une relation du dramaturge avec la jolie femme d'un aubergiste d'Oxford.
Après un quart de siècle de recherches et de publications sur la vie de Shakespeare, je suis douloureusement conscient que ce que j'aimerais savoir de lui, ses opinions politiques, ses croyances religieuses, ses amours, quel père, mari et ami il était, ce qu'il faisait du temps où il n'écrivait ni ne jouait, est définitivement perdu. La possibilité d'une telle biographie a disparu à la fin du XVII°s, quand les derniers témoins vivants emportèrent leurs histoires et leurs secrets dans la tombe. Les biographes modernes qui, malgré cela, spéculent sur ces choses, ou qui, en l'absence d'archives lisent ses poèmes et ses pièces comme de pures autobiographies, finissent toujours par en dire plus sur eux-mêmes que sur Shakespeare.
Cependant, même si la vie personnelle de Shakespeare en 1606 est totalement inconnaissable, il est possible de reconstituer ses pensées et ses combats avec le monde extérieur, en regardant ce qu'il écrivit dans le cadre de son dialogue avec son époque, quand il composa ces trois pièces [Le roi Lear, Macbeth, Antoine et Cléopâtre]. Ses réactions à la lecture d'une vieille pièce de théâtre, "King Leir", ou du traité de Samuel Harsnett sur les possessions démoniaques, ou encore de son livre favori, la "Vie d'Antoine" de Plutarque, peuvent être retrouvées. Bien qu'il préférât demeurer dans l'ombre, on peut l'apercevoir dans l'éclat des événements contemporains. On peut le surprendre cette année-là dans son rôle d'Homme du Roi apparaissant avec ses collègues acteurs devant le roi à Greenwich, Hampton Court et Whitehall, et dans les processions royales; en vertu de son statut officiel de Valet de Chambre - occasions pour lui d'observer la cour de l'intérieur.
A cette fin, les pages qui suivent présentent une tranche de la vie d'un écrivain, et, je l'espère, ressusciteront son monde et ses oeuvres. La richesse même de ce moment culturel entrave et permet cet effort : malgré les inconnues, dessiner une silhouette de Shakespeare exige beaucoup de travail et d'imagination, car il nous faut remonter le cours de quatre siècles et nous immerger dans les espérances et les peurs de cette époque ; mais les récompenses sont à la hauteur, car cette richesse, à son tour, nous aide à relire d'un oeil neuf les tragédies qu'il créa pendant cette année tumultueuse.
pp. 14-16, fin du prologue.
Les historiens, romanciers et cinéastes modernes ne nous aident pas, eux qui se sont consacrés avec enthousiasme à la période Tudor, en méprisant celle du roi Jacques Stuart, malgré son importance historique. Que l'on admire Jacques, qui fut de tous les dirigeants anglais le plus intellectuel, ou qu'on le rejette (comme fit Antony Weldon en 1650) parce qu'il fut "l'imbécile le plus sage de toute la Chrétienté", il reste difficile de comprendre les oeuvres du Shakespeare jacobéen sans une connaissance approfondie de ce qu'était la vie pendant son règne. Pour aggraver la chose, les biographes de Shakespeare ont lourdement insisté sur sa vie sous Elisabeth, par intérêt pour ses années de formation. Que l'on ouvre n'importe quelle biographie, on verra qu'il reste peu de pages à lire sur les années suivant la prise de pouvoir de Jacques I° en 1603. Ce que vivait le Shakespeare jacobéen à l'un des sommets de sa carrière d'écrivain, - et qui devrait avoir une immense importance pour ceux qui étudient sa vie -, est vite bâclé, et les biographes qui s'arrêtent à l'année 1606 se dispersent stérilement à enquêter sur des rumeurs apparues des décennies plus tard, à propos d'une relation du dramaturge avec la jolie femme d'un aubergiste d'Oxford.
Après un quart de siècle de recherches et de publications sur la vie de Shakespeare, je suis douloureusement conscient que ce que j'aimerais savoir de lui, ses opinions politiques, ses croyances religieuses, ses amours, quel père, mari et ami il était, ce qu'il faisait du temps où il n'écrivait ni ne jouait, est définitivement perdu. La possibilité d'une telle biographie a disparu à la fin du XVII°s, quand les derniers témoins vivants emportèrent leurs histoires et leurs secrets dans la tombe. Les biographes modernes qui, malgré cela, spéculent sur ces choses, ou qui, en l'absence d'archives lisent ses poèmes et ses pièces comme de pures autobiographies, finissent toujours par en dire plus sur eux-mêmes que sur Shakespeare.
Cependant, même si la vie personnelle de Shakespeare en 1606 est totalement inconnaissable, il est possible de reconstituer ses pensées et ses combats avec le monde extérieur, en regardant ce qu'il écrivit dans le cadre de son dialogue avec son époque, quand il composa ces trois pièces [Le roi Lear, Macbeth, Antoine et Cléopâtre]. Ses réactions à la lecture d'une vieille pièce de théâtre, "King Leir", ou du traité de Samuel Harsnett sur les possessions démoniaques, ou encore de son livre favori, la "Vie d'Antoine" de Plutarque, peuvent être retrouvées. Bien qu'il préférât demeurer dans l'ombre, on peut l'apercevoir dans l'éclat des événements contemporains. On peut le surprendre cette année-là dans son rôle d'Homme du Roi apparaissant avec ses collègues acteurs devant le roi à Greenwich, Hampton Court et Whitehall, et dans les processions royales; en vertu de son statut officiel de Valet de Chambre - occasions pour lui d'observer la cour de l'intérieur.
A cette fin, les pages qui suivent présentent une tranche de la vie d'un écrivain, et, je l'espère, ressusciteront son monde et ses oeuvres. La richesse même de ce moment culturel entrave et permet cet effort : malgré les inconnues, dessiner une silhouette de Shakespeare exige beaucoup de travail et d'imagination, car il nous faut remonter le cours de quatre siècles et nous immerger dans les espérances et les peurs de cette époque ; mais les récompenses sont à la hauteur, car cette richesse, à son tour, nous aide à relire d'un oeil neuf les tragédies qu'il créa pendant cette année tumultueuse.
pp. 14-16, fin du prologue.
[Samuel Harsnett, "Discours des immenses impostures papistes", 1603, à propos de faux exorcismes et possessions démoniaques]
Une des qualités majeures que Shakespeare trouvait à Harsnett, était son emploi du langage théâtral pour décrire ceux qui feignaient la possession démoniaque. Son livre regorge d'allusions aux jeux de scène, aux acteurs, aux contrefaçons, aux feintes, tragédiens, comédiens, rôles bien joués, etc. Quand il cherche des analogies commodes, Harsnett évoque les comédiens itinérants, le personnage du Vice dans les anciennes moralités, ou le spectacle des combats d'ours à Paris Gardens. Il va jusqu'à comparer la mise en scène des faux exorcistes à divers genres dramatiques, et conclut que cette "fiction diabolique" n'est ni de la comédie pure, ni de la tragédie, mais un mélange tragicomique des deux. Shakespeare n'aurait pu qu'approuver, d'autant que la description des souffrances des possédés (réels ou imaginaires) ne peut que susciter la sympathie. Le langage théâtral de Harsnett n'était pas dû au hasard. En tant que chapelain de Richard Bancroft, évêque de Londres, une de ses charges consistait à lire et à autoriser le texte, pour l'impression, des pièces que l'on jouait sur scène, comme celle que représentait, justement, la compagnie de Shakespeare, "Every Man out of His Humour", de Ben Jonson. Harsnett comprenait le pouvoir extraordinaire du théâtre, et était gêné par le fait que de faux exorcismes s'appropriaient ce pouvoir. Ce serait une erreur de voir en lui une caricature de Puritain ennemi du théâtre, ou de croire que sa colère tombait sur les acteurs londoniens et sur leurs fictions.
p. 90.
Une des qualités majeures que Shakespeare trouvait à Harsnett, était son emploi du langage théâtral pour décrire ceux qui feignaient la possession démoniaque. Son livre regorge d'allusions aux jeux de scène, aux acteurs, aux contrefaçons, aux feintes, tragédiens, comédiens, rôles bien joués, etc. Quand il cherche des analogies commodes, Harsnett évoque les comédiens itinérants, le personnage du Vice dans les anciennes moralités, ou le spectacle des combats d'ours à Paris Gardens. Il va jusqu'à comparer la mise en scène des faux exorcistes à divers genres dramatiques, et conclut que cette "fiction diabolique" n'est ni de la comédie pure, ni de la tragédie, mais un mélange tragicomique des deux. Shakespeare n'aurait pu qu'approuver, d'autant que la description des souffrances des possédés (réels ou imaginaires) ne peut que susciter la sympathie. Le langage théâtral de Harsnett n'était pas dû au hasard. En tant que chapelain de Richard Bancroft, évêque de Londres, une de ses charges consistait à lire et à autoriser le texte, pour l'impression, des pièces que l'on jouait sur scène, comme celle que représentait, justement, la compagnie de Shakespeare, "Every Man out of His Humour", de Ben Jonson. Harsnett comprenait le pouvoir extraordinaire du théâtre, et était gêné par le fait que de faux exorcismes s'appropriaient ce pouvoir. Ce serait une erreur de voir en lui une caricature de Puritain ennemi du théâtre, ou de croire que sa colère tombait sur les acteurs londoniens et sur leurs fictions.
p. 90.
[L'année 1606 : Conspiration des Poudres, projets d'union de l'Angleterre et de l'Ecosse, etc...]
Bien d'autres choses arrivèrent pendant ces mois tumultueux. On a presque oublié l'enquête de la Chambre Etoilée sur de faux cas de possession démoniaque. Un souverain étranger fit une visite d'état en Angleterre, pour la première fois de toute son histoire connue. Et cette année-là, les Londoniens étaient de plus en plus mécontents de leur nouveau roi écossais, et d'autant plus nostalgiques de la défunte Reine Bess ; ils virent ses ossements exhumés dans l'Abbaye de Westminster et mélangés à ceux de sa demi-soeur, la Reine Marie, puis l'érection d'un nouveau tombeau par-dessus. C'était aussi l'année où l'Union Jack fut dessinée et déployée pour la première fois, et où, - événement important dans l'histoire de l'Empire Britannique-, en décembre 1606, des navires quittèrent les quais du port de Londres pour fonder la première colonie anglaise permanente d'Amérique, Jamestown. Pour couronner le tout, la peste revint à Londres, une des plus graves crises épidémiques depuis 1603, de la fin de juillet jusqu'à l'automne, frappant de près l'entourage et la famille mêmes de Shakespeare.
pp. 12-13
Bien d'autres choses arrivèrent pendant ces mois tumultueux. On a presque oublié l'enquête de la Chambre Etoilée sur de faux cas de possession démoniaque. Un souverain étranger fit une visite d'état en Angleterre, pour la première fois de toute son histoire connue. Et cette année-là, les Londoniens étaient de plus en plus mécontents de leur nouveau roi écossais, et d'autant plus nostalgiques de la défunte Reine Bess ; ils virent ses ossements exhumés dans l'Abbaye de Westminster et mélangés à ceux de sa demi-soeur, la Reine Marie, puis l'érection d'un nouveau tombeau par-dessus. C'était aussi l'année où l'Union Jack fut dessinée et déployée pour la première fois, et où, - événement important dans l'histoire de l'Empire Britannique-, en décembre 1606, des navires quittèrent les quais du port de Londres pour fonder la première colonie anglaise permanente d'Amérique, Jamestown. Pour couronner le tout, la peste revint à Londres, une des plus graves crises épidémiques depuis 1603, de la fin de juillet jusqu'à l'automne, frappant de près l'entourage et la famille mêmes de Shakespeare.
pp. 12-13
[ Effets de la visite du roi Christian de Danemark, beau-frère de Jacques I° ]
En représentant l'histoire antique, "Antoine et Cléopâtre" juxtapose les géants qui habitèrent Rome un jour, Jules César, Pompée, Brutus et Cassius, et ceux qui vont bientôt les rejoindre, Antoine et sa reine d'Egypte, - au vainqueur de la pièce : Octave, mince personnage, aimant mieux envoyer les autres au combat que s'y risquer lui-même, complotant et intriguant pour conquérir la domination mondiale, prévoyant de traîner ses ennemis dans son triomphe, et édifiant sa grandeur sur les funérailles de ses illustres prédécesseurs. Je soupçonne que pour Shakespeare ou Harington, la venue du roi martial du Danemark et de sa flotte, cet été-là, cristallisa ce que beaucoup ressentaient alors. Au passé élisabéthain, monde de victoires sur l'Armada et les Irlandais, rempli de personnages plus grands que nature morts depuis, ou exécutés, ou encore emprisonnés (Essex, bien sûr, mais aussi Sir Walter Ralegh, Lord Burleigh, redoutable conseiller de la reine (et père de Salisbury), Lord Mountjoy qui venait à peine de mourir, et la Reine Elisabeth elle-même) - à ce passé élisabéthain succédait une ère de personnages moins impressionnants, à commencer par le roi Jacques. Même si la chose n'était pas visible quand le roi était seul, tout devint clair avec la visite et le départ précipité du charismatique roi Christian. "Antoine et Cléopâtre" est une tragédie de la nostalgie, une oeuvre politique : elle exprime de manière oblique (car on ne peut jamais associer terme à terme, mécaniquement, les personnages antiques et les modernes) le regret du passé élisabéthain, qui, malgré ses nombreuses tares, semblait rétrospectivement bien plus grand que le monde politique actuel.
pp. 309-310
En représentant l'histoire antique, "Antoine et Cléopâtre" juxtapose les géants qui habitèrent Rome un jour, Jules César, Pompée, Brutus et Cassius, et ceux qui vont bientôt les rejoindre, Antoine et sa reine d'Egypte, - au vainqueur de la pièce : Octave, mince personnage, aimant mieux envoyer les autres au combat que s'y risquer lui-même, complotant et intriguant pour conquérir la domination mondiale, prévoyant de traîner ses ennemis dans son triomphe, et édifiant sa grandeur sur les funérailles de ses illustres prédécesseurs. Je soupçonne que pour Shakespeare ou Harington, la venue du roi martial du Danemark et de sa flotte, cet été-là, cristallisa ce que beaucoup ressentaient alors. Au passé élisabéthain, monde de victoires sur l'Armada et les Irlandais, rempli de personnages plus grands que nature morts depuis, ou exécutés, ou encore emprisonnés (Essex, bien sûr, mais aussi Sir Walter Ralegh, Lord Burleigh, redoutable conseiller de la reine (et père de Salisbury), Lord Mountjoy qui venait à peine de mourir, et la Reine Elisabeth elle-même) - à ce passé élisabéthain succédait une ère de personnages moins impressionnants, à commencer par le roi Jacques. Même si la chose n'était pas visible quand le roi était seul, tout devint clair avec la visite et le départ précipité du charismatique roi Christian. "Antoine et Cléopâtre" est une tragédie de la nostalgie, une oeuvre politique : elle exprime de manière oblique (car on ne peut jamais associer terme à terme, mécaniquement, les personnages antiques et les modernes) le regret du passé élisabéthain, qui, malgré ses nombreuses tares, semblait rétrospectivement bien plus grand que le monde politique actuel.
pp. 309-310
[Conséquences de la peste sur l'activité théâtrale londonienne]
Les effets de tout cela sur Shakespeare furent considérables. Les biographes aiment expliquer les tournants de la carrière de Shakespeare par les variations de ses états d'âme (il était ou non amoureux quand il écrivait comédies et sonnets, déprimé en créant des tragédies, en deuil au moment d'inventer Hamlet). Il est certain que ses états d'âme eurent une profonde influence sur ses écrits ; le problème, c'est que nous ne savons absolument rien d'eux tout au long des vingt-cinq années de sa carrière - sauf si, de manière circulaire, nous les déduisons de ses oeuvres. En revanche, nous avons bien plus de renseignements sur les conséquences qu'eut une épidémie de 1606 transportée par les rats : comment elle altéra les contours de sa vie professionnelle, transforma et vivifia sa troupe d'acteurs, frappa la concurrence, modifia la composition du public pour qui il écrivait (et donc aussi, le genre de pièces qu'il écrivait), et lui permit de collaborer avec des musiciens et dramaturges de talent - une poussée de peste qui avait été bien près de le tuer.
pp. 341-342
Les effets de tout cela sur Shakespeare furent considérables. Les biographes aiment expliquer les tournants de la carrière de Shakespeare par les variations de ses états d'âme (il était ou non amoureux quand il écrivait comédies et sonnets, déprimé en créant des tragédies, en deuil au moment d'inventer Hamlet). Il est certain que ses états d'âme eurent une profonde influence sur ses écrits ; le problème, c'est que nous ne savons absolument rien d'eux tout au long des vingt-cinq années de sa carrière - sauf si, de manière circulaire, nous les déduisons de ses oeuvres. En revanche, nous avons bien plus de renseignements sur les conséquences qu'eut une épidémie de 1606 transportée par les rats : comment elle altéra les contours de sa vie professionnelle, transforma et vivifia sa troupe d'acteurs, frappa la concurrence, modifia la composition du public pour qui il écrivait (et donc aussi, le genre de pièces qu'il écrivait), et lui permit de collaborer avec des musiciens et dramaturges de talent - une poussée de peste qui avait été bien près de le tuer.
pp. 341-342
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de James Shapiro (3)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Retrouvez le bon adjectif dans le titre - (5 - essais )
Roland Barthes : "Fragments d'un discours **** "
amoureux
positiviste
philosophique
20 questions
861 lecteurs ont répondu
Thèmes :
essai
, essai de société
, essai philosophique
, essai documentCréer un quiz sur ce livre861 lecteurs ont répondu