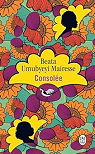Citations sur Tous tes enfants dispersés (163)
Je l’ai nourrie à la petite cuillère les premiers jours, comme un
enfant. Nous avions peu de vivres, je lui donnais ma ration
quotidienne, elle parlait, parlait et pleurait dès que, depuis sa couche
dans le hangar où nous avions installé les rescapés, elle
reconnaissait quelqu’un. Pour elle, les retrouvailles étaient comme
des miracles. Elle demandait des informations sur ce qui s’était
passé dans tel ou tel quartier, qui avait été tué, quand et par qui.
Mama avait été cachée tout ce temps tu sais, elle avait entendu les
bruits, les cris parfois, des coups de feu, mais elle n’avait rien vu. Le
soir, quand je rentrais la voir, elle voulait tout me raconter, qui avait
été tué quand et par qui et de la plus atroce des façons. Je n’avais
pas la force d’écouter toutes les histoires qu’elle vomissait, ça
m’épuisait. Je venais de marcher sur un pays couvert de cadavres
en décomposition, de Kagitumba à Butare, du Nord au Sud. Tu sais
combien d’églises pleines de crânes défoncés, de fosses
communes, de maisons éventrées nous avons vues ? De Kagitumba
à Butare, du Nord au Sud, les mêmes squelettes qui nous tendaient
les bras avec leur dernier souffle épargné, les mêmes femmes à la
démarche chancelante. Les regards des violées qui fuient
l’humiliation de leurs corps ravagés par des monstres au sexe
empoisonné, des dizaines, des milliers. Les mêmes moignons
purulents sous des pansements de fortune, des fronts troués, des
joues arrachées et moi, tu sais, qui avais été soldat, valeureux au
combat, je n’avais plus les larmes pour sangloter avec eux. Je
n’avais pas les tripes pour supporter cette catastrophe sous nos
yeux. Amagara araseseka ntayorwa. Les tripes répandues ne
peuvent se ramasser, comme disaient nos anciens. Et moi, à chaque
escale, de Kagitumba à Butare, du Nord au Sud, j’imaginais le
visage de notre mère derrière chaque femme morte ou vivante que
je découvrais, dans un trou, derrière une porte. Je devais rester
stoïque alors qu’autour de moi tout s’était effondré. Je voulais me
précipiter, j’ai pensé déserter, tu sais, pour traverser le pays de nuit,
venir la chercher, mais je savais le sort réservé aux déserteurs. Si
elle survivait, Mama aurait besoin d’un fils vivant. Pas liquidé au
peloton d’exécution.
enfant. Nous avions peu de vivres, je lui donnais ma ration
quotidienne, elle parlait, parlait et pleurait dès que, depuis sa couche
dans le hangar où nous avions installé les rescapés, elle
reconnaissait quelqu’un. Pour elle, les retrouvailles étaient comme
des miracles. Elle demandait des informations sur ce qui s’était
passé dans tel ou tel quartier, qui avait été tué, quand et par qui.
Mama avait été cachée tout ce temps tu sais, elle avait entendu les
bruits, les cris parfois, des coups de feu, mais elle n’avait rien vu. Le
soir, quand je rentrais la voir, elle voulait tout me raconter, qui avait
été tué quand et par qui et de la plus atroce des façons. Je n’avais
pas la force d’écouter toutes les histoires qu’elle vomissait, ça
m’épuisait. Je venais de marcher sur un pays couvert de cadavres
en décomposition, de Kagitumba à Butare, du Nord au Sud. Tu sais
combien d’églises pleines de crânes défoncés, de fosses
communes, de maisons éventrées nous avons vues ? De Kagitumba
à Butare, du Nord au Sud, les mêmes squelettes qui nous tendaient
les bras avec leur dernier souffle épargné, les mêmes femmes à la
démarche chancelante. Les regards des violées qui fuient
l’humiliation de leurs corps ravagés par des monstres au sexe
empoisonné, des dizaines, des milliers. Les mêmes moignons
purulents sous des pansements de fortune, des fronts troués, des
joues arrachées et moi, tu sais, qui avais été soldat, valeureux au
combat, je n’avais plus les larmes pour sangloter avec eux. Je
n’avais pas les tripes pour supporter cette catastrophe sous nos
yeux. Amagara araseseka ntayorwa. Les tripes répandues ne
peuvent se ramasser, comme disaient nos anciens. Et moi, à chaque
escale, de Kagitumba à Butare, du Nord au Sud, j’imaginais le
visage de notre mère derrière chaque femme morte ou vivante que
je découvrais, dans un trou, derrière une porte. Je devais rester
stoïque alors qu’autour de moi tout s’était effondré. Je voulais me
précipiter, j’ai pensé déserter, tu sais, pour traverser le pays de nuit,
venir la chercher, mais je savais le sort réservé aux déserteurs. Si
elle survivait, Mama aurait besoin d’un fils vivant. Pas liquidé au
peloton d’exécution.
Un nouvel univers s’ouvrit à moi le jour de mon entrée à l’école
secondaire de Nyanza. Non seulement le corps professoral était
composé en grande majorité d’Occidentaux, mais surtout il s’agissait
de femmes, donc d’êtres plus proches de moi, du moins par leur
physionomie.
Tout chez elles était mystérieusement nouveau : leurs yeux
couleur d’eau, leurs cheveux jaunes ou effilés, leurs odeurs que je
ne pouvais rattacher à aucune autre connue. Je les observais
longuement quand l’occasion se présentait : en classe, à la chapelle
ou au réfectoire. Au début je m’asseyais toujours le plus près
possible de l’une d’elles pour mieux les examiner. Des questions
restaient en suspens, et je n’osais les poser aux autres filles par
crainte de passer pour « bizarre » : avaient-elles la même intimité
que nous, leurs seins étaient-ils plus durs, plus pointus que les
nôtres ? De quelle couleur pouvaient bien être leurs tétons ? Un jour
que la professeure de biologie levait les bras pour accrocher une
planche anatomique sur le mur, je vis les poils de ses aisselles : ils
étaient blancs et frisés alors que des cheveux noirs, fins comme les
épillets des papyrus plantés devant la classe, encadraient son
visage d’un carré austère.
Les camarades de classe originaires de Kigali, Nyundo ou Zaza,
où des missions avaient été fondées bien longtemps auparavant, se
moquaient de ma fascination, elles qui voyaient des Blancs dans
leur entourage depuis toujours.
Au fil des mois, des années, j’appris à connaître ce qui nous
séparait : les objets, la langue, la nourriture ; mais aussi ce qui nous
rassemblait : le rire, la musique, le mensonge.
secondaire de Nyanza. Non seulement le corps professoral était
composé en grande majorité d’Occidentaux, mais surtout il s’agissait
de femmes, donc d’êtres plus proches de moi, du moins par leur
physionomie.
Tout chez elles était mystérieusement nouveau : leurs yeux
couleur d’eau, leurs cheveux jaunes ou effilés, leurs odeurs que je
ne pouvais rattacher à aucune autre connue. Je les observais
longuement quand l’occasion se présentait : en classe, à la chapelle
ou au réfectoire. Au début je m’asseyais toujours le plus près
possible de l’une d’elles pour mieux les examiner. Des questions
restaient en suspens, et je n’osais les poser aux autres filles par
crainte de passer pour « bizarre » : avaient-elles la même intimité
que nous, leurs seins étaient-ils plus durs, plus pointus que les
nôtres ? De quelle couleur pouvaient bien être leurs tétons ? Un jour
que la professeure de biologie levait les bras pour accrocher une
planche anatomique sur le mur, je vis les poils de ses aisselles : ils
étaient blancs et frisés alors que des cheveux noirs, fins comme les
épillets des papyrus plantés devant la classe, encadraient son
visage d’un carré austère.
Les camarades de classe originaires de Kigali, Nyundo ou Zaza,
où des missions avaient été fondées bien longtemps auparavant, se
moquaient de ma fascination, elles qui voyaient des Blancs dans
leur entourage depuis toujours.
Au fil des mois, des années, j’appris à connaître ce qui nous
séparait : les objets, la langue, la nourriture ; mais aussi ce qui nous
rassemblait : le rire, la musique, le mensonge.
Dans les mois puis les années qui suivirent, d’autres Blancs, en
voiture ou à pied, firent des apparitions de plus en plus régulières
dans notre paysage quotidien. Les adultes savaient feindre
l’indifférence polie, tout en leur jetant de discrets regards de biais,
car j’imagine que pour eux aussi tout cela était curieux, mais nous,
les enfants, avions immanquablement la même réaction. Tout
véhicule paraissant au loin sur la route de Butare donnait le signal à
des grappes de mômes qui quittaient précipitamment leur maison,
cour, champ ou pâturage pour se regrouper à l’entrée de ce qui était
en train de devenir le centre de négoce d’Ikomoko et attendre
l’arrivée du véhicule en faisant des pronostics sur ses occupants.
Quand c’étaient des Blancs, nous tendions le cou pour essayer de
voir leurs visages, même si, de l’avis des plus jeunes, ils se
ressemblaient tous comme deux gouttes d’eau. Ceux d’entre nous
qui avaient un peu plus de bouteille et le cœur accroché osaient
suivre en courant la voiture qui ralentissait immanquablement au
virage menant à la mission. Les automobiles des muzungu
s’arrêtaient toujours à la mission. Là, nous restions agglutinés
devant les buissons d’euphorbe rouge, notre main collée sur la
bouche d’étonnement et d’admiration, juste à la bonne distance pour
voir les passagers sortir, ce qu’ils apportaient avec eux, malles,
valises en carton ou instruments mystérieux, sans craindre les
morsures du chien attaché devant la porte, ni le bâton de l’homme à
tout faire des lieux qui était trop paresseux pour venir jusqu’à nous
afin de nous chasser. Quand l’un des muzungu, qui ne pouvait
ignorer notre manège, faisait un pas vers nous, sans doute pour
nous saluer, c’était la panique. Nous détalions sans concertation, les
plus grands poussant les autres dans les buissons d’euphorbe, dont
la sève qui coulait abondamment des branches piétinées laissait sur
nos vêtements des taches indélébiles, pour lesquelles nos mères ne
manqueraient pas de nous punir sévèrement.
Et c’est bien longtemps après que les étrangers eurent pénétré
dans la bâtisse en brique dans laquelle aucun de nous n’avait jamais
mis les pieds que nous nous résolvions à rentrer chez nous, pour
raconter ce que nous avions vu, avec quelques exagérations en
prime, aux petits froussards restés derrière.
voiture ou à pied, firent des apparitions de plus en plus régulières
dans notre paysage quotidien. Les adultes savaient feindre
l’indifférence polie, tout en leur jetant de discrets regards de biais,
car j’imagine que pour eux aussi tout cela était curieux, mais nous,
les enfants, avions immanquablement la même réaction. Tout
véhicule paraissant au loin sur la route de Butare donnait le signal à
des grappes de mômes qui quittaient précipitamment leur maison,
cour, champ ou pâturage pour se regrouper à l’entrée de ce qui était
en train de devenir le centre de négoce d’Ikomoko et attendre
l’arrivée du véhicule en faisant des pronostics sur ses occupants.
Quand c’étaient des Blancs, nous tendions le cou pour essayer de
voir leurs visages, même si, de l’avis des plus jeunes, ils se
ressemblaient tous comme deux gouttes d’eau. Ceux d’entre nous
qui avaient un peu plus de bouteille et le cœur accroché osaient
suivre en courant la voiture qui ralentissait immanquablement au
virage menant à la mission. Les automobiles des muzungu
s’arrêtaient toujours à la mission. Là, nous restions agglutinés
devant les buissons d’euphorbe rouge, notre main collée sur la
bouche d’étonnement et d’admiration, juste à la bonne distance pour
voir les passagers sortir, ce qu’ils apportaient avec eux, malles,
valises en carton ou instruments mystérieux, sans craindre les
morsures du chien attaché devant la porte, ni le bâton de l’homme à
tout faire des lieux qui était trop paresseux pour venir jusqu’à nous
afin de nous chasser. Quand l’un des muzungu, qui ne pouvait
ignorer notre manège, faisait un pas vers nous, sans doute pour
nous saluer, c’était la panique. Nous détalions sans concertation, les
plus grands poussant les autres dans les buissons d’euphorbe, dont
la sève qui coulait abondamment des branches piétinées laissait sur
nos vêtements des taches indélébiles, pour lesquelles nos mères ne
manqueraient pas de nous punir sévèrement.
Et c’est bien longtemps après que les étrangers eurent pénétré
dans la bâtisse en brique dans laquelle aucun de nous n’avait jamais
mis les pieds que nous nous résolvions à rentrer chez nous, pour
raconter ce que nous avions vu, avec quelques exagérations en
prime, aux petits froussards restés derrière.
Samora a longtemps voulu être plus blanc que blanc. Personne
n’y croyait, mis à part lui. Dans le petit village du Médoc où il a
grandi, pourtant, ça n’était pas les petits noms le renvoyant à son
statut de nègre qui manquaient. Mais il avait choisi de vivre dans le
déni. Ce n’est qu’une fois atteint l’âge adulte qu’il a changé de
couleur, ou du moins accepté celle qu’on lui avait toujours assignée.
Il disait avoir eu une épiphanie en arrivant en ville, à Bordeaux, où il
avait eu accès aux textes de Césaire et Fanon pour la première fois.
C’est moi qui ai choisi ma condition, oui, pas les autres qui me l’ont
imposée, aime-t-il encore à répéter. Je le laisse parler, si ça peut
l’aider de voir les choses ainsi…
En réalité, il ne peut véritablement être ni l’un ni l’autre, et c’est là
tout son drame. Il fait partie de ces gens qui pensent que la vie se
trace uniquement avec des lignes et des angles droits, ignorant toute
la latitude qu’offrent les courbes, les renflements cachés, les bulles
qui prennent la tangente, feignant de ne pas voir la monotonie atroce
des parallèles. Comme si les métis pouvaient jamais choisir entre
blanc et noir, comme si un enfant pouvait jamais n’être que la mère
ou le père. Même parti, même absent, ou peut-être surtout quand il
s’est évanoui dans la nature, sa couleur nous colle à la peau. Son
absence nous marque le front, nous écorche de l’intérieur, créant
dans notre corps un flux tourmenté de sang-mêlé. Ce sont les
autres, ceux qui croient avoir le luxe d’être monochromes, d’être
indivisibles, fondus dans la masse rassurante de leurs semblables,
qui nous somment de choisir, nous assignent, nous crucifient.
n’y croyait, mis à part lui. Dans le petit village du Médoc où il a
grandi, pourtant, ça n’était pas les petits noms le renvoyant à son
statut de nègre qui manquaient. Mais il avait choisi de vivre dans le
déni. Ce n’est qu’une fois atteint l’âge adulte qu’il a changé de
couleur, ou du moins accepté celle qu’on lui avait toujours assignée.
Il disait avoir eu une épiphanie en arrivant en ville, à Bordeaux, où il
avait eu accès aux textes de Césaire et Fanon pour la première fois.
C’est moi qui ai choisi ma condition, oui, pas les autres qui me l’ont
imposée, aime-t-il encore à répéter. Je le laisse parler, si ça peut
l’aider de voir les choses ainsi…
En réalité, il ne peut véritablement être ni l’un ni l’autre, et c’est là
tout son drame. Il fait partie de ces gens qui pensent que la vie se
trace uniquement avec des lignes et des angles droits, ignorant toute
la latitude qu’offrent les courbes, les renflements cachés, les bulles
qui prennent la tangente, feignant de ne pas voir la monotonie atroce
des parallèles. Comme si les métis pouvaient jamais choisir entre
blanc et noir, comme si un enfant pouvait jamais n’être que la mère
ou le père. Même parti, même absent, ou peut-être surtout quand il
s’est évanoui dans la nature, sa couleur nous colle à la peau. Son
absence nous marque le front, nous écorche de l’intérieur, créant
dans notre corps un flux tourmenté de sang-mêlé. Ce sont les
autres, ceux qui croient avoir le luxe d’être monochromes, d’être
indivisibles, fondus dans la masse rassurante de leurs semblables,
qui nous somment de choisir, nous assignent, nous crucifient.
Bosco. Mon enfant-accident. Ton père ne sut sans doute jamais
que tu existais, un fils en chute libre dont il eût pu être l’unique filet. Il
fut transféré dans une prison du Nord, chez les bakiga qui le
haïssaient, il partit avant que tu n’arrives.
Moi, je fus libérée. Le médecin du service pénitentiaire me dit : « Il
sera sans doute prématuré, à moins que vous ne le perdiez avant »
et sidérée je pensai : « Il n’aura pas de père, je ne peux pas
recommencer, un autre enfant sans père, je ne veux pas, je ne peux
pas, je vais m’en débarrasser. » Puis on me laissa rentrer à la
maison après m’avoir concédé un instant volé pour dire adieu à
votre amant. Ils utilisèrent délibérément ce mot d’amant car ils
savaient qu’il me souillait, m’encombrerait, moi et sa descendance
illégitime, partout où nous irions. Je n’étais qu’une femme, pas sa
femme, et je n’aurais pas le droit de le visiter, une fois la porte du
pénitencier passée. Que peut-on dire à son premier amour gisant
dans une pièce aux murs éclaboussés, à un homme tabassé,
désemparé, que peut-on dire d’une histoire qui se défait avant même
d’avoir commencé ? « J’ai quelque chose en moi qui est aussi à toi,
mais je n’ai pas l’intention de le garder » ? La belle affaire. Je lui dis
que je l’attendrais, je savais que ça ne serait pas vrai.
De toi je ne parlai pas. Nous ne t’avions pas fait exprès.
que tu existais, un fils en chute libre dont il eût pu être l’unique filet. Il
fut transféré dans une prison du Nord, chez les bakiga qui le
haïssaient, il partit avant que tu n’arrives.
Moi, je fus libérée. Le médecin du service pénitentiaire me dit : « Il
sera sans doute prématuré, à moins que vous ne le perdiez avant »
et sidérée je pensai : « Il n’aura pas de père, je ne peux pas
recommencer, un autre enfant sans père, je ne veux pas, je ne peux
pas, je vais m’en débarrasser. » Puis on me laissa rentrer à la
maison après m’avoir concédé un instant volé pour dire adieu à
votre amant. Ils utilisèrent délibérément ce mot d’amant car ils
savaient qu’il me souillait, m’encombrerait, moi et sa descendance
illégitime, partout où nous irions. Je n’étais qu’une femme, pas sa
femme, et je n’aurais pas le droit de le visiter, une fois la porte du
pénitencier passée. Que peut-on dire à son premier amour gisant
dans une pièce aux murs éclaboussés, à un homme tabassé,
désemparé, que peut-on dire d’une histoire qui se défait avant même
d’avoir commencé ? « J’ai quelque chose en moi qui est aussi à toi,
mais je n’ai pas l’intention de le garder » ? La belle affaire. Je lui dis
que je l’attendrais, je savais que ça ne serait pas vrai.
De toi je ne parlai pas. Nous ne t’avions pas fait exprès.
Bosco. Mon enfant-accident. Ton père ne sut sans doute jamais
que tu existais, un fils en chute libre dont il eût pu être l’unique filet. Il
fut transféré dans une prison du Nord, chez les bakiga qui le
haïssaient, il partit avant que tu n’arrives.
que tu existais, un fils en chute libre dont il eût pu être l’unique filet. Il
fut transféré dans une prison du Nord, chez les bakiga qui le
haïssaient, il partit avant que tu n’arrives.
Les seuls moments où je sentais ton dos se détendre, où tes bras
chauds s’enroulaient à mes hanches comme des serpents
paresseux, c’était sur le petit banc de crépuscule, la barza au pied
des jacarandas. Glissé entre Blanche et moi, un noyau de mangue
ou un bout de canne à sucre à mâchouiller entre les mains, tu
reposais un instant ton esprit en alerte pour t’abandonner à
l’imagination, pour habiter avec nous les histoires que je vous
déroulais chaque soir comme un fil. Et nous tissions dans la
pénombre du jour atténué les vies dénuées de péchés des cigales,
les prières-poésies des grenouilles de la vallée, les contes de
Bakame, lièvre malin capable de déjouer la méchanceté des
hommes.
chauds s’enroulaient à mes hanches comme des serpents
paresseux, c’était sur le petit banc de crépuscule, la barza au pied
des jacarandas. Glissé entre Blanche et moi, un noyau de mangue
ou un bout de canne à sucre à mâchouiller entre les mains, tu
reposais un instant ton esprit en alerte pour t’abandonner à
l’imagination, pour habiter avec nous les histoires que je vous
déroulais chaque soir comme un fil. Et nous tissions dans la
pénombre du jour atténué les vies dénuées de péchés des cigales,
les prières-poésies des grenouilles de la vallée, les contes de
Bakame, lièvre malin capable de déjouer la méchanceté des
hommes.
Donner la vie. Ensemble ou seule ? Toujours seule. Refuser de le
dire ou partager la nouvelle, dire « notre enfant à venir ». Ce
pouvoir-là, invisible. Les hommes restent toujours sur le seuil, en
réalité, essuient leurs pieds sur le paillasson, esquissent des gestes
maladroits pour lesquels ils sont déjà pardonnés, parce qu’ils ne
sont pas censés savoir y faire, attendent ou s’en vont. S’ils restent,
ils deviennent nos héros, s’ils partent, nous devenons des filles-
mères. Nous en sommes conscientes, dès le premier instant de
cohabitation avec cet être qui pousse en dedans, et la peur de leur
décision nous contraint.
Ce qui se passe ensuite, en nous, dans la pénombre de notre
sein, dans ce corps colonisé ?
Cela, personne ne nous l’a jamais appris, nous devons nous
résigner à attendre le verdict.
Avons-nous le choix ? Ai-je eu le choix ? Ai-je fait les mauvais
choix pour toi ?
En quelque sorte, oui, de cette sorte que l’on appelle le destin, qui
rôdait dans la prison de Karubanda à l’orée de ta vie. C’est terrible,
n’est-ce pas, mon enfant ?
dire ou partager la nouvelle, dire « notre enfant à venir ». Ce
pouvoir-là, invisible. Les hommes restent toujours sur le seuil, en
réalité, essuient leurs pieds sur le paillasson, esquissent des gestes
maladroits pour lesquels ils sont déjà pardonnés, parce qu’ils ne
sont pas censés savoir y faire, attendent ou s’en vont. S’ils restent,
ils deviennent nos héros, s’ils partent, nous devenons des filles-
mères. Nous en sommes conscientes, dès le premier instant de
cohabitation avec cet être qui pousse en dedans, et la peur de leur
décision nous contraint.
Ce qui se passe ensuite, en nous, dans la pénombre de notre
sein, dans ce corps colonisé ?
Cela, personne ne nous l’a jamais appris, nous devons nous
résigner à attendre le verdict.
Avons-nous le choix ? Ai-je eu le choix ? Ai-je fait les mauvais
choix pour toi ?
En quelque sorte, oui, de cette sorte que l’on appelle le destin, qui
rôdait dans la prison de Karubanda à l’orée de ta vie. C’est terrible,
n’est-ce pas, mon enfant ?
Cet après-midi le ciel rugissait sur nos têtes baissées et j’eusse
voulu te planter là pour aller fumer une cigarette sur la barza de la
maternité malgré l’orage, malgré les jambes flageolantes. Je rêvais
d’une bière fraîche, aussi, pour apaiser ma gorge asséchée par des
heures de cris et d’efforts. Il avait fallu m’ouvrir le ventre au scalpel
pour t’en extraire. J’avais entendu la sage-femme dire : « Celui-ci a
tout compris de ce qui se passe au-dehors, il préfère rester au
chaud » avant que l’anesthésie ne m’emporte vers un état comateux
d’où je ne sortis que quelques heures après, la bouche rêche et le
ventre suturé. L’instinct maternel, ceux qui l’ont inventé ne savent
pas ce qu’ils disent, ils n’ont pas la moindre idée, ne sauraient qu’en
faire s’il s’agissait d’eux. Forfanterie et escroquerie. À notre
désavantage, il va sans dire.
Nos hormones ne nous font pas don d’un amour infini, non, il faut
arrêter cette fable. Si les femmes tuent moins, ce n’est pas par un
trop-plein de tendresse, c’est par dégoût de la violence contenue,
celle qui réside là, au creux de leur corps fécondable, propriété de
toute la société.
Le pouvoir de donner la vie, qu’on le veuille ou non, cette farce
tragique. Et à quel saint puis-je me vouer si je ne le veux pas, si mes
entrailles refusent ?
J’avais envie d’uriner mais il n’y avait personne pour m’aider à me
relever, j’aurais pu t’échanger contre une bière fraîche, alors je
pleurais en attendant d’apprendre à t’aimer.
voulu te planter là pour aller fumer une cigarette sur la barza de la
maternité malgré l’orage, malgré les jambes flageolantes. Je rêvais
d’une bière fraîche, aussi, pour apaiser ma gorge asséchée par des
heures de cris et d’efforts. Il avait fallu m’ouvrir le ventre au scalpel
pour t’en extraire. J’avais entendu la sage-femme dire : « Celui-ci a
tout compris de ce qui se passe au-dehors, il préfère rester au
chaud » avant que l’anesthésie ne m’emporte vers un état comateux
d’où je ne sortis que quelques heures après, la bouche rêche et le
ventre suturé. L’instinct maternel, ceux qui l’ont inventé ne savent
pas ce qu’ils disent, ils n’ont pas la moindre idée, ne sauraient qu’en
faire s’il s’agissait d’eux. Forfanterie et escroquerie. À notre
désavantage, il va sans dire.
Nos hormones ne nous font pas don d’un amour infini, non, il faut
arrêter cette fable. Si les femmes tuent moins, ce n’est pas par un
trop-plein de tendresse, c’est par dégoût de la violence contenue,
celle qui réside là, au creux de leur corps fécondable, propriété de
toute la société.
Le pouvoir de donner la vie, qu’on le veuille ou non, cette farce
tragique. Et à quel saint puis-je me vouer si je ne le veux pas, si mes
entrailles refusent ?
J’avais envie d’uriner mais il n’y avait personne pour m’aider à me
relever, j’aurais pu t’échanger contre une bière fraîche, alors je
pleurais en attendant d’apprendre à t’aimer.
Le jour où tu naquis, Bosco, je pleurai toutes les larmes de mon
corps. Et ce n’est pas la douleur qui sourdait de mon ventre en
charpie, ni la solitude immense s’abattant sur moi qui étaient la
cause de mon état de délabrement. Non. Le ciel tambourinait sans
pitié sur le toit en tôles de la maternité, le bruit des torrents d’eau
débordant des rigoles recouvrait les pleurs des nourrissons que les
mères épuisées tardaient à mettre au sein. Tu dormais, impassible,
indifférent aux manifestations de la grande saison des pluies, à mon
chagrin de parturiente qui retardait ma montée de lait. Cette attitude
de calme apparent que tu as toujours eue, dès les premières heures
de la vie, que tu portais sur le visage comme un masque, sans doute
l’avais-tu adoptée déjà à l’intérieur de moi quand alors il t’avait fallu
t’accrocher à mon utérus malgré les cahots, malgré les coups et les
barreaux. Vous enfanterez dans la violence. Vous êtes la douceur,
vous donnez la vie. Que d’injonctions paradoxales accrochées
arbitrairement par d’autres à nos existences, que de mensonges
rapiécés depuis mille ans et que nous nous devons de porter
dignement, parce qu’il fut décidé un jour que ça devait être ainsi et
pas autrement. C’est sans doute pour cela que nous apprenons à
louvoyer très tôt. Mentir comme on respire, pour accepter, se couler
dans cette arrangeante affabulation. L’instinct maternel, la belle
affaire. Parce que nous donnons plus souvent la vie que nous ne la
prenons, nous nous devrions d’être la solution humaine à la violence
des hommes.
corps. Et ce n’est pas la douleur qui sourdait de mon ventre en
charpie, ni la solitude immense s’abattant sur moi qui étaient la
cause de mon état de délabrement. Non. Le ciel tambourinait sans
pitié sur le toit en tôles de la maternité, le bruit des torrents d’eau
débordant des rigoles recouvrait les pleurs des nourrissons que les
mères épuisées tardaient à mettre au sein. Tu dormais, impassible,
indifférent aux manifestations de la grande saison des pluies, à mon
chagrin de parturiente qui retardait ma montée de lait. Cette attitude
de calme apparent que tu as toujours eue, dès les premières heures
de la vie, que tu portais sur le visage comme un masque, sans doute
l’avais-tu adoptée déjà à l’intérieur de moi quand alors il t’avait fallu
t’accrocher à mon utérus malgré les cahots, malgré les coups et les
barreaux. Vous enfanterez dans la violence. Vous êtes la douceur,
vous donnez la vie. Que d’injonctions paradoxales accrochées
arbitrairement par d’autres à nos existences, que de mensonges
rapiécés depuis mille ans et que nous nous devons de porter
dignement, parce qu’il fut décidé un jour que ça devait être ainsi et
pas autrement. C’est sans doute pour cela que nous apprenons à
louvoyer très tôt. Mentir comme on respire, pour accepter, se couler
dans cette arrangeante affabulation. L’instinct maternel, la belle
affaire. Parce que nous donnons plus souvent la vie que nous ne la
prenons, nous nous devrions d’être la solution humaine à la violence
des hommes.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Beata Umubyeyi Mairesse (9)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3192 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3192 lecteurs ont répondu