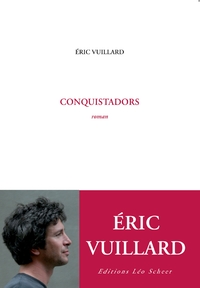>
Critique de Quarto
Peut-on s'ennuyer à la lecture de Conquistadors ? Certainement. Sur ce passons, chacun verra. Conquistadors échappe aux tentatives de le circonscrire à un genre. Épopée, roman, poème ? Oui, à la fois et sûrement davantage encore. Un roman historique ? Non, sûrement pas ; et doublement pas, car pas d'Histoire ni d'histoire, rien qui ne file en ligne droite.
Conquistadors est un livre impressionnant, dans son ambition et par la trace qu'il imprime, un livre à l'écriture habitée, presque hallucinée, un livre exténué, aussi, comme ses personnages, épuisant parfois, mais à la litanie prise de vie par des ivresses soudaines, des élans dans sa lenteur, des échappées dans sa circularité.
Éric Vuillard époussette les cuirasses et au bout d'une phrase inaugurale longue comme un inventaire accouche d'un « avançait » qui ébranle depuis l'été 1532 le cortège de Pizarre, des Pizarre et des autres qu'il m'est souvent arrivé de confondre – mais d'une meute, qu'importe de savoir à qui sont tous les crocs ? le cortège s'ébranle, difficilement. Conquistadors n'est pas un livre difficile mais son souffle (intérieur) n'emporte pas le lecteur ; il n'est pas difficile, il est immobile. Si c'est une épopée, elle ne va nulle part.
Nous sommes à ce point, nous tournons autour, embourbés avant la fulgurante mondialisation de l'or et de la syphilis. Dans un temps circulaire – contre un temps historique – un temps qui nous est coalescent. Dans un tableau du Titien où « tout [serait] soudain pris dans tout, comme si la double comptabilité, l'eau bénite et la porcelaine formaient une seule lave vivante, dont les éléments disparates seraient tenus ensemble par le sang ».
Nous en sommes là, un lieu, un temps : le moment ; l'événement, après lequel « il n'y aurait plus de terre promise », « de royaume rêvé », « d'Éden sauvage », mais l'unité du monde, notre monde, d'où le roman s'écrit, quand les idoles ont été fondues dans les coffres en minuscules lingots, qu'une cabine se loue 1,50 dollar aux thermes de Pulcamarca. Là-maintenant où, depuis, l'avenir serait écrit, et le passé aussi « car nous ne saurons jamais ce que les événements ont enfouis sous eux. Ils se labourent seuls, sans cesse. » Et encore : « Les événements brûlent leurs racines. C'est de ça qu'ils se chauffent. »
Devant ce labour, à ce foyer, nous sommes tenus pendant qu'il est trop tard : nous avons le temps. le temps, matière du livre. Dans le sang, la boue, la neige. Et l'or « qui allait les décevoir. » L'or en sa quintessence et non sa quête – au sens d'une progression. Pas de sens : « Les événements appartenaient à la même fourrure dont le monde se couvrait le corps (...) Mais le sens ne voulait pas être approfondi. Rien ne voulait être compris. La vie circule et danse. »
Plus que des hommes de leur temps, les conquistadors sont des hommes du moment, ce moment dont ils ont la chair et l'étoffe. Ils ne sont pas des colonisateurs qui inscrivent leur projet dans le temps, mais des conquérants engagés par une geste abominable à laquelle seul le mirage de l'or donne un mirage de sens.
Nous sommes à un point aveugle, littéralement sidérant, qu'un des Pizarre ressent aussi confusément, constatant que plus une règle ne vaut, à tel point qu'un nègre peut trôner en litière sur un royaume vaincu. « Les mots restaient là, comme des pierres. Il y avait quelque chose d'inexistant dans les mots. Une fente secrète où il ne pouvait glisser son haleine et sa rage. »
Nous sommes à ce moment qui travaille en nous, dans sa succession et dans sa permanence, à « l'envahissement du Nouveau Monde » que Levi-Strauss oppose à sa « découverte ». « La destruction de ses peuples et de ses valeurs » qui, dit celui-ci, appelle encore « un acte de contrition et de pitié », quand, écrit Éric Vuillard « les Indiens, les péons, les nègres durent pour la suite des temps demander pardon du péché commis au détriment de leurs races. » (En épigraphe, en épitaphe : « Gloria victis ! »)
La sidération est pour le lecteur un moment d'envoûtement. J'ai lu Conquistadors comme dans un rêve ; j'ai rêvé avec Vuillard. Éric Vuillard a rêvé la conquête et les conquistadors se lèvent de son rêve. « Au matin, tels des cadavres les hommes surgissaient lentement de la terre. » Et comme dans un rêve, il ne soutient pas la réalité en entier, se passe de grandes descriptions, de contexte, de chronologie, se concentre sur des impressions, des sensations, esquissant les nuages d'un ciel changeant.
Les conquistadors ont leurs raisons pour avoir quitté l'Espagne. Petites raisons : une mule, un cochon, un couteau. Mais de fait ils sont appelés : un destin doit se réaliser. Pas question bien sûr de nécessité historique, ils sont appelés a posteriori, par le rêve de Vuillard dont ils sont en quelque sorte possédés. D'où leurs exploits insensés : « Pendant que Pantagruel construisait le pont du Gard et les arènes de Nîmes en moins de trois heures, Pizarre faisait crouler un empire en moins de deux. » Une bande de coupe-jarrets défait une armée ; ils le peuvent parce qu'ils le doivent, c'est leur destin. « Après vingt-cinq ans passés à le pourchasser [Pizarre] faisait enfin face à l'adversaire qu'il s'était créé. »
Dans le moment, s'infiltre le souvenir d'un baiser, la saveur d'un fromage. D'un ailleurs plutôt que d'un passé. N'ont-ils pas toujours été où les Indiens les attendaient ? A peine subie, Atahualpa se souvient de sa défaite. Vague souvenir, comme un songe : « Elle semblait réaliser un désir, obéir à une révélation très ancienne qu'on lui avait dite, mais dont il ne se souvenait plus ». Les Espagnols conquièrent sans découvrir, dans un « déjà vu ». Leurs futurs exploits ont déjà été chantés « dans une cour d'auberge à Caceres ou à Burgos ». Ils sont déjà venus, ils ont déjà vécu. Éric Vuillard les rappelle, les ranime.
Le moment convoqué les réveille ; ils sont à jamais de ce moment, c'est le leur, ce moment sur lequel ils règnent comme des dieux. « Pizarre nommait les rivières, les collines, il donnait aux lieux les noms de l'avenir. » Dieux gibbeux : Roi-chèvre, dieu de corne, scorpion des collines, petits génies des foins dans ce « désordre des temps ». Petits dieux jaloux dont les états d'âmes flétrissent dans l'ombre tutélaire du « Dieu sévère de Moïse », celui « des retables et de la lumière qui recueillerait des pluies d'or ». Petits dieux et leur terrain de jeux, comme des enfants dans la toute-puissance. « Ils bramaient leurs déclarations au nez de peuples qui ne les entendaient pas ; ils s'adressaient aux mouches, aux tarentules, aux perroquets. »
Pour quel dessein ? « Étaient-ils venus de si loin pour réaliser en tous points les prophéties d'un peuple ? » Ils ne sont là que pour eux. Rien d'entièrement humain ne les meut. Qu'ils soient de notre espace-temps ne nous les rend pas plus proches. Bien « qu'un immense plateau dénudé nous sépare de ce qu'ils pensaient, craignaient, complotaient », les Indiens nous sont moins étrangers qui, comme nous, sont spectateurs de ces Espagnols caracolant, cavaliers de leur apocalypse. Les Indiens : « Mais qu'ont-ils vu au juste ? Ils ont vu ce que l'on rêve de voir. La fin. » Car : « Je ne verrai jamais un monde qui s'écroule, pense chacun de nous. Mais au fond, c'est notre grand désir : pieuse et brutale fin des temps. Et voilà qu'un peuple l'a vue. Il faisait beau. le ciel était clair et l'air frais, lorsque défilèrent les armes rutilantes. »
Les conquistadors sont à la fin. Pour vivre ces nuits quand « la crainte et le désir du lendemain ramènent à nous les pensées enfouies. (...) Peut-être ne devient-on conquistador que pour ça. » Et à la fin du monde, ces types font froid dans le dos. Dans l'entropie de l'événement, ils se déchirent. Pour les Indiens « assis sur les gradins naturels de cette arène de collines », le match est disputé « et la tête d'Orgoñez passe de mains en mains comme un ballon de cuir. »
Le plus humain des cavaliers d'Apocalypse, c'est Almagro, l'homme à contretemps qui, arrivé plus tard, arrivé trop tard, n'est lui pas tout à fait du moment, mais de sa répétition (perte de l'innocence, nous dit Freud), rêvant qu'il aurait pu le partager dans une fraternité enfantine. « Peut-être ne reste-t-il des choses accomplies que les rêves tristes », se demande-t-il. Dans le regret du monde, de prolonger sa fin, proroger l'événement de la fin, il implore « un moment, juste un petit moment ».
Conquistadors est un livre impressionnant, dans son ambition et par la trace qu'il imprime, un livre à l'écriture habitée, presque hallucinée, un livre exténué, aussi, comme ses personnages, épuisant parfois, mais à la litanie prise de vie par des ivresses soudaines, des élans dans sa lenteur, des échappées dans sa circularité.
Éric Vuillard époussette les cuirasses et au bout d'une phrase inaugurale longue comme un inventaire accouche d'un « avançait » qui ébranle depuis l'été 1532 le cortège de Pizarre, des Pizarre et des autres qu'il m'est souvent arrivé de confondre – mais d'une meute, qu'importe de savoir à qui sont tous les crocs ? le cortège s'ébranle, difficilement. Conquistadors n'est pas un livre difficile mais son souffle (intérieur) n'emporte pas le lecteur ; il n'est pas difficile, il est immobile. Si c'est une épopée, elle ne va nulle part.
Nous sommes à ce point, nous tournons autour, embourbés avant la fulgurante mondialisation de l'or et de la syphilis. Dans un temps circulaire – contre un temps historique – un temps qui nous est coalescent. Dans un tableau du Titien où « tout [serait] soudain pris dans tout, comme si la double comptabilité, l'eau bénite et la porcelaine formaient une seule lave vivante, dont les éléments disparates seraient tenus ensemble par le sang ».
Nous en sommes là, un lieu, un temps : le moment ; l'événement, après lequel « il n'y aurait plus de terre promise », « de royaume rêvé », « d'Éden sauvage », mais l'unité du monde, notre monde, d'où le roman s'écrit, quand les idoles ont été fondues dans les coffres en minuscules lingots, qu'une cabine se loue 1,50 dollar aux thermes de Pulcamarca. Là-maintenant où, depuis, l'avenir serait écrit, et le passé aussi « car nous ne saurons jamais ce que les événements ont enfouis sous eux. Ils se labourent seuls, sans cesse. » Et encore : « Les événements brûlent leurs racines. C'est de ça qu'ils se chauffent. »
Devant ce labour, à ce foyer, nous sommes tenus pendant qu'il est trop tard : nous avons le temps. le temps, matière du livre. Dans le sang, la boue, la neige. Et l'or « qui allait les décevoir. » L'or en sa quintessence et non sa quête – au sens d'une progression. Pas de sens : « Les événements appartenaient à la même fourrure dont le monde se couvrait le corps (...) Mais le sens ne voulait pas être approfondi. Rien ne voulait être compris. La vie circule et danse. »
Plus que des hommes de leur temps, les conquistadors sont des hommes du moment, ce moment dont ils ont la chair et l'étoffe. Ils ne sont pas des colonisateurs qui inscrivent leur projet dans le temps, mais des conquérants engagés par une geste abominable à laquelle seul le mirage de l'or donne un mirage de sens.
Nous sommes à un point aveugle, littéralement sidérant, qu'un des Pizarre ressent aussi confusément, constatant que plus une règle ne vaut, à tel point qu'un nègre peut trôner en litière sur un royaume vaincu. « Les mots restaient là, comme des pierres. Il y avait quelque chose d'inexistant dans les mots. Une fente secrète où il ne pouvait glisser son haleine et sa rage. »
Nous sommes à ce moment qui travaille en nous, dans sa succession et dans sa permanence, à « l'envahissement du Nouveau Monde » que Levi-Strauss oppose à sa « découverte ». « La destruction de ses peuples et de ses valeurs » qui, dit celui-ci, appelle encore « un acte de contrition et de pitié », quand, écrit Éric Vuillard « les Indiens, les péons, les nègres durent pour la suite des temps demander pardon du péché commis au détriment de leurs races. » (En épigraphe, en épitaphe : « Gloria victis ! »)
La sidération est pour le lecteur un moment d'envoûtement. J'ai lu Conquistadors comme dans un rêve ; j'ai rêvé avec Vuillard. Éric Vuillard a rêvé la conquête et les conquistadors se lèvent de son rêve. « Au matin, tels des cadavres les hommes surgissaient lentement de la terre. » Et comme dans un rêve, il ne soutient pas la réalité en entier, se passe de grandes descriptions, de contexte, de chronologie, se concentre sur des impressions, des sensations, esquissant les nuages d'un ciel changeant.
Les conquistadors ont leurs raisons pour avoir quitté l'Espagne. Petites raisons : une mule, un cochon, un couteau. Mais de fait ils sont appelés : un destin doit se réaliser. Pas question bien sûr de nécessité historique, ils sont appelés a posteriori, par le rêve de Vuillard dont ils sont en quelque sorte possédés. D'où leurs exploits insensés : « Pendant que Pantagruel construisait le pont du Gard et les arènes de Nîmes en moins de trois heures, Pizarre faisait crouler un empire en moins de deux. » Une bande de coupe-jarrets défait une armée ; ils le peuvent parce qu'ils le doivent, c'est leur destin. « Après vingt-cinq ans passés à le pourchasser [Pizarre] faisait enfin face à l'adversaire qu'il s'était créé. »
Dans le moment, s'infiltre le souvenir d'un baiser, la saveur d'un fromage. D'un ailleurs plutôt que d'un passé. N'ont-ils pas toujours été où les Indiens les attendaient ? A peine subie, Atahualpa se souvient de sa défaite. Vague souvenir, comme un songe : « Elle semblait réaliser un désir, obéir à une révélation très ancienne qu'on lui avait dite, mais dont il ne se souvenait plus ». Les Espagnols conquièrent sans découvrir, dans un « déjà vu ». Leurs futurs exploits ont déjà été chantés « dans une cour d'auberge à Caceres ou à Burgos ». Ils sont déjà venus, ils ont déjà vécu. Éric Vuillard les rappelle, les ranime.
Le moment convoqué les réveille ; ils sont à jamais de ce moment, c'est le leur, ce moment sur lequel ils règnent comme des dieux. « Pizarre nommait les rivières, les collines, il donnait aux lieux les noms de l'avenir. » Dieux gibbeux : Roi-chèvre, dieu de corne, scorpion des collines, petits génies des foins dans ce « désordre des temps ». Petits dieux jaloux dont les états d'âmes flétrissent dans l'ombre tutélaire du « Dieu sévère de Moïse », celui « des retables et de la lumière qui recueillerait des pluies d'or ». Petits dieux et leur terrain de jeux, comme des enfants dans la toute-puissance. « Ils bramaient leurs déclarations au nez de peuples qui ne les entendaient pas ; ils s'adressaient aux mouches, aux tarentules, aux perroquets. »
Pour quel dessein ? « Étaient-ils venus de si loin pour réaliser en tous points les prophéties d'un peuple ? » Ils ne sont là que pour eux. Rien d'entièrement humain ne les meut. Qu'ils soient de notre espace-temps ne nous les rend pas plus proches. Bien « qu'un immense plateau dénudé nous sépare de ce qu'ils pensaient, craignaient, complotaient », les Indiens nous sont moins étrangers qui, comme nous, sont spectateurs de ces Espagnols caracolant, cavaliers de leur apocalypse. Les Indiens : « Mais qu'ont-ils vu au juste ? Ils ont vu ce que l'on rêve de voir. La fin. » Car : « Je ne verrai jamais un monde qui s'écroule, pense chacun de nous. Mais au fond, c'est notre grand désir : pieuse et brutale fin des temps. Et voilà qu'un peuple l'a vue. Il faisait beau. le ciel était clair et l'air frais, lorsque défilèrent les armes rutilantes. »
Les conquistadors sont à la fin. Pour vivre ces nuits quand « la crainte et le désir du lendemain ramènent à nous les pensées enfouies. (...) Peut-être ne devient-on conquistador que pour ça. » Et à la fin du monde, ces types font froid dans le dos. Dans l'entropie de l'événement, ils se déchirent. Pour les Indiens « assis sur les gradins naturels de cette arène de collines », le match est disputé « et la tête d'Orgoñez passe de mains en mains comme un ballon de cuir. »
Le plus humain des cavaliers d'Apocalypse, c'est Almagro, l'homme à contretemps qui, arrivé plus tard, arrivé trop tard, n'est lui pas tout à fait du moment, mais de sa répétition (perte de l'innocence, nous dit Freud), rêvant qu'il aurait pu le partager dans une fraternité enfantine. « Peut-être ne reste-t-il des choses accomplies que les rêves tristes », se demande-t-il. Dans le regret du monde, de prolonger sa fin, proroger l'événement de la fin, il implore « un moment, juste un petit moment ».