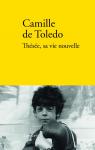Critiques de Camille de Toledo (112)
J'étais impatiente de lire ce livre en lice pour le Goncourt 2020 : Thésée est un personnage qui me fascine et je garde un excellent souvenir du Thésée d'André Gide notamment.
Voilà donc un autre Thésée mais cette fois, j'ai fini par me perdre dans son labyrinthe. Après le suicide de son frère Jérôme, le décès de sa mère puis celui de son père, Thésée quitte tout pour aller s'installer avec sa famille dans une ville de l'Est. Il emporte trois boites d'archives familiales en guise de fil d'Ariane. Très vite, il sombre dans une profonde dépression et les archives familiales gisent autour de lui dans sa chambre.... De temps en temps des flashes éclairent le lecteur sur les sources du malaise : la difficulté d'être Juif en France sous Vichy, la judaïté refoulée au profit de la réussite sociale, ... Mais le récit revient sans cesse aux mêmes idées et tisse des liens obscur entre des dates et des événements, la mise en page mêle photos, manuscrits, texte en italiques en vers libres et texte en prose qui reprend soudain en milieu de phrase ! Bref, un labyrinthe où l'on se perd et dont je ne suis pas ressortie.
Ce livre est vendu en librairie 18, 50 €, je le revends à 15 €
Lien : http://www.lirelire.net/2020..
J'étais impatiente de lire ce livre en lice pour le Goncourt 2020 : Thésée est un personnage qui me fascine et je garde un excellent souvenir du Thésée d'André Gide notamment.
Voilà donc un autre Thésée mais cette fois, j'ai fini par me perdre dans son labyrinthe. Après le suicide de son frère Jérôme, le décès de sa mère puis celui de son père, Thésée quitte tout pour aller s'installer avec sa famille dans une ville de l'Est. Il emporte trois boites d'archives familiales en guise de fil d'Ariane. Très vite, il sombre dans une profonde dépression et les archives familiales gisent autour de lui dans sa chambre.... De temps en temps des flashes éclairent le lecteur sur les sources du malaise : la difficulté d'être Juif en France sous Vichy, la judaïté refoulée au profit de la réussite sociale, ... Mais le récit revient sans cesse aux mêmes idées et tisse des liens obscur entre des dates et des événements, la mise en page mêle photos, manuscrits, texte en italiques en vers libres et texte en prose qui reprend soudain en milieu de phrase ! Bref, un labyrinthe où l'on se perd et dont je ne suis pas ressortie.
Ce livre est vendu en librairie 18, 50 €, je le revends à 15 €
Lien : http://www.lirelire.net/2020..
C'est une évocation triste d'une tristesse européenne, une tendance à s'apitoyer, à s'enfermer dans un passé qui bloque le présent, une hantise de la honte, qui mène à l'aspiration de la consolation comme on rafistole des pneus crevés, un éternel ressassement d'un épisode tragique, comme une exégèse biblique sans cesse reprise. Pour la dépasser, il faudrait une renaissance, faire du vertige un projet civilisationnel, une refondation linguistique et littéraire qui insinue la transformation de l'ancien dans la langue elle-même. Et c'est encore l'idée d'une langue unique qui revient, sous la forme d'une évocation, d'une vision : langue du passage, de la diaspora, le yiddish deviendrait la langue européenne...
Le second essai, "L'utopie linguistique", reprend la phrase d'Umberto Eco selon laquelle la langue de l'Europe est la traduction et propose un projet linguistique européen d'enseignement des langues et de la traduction...
Le premier essai s'apparente plutôt à un état d'âme, une évocation poétique, une rêverie langoureuse qu'un essai philosophique. Il prend l'envie de se dire que la réponse aux interrogations de l'auteur sur le flottement de cette tristesse européenne serait un retour du romantisme, ce goût macabre pour le passé, cette volonté de se souvenir de ce qu'on n'a pas connu, un âge d'or dont on déplore que la catastrophe l'ait effacé... l'option du yiddish comme langue européenne intervient sans heurts dans cette expression poétique et nostalgique. Côté rationnel, on pourrait se limiter à remarquer que se lamenter qu'on se lamente trop n'est que la démonstration de la suggestion que l'on fait et que l'on s'exonère d'envisager des solutions à la dissipation de sa peine, comme le plaisir que l'on a de vivre la tristesse - et que la proposition d'une langue européenne comme solution à un projet multiculturel n'a rien, ni d'entraînant, ni d'innovant... On pourrait seulement ajouter que faire de la langue même le moyen du souvenir revient à conceptualiser cette éternelle présentification d'une même histoire et pourrait bien instaurer l'idée qu'une seule langue ait la capacité à dire la vérité du souvenir : faut-il à l'Europe une langue sacrée ?... on pourrait enfin achever en faisant remarquer que le souvenir est un thème juif, que le yiddish..., et que faire du yiddish la langue d'une organisation politique... et l'Europe devient un autre Israël... où la recherche de l'universel semble remarquablement biaisée... reste que c'est une idée poétique, une fantaisie, un état d'âme... rien n'empêche, sans frustration, d'entrer dans la rêverie, qui en vaut bien une autre...
En revanche, le second essai se veut davantage démonstratif, si bien qu'il échappe moins à la critique rationnelle. Là aussi, on peut se limiter à faire remarquer qu'institutionnaliser la traduction revient à souder les langues, c'est-à-dire suggérer que les langues aient déjà tout dit, qu'elles soient éternellement figées, ce qui autorise à proposer, par cet assemblage rigide et tentaculaire de passage et de points de jonction... une nouvelle langue unique... Et que se passe-t-il si personne ne produit plus d'énoncés qui "valent" quoi que ce soit ? On aura une belle construction linguistique sans rien à dire... Faut-il traduire le vide, la répétition, le ressassement ?
Finalement, le soupçon de délicatesse né du charme du premier essai s'évanouit malheureusement à la lecture de la brutalité superficielle du second... et il ne reste plus à la tristesse qu'à noyer son chagrin dans l'oubli...
Le second essai, "L'utopie linguistique", reprend la phrase d'Umberto Eco selon laquelle la langue de l'Europe est la traduction et propose un projet linguistique européen d'enseignement des langues et de la traduction...
Le premier essai s'apparente plutôt à un état d'âme, une évocation poétique, une rêverie langoureuse qu'un essai philosophique. Il prend l'envie de se dire que la réponse aux interrogations de l'auteur sur le flottement de cette tristesse européenne serait un retour du romantisme, ce goût macabre pour le passé, cette volonté de se souvenir de ce qu'on n'a pas connu, un âge d'or dont on déplore que la catastrophe l'ait effacé... l'option du yiddish comme langue européenne intervient sans heurts dans cette expression poétique et nostalgique. Côté rationnel, on pourrait se limiter à remarquer que se lamenter qu'on se lamente trop n'est que la démonstration de la suggestion que l'on fait et que l'on s'exonère d'envisager des solutions à la dissipation de sa peine, comme le plaisir que l'on a de vivre la tristesse - et que la proposition d'une langue européenne comme solution à un projet multiculturel n'a rien, ni d'entraînant, ni d'innovant... On pourrait seulement ajouter que faire de la langue même le moyen du souvenir revient à conceptualiser cette éternelle présentification d'une même histoire et pourrait bien instaurer l'idée qu'une seule langue ait la capacité à dire la vérité du souvenir : faut-il à l'Europe une langue sacrée ?... on pourrait enfin achever en faisant remarquer que le souvenir est un thème juif, que le yiddish..., et que faire du yiddish la langue d'une organisation politique... et l'Europe devient un autre Israël... où la recherche de l'universel semble remarquablement biaisée... reste que c'est une idée poétique, une fantaisie, un état d'âme... rien n'empêche, sans frustration, d'entrer dans la rêverie, qui en vaut bien une autre...
En revanche, le second essai se veut davantage démonstratif, si bien qu'il échappe moins à la critique rationnelle. Là aussi, on peut se limiter à faire remarquer qu'institutionnaliser la traduction revient à souder les langues, c'est-à-dire suggérer que les langues aient déjà tout dit, qu'elles soient éternellement figées, ce qui autorise à proposer, par cet assemblage rigide et tentaculaire de passage et de points de jonction... une nouvelle langue unique... Et que se passe-t-il si personne ne produit plus d'énoncés qui "valent" quoi que ce soit ? On aura une belle construction linguistique sans rien à dire... Faut-il traduire le vide, la répétition, le ressassement ?
Finalement, le soupçon de délicatesse né du charme du premier essai s'évanouit malheureusement à la lecture de la brutalité superficielle du second... et il ne reste plus à la tristesse qu'à noyer son chagrin dans l'oubli...
C'est une contestation au "Manifeste pour une littérature-monde" publié le 16 mars 2007 dans le journal le Monde et signé par quarante-quatre écrivains de langue française.
L'auteur comprend ce manifeste comme la promotion de romans francophones écrits hors de la métropole, la littérature-voyage aux dépens de l'invention formelle, l'ouverture et l'espace contre le renfermement et le parisianisme, la nation (je simplifie). Il note : que le moment critique d'apparition de la littérature-monde est considéré comme étant l'année 2007 et l'attribution des prix littéraires à des auteurs non métropolitains, ce qui signifient que l'autorité reste, pour les signataires du manifeste, la métropole ; que le voyage n'est pas antinomique de la quête de soi ; que les signataires semblent vouloir calquer la littérature française, littérature de strates et de hiérarchies, sur la littérature anglophone, hétéroclite et horizontale et qu'il faudrait en conséquence bouleverser toute la structure de la politique, de l'économie et de la culture française pour aller vers la promotion de la littérature-voyage - devenir britannique ; que la faveur du voyage ne doit pas signifier l'abandon de la rechercher formelle ou alors c'est la fin de toute littérature.
Donc il conclut que les auteurs du manifeste restent eux-même enfermés dans les frontières qu'ils prétendent dépasser et que leur appétit d'exotisme n'est qu'un appel à une littérature vivante, comme il existe chez tous les amateurs de littérature. L'aporie est qu'ils tombent dans l'apologie d'une littérature figée, soumise à des jugements esthétiques qui portent la beauté des formes et le souffle épique, conception passéiste, celle des Anciens, tout en prétendant avoir rénové la littérature en ayant repéré quelques nouveautés qui, dans une époque mondialisée, peut bien surgir n'importe où. Leur conception qui veut enterrer la littérature-à-papa, défend ostensiblement le roman postcolonial sans le dire, ce qui n'est pas la même chose que de se placer du côté des Modernes.
Puis, ayant saisi l'intention des signataires, il propose de refaire le manifeste. le lieu du Voyage, c'est les DOM-TOM ou l'île au trésor aussi bien que le Farghestan du Rivage des Syrtes : toute littérature est voyage, le mot "roman" est synonyme de l'adverbe "ailleurs". Alors de Toledo invente un pays, le Flurkistan, qui mélange le ridicule d'une syllabe laide, "Flur", et la noblesse d'un suffixe, "istan", comme pour rappeler que Don Quichotte a besoin d'un Sancho Pança pour faire naître le roman. Mais le Flurkistan est un faux pays, une copie, un monde dégradé et raté, que l'on invente pour se faire croire que l'on a besoin d'un ailleurs, vraiment ailleurs et artificiel, pour faire de la littérature. C'est bidon, le roman a tout autant besoin du réel - et cela se complique lorsque, comme aujourd'hui, le réel et l'illusion se mélangent : le Flurkistan paraît être un monde authentique, comme le Farghestan. Des illusions et du réel, du formel et des aventures, du ridicule et du noble, c'est tout cela qui doit former la littérature et lui permet de rester vivante. Césaire n'a pas besoin d'entrer au Panthéon et on n'a pas besoin de Panthéon du tout. La littérature contemporaine ou mondialisée, doit-être une reprise, une réécriture présentifiée de romans anciens - et l'auteur doit se faire, pour reprendre Césaire, écrivain-juif.
Sinon, on perd le désir au bénéfice de la foi, celle d'un au-delà idéal, idyllique et paradisiaque, celui auquel on aspire et pour lequel on prie la divinité, celui auquel on se soumet et que l'on adore par principe, comme un dieu.
Cet argumentaire me contente parce qu'il me semblait aussi que cette promotion d'une littérature-monde était pleine d'affectation sans que les idées me soient venues en aussi grand nombre et aussi précises qu'elles sont ici exposées. Mais pourtant, il reste une once d'incertitude. Bien sûr du point de vue de l'écrivain, le Panthéon est inutile. Mais la collectivité peut-elle s'en passer si facilement ? Que serait la culture sinon la consolidation d'une forme dont la collectivité reconnaît qu'elle a marqué son époque ? Peut-il exister une mémoire collective sans Panthéon ? Après, quant à savoir si la collectivité a besoin de mémoire, c'est sans doute une question qui échappe au champ littéraire - quoique (la réalité n'est-elle pas issue des récits du passé que l'on apprend comme formant une "culture"...)
L'auteur comprend ce manifeste comme la promotion de romans francophones écrits hors de la métropole, la littérature-voyage aux dépens de l'invention formelle, l'ouverture et l'espace contre le renfermement et le parisianisme, la nation (je simplifie). Il note : que le moment critique d'apparition de la littérature-monde est considéré comme étant l'année 2007 et l'attribution des prix littéraires à des auteurs non métropolitains, ce qui signifient que l'autorité reste, pour les signataires du manifeste, la métropole ; que le voyage n'est pas antinomique de la quête de soi ; que les signataires semblent vouloir calquer la littérature française, littérature de strates et de hiérarchies, sur la littérature anglophone, hétéroclite et horizontale et qu'il faudrait en conséquence bouleverser toute la structure de la politique, de l'économie et de la culture française pour aller vers la promotion de la littérature-voyage - devenir britannique ; que la faveur du voyage ne doit pas signifier l'abandon de la rechercher formelle ou alors c'est la fin de toute littérature.
Donc il conclut que les auteurs du manifeste restent eux-même enfermés dans les frontières qu'ils prétendent dépasser et que leur appétit d'exotisme n'est qu'un appel à une littérature vivante, comme il existe chez tous les amateurs de littérature. L'aporie est qu'ils tombent dans l'apologie d'une littérature figée, soumise à des jugements esthétiques qui portent la beauté des formes et le souffle épique, conception passéiste, celle des Anciens, tout en prétendant avoir rénové la littérature en ayant repéré quelques nouveautés qui, dans une époque mondialisée, peut bien surgir n'importe où. Leur conception qui veut enterrer la littérature-à-papa, défend ostensiblement le roman postcolonial sans le dire, ce qui n'est pas la même chose que de se placer du côté des Modernes.
Puis, ayant saisi l'intention des signataires, il propose de refaire le manifeste. le lieu du Voyage, c'est les DOM-TOM ou l'île au trésor aussi bien que le Farghestan du Rivage des Syrtes : toute littérature est voyage, le mot "roman" est synonyme de l'adverbe "ailleurs". Alors de Toledo invente un pays, le Flurkistan, qui mélange le ridicule d'une syllabe laide, "Flur", et la noblesse d'un suffixe, "istan", comme pour rappeler que Don Quichotte a besoin d'un Sancho Pança pour faire naître le roman. Mais le Flurkistan est un faux pays, une copie, un monde dégradé et raté, que l'on invente pour se faire croire que l'on a besoin d'un ailleurs, vraiment ailleurs et artificiel, pour faire de la littérature. C'est bidon, le roman a tout autant besoin du réel - et cela se complique lorsque, comme aujourd'hui, le réel et l'illusion se mélangent : le Flurkistan paraît être un monde authentique, comme le Farghestan. Des illusions et du réel, du formel et des aventures, du ridicule et du noble, c'est tout cela qui doit former la littérature et lui permet de rester vivante. Césaire n'a pas besoin d'entrer au Panthéon et on n'a pas besoin de Panthéon du tout. La littérature contemporaine ou mondialisée, doit-être une reprise, une réécriture présentifiée de romans anciens - et l'auteur doit se faire, pour reprendre Césaire, écrivain-juif.
Sinon, on perd le désir au bénéfice de la foi, celle d'un au-delà idéal, idyllique et paradisiaque, celui auquel on aspire et pour lequel on prie la divinité, celui auquel on se soumet et que l'on adore par principe, comme un dieu.
Cet argumentaire me contente parce qu'il me semblait aussi que cette promotion d'une littérature-monde était pleine d'affectation sans que les idées me soient venues en aussi grand nombre et aussi précises qu'elles sont ici exposées. Mais pourtant, il reste une once d'incertitude. Bien sûr du point de vue de l'écrivain, le Panthéon est inutile. Mais la collectivité peut-elle s'en passer si facilement ? Que serait la culture sinon la consolidation d'une forme dont la collectivité reconnaît qu'elle a marqué son époque ? Peut-il exister une mémoire collective sans Panthéon ? Après, quant à savoir si la collectivité a besoin de mémoire, c'est sans doute une question qui échappe au champ littéraire - quoique (la réalité n'est-elle pas issue des récits du passé que l'on apprend comme formant une "culture"...)
L'Europe s'est détruite en revendiquant trop d'identité - le temps de l'inquiétude est venu, celui où il faut être sans identité, sans racine, sans langue. La vie au XXIème siècle sera-t-elle une vie de fiction, un entre-deux, cet espace entre les langues où il faut se tenir pour ne pas être un antagoniste impérieux et destructeur, sera-t-elle une interrogation permanente sur ce que l'on est, là d'où l'on vient et ce que l'on veut, sans pouvoir le dire, sans le savoir en fait ?
Dans le roman de Camille de Toledo, le lecteur se retrouve face à un personnage principal en fuite, hanté par le passé de sa famille, par le manque de son présent. Camille de Toledo aborde la vie de celui qui reste après le suicide et la mort de ses proches. Il y a plusieurs mises en pages, des mots, des phrases et des images. Je suis rentré dans ce livre grâce à son ton, à la profonde empathie qui embrasse l’histoire. Le roman est à la troisième personne et parfois à la première personne. On fait ainsi des allers-retours avec les personnages et leur histoire, comme un nageur qui régulièrement reprendrait son souffle au cours de son avancée dans l’eau. J’ai eu l’impression d’être entre la conscience et le subconscient de Thésée, entre ce qu’il constate (surtout son présent) et ce qu’il refuse d’intégrer, ce qu’il tente d’étouffer (son passé donc). À partir de la situation tragique de son personnage, Camille de Toledo remonte l’histoire d’une famille, d’un héritage, d’un territoire et d’un continent. On remonte ainsi aux années 1930 par le récit de l’arrière-grand-père de Thésée, le récit d’une mort, à la veille de la Seconde Guerre mondiale et on revient vers Thésée en passant par la vie des générations qui l’ont précédé. L’auteur parle de l’exil, de cette Histoire qui détruisit des générations, de la Shoah et du poids du passé. Thésée veut seulement se projeter dans l’avenir, tente de ne plus sentir le passé dans lequel est planté son arbre généalogique. On suit un personnage qui étouffe à cause de son propre héritage. Il veut être moderne, ne porter son regard qu’ailleurs. Son esprit, puis son corps rapidement, s’embourbent dans ce passé que nous découvrons au fur et à mesure. Des moments de cette famille, les douleurs devenues secrets, se révèlent et montrent à quel point la parole a été éteinte pour éviter de parler du passé. Il fallait toujours regarder vers l’avenir. Thésée refuse les morts de sa propre histoire avant de se lancer dans le récit familial, de mettre des mots pour construire ce qui lui appartient.
On lit ce texte porté par un certain élan. Il n’y a pas de majuscule, pas de points. La ponctuation existe quand même, le rythme de la narration venant des virgules, des points-virgules. Et il y a ces blancs, ces sauts de lignes, des mots centrés, alignés d’un côté ou de l’autre, ouvrant des respirations, des hésitations, des doutes, des moments d’absence dans le fil de la pensée de Thésée, transformant ainsi le roman en poème. S’ajoutent des photos recadrées, rognées, aperçus plus ou moins là pour illustrer le texte. Ce livre foisonne d’informations, de souvenirs qui éclatent dans la tête de Thésée. Avec ses choix esthétiques, les pages prennent la forme de notes, d’esquisses, de tableaux. Le roman a de la texture, les feuilles ont de l’ampleur. On parcourt l’esprit de Thésée comme lui a fait son voyage vers l’Est. Le texte, dans une forme hybride et une narration qui donne de l’élan au chaos, montre brillamment la difficulté de construire son passé avec des manques, des absences et le fait de ne pas tout savoir, tout comprendre.
Lien : https://tourneurdepages.word..
On lit ce texte porté par un certain élan. Il n’y a pas de majuscule, pas de points. La ponctuation existe quand même, le rythme de la narration venant des virgules, des points-virgules. Et il y a ces blancs, ces sauts de lignes, des mots centrés, alignés d’un côté ou de l’autre, ouvrant des respirations, des hésitations, des doutes, des moments d’absence dans le fil de la pensée de Thésée, transformant ainsi le roman en poème. S’ajoutent des photos recadrées, rognées, aperçus plus ou moins là pour illustrer le texte. Ce livre foisonne d’informations, de souvenirs qui éclatent dans la tête de Thésée. Avec ses choix esthétiques, les pages prennent la forme de notes, d’esquisses, de tableaux. Le roman a de la texture, les feuilles ont de l’ampleur. On parcourt l’esprit de Thésée comme lui a fait son voyage vers l’Est. Le texte, dans une forme hybride et une narration qui donne de l’élan au chaos, montre brillamment la difficulté de construire son passé avec des manques, des absences et le fait de ne pas tout savoir, tout comprendre.
Lien : https://tourneurdepages.word..
Thésée a perdu son frère Jérôme qui s'est suicidé, sa mère qui s'est laissée mourir suite à cet acte et son père qui en a développé un cancer qui l'a terrassé.
Et lui, quels sont ses séquelles ? Enormes, tout son corps lui fait mal, ses organes, ses os , ses articulations le lâchent mais rien aux radiographies, échographies, examens divers ne décèlent de maladie alors il entreprend une analyse psycho généalogique qui raconte l'histoire de sa famille espagno-turco- juive-française.
De cette recherche il nous raconte l'histoire de sa famille, ses peurs, ses espoirs.
Parsemés d'archives, de photos ce roman/enquête écrit de façon très poétique nous fait réfléchir à notre vie que nous pensons diriger mais qui en réalité n'est que le fruit de plus de 14 générations avant nous. Intéressant.
Et lui, quels sont ses séquelles ? Enormes, tout son corps lui fait mal, ses organes, ses os , ses articulations le lâchent mais rien aux radiographies, échographies, examens divers ne décèlent de maladie alors il entreprend une analyse psycho généalogique qui raconte l'histoire de sa famille espagno-turco- juive-française.
De cette recherche il nous raconte l'histoire de sa famille, ses peurs, ses espoirs.
Parsemés d'archives, de photos ce roman/enquête écrit de façon très poétique nous fait réfléchir à notre vie que nous pensons diriger mais qui en réalité n'est que le fruit de plus de 14 générations avant nous. Intéressant.
« Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées ? »
Livre d'Ézéchiel, chapitre 18. En exergue du récit, cette citation de l'Ancien Testament dit beaucoup de ce qui suit. Elle évoque sans le nommer, tout ce qui au fil du temps, se transmet en silence dans la chaîne des générations. Thésée le frère survivant va ainsi chercher dans les souffrances passées de ses ancêtres, ce qui pourrait donner sens à celles qui ont conduit son frère Jérôme à se donner la mort par pendaison, à trente-trois ans le 1er mars 2005.
« Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ?
Car avec cette question s'ouvre le récit archaïque
Qui coupe entre les âges et ricoche
De vie en vie, du passé vers l'avenir
l'avenir »
Cet avenir, le frère survivant veut y croire, pour ses enfants, pour lui, il décide de quitter le lieu de sa vie pour un nouvel horizon dans une ville de l'est qu'il ne choisit pas par hasard car le hasard n'existe pas pour Thésée, les pas se fondent toujours dans d'autres pas, les vies résonnent d'autres vies. Dans cette ville de l'est, l'avenir se révèle pourtant impossible à construire. La douleur terrasse Thésée, le corps se rebelle et se casse. C'est dans cette souffrance que se trouve le fil d'Ariane. Apprendre à écouter son corps, c'est aussi prendre le temps de se relier aux corps disparus. Les corps ont à transmettre, à l'image de ces vers de terre dont les chercheurs ont révélé leur capacité à faire suivre sur 14 générations, le traumatisme qu'un seul gène a pu subir. L'auteur nous prend donc par la main pour suivre Thésée dans l'abîme de sa souffrance et l'accompagner dans son voyage au pays des morts ; la mort d'Oved, celle de Talmaï, celle de Nissim, celle du frère, du père, de la mère.
Récit poétique beau et fort comme un kaddish, construit dans une scansion douloureuse, où se lit l'infini de ce qui fait mal, l'écriture propose une symbiose poignante à la quête de Thésée qui rétablira le fil des vies passées. le frère mort n'est plus seul.
Un livre superbe.
Lien : https://weblirelavie.com
Livre d'Ézéchiel, chapitre 18. En exergue du récit, cette citation de l'Ancien Testament dit beaucoup de ce qui suit. Elle évoque sans le nommer, tout ce qui au fil du temps, se transmet en silence dans la chaîne des générations. Thésée le frère survivant va ainsi chercher dans les souffrances passées de ses ancêtres, ce qui pourrait donner sens à celles qui ont conduit son frère Jérôme à se donner la mort par pendaison, à trente-trois ans le 1er mars 2005.
« Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ?
Car avec cette question s'ouvre le récit archaïque
Qui coupe entre les âges et ricoche
De vie en vie, du passé vers l'avenir
l'avenir »
Cet avenir, le frère survivant veut y croire, pour ses enfants, pour lui, il décide de quitter le lieu de sa vie pour un nouvel horizon dans une ville de l'est qu'il ne choisit pas par hasard car le hasard n'existe pas pour Thésée, les pas se fondent toujours dans d'autres pas, les vies résonnent d'autres vies. Dans cette ville de l'est, l'avenir se révèle pourtant impossible à construire. La douleur terrasse Thésée, le corps se rebelle et se casse. C'est dans cette souffrance que se trouve le fil d'Ariane. Apprendre à écouter son corps, c'est aussi prendre le temps de se relier aux corps disparus. Les corps ont à transmettre, à l'image de ces vers de terre dont les chercheurs ont révélé leur capacité à faire suivre sur 14 générations, le traumatisme qu'un seul gène a pu subir. L'auteur nous prend donc par la main pour suivre Thésée dans l'abîme de sa souffrance et l'accompagner dans son voyage au pays des morts ; la mort d'Oved, celle de Talmaï, celle de Nissim, celle du frère, du père, de la mère.
Récit poétique beau et fort comme un kaddish, construit dans une scansion douloureuse, où se lit l'infini de ce qui fait mal, l'écriture propose une symbiose poignante à la quête de Thésée qui rétablira le fil des vies passées. le frère mort n'est plus seul.
Un livre superbe.
Lien : https://weblirelavie.com
Un livre assez unique que nous offre l'auteur, que ce soit dans son écriture ou la façon de le présenter en une sorte de long poème lyrique pour nous raconter l'histoire d'une lignée qui porte sur ses épaule une terrible malédiction : celle qui pousse les hommes de cette famille à se suicider.
Un récit bouleversant et assez poignant écrit d'une très belle plume avec beaucoup de poésie.
J'ai bien aimé aussi les photos présentes dans le roman pour illustrer certains passages marquants.
Un récit bouleversant et assez poignant écrit d'une très belle plume avec beaucoup de poésie.
J'ai bien aimé aussi les photos présentes dans le roman pour illustrer certains passages marquants.
Quelques mots classiques et ramassés d’abord : Thésée quitte, part, s’enfuit vers l’Allemagne, vers le pays de l’Est, à l’opposé de l’Ouest familial et familier, avec ses enfants et des cartons d’archives, photos, textes du passé. Ce passé, il tente de lui échapper : un frère suicidé, et deux parents tour à tour emportés par la mort peu de temps après. En croyant choisir la vie, loin de ces deuils et des absences pesantes, il est rattrapé par le corps, lequel se paralyse, s’endolorit jusqu’à l’immobiliser au point cruel d’une tristesse infinie et mortifère. Les cartons à fouiller vont lui permettre d’interroger autrement l’histoire familiale pour se sortir de ce labyrinthe inconscient, entre vivants et morts de la lignée.
Bon, à présent ce qui m’a chavirée dans ce livre : les mots. Pas très original me direz-vous ! En effet. Mais ces mots sont venus dire, exprimer, expliquer, raisonner et résonner ce que j’expérimente depuis de nombreuses années, tant professionnellement que personnellement. La répétition, les pièges des destins reliés, les valises des aïeux, la mémoire du corps, la transmission intergénérationnelle, notre ADN inconscient et agissant…cette quête de sens, ou ce constat de non-sens, nos tentatives pour s’élever et être bien, juste être bien.
Enoncés ainsi, j’ai conscience sans doute de ne pas être des plus convaincantes et ces dernières lignes s’inscriraient davantage dans une analyse psycho, un peu loin de la littérature ?
Pourtant la force de ce livre réside dans les mots qui révèlent, des mots affûtés, chercheurs, qui s’obstinent à poser les bonnes questions, celles qui fâchent aussi sans doute, celles qu’on fuit. Plus largement on vient réinterroger là notre place et notre libre arbitre : nos choix, nos rencontres, nos orientations, nos épreuves, nos symptômes…Sommes-nous à ce point déterminés par le maillage dont nous sommes issus, en plus du conditionnement culturel et éducatif ? Quid de notre liberté ? Ce qui passe à travers nous et qui nous entrave, suffit-il à nous limiter dans une répétition morbide ? Ou appelle à notre singularité, à notre créativité pour s’inventer et se nommer, se re-nommer, malgré les attaches et les dettes, les débusquées, les sublimées ?
J’illustre cette bafouille avec ce tableau, cette vague en symétrie, cette illusion d’optique en miroir qui trouble…car la construction narrative du roman réside en ce retour incessant, ce va et vient pour décrire, symboliser et incarner ce tâtonnement, ce retour sur soi qui repasse, vire et revire, se cherche, se perd, se confond… Il y a redite mais jamais totalement à l’identique. Chaque fois la vague dessine une autre ligne, grapille ou libère un rond de sable, gagne un cran pour l’effacer de retour. Dans cet infiniment petit qui bouge réside la dynamique et la respiration vitale du changement, à peine perceptible parfois mais susceptible de se réaliser, le petit rien, pas de côté qui sauve de la mêmeté qui cristallise et assassine. Le brillant du livre est là : les mots pour symboliser et nous faire ressentir avec finesse les tourments, les douleurs et les émois d’une quête quand on vacille dangereusement ; les mots pour dire la matière du corps qui détient tout, mémoire de chair ; les mots pour broder autour des silences qui pèsent : un récit-enquête pour nous embarquer dans ce voyage de longue haleine, laborieux, éreintant, nécessaire. La vague, inconsciente nous meut, nous retient, nous noie parfois, ou nous réveille, nous secoue et nous transporte vers d’autres rives plus clémentes.
Alors il ne s’agit pas là d’une fiction « classique », laquelle au milieu de multiples personnages viendrait à dévoiler un secret caché aux confins d’un arbre généalogique. On est plutôt là dans un exil qui interroge et partage ses réflexions. Pas loin de la psychanalyse peut-être et dans ce sens le roman est-il écorné ? Pour ma part, la poésie a fonctionné pour se jumeler à l’intelligence ciselée de ce qu’il est pourtant si difficile à partager. Les sentences formulées, en reflet d’une fatalité à démonter, incarnent ces instants, ces fugacités où la conscience s’éclaire enfin, s’énonce lisible et limpide. Ce n’est plus l’oracle qui déclame, c’est bien le cœur intérieur, le cœur voilé de ne plus être écouté, qui prend enfin la parole et que s’entende une autre voix, et que s’ouvre une autre voie, la libérée.
Bon, à présent ce qui m’a chavirée dans ce livre : les mots. Pas très original me direz-vous ! En effet. Mais ces mots sont venus dire, exprimer, expliquer, raisonner et résonner ce que j’expérimente depuis de nombreuses années, tant professionnellement que personnellement. La répétition, les pièges des destins reliés, les valises des aïeux, la mémoire du corps, la transmission intergénérationnelle, notre ADN inconscient et agissant…cette quête de sens, ou ce constat de non-sens, nos tentatives pour s’élever et être bien, juste être bien.
Enoncés ainsi, j’ai conscience sans doute de ne pas être des plus convaincantes et ces dernières lignes s’inscriraient davantage dans une analyse psycho, un peu loin de la littérature ?
Pourtant la force de ce livre réside dans les mots qui révèlent, des mots affûtés, chercheurs, qui s’obstinent à poser les bonnes questions, celles qui fâchent aussi sans doute, celles qu’on fuit. Plus largement on vient réinterroger là notre place et notre libre arbitre : nos choix, nos rencontres, nos orientations, nos épreuves, nos symptômes…Sommes-nous à ce point déterminés par le maillage dont nous sommes issus, en plus du conditionnement culturel et éducatif ? Quid de notre liberté ? Ce qui passe à travers nous et qui nous entrave, suffit-il à nous limiter dans une répétition morbide ? Ou appelle à notre singularité, à notre créativité pour s’inventer et se nommer, se re-nommer, malgré les attaches et les dettes, les débusquées, les sublimées ?
J’illustre cette bafouille avec ce tableau, cette vague en symétrie, cette illusion d’optique en miroir qui trouble…car la construction narrative du roman réside en ce retour incessant, ce va et vient pour décrire, symboliser et incarner ce tâtonnement, ce retour sur soi qui repasse, vire et revire, se cherche, se perd, se confond… Il y a redite mais jamais totalement à l’identique. Chaque fois la vague dessine une autre ligne, grapille ou libère un rond de sable, gagne un cran pour l’effacer de retour. Dans cet infiniment petit qui bouge réside la dynamique et la respiration vitale du changement, à peine perceptible parfois mais susceptible de se réaliser, le petit rien, pas de côté qui sauve de la mêmeté qui cristallise et assassine. Le brillant du livre est là : les mots pour symboliser et nous faire ressentir avec finesse les tourments, les douleurs et les émois d’une quête quand on vacille dangereusement ; les mots pour dire la matière du corps qui détient tout, mémoire de chair ; les mots pour broder autour des silences qui pèsent : un récit-enquête pour nous embarquer dans ce voyage de longue haleine, laborieux, éreintant, nécessaire. La vague, inconsciente nous meut, nous retient, nous noie parfois, ou nous réveille, nous secoue et nous transporte vers d’autres rives plus clémentes.
Alors il ne s’agit pas là d’une fiction « classique », laquelle au milieu de multiples personnages viendrait à dévoiler un secret caché aux confins d’un arbre généalogique. On est plutôt là dans un exil qui interroge et partage ses réflexions. Pas loin de la psychanalyse peut-être et dans ce sens le roman est-il écorné ? Pour ma part, la poésie a fonctionné pour se jumeler à l’intelligence ciselée de ce qu’il est pourtant si difficile à partager. Les sentences formulées, en reflet d’une fatalité à démonter, incarnent ces instants, ces fugacités où la conscience s’éclaire enfin, s’énonce lisible et limpide. Ce n’est plus l’oracle qui déclame, c’est bien le cœur intérieur, le cœur voilé de ne plus être écouté, qui prend enfin la parole et que s’entende une autre voix, et que s’ouvre une autre voie, la libérée.
C'est la première fois que je lis un roman qui se rapproche autant d'une partie de mon histoire familiale. Il est important de savoir que ce livre est empreint de ce qu'on appelle la psychogénéalogie, théorie selon laquelle « les événements, les traumatismes, les secrets et les conflits vécus par les ancêtres d'un individu conditionnent ses faiblesses constitutionnelles, ses troubles psychologiques, ses maladies, voire ses comportements étranges ou inexplicables. »
Si vous êtes en total désaccord avec cette théorie, vous pouvez passer votre chemin car vous trouverez le cheminement suivi par Camille de Toledo complètement extravagant, voire absurde. Mais si cette théorie vous parle alors vous trouverez un témoignage très intéressant qui se présente sous la forme d'un récit parfois poétique, parfois incantatoire accompagné de photographies. Je ne peux que souscrire à cette idée selon laquelle les suicides/morts très brutales qui se répètent au fil des générations au sein d'une famille peuvent devenir un fardeau très lourd à porter pour les descendants et que le besoin de trouver un sens à tout cela devient parfois vital ! La psychogénéalogie permet d'en apporter, même si ce n'est qu'une théorie parmi d'autres. Merci Camille de Toledo !
Si vous êtes en total désaccord avec cette théorie, vous pouvez passer votre chemin car vous trouverez le cheminement suivi par Camille de Toledo complètement extravagant, voire absurde. Mais si cette théorie vous parle alors vous trouverez un témoignage très intéressant qui se présente sous la forme d'un récit parfois poétique, parfois incantatoire accompagné de photographies. Je ne peux que souscrire à cette idée selon laquelle les suicides/morts très brutales qui se répètent au fil des générations au sein d'une famille peuvent devenir un fardeau très lourd à porter pour les descendants et que le besoin de trouver un sens à tout cela devient parfois vital ! La psychogénéalogie permet d'en apporter, même si ce n'est qu'une théorie parmi d'autres. Merci Camille de Toledo !
COUP DE CŒUR
" Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ? - " Celui qui survit, c'est pour raconter quelle histoire ?"
Le texte s'ouvre le 1er mars 2005 par le suicide par pendaison de Jérôme, le frère du narrateur Thésée. Leurs parents mourront eux-mêmes peu après. Moins d’un an plus tard après le suicide de Jérôme, leur mère est retrouvée dans un bus, " endormie pour l’éternité ", victime d'une rupture d’anévrisme, le jour de l'anniversaire de Jérôme et quatre ans plus tard, leur père meurt d’un cancer.
Le frère survivant, Thésée, quitte Paris, la ville de l'Ouest, avec plusieurs cartons d'archives familiales qu'il n'a jamais ouverts, il part vers une ville de l'Est, Berlin qui n'est jamais nommée. Il fuit pour oublier, il quitte sa ville, son pays et sa langue avec ses trois enfants, en colère contre ses morts, assailli de la culpabilité du survivant. Il veut se libérer de sa famille, échapper à la malédiction familiale, rompre la "lignée des hommes qui meurent".
Mais cette fuite ne résout rien. Treize ans après la mort de Jérôme, Thésée tombe, son corps ne le porte plus, les médecins ne comprennent pas et ne peuvent pas le soulager. Il comprend qu'il porte un poids trop lourd pour lui, "la charge du survivant". Il comprend qu'il doit résoudre l'énigme de ses morts, aller à la rencontre des fantômes qui vivent en lui, s'opposer à la loi familiale, le commandement familial qui impose de " ne pas ouvrir les fenêtres du temps" depuis la mort de son arrière-grand père dont il découvrira l'histoire dans ses archives. Il doit entreprendre le "voyage dans les strates du temps" . Il sent " dans l’effondrement de ses os, de ses reins, de ses dents, qu’il est ça : un frère attaché au frère, relié à une histoire de la peine et de la perte".
Dès lors, grâce aux archives familiales qu'il a emportées, il n'a de cesse de répondre à ces questions qui ne le lâchent pas, qui reviennent comme un leitmotiv dans le texte : " Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ? - " Celui qui survit, c'est pour raconter quelle histoire ?" Dans les cartons il trouve des photos, le vieux manuscrit d'un ancêtre, des lettres de guerre d'un autre ancêtre... le passé lui révèle ce que la légende familiale a pris soin de cacher : " En déverser le contenu sur le sol, c’est accueillir la mémoire, le passé, et aussi transgresser la loi d’une lignée qui n’eut de cesse de vouloir cacher, cacher tout ce qui tremble, mais "on ne rouvre pas les fenêtres du temps" te souviens-tu, Jérôme ?"
"Thésée, sa vie nouvelle" n’est pas une autobiographie, ni un récit d’autofiction, c'est un texte qui, selon les propres termes de l'auteur, mêle fiction et enquête généalogique. Camille de Toledo parle de lui à la troisième personne, il se nomme " le frère qui reste, Thésée " et intervient de façon occasionnelle à la première personne mais c'est bien sa propre histoire familiale qu'il tente de remonter dans ce texte avec une mise à distance que l'on retrouve tout au long du récit.
La forme adoptée par Camille de Toledo pour la quête qu'engage Thésée dans le labyrinthe de ses souvenirs est remarquable. Dans son récit qui allie prière, confession, répétitions incantatoires, dialogue avec les morts il insère des documents, les fragments d'un manuscrit, des lettres de guerre, des photos des visages de ses morts en plan serré mais aussi des phrases répétitives en italique détachées dans le texte comme des poèmes.
Il aborde la question des synchronies, ces dates qui entrent en résonance de façon troublante, comme celle de la mort de la mère le jour de l'anniversaire du fils suicidé, comme celle de la rédaction du manuscrit de l'ancêtre à la date où Jérôme a mis fin à ses jours. Il aborde ce qui se noue dans une famille après le suicide d'un ancêtre, dans une famille soumise à la loi du silence, embarquée dans l'obsession de la Croissance à l'époque des Trente Glorieuses, soumise à la comédie de la force et de la réussite. Pour mieux trouver un sens à son histoire il fait se côtoyer quatre générations et leurs peurs retrouvant en chemin les racines du judaïsme errant de ses ancêtres.
La beauté de la langue, la force des questionnements de Camille de Toledo font de ce roman une pépite. Un texte bouleversant, certes un peu exigeant, qui hantera longtemps le lecteur après l'avoir refermé. Un texte qui fait parfois écho au sublime "Saturne" de Sarah Chiche.
Lien : https://leslivresdejoelle.bl..
" Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ? - " Celui qui survit, c'est pour raconter quelle histoire ?"
Le texte s'ouvre le 1er mars 2005 par le suicide par pendaison de Jérôme, le frère du narrateur Thésée. Leurs parents mourront eux-mêmes peu après. Moins d’un an plus tard après le suicide de Jérôme, leur mère est retrouvée dans un bus, " endormie pour l’éternité ", victime d'une rupture d’anévrisme, le jour de l'anniversaire de Jérôme et quatre ans plus tard, leur père meurt d’un cancer.
Le frère survivant, Thésée, quitte Paris, la ville de l'Ouest, avec plusieurs cartons d'archives familiales qu'il n'a jamais ouverts, il part vers une ville de l'Est, Berlin qui n'est jamais nommée. Il fuit pour oublier, il quitte sa ville, son pays et sa langue avec ses trois enfants, en colère contre ses morts, assailli de la culpabilité du survivant. Il veut se libérer de sa famille, échapper à la malédiction familiale, rompre la "lignée des hommes qui meurent".
Mais cette fuite ne résout rien. Treize ans après la mort de Jérôme, Thésée tombe, son corps ne le porte plus, les médecins ne comprennent pas et ne peuvent pas le soulager. Il comprend qu'il porte un poids trop lourd pour lui, "la charge du survivant". Il comprend qu'il doit résoudre l'énigme de ses morts, aller à la rencontre des fantômes qui vivent en lui, s'opposer à la loi familiale, le commandement familial qui impose de " ne pas ouvrir les fenêtres du temps" depuis la mort de son arrière-grand père dont il découvrira l'histoire dans ses archives. Il doit entreprendre le "voyage dans les strates du temps" . Il sent " dans l’effondrement de ses os, de ses reins, de ses dents, qu’il est ça : un frère attaché au frère, relié à une histoire de la peine et de la perte".
Dès lors, grâce aux archives familiales qu'il a emportées, il n'a de cesse de répondre à ces questions qui ne le lâchent pas, qui reviennent comme un leitmotiv dans le texte : " Qui commet le meurtre d'un homme qui se tue ? - " Celui qui survit, c'est pour raconter quelle histoire ?" Dans les cartons il trouve des photos, le vieux manuscrit d'un ancêtre, des lettres de guerre d'un autre ancêtre... le passé lui révèle ce que la légende familiale a pris soin de cacher : " En déverser le contenu sur le sol, c’est accueillir la mémoire, le passé, et aussi transgresser la loi d’une lignée qui n’eut de cesse de vouloir cacher, cacher tout ce qui tremble, mais "on ne rouvre pas les fenêtres du temps" te souviens-tu, Jérôme ?"
"Thésée, sa vie nouvelle" n’est pas une autobiographie, ni un récit d’autofiction, c'est un texte qui, selon les propres termes de l'auteur, mêle fiction et enquête généalogique. Camille de Toledo parle de lui à la troisième personne, il se nomme " le frère qui reste, Thésée " et intervient de façon occasionnelle à la première personne mais c'est bien sa propre histoire familiale qu'il tente de remonter dans ce texte avec une mise à distance que l'on retrouve tout au long du récit.
La forme adoptée par Camille de Toledo pour la quête qu'engage Thésée dans le labyrinthe de ses souvenirs est remarquable. Dans son récit qui allie prière, confession, répétitions incantatoires, dialogue avec les morts il insère des documents, les fragments d'un manuscrit, des lettres de guerre, des photos des visages de ses morts en plan serré mais aussi des phrases répétitives en italique détachées dans le texte comme des poèmes.
Il aborde la question des synchronies, ces dates qui entrent en résonance de façon troublante, comme celle de la mort de la mère le jour de l'anniversaire du fils suicidé, comme celle de la rédaction du manuscrit de l'ancêtre à la date où Jérôme a mis fin à ses jours. Il aborde ce qui se noue dans une famille après le suicide d'un ancêtre, dans une famille soumise à la loi du silence, embarquée dans l'obsession de la Croissance à l'époque des Trente Glorieuses, soumise à la comédie de la force et de la réussite. Pour mieux trouver un sens à son histoire il fait se côtoyer quatre générations et leurs peurs retrouvant en chemin les racines du judaïsme errant de ses ancêtres.
La beauté de la langue, la force des questionnements de Camille de Toledo font de ce roman une pépite. Un texte bouleversant, certes un peu exigeant, qui hantera longtemps le lecteur après l'avoir refermé. Un texte qui fait parfois écho au sublime "Saturne" de Sarah Chiche.
Lien : https://leslivresdejoelle.bl..
Les parents et le frère de l'auteur sont décédés, ne laissant à l'être que le souvenir pour se donner une identité et tenter de poursuivre la création de soi-même, trouver un sens pour légitimer la transmission, devenir soi-même créateur, procréateur. Les vies potentielles sont une aide, un support, une structure à laquelle raccrocher des morceaux de soi qui demandent à s'assembler.
Les images contribuent à créer une ambiance que je retiendrai sans doute davantage que l'histoire elle-même. C'est reposant d'avoir de temps en temps des histoires en images.
Encore un livre trouvé dans un passage des livres qui est arrivé à point pour moi. Est-ce pour cela que sa lecture m’a été tellement précieuse et révélatrice ? Une lecture en dehors des sentiers battus, une construction extrêmement singulière en spirales avec des voix qui se répondent , des questions auxquelles il n’existe pas de réponse, des pensées magiques peut-être, des souffrances qui se répètent en écho. Un livre magnifique dont la lecture poursuit le lecteur une fois achevée comme une lecture fondamentale.
Le grand-oncle est mort, l'arrière-grand-père s'est tiré une balle dans la tête, le frère s'est pendu, la mère est morte le jour de l'anniversaire du frère pendu, le père est mort d'un cancer trois ans plus tard et le "frère qui reste" se lamente pendant les 250 pages. Le tout, on le comprend assez vite, est autobiographique.
Ce livre est une longue plainte qui rondouillonne autour de ces drames familiaux, de cette "lignée d'hommes qui meurent", de leur judéité niée. La longue plainte d'un homme qui sombre, d'un corps qui lâche.
Autocentré et intello à souhait, un roman "à la française" comme je les aime tant. Le genre de romans qui vous redonne le moral dans ces temps de paix nationale, et me donnent l’impression d’avoir payé 20 balles la thérapie de l’auteur sans rien en tirer d’intéressant.
S'ajoute à cela un roman des plus faciles à lire: phrases alambiquées, pas de majuscules, la touche "point" en panne remplacée par la touche "point-virgule".
Non messieurs dames, la touche "point-virgule" n'est pas désuète! Elle est carrément "in". Et les majuscules, les guillemets, les points, c'est "has been". Les auteurs qui s'embarrassent de toute cette ponctuation sont d'un autre temps. De même que ceux qui s'emmerdent encore à faire des phrases sans les répéter dix-huit fois dans leur bouquin.
Anne Pauly, chez le même éditeur l'an dernier m'avait donné la pêche, sur un sujet pourtant très grave. Camille de Toledo vient de me faire vivre quelques heures de torture littéraire, ce qui pourtant ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'empathie pour lui. Je suis pleine de contradictions.
Lien : https://carpentersracontent...
Ce livre est une longue plainte qui rondouillonne autour de ces drames familiaux, de cette "lignée d'hommes qui meurent", de leur judéité niée. La longue plainte d'un homme qui sombre, d'un corps qui lâche.
Autocentré et intello à souhait, un roman "à la française" comme je les aime tant. Le genre de romans qui vous redonne le moral dans ces temps de paix nationale, et me donnent l’impression d’avoir payé 20 balles la thérapie de l’auteur sans rien en tirer d’intéressant.
S'ajoute à cela un roman des plus faciles à lire: phrases alambiquées, pas de majuscules, la touche "point" en panne remplacée par la touche "point-virgule".
Non messieurs dames, la touche "point-virgule" n'est pas désuète! Elle est carrément "in". Et les majuscules, les guillemets, les points, c'est "has been". Les auteurs qui s'embarrassent de toute cette ponctuation sont d'un autre temps. De même que ceux qui s'emmerdent encore à faire des phrases sans les répéter dix-huit fois dans leur bouquin.
Anne Pauly, chez le même éditeur l'an dernier m'avait donné la pêche, sur un sujet pourtant très grave. Camille de Toledo vient de me faire vivre quelques heures de torture littéraire, ce qui pourtant ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'empathie pour lui. Je suis pleine de contradictions.
Lien : https://carpentersracontent...
C'est le roman d'apprentissage d'un jeune homme intelligent et bien né qui s'interroge sur l'organisation du monde dans lequel il fait ses classes : et si tout ce que j'apprends n'était que du vent ? et si ma propre vérité ne se trouvait pas derrière les enseignements, les vérités assénées, les cadres et les règles inculqués ? Et si je devais vivre ma vie, la mienne...
De fait, ses interrogations mènent à une naissance, celle d'un pseudonyme, et un exil, celui de vivre dans le monde des mots pour vivre dans le vrai... où l'on remarque avec amusement que la critique formulée tout au long de l'ouvrage sur le mépris du corps dans la société dématérialisée trouve une issue immatérielle dans cette création d'un corps sémantique, désincarné...
Le tout est assez monocorde, mais c'est bien écrit, quelques idées sont amusantes ; sans doute la marque d'une époque : celle qui découvre que la "société du spectacle" en absorbant tout et son contraire et est à la fois libertaire et liberticide et que vouloir son renversement, c'est toujours se maintenir dans l'idée d'une société autoritaire... y a-t-il une alternative à la liberté ? la sienne, celle des autres, celle de soi contre les autres... et des autres contre soi ? y a-t-il d'autres choix que de vivre et de se construire, en absorbant dans son corps les contradictions du monde, interne comme externe ? l'échappatoire littéraire ne paraît n'être qu'une prise de distance momentanée du corps qui se refuse - qui se résoudra forcément dans une nouvelle incarnation, le cas échéant altérée. Naître en littérature pour commencer de vivre dans le monde, c'est le choix de l'auteur... c'est sans doute celui de tout le monde - se raconter des histoires pour échapper à l'écrasement contemporain, comprendre, et revenir sur terre pour y reprendre sa place, recommencer... un roman d'apprentissage en plein dans l'esprit du spectacle...
De fait, ses interrogations mènent à une naissance, celle d'un pseudonyme, et un exil, celui de vivre dans le monde des mots pour vivre dans le vrai... où l'on remarque avec amusement que la critique formulée tout au long de l'ouvrage sur le mépris du corps dans la société dématérialisée trouve une issue immatérielle dans cette création d'un corps sémantique, désincarné...
Le tout est assez monocorde, mais c'est bien écrit, quelques idées sont amusantes ; sans doute la marque d'une époque : celle qui découvre que la "société du spectacle" en absorbant tout et son contraire et est à la fois libertaire et liberticide et que vouloir son renversement, c'est toujours se maintenir dans l'idée d'une société autoritaire... y a-t-il une alternative à la liberté ? la sienne, celle des autres, celle de soi contre les autres... et des autres contre soi ? y a-t-il d'autres choix que de vivre et de se construire, en absorbant dans son corps les contradictions du monde, interne comme externe ? l'échappatoire littéraire ne paraît n'être qu'une prise de distance momentanée du corps qui se refuse - qui se résoudra forcément dans une nouvelle incarnation, le cas échéant altérée. Naître en littérature pour commencer de vivre dans le monde, c'est le choix de l'auteur... c'est sans doute celui de tout le monde - se raconter des histoires pour échapper à l'écrasement contemporain, comprendre, et revenir sur terre pour y reprendre sa place, recommencer... un roman d'apprentissage en plein dans l'esprit du spectacle...
Au coeur de L''inquiétude face au monde l'inquiétude et le monde se tutoient. Camille de Toledo observe le siècle qui s'achève dans le vertige et ouvre la voie à un 21ème siècle tout aussi inquiétant. Pour scander le mal-être dominant de ce siècle, il choisit de s’exprimer à travers une prose poétique qui épouse au plus près l'inquiétude lancinante des êtres perdus dans un monde recelant quantité de dangers potentiels, qu'il s'agisse de la perte d'un enfant, ou de la folie de ce même enfant capable de massacrer ses camarades comme à Columbine en 1999 ou à Utoya en 2011.
« Qui prépare les enfants à ce temps nucléaire ?
Pour eux, c’est le soupçon qui triomphe.
Ou le romantisme malade de la refondation :
Voyez encore !
Columbine !
Utoya.
(…)
Les gamins savent intuitivement,
Comme des dieux, que l’enseignement
De leurs écoles est inadapté.
Vieille herméneutique du savoir.
Vieilles catégories de l’être.
Penser, classer, écrivait Pérec.
Et comme il a raison.
La pensée occidentale est une névrose d’enfant
à qui l’on répète :
Allez ! Range ta chambre ! » (p.47)
L'inquiétude ronge les êtres et le monde qui ne peuvent trouver d'échappatoire face à ce naufrage progressif. Née des horreurs du 20ème siècle, de la guerre, de la déportation, des politiques démagogiques pernicieuses, cette inquiétude est sans fond car ancrée profondément en l'homme du 21ème siècle.
« Il y eut un autre mot pour le vingtième siècle.
Ce fut la dé-mesure. Dé-liaison,
Dé-litement, dé-lit de l’esprit, qui,
Croyait-on avant, gouvernait la flèche du temps,
Ou peut-être aussi, dé-règlement de la mesure,
Emballement de la raison
Qui, après avoir classé les peuples,
Entre sauvages et civilisés, noirs et blancs,
S’est mis à diviser, couper, entre le soi et le presque soi.
Le dé du déluge, de la démence, le dé du hasard
Et de la fin, s’insinua dans le pli de chaque chose,
Comme l’accident et la catastrophe. » (p. 24)
« C’est l’inquiétude et la peur qui nous livrent à la pharmacie, aux pouvoirs, à tous ceux qui prétendent nous en libérer. C’est l’inquiétude et la peur qui nous poussent à déléguer la charge de l’homme aux prêtres, aux moralistes, aux dogmes et aux milices. (…) Par peur, s’en remettre au commerce de la consolation. C'est-à-dire à l’intoxication : nous voulons être délivrés du risque, du mal, de la pluie qui tombe en été. Nous voulons être délivrés de la peur, de la mort, et finalement, de la vie.» (p. 30)
Que reste-t-il comme espoir au poète si ce n'est celui de charmer ou d'enivrer les Dieux par son chant, tel Orphée devant Hadès. Espoir de « de voir les mots agir sur et dévier l’esprit contemporain de l’Europe ».
Lien : http://lecturissime.over-blo..
« Qui prépare les enfants à ce temps nucléaire ?
Pour eux, c’est le soupçon qui triomphe.
Ou le romantisme malade de la refondation :
Voyez encore !
Columbine !
Utoya.
(…)
Les gamins savent intuitivement,
Comme des dieux, que l’enseignement
De leurs écoles est inadapté.
Vieille herméneutique du savoir.
Vieilles catégories de l’être.
Penser, classer, écrivait Pérec.
Et comme il a raison.
La pensée occidentale est une névrose d’enfant
à qui l’on répète :
Allez ! Range ta chambre ! » (p.47)
L'inquiétude ronge les êtres et le monde qui ne peuvent trouver d'échappatoire face à ce naufrage progressif. Née des horreurs du 20ème siècle, de la guerre, de la déportation, des politiques démagogiques pernicieuses, cette inquiétude est sans fond car ancrée profondément en l'homme du 21ème siècle.
« Il y eut un autre mot pour le vingtième siècle.
Ce fut la dé-mesure. Dé-liaison,
Dé-litement, dé-lit de l’esprit, qui,
Croyait-on avant, gouvernait la flèche du temps,
Ou peut-être aussi, dé-règlement de la mesure,
Emballement de la raison
Qui, après avoir classé les peuples,
Entre sauvages et civilisés, noirs et blancs,
S’est mis à diviser, couper, entre le soi et le presque soi.
Le dé du déluge, de la démence, le dé du hasard
Et de la fin, s’insinua dans le pli de chaque chose,
Comme l’accident et la catastrophe. » (p. 24)
« C’est l’inquiétude et la peur qui nous livrent à la pharmacie, aux pouvoirs, à tous ceux qui prétendent nous en libérer. C’est l’inquiétude et la peur qui nous poussent à déléguer la charge de l’homme aux prêtres, aux moralistes, aux dogmes et aux milices. (…) Par peur, s’en remettre au commerce de la consolation. C'est-à-dire à l’intoxication : nous voulons être délivrés du risque, du mal, de la pluie qui tombe en été. Nous voulons être délivrés de la peur, de la mort, et finalement, de la vie.» (p. 30)
Que reste-t-il comme espoir au poète si ce n'est celui de charmer ou d'enivrer les Dieux par son chant, tel Orphée devant Hadès. Espoir de « de voir les mots agir sur et dévier l’esprit contemporain de l’Europe ».
Lien : http://lecturissime.over-blo..
Le titre du roman graphique reprend le nom d’un journaliste et écrivain austro-hongrois Theodor Herzl, (1860-1904), fondateur du mouvement sioniste et du Fonds pour l’implantation juive pour l'achat de terres en Palestine à l’empire ottoman. Il a été l'un des premiers à mettre en place l'idée d'un État autonome juif.
Ce livre est le testament d’un Juif « sans terre », chassé de Russie par les pogroms, Ilia Brodsky, qui dans les années vingt et trente du xx e siècle rencontre dans l’un des premiers studios photographiques de Vienne le dénommé Herzl.
La vie des deux personnages est mixée, Ilia est le narrateur et nous suivons sa fuite de la Russie en 1882, son parcours à travers l’Europe et sa brève rencontre avec Herzl qui à l’époque n’est qu’un dandy nanti.
Quand les ambitions de Herzl prennent formes, la narration de son histoire fait se dissoudre la vie d’Ilia qui n’apparaît plus alors que comme faire parler de son mentor.
Ce qui est passionnant au delà de ce que ce roman graphique nous montre de ces deux existences c’est le tableau saisissant de l’Europe entre 1880 et 1930 approximativement, les courants politiques qui le traversent, la construction des sociétés juives et socialistes qui croyaient à la transformation sociale par l’Histoire, les interrogations des intellectuels sur le monde qu’ils souhaitent construire, la montée des nationalismes et de l’antisémitisme,
Le dessin d’Alexander Pavlenko est remarquable, il nous emmène tout au long du roman dans la description d’un rêve qui aurait pu émerger à la charnière du XIX et du XXe siècle, un rêve qui allait s’effondrer dans les flammes de l’Europe.
Comme le signale Camille de Toledo, il y a un livre « à l’intérieur du livre, c’est une histoire subalterne de l’Europe, du point de vue du migrant, de l’exilé, celui qui est à côté des nations. Ilia Brodsky est le double, en miroir, de Herzl le bourgeois assimilé, qui s’est intégré dans la société viennoise ».
J’ai lu quelque part qu’il envisage d’écrire un livre sur l’histoire du Bund (1), c’est une excellente idée et je ne manquerai pas de le rechercher quand il sortira !
(1)
L’Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, plus connue comme le Bund, est un mouvement socialiste juif créé au Congrès de Vilnius en septembre 1897 et s'est dissout en Pologne le 16 janvier 1949 au congrès de Wroclaw. C’est le premier parti politique juif socialiste et laïc destiné à représenter la minorité juive de l’empire russe.
Militant pour l’émancipation des travailleurs juifs dans le cadre d’un combat plus général pour le socialisme, il prône le droit des Juifs à constituer une nationalité laïque de langue yiddish. Son concept d'autonomie culturelle s’oppose donc tant au sionisme qu’au bolchévisme dont les bundistes critiquent les tendances centralisatrices. Ce parti est également profondément antireligieux et considère les rabbins comme des représentants de l’arriération. Le mouvement perd la plupart de ses adhérents et de son influence avec la Shoah.
Ce livre est le testament d’un Juif « sans terre », chassé de Russie par les pogroms, Ilia Brodsky, qui dans les années vingt et trente du xx e siècle rencontre dans l’un des premiers studios photographiques de Vienne le dénommé Herzl.
La vie des deux personnages est mixée, Ilia est le narrateur et nous suivons sa fuite de la Russie en 1882, son parcours à travers l’Europe et sa brève rencontre avec Herzl qui à l’époque n’est qu’un dandy nanti.
Quand les ambitions de Herzl prennent formes, la narration de son histoire fait se dissoudre la vie d’Ilia qui n’apparaît plus alors que comme faire parler de son mentor.
Ce qui est passionnant au delà de ce que ce roman graphique nous montre de ces deux existences c’est le tableau saisissant de l’Europe entre 1880 et 1930 approximativement, les courants politiques qui le traversent, la construction des sociétés juives et socialistes qui croyaient à la transformation sociale par l’Histoire, les interrogations des intellectuels sur le monde qu’ils souhaitent construire, la montée des nationalismes et de l’antisémitisme,
Le dessin d’Alexander Pavlenko est remarquable, il nous emmène tout au long du roman dans la description d’un rêve qui aurait pu émerger à la charnière du XIX et du XXe siècle, un rêve qui allait s’effondrer dans les flammes de l’Europe.
Comme le signale Camille de Toledo, il y a un livre « à l’intérieur du livre, c’est une histoire subalterne de l’Europe, du point de vue du migrant, de l’exilé, celui qui est à côté des nations. Ilia Brodsky est le double, en miroir, de Herzl le bourgeois assimilé, qui s’est intégré dans la société viennoise ».
J’ai lu quelque part qu’il envisage d’écrire un livre sur l’histoire du Bund (1), c’est une excellente idée et je ne manquerai pas de le rechercher quand il sortira !
(1)
L’Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de Russie, plus connue comme le Bund, est un mouvement socialiste juif créé au Congrès de Vilnius en septembre 1897 et s'est dissout en Pologne le 16 janvier 1949 au congrès de Wroclaw. C’est le premier parti politique juif socialiste et laïc destiné à représenter la minorité juive de l’empire russe.
Militant pour l’émancipation des travailleurs juifs dans le cadre d’un combat plus général pour le socialisme, il prône le droit des Juifs à constituer une nationalité laïque de langue yiddish. Son concept d'autonomie culturelle s’oppose donc tant au sionisme qu’au bolchévisme dont les bundistes critiquent les tendances centralisatrices. Ce parti est également profondément antireligieux et considère les rabbins comme des représentants de l’arriération. Le mouvement perd la plupart de ses adhérents et de son influence avec la Shoah.
Cette histoire n'aura pas créer chez moi le vertige annoncé. La distance suscité par l'adresse pénible au lecteur ("tu vois", "tu sais", "si tu veux bien" à tous les carrefours. Avec même un ton qui se veut amical "je te résume" ou "va voir si tu en as le temps" et qui frôle le surplomb et même la condescendance) a sans doute beaucoup joué. Mais surtout, je trouve que le fond de l'affaire est confus et souvent verbeux. le hiatus entre le langage et ce que l'auteur appelle joliment "la vie nue" n'est pas nouveau. De nombreux poètes en ont parlé de cet arbitraire du signe et de ces "encodages" dont il faudrait se dégager pour trouver la présence (selon la terminologie de Bonnefoy par ex). Ces "habitations narratives" (autre gimmick qui revient sans cesse) auraient mérité d'être plus précisément explorées, plus posément discutées, plus précises aussi (à titre d'exemple, il postule que le "narrateur de Danube [Magris] va vers la source"- p.68 alors que le mouvement du texte va de la source à l'embouchure). Je trouve que Camille de Toledo se pose un peu en poète-penseur avec des phrases qui sonnent bien mais assez creux selon moi. Ce n'est ni Jean-Christophe Bailly, ni Baptiste Morizot. Et si sa "vision inconsolable de notre condition narrative"(p.100) suscite par instants de l'intérêt et des réflexions justes, l'ensemble aurait gagné à chercher un ton plus modeste, plus murmuré, plus "tremblé" justement. Faute de quoi, et malgré dessins et schémas "conceptuels" (qui relèvent paradoxalement d'un encodage didactique voire autoritaire, une grille de lecture presque rigide et dogmatique), j'ai trouvé les analyses ou les allusions à Glissant, Faulkner, Pessoa ou Sebald assez convenues et superficielles. Dommage. Mais cela reste une déception intéressante et quelquefois féconde.
Ce roman graphique s'attache au personnage d'Isaac Babel et raconte son arrestation et sa détention en 1939. Il est composé de 5 "livres" :
I. -Moscou 1939 : arrestation de Babel,
II. -Odessa 1913-1921 : Ce que Babel a vu avant pendant et après la Révolution : l'histoire du brigand Bénia
III. -Moscou 26 janvier 1940 : "ce que Babel avait deviné en imaginant le destin du brigand Bénia Krik
IV. -Washington 17 mai 1995 : ce qu'il advint de la dernière lettre de Babel
V. - Moscou 1939 -1940 : ce que contenait la lettre que Babel écrivit dans sa cellule de la Loubianka
Les deux livres qui se déroulent à la Loubianka sont composés de manière saisissante : les vignettes en noir et blanc (même pas de gris comme on s'y attend dans le N&B ) avec des pointes acérées et une rare violence, tandis que Bénia représenté en couleur (rouge pour son sang) est cerné par cette brutalité, comme écrasé par les bottes qui empiètent la vignette centrale.
Le livre II est d'un graphisme plus classique. Bande dessinée en couleur, bulles blanches contenant les paroles (rares) et les chansons que fredonnent les personnages. C'est l'histoire de Bénia, le Roi des brigands juifs, qui détrousse les riches (juifs ou goys) pour redistribuer les richesses aux miséreux. Ce communisme rudimentaire (extorsions) rencontre la Révolution et se joint à l'armée rouge. la fin sera tragique.
Babel a raconté cette histoire dans les Contes d'Odessa et il en tiré un scénario pour Eisenstein finalement un autre cinéaste tournera le film.
Le livre V n'est pas dessiné, c'est le texte de la lettre de Babel à sa fille, encadré encore par les zigzags noir et blanc de la Loubianka.
Un abondant corpus de notes, chronologie, bibliographie et histoire de Mémorial complète le volume passionnant.
Depuis longtemps je tourne autour de Babel, l'écrivain, et d'Odessa aux temps de la Révolution . Les Aventures extraordinaires d'un Juif Révolutionnaire de Alexandre Thabor, Odessa Transfer, La Route du Danube de Ruben, Aux Frontières de l'Europe de Rumiz, et tant d'autres m'y ont conduite. Cependant, je reste un peu sur ma faim quant à l'auteur et son œuvre. J'ai donc téléchargé Cavalerie rouge et je vais chercher les Contes d'Odessa
Lien : https://netsdevoyages.car.bl..
I. -Moscou 1939 : arrestation de Babel,
II. -Odessa 1913-1921 : Ce que Babel a vu avant pendant et après la Révolution : l'histoire du brigand Bénia
III. -Moscou 26 janvier 1940 : "ce que Babel avait deviné en imaginant le destin du brigand Bénia Krik
IV. -Washington 17 mai 1995 : ce qu'il advint de la dernière lettre de Babel
V. - Moscou 1939 -1940 : ce que contenait la lettre que Babel écrivit dans sa cellule de la Loubianka
Les deux livres qui se déroulent à la Loubianka sont composés de manière saisissante : les vignettes en noir et blanc (même pas de gris comme on s'y attend dans le N&B ) avec des pointes acérées et une rare violence, tandis que Bénia représenté en couleur (rouge pour son sang) est cerné par cette brutalité, comme écrasé par les bottes qui empiètent la vignette centrale.
Le livre II est d'un graphisme plus classique. Bande dessinée en couleur, bulles blanches contenant les paroles (rares) et les chansons que fredonnent les personnages. C'est l'histoire de Bénia, le Roi des brigands juifs, qui détrousse les riches (juifs ou goys) pour redistribuer les richesses aux miséreux. Ce communisme rudimentaire (extorsions) rencontre la Révolution et se joint à l'armée rouge. la fin sera tragique.
Babel a raconté cette histoire dans les Contes d'Odessa et il en tiré un scénario pour Eisenstein finalement un autre cinéaste tournera le film.
Le livre V n'est pas dessiné, c'est le texte de la lettre de Babel à sa fille, encadré encore par les zigzags noir et blanc de la Loubianka.
Un abondant corpus de notes, chronologie, bibliographie et histoire de Mémorial complète le volume passionnant.
Depuis longtemps je tourne autour de Babel, l'écrivain, et d'Odessa aux temps de la Révolution . Les Aventures extraordinaires d'un Juif Révolutionnaire de Alexandre Thabor, Odessa Transfer, La Route du Danube de Ruben, Aux Frontières de l'Europe de Rumiz, et tant d'autres m'y ont conduite. Cependant, je reste un peu sur ma faim quant à l'auteur et son œuvre. J'ai donc téléchargé Cavalerie rouge et je vais chercher les Contes d'Odessa
Lien : https://netsdevoyages.car.bl..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Camille de Toledo
Quiz
Voir plus
Démasqué ! 🎭
"Le Masque de la mort rouge" est le titre d'une nouvelle écrite par ...
Oscar Wilde
William Irish
Edgar Poe
12 questions
32 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature française
, critique littéraire
, théâtre
, littérature étrangère
, carnaval
, culture littéraireCréer un quiz sur cet auteur32 lecteurs ont répondu