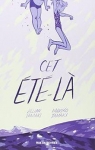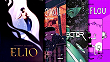Critiques de Mariko Tamaki (222)
La perception de deux filles entrant dans l'adolescence, leur vie pendant un été, la découverte des films d'horreur, de la sexualité des autres, des problèmes parentaux.
Si j'ai apprécié Windy, je n'ai pas vraiment aimé Rose. Je crois que le jugement qu'elle porte sur son entourage m'a un peu refroidi. Elle reste une ado à qui les choses importantes ne sont pas dites, elle ne peut pas les deviner mais interprète les choses à sa manière.
J'ai aimé la relation qu'à Windy avec sa mère et sa grand mère, je l'ai trouvée touchante et drôle.
Les graphismes sont très sympa mais les histoires secondaires étaient plus intéressantes finalement.
Si j'ai apprécié Windy, je n'ai pas vraiment aimé Rose. Je crois que le jugement qu'elle porte sur son entourage m'a un peu refroidi. Elle reste une ado à qui les choses importantes ne sont pas dites, elle ne peut pas les deviner mais interprète les choses à sa manière.
J'ai aimé la relation qu'à Windy avec sa mère et sa grand mère, je l'ai trouvée touchante et drôle.
Les graphismes sont très sympa mais les histoires secondaires étaient plus intéressantes finalement.
Un roman graphique contemplatif sur l'adolescence et les problématiques qui l'accompagnent.
Deux amies se retrouvent chaque été au même endroit, mais cet été là, la période de l'adolescence est arrivée et la fin de l'innocence avec elle.
C'est avec un autre regard que les deux jeunes filles sont confrontées à mille petits détails de leur vie qui les bouleverses (parentalité, désir d'enfant, grossesse non désirée, fuite en avant, non-dits, séduction, sexualité... ).
J'ai trouvé l'approche de l'auteur douce et poétique, le ton était juste et l'histoire touchante. Une très belle BD sur l'adolescence, le temps qui passe et ces étés que l'on oubli pas.
Deux amies se retrouvent chaque été au même endroit, mais cet été là, la période de l'adolescence est arrivée et la fin de l'innocence avec elle.
C'est avec un autre regard que les deux jeunes filles sont confrontées à mille petits détails de leur vie qui les bouleverses (parentalité, désir d'enfant, grossesse non désirée, fuite en avant, non-dits, séduction, sexualité... ).
J'ai trouvé l'approche de l'auteur douce et poétique, le ton était juste et l'histoire touchante. Une très belle BD sur l'adolescence, le temps qui passe et ces étés que l'on oubli pas.
Ce tome contient une histoire complète indépendante de toute autre. La première édition date de 2008, le premier chapitre de 30 pages ayant été publié en 2005. Il a été réalisé par Mariko Tamaki pour le scénario et sa sœur Jillian Tamaki pour les dessins et l'encrage. Il s'agit d'une bande dessinée en noir & blanc avec des nuances de gris.
Aujourd'hui Lisa a déclaré : tout le monde pense être unique Ce n'est pas unique ! Elle s'appelle Kimberly Keiko Cameron, surnommée Skim, et sa meilleure amie est Lisa Shore. Son chat s'appelle Sumo. Ses centres d'intérêt : le Wicca, les tarots, l'astrologie et la philosophie. Sa couleur favorite : le noir, ou non, plutôt le rouge à la réflexion. La scène se déroule en 1993. La veille au soir, Skim a essayé de prendre en photo, son plâtre au bras droit, mais elle était trop maladroite de la main gauche pour obtenir une photographie nette. Lisa la rejoint dans l'espace vert à proximité du lycée. Elle lui demande comment elle s'est cassé le bras : Skim lui répond qu'elle a fait une chute à vélo. En fait, elle est tombée en sortant de son lit et en trébuchant sur l'autel dans sa chambre, cassant le candélabre de sa mère. D'ailleurs, tant qu'à faire, elle aurait préféré chuter sur une bouteille de bière et avoir des points de suture plutôt que ce plâtre tout blanc. Lisa écrit un mot sur le plâtre de son amie. Celle-ci repense à sa mère mécontente pour son candélabre, puis à son père et ses deux attaques cardiaques de l'année passée, au fait qu'ils soient divorcés. Son père est une crème et sa mère est une femme froide et cynique.
Autre nouvelle sans rapport que Skim confie à son journal intime : John Reddear a laissé tomber sa copine Katie Matthews : du coup elle a le cœur brisé, et en a dessiné un sur chacune de ses mains, celui de la main gauche est le plus réussi car elle a pu le dessiner avec la main droite. Lisa la tient en piètre estime : elle n'a pas à se conduire comme si c'était la fin du monde, tout ça parce qu'elle s'est fait larguer. Madame Archer, la professeure d'art dramatique a dit à une de ses collègues que Katie se conduit comme ça parce qu'elle n'est qu'un récipient vide, attendant d'être remplie. Pour elle, ça veut dire qu'elle n'est qu'une traînée. Madame Archer enseigne le théâtre et la littérature anglaise, et elle est vraiment excentrique. Elle est très maigre, avec une chevelure rousse indisciplinée, toujours en train de manger et de sortir des trucs bizarres comme le fait que le chocolat, c'est mieux que le sexe. Une fois, elle a indiqué à Skim qu'elle a des yeux de diseuse de bonne aventure. Lisa a traduit ça par le fait que sa copine met trop de l'eyeliner. Dans sa chambre, Skim a dressé un autel avec une statuette de la déesse, un candélabre cassé, des brins de lavande, des bougies, des cristaux, des tarots, un linge pour les manipuler, un livre des sorts. Plusieurs éléments lui font encore défaut : une statuette de dieu, un bol de sel, une baguette, un chaudron, un couteau magique, et peut-être plus d'herbes aromatiques.
Les sœurs Tamaki ont connu le succès avec l'extraordinaire This One Summer en 2014. Le présent ouvrage est donc leur première bande dessinée ensemble, une dizaine d'années auparavant. Comme l'indique le titre, le récit se focalise sur Skim, une adolescente au collège, étant pratiquement de tous les plans. Le récit est raconté à la fois au travers de très brefs extraits de son journal intime, de ses interactions avec les autres personnes de sa classe, surtout avec sa copine Lisa, et de ses activités quotidiennes. Elle fait preuve d'une forme de cynisme assez critique envers les autres, bien entretenu par sa copine Lisa avec qui elle est sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de fibre d'auto-apitoiement, ni de fascination morbide explicite. Mais la nature critique de Skim apporte une forme de détachement émotionnel, de maturité inattendue chez une demoiselle de son âge. Le lecteur suit sa vie quotidienne, à l'évidence des morceaux choisis plutôt qu'un reportage minute par minute, avec un accès à son flux de pensée. Bien évidemment, il se produit des événements tout du long de ces 140 pages. Le lecteur peut donc assister à des moments banals : les discussions entre élèves dans les couloirs du lycée, des discussions avec des adultes, un repas avec son père et sa nouvelle conjointe, une soirée déguisée, un cours de biologie, une première rencontre avec deux garçons qui doivent les accompagner à un bal de charité, des disputes entre copines, etc. Le lecteur peut déceler dans les dessins, l'influence discrète de quelques aspects visuels des shojos, sans que cela ne donne l'impression d'imports artificiels. En fait les dessins ne sont pas marqués d'un parti pris féminin : ils restent dans un registre descriptif, avec des contours parfois un peu lâches.
L'artiste sait emmener le lecteur dans le monde de Skim, de la manière dont elle le perçoit. Cela ne veut pas dire que la narration est exclusivement en vue subjective : ça se produit de temps à autre, mais Skim est plus souvent présente dans la case que le lecteur ne voit ce qui l'entoure par ses yeux. Jillian Tamaki impressionne le lecteur par le naturel des postures et des mouvements des personnages, qu'il s'agisse des jeunes filles ou des adultes, et par sa capacité à concevoir des plans de prise de vue qui rendent visuellement intéressant les moments de dialogue, sans effet d'enfilade de cases avec uniquement des têtes en train de parler. Les personnages peuvent être en mouvement, en train de se déplacer, ou statiques tout en continuant leur occupation banale. Les cases montrent les décors, ainsi que les différents accessoires ou meubles présents dans le cadre, apportant des indications sur la personnalité du propriétaire ou de l'occupant des lieux. Cela va de la décoration de l'autel Wicca dans la chambre de Skim, aux couloirs fonctionnels et sans âme du lycée. De page en page, le lecteur se rend compte qu'il regarde avec intérêt des éléments aussi communs que la jupe de madame Archer, les bougies sur l'autel de la chambre, un fût métallique utilisé comme brasero, la bague en toc en forme de tête de mort de Lisa, le passage de l'aspirateur dans le salon, la forme du canapé de madame Archer, les restes dans l'assiette de Skim, les déguisements de ballerine, la tenue du sport du lycée, etc. Il se retrouve surpris de s'intéresser à ces éléments anodins et banals auxquels il ne prête plus attention dans sa propre vie.
Cela n'a rien d'évident de capter l'attention d'un lecteur et de la conserver pendant une telle pagination, avec les petits riens de la vie de tous les jours. Effectivement, la scénariste intègre quelques événements moins communs comme un bras cassé (plusieurs en fait) ou un suicide, mais en les ramenant dans la vie quotidienne, sans dramatisation. Évidemment, la sensibilité de Kimberly et de Lisa est plus importante que celle d'un adulte, mais sans être surjouée ou à fleur de peau. En fait, Kimberly est une adolescente très posée, capable de recul, prompte à porter des jugements de valeur, mais ne s'emportant jamais, restant calme, tolérante, et portée à l'introspection, sans tendance dépressive ou suicidaire. Le lecteur accompagne donc bien volontiers cette demoiselle dans sa vie quotidienne, sans ressentir d'ennui. Le lecteur fait donc l'expérience de ce quotidien par l'entremise des observations de Skim : sa remarque sur son père, sa remarque sur la séparation de Katie et John, ses observations sur l'allure de madame Archer, la participation à la réunion d'une étrange assemblée de sorcières, etc. Il note que les observations de Kimberly sont souvent complétées par ce que Lisa ou une autre personne lui a dit sur le sujet.
Le lecteur ressent les émotions de Kimberly qui semblent comme émoussées, pour autant elle fait preuve d'empathie pour ses amies. Petit à petit, le lecteur ressent ce qui génère cet état de conscience chez Kimberly. Ce n'est pas explicité avec des gros sabots dans son journal comme si elle s'auto-analysait. Ce n'est pas dit à haute voix par sa copine ou par d'autres camarades de classe. Le lecteur le perçoit dans son comportement, dans ses affinités électives qui se produisent tout naturellement. Alors que son comportement ne se conforme pas aux principes moraux classiques, cela n'a rien de choquant au point que le lecteur doive prendre un peu de recul pour mesurer le degré de transgression de ce qui vient de se passer de manière si naturelle sous yeux, sans jugement de la part des autrices. Ce n'est ni du laisser-faire, ni du dévergondage. En fonction de sa propre sensibilité, de ses propres convictions, il réagit de manière plus ou moins vive. Il effectue une projection de ses propres valeurs pour interpréter cet élan du cœur, libre de penser ce qu'il veut, la narration le guidant vers une absence de condamnation morale, plutôt vers une empathie compréhensive. Finalement, il s'agit d'une étape essentielle dans le développement de Kimberly, sans être traumatique ou scandaleuse.
Une œuvre de jeunesse : oui, mais pas une œuvre relevant de l'ébauche. Les sœurs Tamaki évoquent le quotidien d'une jeune adolescente dans la banlieue de Toronto, avec un tact et un naturel étonnants, réussissant à conserver l'attention du lecteur tout du long des jours qui passent, avec délicatesse, justesse et une forme de pudeur incitant au respect.
Aujourd'hui Lisa a déclaré : tout le monde pense être unique Ce n'est pas unique ! Elle s'appelle Kimberly Keiko Cameron, surnommée Skim, et sa meilleure amie est Lisa Shore. Son chat s'appelle Sumo. Ses centres d'intérêt : le Wicca, les tarots, l'astrologie et la philosophie. Sa couleur favorite : le noir, ou non, plutôt le rouge à la réflexion. La scène se déroule en 1993. La veille au soir, Skim a essayé de prendre en photo, son plâtre au bras droit, mais elle était trop maladroite de la main gauche pour obtenir une photographie nette. Lisa la rejoint dans l'espace vert à proximité du lycée. Elle lui demande comment elle s'est cassé le bras : Skim lui répond qu'elle a fait une chute à vélo. En fait, elle est tombée en sortant de son lit et en trébuchant sur l'autel dans sa chambre, cassant le candélabre de sa mère. D'ailleurs, tant qu'à faire, elle aurait préféré chuter sur une bouteille de bière et avoir des points de suture plutôt que ce plâtre tout blanc. Lisa écrit un mot sur le plâtre de son amie. Celle-ci repense à sa mère mécontente pour son candélabre, puis à son père et ses deux attaques cardiaques de l'année passée, au fait qu'ils soient divorcés. Son père est une crème et sa mère est une femme froide et cynique.
Autre nouvelle sans rapport que Skim confie à son journal intime : John Reddear a laissé tomber sa copine Katie Matthews : du coup elle a le cœur brisé, et en a dessiné un sur chacune de ses mains, celui de la main gauche est le plus réussi car elle a pu le dessiner avec la main droite. Lisa la tient en piètre estime : elle n'a pas à se conduire comme si c'était la fin du monde, tout ça parce qu'elle s'est fait larguer. Madame Archer, la professeure d'art dramatique a dit à une de ses collègues que Katie se conduit comme ça parce qu'elle n'est qu'un récipient vide, attendant d'être remplie. Pour elle, ça veut dire qu'elle n'est qu'une traînée. Madame Archer enseigne le théâtre et la littérature anglaise, et elle est vraiment excentrique. Elle est très maigre, avec une chevelure rousse indisciplinée, toujours en train de manger et de sortir des trucs bizarres comme le fait que le chocolat, c'est mieux que le sexe. Une fois, elle a indiqué à Skim qu'elle a des yeux de diseuse de bonne aventure. Lisa a traduit ça par le fait que sa copine met trop de l'eyeliner. Dans sa chambre, Skim a dressé un autel avec une statuette de la déesse, un candélabre cassé, des brins de lavande, des bougies, des cristaux, des tarots, un linge pour les manipuler, un livre des sorts. Plusieurs éléments lui font encore défaut : une statuette de dieu, un bol de sel, une baguette, un chaudron, un couteau magique, et peut-être plus d'herbes aromatiques.
Les sœurs Tamaki ont connu le succès avec l'extraordinaire This One Summer en 2014. Le présent ouvrage est donc leur première bande dessinée ensemble, une dizaine d'années auparavant. Comme l'indique le titre, le récit se focalise sur Skim, une adolescente au collège, étant pratiquement de tous les plans. Le récit est raconté à la fois au travers de très brefs extraits de son journal intime, de ses interactions avec les autres personnes de sa classe, surtout avec sa copine Lisa, et de ses activités quotidiennes. Elle fait preuve d'une forme de cynisme assez critique envers les autres, bien entretenu par sa copine Lisa avec qui elle est sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de fibre d'auto-apitoiement, ni de fascination morbide explicite. Mais la nature critique de Skim apporte une forme de détachement émotionnel, de maturité inattendue chez une demoiselle de son âge. Le lecteur suit sa vie quotidienne, à l'évidence des morceaux choisis plutôt qu'un reportage minute par minute, avec un accès à son flux de pensée. Bien évidemment, il se produit des événements tout du long de ces 140 pages. Le lecteur peut donc assister à des moments banals : les discussions entre élèves dans les couloirs du lycée, des discussions avec des adultes, un repas avec son père et sa nouvelle conjointe, une soirée déguisée, un cours de biologie, une première rencontre avec deux garçons qui doivent les accompagner à un bal de charité, des disputes entre copines, etc. Le lecteur peut déceler dans les dessins, l'influence discrète de quelques aspects visuels des shojos, sans que cela ne donne l'impression d'imports artificiels. En fait les dessins ne sont pas marqués d'un parti pris féminin : ils restent dans un registre descriptif, avec des contours parfois un peu lâches.
L'artiste sait emmener le lecteur dans le monde de Skim, de la manière dont elle le perçoit. Cela ne veut pas dire que la narration est exclusivement en vue subjective : ça se produit de temps à autre, mais Skim est plus souvent présente dans la case que le lecteur ne voit ce qui l'entoure par ses yeux. Jillian Tamaki impressionne le lecteur par le naturel des postures et des mouvements des personnages, qu'il s'agisse des jeunes filles ou des adultes, et par sa capacité à concevoir des plans de prise de vue qui rendent visuellement intéressant les moments de dialogue, sans effet d'enfilade de cases avec uniquement des têtes en train de parler. Les personnages peuvent être en mouvement, en train de se déplacer, ou statiques tout en continuant leur occupation banale. Les cases montrent les décors, ainsi que les différents accessoires ou meubles présents dans le cadre, apportant des indications sur la personnalité du propriétaire ou de l'occupant des lieux. Cela va de la décoration de l'autel Wicca dans la chambre de Skim, aux couloirs fonctionnels et sans âme du lycée. De page en page, le lecteur se rend compte qu'il regarde avec intérêt des éléments aussi communs que la jupe de madame Archer, les bougies sur l'autel de la chambre, un fût métallique utilisé comme brasero, la bague en toc en forme de tête de mort de Lisa, le passage de l'aspirateur dans le salon, la forme du canapé de madame Archer, les restes dans l'assiette de Skim, les déguisements de ballerine, la tenue du sport du lycée, etc. Il se retrouve surpris de s'intéresser à ces éléments anodins et banals auxquels il ne prête plus attention dans sa propre vie.
Cela n'a rien d'évident de capter l'attention d'un lecteur et de la conserver pendant une telle pagination, avec les petits riens de la vie de tous les jours. Effectivement, la scénariste intègre quelques événements moins communs comme un bras cassé (plusieurs en fait) ou un suicide, mais en les ramenant dans la vie quotidienne, sans dramatisation. Évidemment, la sensibilité de Kimberly et de Lisa est plus importante que celle d'un adulte, mais sans être surjouée ou à fleur de peau. En fait, Kimberly est une adolescente très posée, capable de recul, prompte à porter des jugements de valeur, mais ne s'emportant jamais, restant calme, tolérante, et portée à l'introspection, sans tendance dépressive ou suicidaire. Le lecteur accompagne donc bien volontiers cette demoiselle dans sa vie quotidienne, sans ressentir d'ennui. Le lecteur fait donc l'expérience de ce quotidien par l'entremise des observations de Skim : sa remarque sur son père, sa remarque sur la séparation de Katie et John, ses observations sur l'allure de madame Archer, la participation à la réunion d'une étrange assemblée de sorcières, etc. Il note que les observations de Kimberly sont souvent complétées par ce que Lisa ou une autre personne lui a dit sur le sujet.
Le lecteur ressent les émotions de Kimberly qui semblent comme émoussées, pour autant elle fait preuve d'empathie pour ses amies. Petit à petit, le lecteur ressent ce qui génère cet état de conscience chez Kimberly. Ce n'est pas explicité avec des gros sabots dans son journal comme si elle s'auto-analysait. Ce n'est pas dit à haute voix par sa copine ou par d'autres camarades de classe. Le lecteur le perçoit dans son comportement, dans ses affinités électives qui se produisent tout naturellement. Alors que son comportement ne se conforme pas aux principes moraux classiques, cela n'a rien de choquant au point que le lecteur doive prendre un peu de recul pour mesurer le degré de transgression de ce qui vient de se passer de manière si naturelle sous yeux, sans jugement de la part des autrices. Ce n'est ni du laisser-faire, ni du dévergondage. En fonction de sa propre sensibilité, de ses propres convictions, il réagit de manière plus ou moins vive. Il effectue une projection de ses propres valeurs pour interpréter cet élan du cœur, libre de penser ce qu'il veut, la narration le guidant vers une absence de condamnation morale, plutôt vers une empathie compréhensive. Finalement, il s'agit d'une étape essentielle dans le développement de Kimberly, sans être traumatique ou scandaleuse.
Une œuvre de jeunesse : oui, mais pas une œuvre relevant de l'ébauche. Les sœurs Tamaki évoquent le quotidien d'une jeune adolescente dans la banlieue de Toronto, avec un tact et un naturel étonnants, réussissant à conserver l'attention du lecteur tout du long des jours qui passent, avec délicatesse, justesse et une forme de pudeur incitant au respect.
Quelle déception lamentable ... ormis le graphisme rien ne vas ... les enchaînements sont très mal fait. on passe du coq à l âne ,très souvent, sans aucun lien entre les scènes.
La personnalité de Laura dean est faussement mystérieuse. Pour avoir connu le profil pervers narcissique on ne le ressent que très peu. C est vraiment vraiment dommage. Avec toute la joie que je me faisais de découvrir ce roman graphique c est déplorable.
Je ne le recommande absolument pas sauf si vous avez envie de voir de beau graphisme.
La personnalité de Laura dean est faussement mystérieuse. Pour avoir connu le profil pervers narcissique on ne le ressent que très peu. C est vraiment vraiment dommage. Avec toute la joie que je me faisais de découvrir ce roman graphique c est déplorable.
Je ne le recommande absolument pas sauf si vous avez envie de voir de beau graphisme.
Mes ruptures avec Laura Dean, scénario de Mariko Tamaki et dessin de Rosemary Valero-O'Connell est une bande-dessinée qui m'a beaucoup plu. Un regard sensible sur l'adolescence qui aborde des sujets profonds .
Frederica est amoureuse de Laura Dean, la fille la plus populaire de son lycée. Elle devrait se sentir comblée de bonheur et pourtant c'est tout le contraire, car Laura lui brise le cœur tous les quatre matins et vient la reconquérir en un claquement de doigts. Freddy est complètement rongée par cette relation et se replie tellement sur elle-même qu'elle ne voit pas que sa meilleure amie Doodle, traverse elle aussi des moments difficiles...
Une bande-dessinée vraiment très esthétique avec son trait de crayon, sa composition dynamique laissant surgir des vignettes dans d'autres vignettes, et surtout sa palette de noir et de rose qui confère une certaine douceur au dessin. On voit de temps à autre des objets s'animer comme sortis de l'imaginaire de Freddy pour répondre aux questions qui la tourmentent.
L'histoire est très intéressante et aborde un sujet peu associé à l'adolescence, la perversion narcissique. Frederica oscille entre le désespoir et l'obsession de plaire encore à Laura malgré tous les coups bas que cette dernière peut lui faire. Quand Laura lui accorde de l'attention, Freddy oublie tout, quitte à laisser sa meilleure amie en plan. Et pourtant qu'elle est belle l'amitié qui unit Frederica et Doodle. La fragilité que dégage le personnage de Doodle m'a beaucoup touchée et, au fil des pages, on souhaite plus que tout que leur amitié traverse les orages.
Mes ruptures avec Laura Dean est une très belle bande-dessinée, sombre et délicate à la fois comme le noir et le rose qui la composent.
Frederica est amoureuse de Laura Dean, la fille la plus populaire de son lycée. Elle devrait se sentir comblée de bonheur et pourtant c'est tout le contraire, car Laura lui brise le cœur tous les quatre matins et vient la reconquérir en un claquement de doigts. Freddy est complètement rongée par cette relation et se replie tellement sur elle-même qu'elle ne voit pas que sa meilleure amie Doodle, traverse elle aussi des moments difficiles...
Une bande-dessinée vraiment très esthétique avec son trait de crayon, sa composition dynamique laissant surgir des vignettes dans d'autres vignettes, et surtout sa palette de noir et de rose qui confère une certaine douceur au dessin. On voit de temps à autre des objets s'animer comme sortis de l'imaginaire de Freddy pour répondre aux questions qui la tourmentent.
L'histoire est très intéressante et aborde un sujet peu associé à l'adolescence, la perversion narcissique. Frederica oscille entre le désespoir et l'obsession de plaire encore à Laura malgré tous les coups bas que cette dernière peut lui faire. Quand Laura lui accorde de l'attention, Freddy oublie tout, quitte à laisser sa meilleure amie en plan. Et pourtant qu'elle est belle l'amitié qui unit Frederica et Doodle. La fragilité que dégage le personnage de Doodle m'a beaucoup touchée et, au fil des pages, on souhaite plus que tout que leur amitié traverse les orages.
Mes ruptures avec Laura Dean est une très belle bande-dessinée, sombre et délicate à la fois comme le noir et le rose qui la composent.
Ce tome fait partie d'une série de 4 avec Hunt for Wolverine: Adamantium Agenda (de Tom Taylor & RB Silva), Hunt for Wolverine: Weapon Lost (de Charles Soule & Matteo Buffagni), Hunt for Wolverine: Mystery in Madripoor (de Jim Zub & Thony Silas). Ces 4 miniséries ont été regroupées dans Hunt for Wolverine. Le présent tome contient le numéro spécial Hunt for Wolverine, ainsi que les 4 épisodes de la minisérie The claws of a killer, initialement parus en 2018.
-
Hunt for Wolverine (40 pages, scénario de Charles Soule, dessins et encrage de David Marquez pour la première partie, dessins de Paulo Siqueira et encrage de Walden Wong pour la deuxième partie) - Dans la région d'Alberta au Canada, le vaisseau des Reavers (un groupe de cyborgs, ennemis des X-Men) arrive en vue de la cabane où repose le corps de Wolverine dans sa gangue d'adamantium, avec Donald Pierce à leur tête. Celui-ci rappelle les paramètres de la mission : s'introduire furtivement dans la cabane, enlever le corps de Wolverine dans son adamantium, prélever un échantillon des cellules du corps à travers la gangue. Leur objectif : revendre tout ça à bon prix pour se payer des pièces de rechange. Alors qu'ils se rendent compte du poids de la statue d'adamantium, un groupe de X-Men arrive sur place. Il se compose de Colossus (Piotr Rasputin), Stom (Ororo Munroe), Nightcrawler (Kurt Wagner), Firestar (Engie Jones) et Kitty Pryde.
Dans le monde des comics, quand la cote de popularité d'un personnage commence à baisser, c’est-à-dire que les chiffres de vente s'érodent lentement mais sûrement, il est retiré des magazines, mis à l'écart, souvent par le biais d'une mort spectaculaire qui permet de vendre quelques unités de plus. C'est ce qui est arrivé à Wolverine en 2014 dans Death of Wolverine (par Charles Soule & Steve McNiven), accompagné de pas moins de 4 miniséries, pour tirer le profit maximum de l'événement. Il est donc tout naturel que les responsables éditoriaux de Marvel mettent en branle une mécanique tout aussi importante pour son retour, avec 4 miniséries de prologue. Le lecteur sait donc par avance qu'il ne doit pas s'attendre à y trouver Logan, que tout cela ne sert que de prélude. Pour donner le coup d'envoi, c'est à nouveau Charles Soule qui écrit l'épisode introductif. Il compose une histoire en 2 parties, qui aurait donc très bien pu paraître sous la forme de 2 épisodes. Dans la première moitié, les Reavers viennent piller le monument au mort, dans un combat étiré, rendu insipide par des dialogues exclusivement fonctionnels, et par des dessins compétents, privés de décors dans 9 pages sur 10, avec des affrontements visuellement inintéressants.
Dans la deuxième partie, Paolo Siqueira fournit un peu plus d'effort que David Marquez, pour les décors, sans les rendre très tangibles. Kitty Pryde contacte plusieurs superhéros pour les informer que Logan est peut-être de retour, ce qui justifie le lancement de 4 miniséries par la suite pour chercher le revenant. Le dessinateur effectue un travail très fonctionnel : les différents superhéros sont facilement identifiables, mais ils semblent mal jouer, tant pour les expressions de visage, très stéréotypées et dénuées de nuances, que pour le langage corporel très posé. Le scénariste accomplit sa mission sans panache. Il montre l'incrédulité de tous ceux qui l'ont précédemment déclaré mort, avec un taux de certitude de 100%, et il laisse planer le doute sur la réalité du retour de Logan. Il n'y a qu'une bonne idée : celle de la gangue vidée de son cadavre, comme si la chenille avait quitté son cocon. 1 étoile.
-
The claws of a killer (scénario de Marko Tamaki, dessins de Butch Guice, avec Mack Chater pour les épisodes 2 à 4, encrage de Cam Smith et Mack Chater, couleurs de Dan Brown, puis Jordan Boyd pour l'épisode 4) - Dans la petite ville de Maybelle (343 habitants) en Arizona, il y a une semaine, le groupe d'une demi-douzaine d'habitués était en train de prendre un verre ou de jouer au flipper, quand le courant a été coupé. L'un d'eux s'est rendu à la station relais pour voir avec le responsable et s'est retrouvé face à un individu griffu. Au temps présent, au bar Chester à New York, Victor Creed (Sabretooth) et Yuriko Oyama (Lady Deathstrike) sont en train de prendre un verre avec Akihiro (Daken). Ils convainquent ce dernier de les accompagner à Maybelle, car Yuriko Oyama y a détecté la présence de Logan, vivant. Sur place toute la population est morte, et des individus armés inspectent les cadavres pour le compte d'un mystérieux Soteira.
Après un épisode introductif aussi calamiteux, le lecteur se rappelle qu'il a été attiré par la présence de Mariko Tamaki en tant que scénariste du fait de la qualité de ses réalisations antérieures pour Marvel (la série She-Hulk), ou en indépendante pour This One Summer En outre c'est elle qui reprend la série X-23 par la suite, avec Juann Cabal. Dès le départ, elle sait donner une voix propre à chacun des 3 personnages, et faire référence à un moment crucial de leur vie, mais aussi à la relation qu'ils entretiennent chacun avec un membre de leur famille. Même dans un projet commercial aussi artificiel que celui-ci elle conserve sa voix d'autrice qui s'exprime par son attachement aux personnages. Pour l'intrigue, elle respecte scrupuleusement le cahier des charges : pas d'apparition réelle de Wolverine, la mise en scène de 3 de ses ennemis emblématiques, et une histoire qui fait la part belle à l'action.
Dans un premier temps, le lecteur se réjouit de découvrir que Butch Guice a réalisé les dessins des 4 épisodes, même s'il n'a pas réalisé toutes les pages des épisodes 2 à 4. Il s'agit d'un artiste qui dessine de manière réaliste et descriptive, ayant peaufiné le rendu de ses cases au fil du temps, pour y intégrer un encrage un peu appuyé et un peu rugueux donnant une impression de sérieux premier degré à ce qu'il raconte, et de véracité. Certes, il est assisté par un autre dessinateur, mais Mack Chatter avait mis en images les aventures d'une communauté séparatiste aux États-Unis, sur un scénario de Brian Wood dans Briggs Land, avec une puissance de conviction épatante. Les 2 artistes ont choisi de représenter les 3 personnages, sans leur costume, comme des êtres humains normaux, sauf quand ils utilisent leur pouvoir. Cela ajoute à l'impression de mission paramilitaire d'un petit commando très spécial, donnant une saveur d'aventures réalistes à l'intrigue. Le premier épisode s'avère sympathique, avec une bonne densité d'informations visuelles, à la fois pour les personnages, à la fois pour les décors. Le lecteur peut voir où se situe chaque scène, à base de décors archétypaux de l'Amérique, mais avec à chaque fois un élément venant y apporter un peu de particularité. Guice se révèle être un bon metteur en scène, sachant insuffler de l'intérêt visuel dans la discussion entre Daken, Creed et Oyama alors même qu'ils restent assis dans un bar, grâce à des mouvements de caméra, des expressions de visage assez nuancées.
Ça se gâte ensuite au fil des épisodes. Dan Brown privilégie les couleurs boueuses et ternes ce qui appose une uniformité visuelle aux épisodes 2 et 3. Jordan Boyd se lâche un peu dans l'épisode 4 avec des zones de couleurs plus vives dans certaines pages. De page en page, le degré de détails diminue pour la représentation des décors, jusqu'à disparaître le temps d'une page dans l'épisode 3. Le lecteur vérifie une fois ou deux, mais visiblement Mack Chater semble éprouver des difficultés à respecter les proportions anatomiques pendant les scènes d'action avec des perspectives un peu appuyées. La lisibilité reste d'un bon niveau, mais il apparaît quelques clichés visuels patents de temps à autre. Les 2 artistes ne sont pas non plus très gâtés par une intrigue peu inspirée. Les 3 principaux personnages se battent contre des zombies génériques qui ne font pas peur visuellement, et qui sont dépourvus de toute originalité. Il y a une mystérieuse organisation qui tire les ficelles dans l'ombre, dont le lecteur n'apprend absolument rien. Il n'arrive donc pas à s'y intéresser. Le bombardement de la fin arrive au choix, soit comme un cheveu sur la soupe, soit comme un cliché plusieurs fois éculé. Enfin la densité narrative est particulièrement faible, les auteurs faisant tout pour tirer à la ligne, afin de remplir leur quota de 20 pages par épisode. Dans ces conditions, 2 numéros auraient suffi.
Avant de commencer ce tome, le lecteur sait bien qu'il 'agit pour l'éditeur Marvel de maximiser le profit à l'occasion du retour de Wolverine. Il a donc commandé des miniséries dérivées, atour de ce retour par encore véritablement entamé. D'un autre côté, il s'agit de Mariko Tamaki et Jackson Guice, des auteurs ayant réalisé des œuvres de qualité pour Marvel. Au final, l'épisode introductif de Charles Soules est délayé et insipide. Par comparaison, la minisérie The claws of a killer est nettement meilleure, mais avec un peu de recul elle apparaît creuse et réalisée dans la précipitation.
-
Hunt for Wolverine (40 pages, scénario de Charles Soule, dessins et encrage de David Marquez pour la première partie, dessins de Paulo Siqueira et encrage de Walden Wong pour la deuxième partie) - Dans la région d'Alberta au Canada, le vaisseau des Reavers (un groupe de cyborgs, ennemis des X-Men) arrive en vue de la cabane où repose le corps de Wolverine dans sa gangue d'adamantium, avec Donald Pierce à leur tête. Celui-ci rappelle les paramètres de la mission : s'introduire furtivement dans la cabane, enlever le corps de Wolverine dans son adamantium, prélever un échantillon des cellules du corps à travers la gangue. Leur objectif : revendre tout ça à bon prix pour se payer des pièces de rechange. Alors qu'ils se rendent compte du poids de la statue d'adamantium, un groupe de X-Men arrive sur place. Il se compose de Colossus (Piotr Rasputin), Stom (Ororo Munroe), Nightcrawler (Kurt Wagner), Firestar (Engie Jones) et Kitty Pryde.
Dans le monde des comics, quand la cote de popularité d'un personnage commence à baisser, c’est-à-dire que les chiffres de vente s'érodent lentement mais sûrement, il est retiré des magazines, mis à l'écart, souvent par le biais d'une mort spectaculaire qui permet de vendre quelques unités de plus. C'est ce qui est arrivé à Wolverine en 2014 dans Death of Wolverine (par Charles Soule & Steve McNiven), accompagné de pas moins de 4 miniséries, pour tirer le profit maximum de l'événement. Il est donc tout naturel que les responsables éditoriaux de Marvel mettent en branle une mécanique tout aussi importante pour son retour, avec 4 miniséries de prologue. Le lecteur sait donc par avance qu'il ne doit pas s'attendre à y trouver Logan, que tout cela ne sert que de prélude. Pour donner le coup d'envoi, c'est à nouveau Charles Soule qui écrit l'épisode introductif. Il compose une histoire en 2 parties, qui aurait donc très bien pu paraître sous la forme de 2 épisodes. Dans la première moitié, les Reavers viennent piller le monument au mort, dans un combat étiré, rendu insipide par des dialogues exclusivement fonctionnels, et par des dessins compétents, privés de décors dans 9 pages sur 10, avec des affrontements visuellement inintéressants.
Dans la deuxième partie, Paolo Siqueira fournit un peu plus d'effort que David Marquez, pour les décors, sans les rendre très tangibles. Kitty Pryde contacte plusieurs superhéros pour les informer que Logan est peut-être de retour, ce qui justifie le lancement de 4 miniséries par la suite pour chercher le revenant. Le dessinateur effectue un travail très fonctionnel : les différents superhéros sont facilement identifiables, mais ils semblent mal jouer, tant pour les expressions de visage, très stéréotypées et dénuées de nuances, que pour le langage corporel très posé. Le scénariste accomplit sa mission sans panache. Il montre l'incrédulité de tous ceux qui l'ont précédemment déclaré mort, avec un taux de certitude de 100%, et il laisse planer le doute sur la réalité du retour de Logan. Il n'y a qu'une bonne idée : celle de la gangue vidée de son cadavre, comme si la chenille avait quitté son cocon. 1 étoile.
-
The claws of a killer (scénario de Marko Tamaki, dessins de Butch Guice, avec Mack Chater pour les épisodes 2 à 4, encrage de Cam Smith et Mack Chater, couleurs de Dan Brown, puis Jordan Boyd pour l'épisode 4) - Dans la petite ville de Maybelle (343 habitants) en Arizona, il y a une semaine, le groupe d'une demi-douzaine d'habitués était en train de prendre un verre ou de jouer au flipper, quand le courant a été coupé. L'un d'eux s'est rendu à la station relais pour voir avec le responsable et s'est retrouvé face à un individu griffu. Au temps présent, au bar Chester à New York, Victor Creed (Sabretooth) et Yuriko Oyama (Lady Deathstrike) sont en train de prendre un verre avec Akihiro (Daken). Ils convainquent ce dernier de les accompagner à Maybelle, car Yuriko Oyama y a détecté la présence de Logan, vivant. Sur place toute la population est morte, et des individus armés inspectent les cadavres pour le compte d'un mystérieux Soteira.
Après un épisode introductif aussi calamiteux, le lecteur se rappelle qu'il a été attiré par la présence de Mariko Tamaki en tant que scénariste du fait de la qualité de ses réalisations antérieures pour Marvel (la série She-Hulk), ou en indépendante pour This One Summer En outre c'est elle qui reprend la série X-23 par la suite, avec Juann Cabal. Dès le départ, elle sait donner une voix propre à chacun des 3 personnages, et faire référence à un moment crucial de leur vie, mais aussi à la relation qu'ils entretiennent chacun avec un membre de leur famille. Même dans un projet commercial aussi artificiel que celui-ci elle conserve sa voix d'autrice qui s'exprime par son attachement aux personnages. Pour l'intrigue, elle respecte scrupuleusement le cahier des charges : pas d'apparition réelle de Wolverine, la mise en scène de 3 de ses ennemis emblématiques, et une histoire qui fait la part belle à l'action.
Dans un premier temps, le lecteur se réjouit de découvrir que Butch Guice a réalisé les dessins des 4 épisodes, même s'il n'a pas réalisé toutes les pages des épisodes 2 à 4. Il s'agit d'un artiste qui dessine de manière réaliste et descriptive, ayant peaufiné le rendu de ses cases au fil du temps, pour y intégrer un encrage un peu appuyé et un peu rugueux donnant une impression de sérieux premier degré à ce qu'il raconte, et de véracité. Certes, il est assisté par un autre dessinateur, mais Mack Chatter avait mis en images les aventures d'une communauté séparatiste aux États-Unis, sur un scénario de Brian Wood dans Briggs Land, avec une puissance de conviction épatante. Les 2 artistes ont choisi de représenter les 3 personnages, sans leur costume, comme des êtres humains normaux, sauf quand ils utilisent leur pouvoir. Cela ajoute à l'impression de mission paramilitaire d'un petit commando très spécial, donnant une saveur d'aventures réalistes à l'intrigue. Le premier épisode s'avère sympathique, avec une bonne densité d'informations visuelles, à la fois pour les personnages, à la fois pour les décors. Le lecteur peut voir où se situe chaque scène, à base de décors archétypaux de l'Amérique, mais avec à chaque fois un élément venant y apporter un peu de particularité. Guice se révèle être un bon metteur en scène, sachant insuffler de l'intérêt visuel dans la discussion entre Daken, Creed et Oyama alors même qu'ils restent assis dans un bar, grâce à des mouvements de caméra, des expressions de visage assez nuancées.
Ça se gâte ensuite au fil des épisodes. Dan Brown privilégie les couleurs boueuses et ternes ce qui appose une uniformité visuelle aux épisodes 2 et 3. Jordan Boyd se lâche un peu dans l'épisode 4 avec des zones de couleurs plus vives dans certaines pages. De page en page, le degré de détails diminue pour la représentation des décors, jusqu'à disparaître le temps d'une page dans l'épisode 3. Le lecteur vérifie une fois ou deux, mais visiblement Mack Chater semble éprouver des difficultés à respecter les proportions anatomiques pendant les scènes d'action avec des perspectives un peu appuyées. La lisibilité reste d'un bon niveau, mais il apparaît quelques clichés visuels patents de temps à autre. Les 2 artistes ne sont pas non plus très gâtés par une intrigue peu inspirée. Les 3 principaux personnages se battent contre des zombies génériques qui ne font pas peur visuellement, et qui sont dépourvus de toute originalité. Il y a une mystérieuse organisation qui tire les ficelles dans l'ombre, dont le lecteur n'apprend absolument rien. Il n'arrive donc pas à s'y intéresser. Le bombardement de la fin arrive au choix, soit comme un cheveu sur la soupe, soit comme un cliché plusieurs fois éculé. Enfin la densité narrative est particulièrement faible, les auteurs faisant tout pour tirer à la ligne, afin de remplir leur quota de 20 pages par épisode. Dans ces conditions, 2 numéros auraient suffi.
Avant de commencer ce tome, le lecteur sait bien qu'il 'agit pour l'éditeur Marvel de maximiser le profit à l'occasion du retour de Wolverine. Il a donc commandé des miniséries dérivées, atour de ce retour par encore véritablement entamé. D'un autre côté, il s'agit de Mariko Tamaki et Jackson Guice, des auteurs ayant réalisé des œuvres de qualité pour Marvel. Au final, l'épisode introductif de Charles Soules est délayé et insipide. Par comparaison, la minisérie The claws of a killer est nettement meilleure, mais avec un peu de recul elle apparaît creuse et réalisée dans la précipitation.
Livre qui décrit très bien l'adolescence dans toute sa grandeur. Je le recommande à tous les fans de Bd
Ce tome fait suite à She-Hulk Vol. 1: Deconstructed (épisodes 1 à 6) qu'il faut avoir lu avant. Il comprend les épisodes 7 à 11, initialement parus en 2017, écrits par Mariko Tmaaki, dessinés et encrés par Georges Duarte pour les épisodes 7 & 8, par Julian Lopez et Francisco Gascón pour les épisodes 9 & 10, et par Bachan pour l'épisode 11. La mise en couleurs a été assurée par Matt Mila pour les épisodes 7 à 10, et par Federico Blee pour l'épisode 11. Les couvertures ont été réalisées par John Tyler Christopher. Ce tome comprend également la couverture alternative réalisée par Rahzzah.
Le vendredi soir, Jennifer Walters se rend à un groupe de parole dans le sous-sol d'une église, pour personnes ayant subi un traumatisme. Elle écoute un monsieur expliquer qu'il a tenté de de passer soirée avec une femme, mais qu'il a fini par craquer en évoquant la mort de son épouse 5 ans auparavant. Quand vient son tour, Jennifer indique qu'elle n'a rien à partager avec le groupe pour le moment. À Brooklyn 2 gugusses se rendent à une adresse bien particulière. Il s'agit de Ray & Steve qui sont venus chercher une substance prohibée appelée CKEF28. Une fois leurs emplettes faites, ils se rendent au studio de l'enregistrement de Oli Cake dont ils sont les techniciens. Ils sont accueillis avec soulagement par Oliver Constantin (l'animateur de cette émission culinaire sur internet) et par Warren, son compagnon. Steve profite d'un moment d'inattention d'Oliver et de Warren pour mettre un peu de drogue dans le gâteau.
De son côté, Jennifer Walters sort de son groupe de parole un peu déçue par manque d'intérêt. L'animatrice lui adresse quelques mots sur le trottoir pour lui dire que plus elle apportera au groupe, plus elle en retirera quelque chose. Jennifer Walters se dirige vers un quartier désaffecté de New York où elle se transforme en Hulk et passe sa rage sur un immeuble en cours de destruction. Elle est interrompue dans ce moment de décompression par Hellcat qui lui demande si tout va bien. Elles vont papoter dans un appartement encore en état. Hellcat s'enquiert de la santé de sa copine. Jennifer lui explique qu'elle estime que le groupe de parole ne lui permet pas de faire des progrès et qu'elle a du mal à accepter qu'elle est un Hulk dans tous les sens du terme.
Le premier tome avait surpris le lecteur par une approche personnelle de la scénariste. Mariko Tamaki avait su mettre à profit la situation personnelle de Jennifer Walters pour écrire une histoire développant le parcours d'une personne ayant subi un traumatisme et essayant de reprendre pied dans la normalité, de retrouver un peu de sens en reprenant une vie routinière, basée à la fois sur le travail et un rituel de détente consistant à regarder des émissions culinaires. L'auteure avait développé le thème de ce syndrome de stress post traumatique, également en contrastant le comportement Jennifer avec celui d'une femme ayant subi une agression et restant sous la prise de l'angoisse de devoir s'exposer à nouveau. Ce premier tome était d'autant plus remarquable que She-Hulk n'apparaissait que dans le dernier épisode, sa couleur grise indiquant que Jennifer Walters avait perdu toute la maîtrise qu'elle possédait avant dans cette forme, ayant été auparavant jusqu'à l'adopter comme forme définitive. La couverture de ce tome 2 indique que sous la carapace grise commence à revenir des traces vertes, correspondant à la version initiale de She-Hulk. Néanmoins elles restent minoritaires et Jennifer Walters a encore du chemin à parcourir avant de retrouver son assurance, sa confiance en elle-même.
Comme dans le premier tome, la scénariste se tient à l'écart des supercriminels aux couleurs vives, et des crises à l'échelle de la planète. Comme dans le premier tome, le lecteur de superhéros peut être un peu déçu de cette narration focalisée sur 2 individus pas très futés qui occasionnent la création d'un monstre pour faire une vidéo à poser sur internet, par un monstre générique, et par des personnages très banals. Par contre, She-Hulk apparaît à 3 ou 4 reprises, et ce dès le premier épisode, ce qui augmente la part d'utilisation de superpouvoirs. Le lecteur peut aussi tiquer sur le fait que Jennifer Walters est à nouveau confrontée à un individu qui subit un traumatisme, et cette fois-ci le même que le sien (l'initial, pas celui subi pendant Civil War II de Brian Michael Bendis & David Marquez). Bien évidemment, Tamaki fait là aussi ressortir le contraste entre le comportement d'Oliver Constantin tout juste transformé en monstre, et celui de Jennifer Walters. Cette dernière en fait même l'observation à un autre personnage en cours de récit. Mais ce n'est pas du surplace pour autant.
Mariko Tamaki déroule une intrigue assez basique, avec des individus irresponsables occasionnant sciemment la création d'un monstre, juste pour faire péter les scores sur Internet. Il est question d'amitié (entre Jennifer & Patsy), d'amour (entre Oliver & Warren), de s'inquiéter pour les autres, d'ambition ou tout du moins de projet (pour Oliver Constantin, mais aussi pour Jennifer Walters), d'internet et de scores sur Internet. Mais la scénariste ne surfe pas vraiment sur l'air du temps, car elle donne la préséance aux personnages et à leurs états d'esprit, sans tomber dans la comédie de situation ou le mélodrame. Si She-Hulk apparaît plus que dans le premier tome, le lecteur n'éprouve pas l'impression que la série a changé de ton pour mieux répondre à des attentes présupposées des lecteurs. Comme il est de coutume dans les comics mensuel, le premier dessinateur a laissé la place à un autre : Georges Duarte succède ainsi à Nico Leon. Il reste dans un registre descriptif, avec une forme épurée des dessins, pour un rendu éloigné des comics de superhéros habituel, en phase avec la tonalité de la narration.
Les épisodes 7 & 8 présentent une narration visuelle facile à suivre, pas très dense. Les traits de contour sont fins, y compris pour les visages, avec des expressions pas toujours très nuancées, où flotte une discrète influence manga, bien intégrée dans l'ensemble. L'artiste évite de trop sexualiser les personnages féminins, sauf pour Hellcat, mais le lecteur peut estimer que cela fait partie de sa personnalité. Il fait en sorte de bien définir où se passe chaque séquence, avec un effort sur la décoration intérieure, et sur les façades des bâtiments. Les personnages portent des tenues civiles normales et différenciées. Pour ces 2 épisodes, la narration visuelle présente un bon niveau de savoir-faire, avec une approche qui respecte la tonalité psychologique du récit, sans être vraiment mémorable.
Le lecteur découvre à nouveau une autre équipe artistique pour les épisodes 9 & 10 : Julian Lopez et Francisco Gascón. Le niveau de détails baisse un peu dans ce registre descriptif. Par contre ces artistes jouent sur les variations d'épaisseur des traits de contour, ce qui donne plus de volume aux formes et de relief aux différents plans. Dans le premier épisode, cette équipe reste dans le registre du quotidien pour l'enquête menée par Jennifer Walters en civil, mais en utilisant des angles de vue plus dramatique, en particulier en augmentant le nombre de contreplongée. En cohérence avec le scénario, les dessins reprennent les conventions visuelles des superhéros pour l'épisode 10 puisqu'il s'agit d'un combat physique entre She-Hulk et son adversaire. La narration est compétente, à nouveau sans être mémorable.
Ces 4 épisodes (7 à 10) continuent de suivre Jennifer Walters assimilant progressivement le traumatisme dont elle a souffert, refusant toujours la position de victime et essayant de reprendre les rênes de sa vie. L'intérêt du récit ne réside donc pas dans les rebondissements de l'intrigue ou dans les hauts faits d'un superhéros utilisant ses superpouvoirs, mais dans l'étude de caractère qui est très bien menée. Les dessins permettent de voir ce qui arrive, sans un registre visuel adapté à ce genre de récit, mais qui n'apporte pas de petit supplément d'âme aux personnages. 4 étoiles.
Le tome s'achève avec l'épisode 11 qui constitue une respiration. Jennifer Walters a décidé de passer une soirée romantique, en acceptant l'invitation de Mark, rencontré sur un site Internet. Elle se prépare en écoutant les conseils d'Hellcat, puis se rend au restaurant.
Là encore la réaction du lecteur dépend de ce qu'il attend de la série. S'il attend un épisode classique avec confrontation, il soupire de mécontentement et il y a de grand risque qu'il ne finisse pas la lecture de cet épisode. C'est un troisième dessinateur qui réalise la mise en images, Bachan. Il utilise lui aussi des traits de contours très fins, et réalise des dessins plus épurés que ceux de Georges Duarte, avec une sensibilité de type féminine qui n'est pas toujours convaincante. Mariko Tamaki s'amuse avec un rendez-vous qui se termine en pugilat général dans le restaurant, à nouveau plus intéressée par les sentiments de son héroïne que par l'intrigue. Le résultat génère plusieurs sourire sur visage du lecteur, pour le côté sentimental pas dupe, mais pas cynique pour autant, et pour une comédie légère et un peu trop gratuite. Entre 3 et 4 étoiles pour ce rencard où le cœur de Jennifer Walters n'est pas vraiment, et l'implication de la scénariste non plus.
Le vendredi soir, Jennifer Walters se rend à un groupe de parole dans le sous-sol d'une église, pour personnes ayant subi un traumatisme. Elle écoute un monsieur expliquer qu'il a tenté de de passer soirée avec une femme, mais qu'il a fini par craquer en évoquant la mort de son épouse 5 ans auparavant. Quand vient son tour, Jennifer indique qu'elle n'a rien à partager avec le groupe pour le moment. À Brooklyn 2 gugusses se rendent à une adresse bien particulière. Il s'agit de Ray & Steve qui sont venus chercher une substance prohibée appelée CKEF28. Une fois leurs emplettes faites, ils se rendent au studio de l'enregistrement de Oli Cake dont ils sont les techniciens. Ils sont accueillis avec soulagement par Oliver Constantin (l'animateur de cette émission culinaire sur internet) et par Warren, son compagnon. Steve profite d'un moment d'inattention d'Oliver et de Warren pour mettre un peu de drogue dans le gâteau.
De son côté, Jennifer Walters sort de son groupe de parole un peu déçue par manque d'intérêt. L'animatrice lui adresse quelques mots sur le trottoir pour lui dire que plus elle apportera au groupe, plus elle en retirera quelque chose. Jennifer Walters se dirige vers un quartier désaffecté de New York où elle se transforme en Hulk et passe sa rage sur un immeuble en cours de destruction. Elle est interrompue dans ce moment de décompression par Hellcat qui lui demande si tout va bien. Elles vont papoter dans un appartement encore en état. Hellcat s'enquiert de la santé de sa copine. Jennifer lui explique qu'elle estime que le groupe de parole ne lui permet pas de faire des progrès et qu'elle a du mal à accepter qu'elle est un Hulk dans tous les sens du terme.
Le premier tome avait surpris le lecteur par une approche personnelle de la scénariste. Mariko Tamaki avait su mettre à profit la situation personnelle de Jennifer Walters pour écrire une histoire développant le parcours d'une personne ayant subi un traumatisme et essayant de reprendre pied dans la normalité, de retrouver un peu de sens en reprenant une vie routinière, basée à la fois sur le travail et un rituel de détente consistant à regarder des émissions culinaires. L'auteure avait développé le thème de ce syndrome de stress post traumatique, également en contrastant le comportement Jennifer avec celui d'une femme ayant subi une agression et restant sous la prise de l'angoisse de devoir s'exposer à nouveau. Ce premier tome était d'autant plus remarquable que She-Hulk n'apparaissait que dans le dernier épisode, sa couleur grise indiquant que Jennifer Walters avait perdu toute la maîtrise qu'elle possédait avant dans cette forme, ayant été auparavant jusqu'à l'adopter comme forme définitive. La couverture de ce tome 2 indique que sous la carapace grise commence à revenir des traces vertes, correspondant à la version initiale de She-Hulk. Néanmoins elles restent minoritaires et Jennifer Walters a encore du chemin à parcourir avant de retrouver son assurance, sa confiance en elle-même.
Comme dans le premier tome, la scénariste se tient à l'écart des supercriminels aux couleurs vives, et des crises à l'échelle de la planète. Comme dans le premier tome, le lecteur de superhéros peut être un peu déçu de cette narration focalisée sur 2 individus pas très futés qui occasionnent la création d'un monstre pour faire une vidéo à poser sur internet, par un monstre générique, et par des personnages très banals. Par contre, She-Hulk apparaît à 3 ou 4 reprises, et ce dès le premier épisode, ce qui augmente la part d'utilisation de superpouvoirs. Le lecteur peut aussi tiquer sur le fait que Jennifer Walters est à nouveau confrontée à un individu qui subit un traumatisme, et cette fois-ci le même que le sien (l'initial, pas celui subi pendant Civil War II de Brian Michael Bendis & David Marquez). Bien évidemment, Tamaki fait là aussi ressortir le contraste entre le comportement d'Oliver Constantin tout juste transformé en monstre, et celui de Jennifer Walters. Cette dernière en fait même l'observation à un autre personnage en cours de récit. Mais ce n'est pas du surplace pour autant.
Mariko Tamaki déroule une intrigue assez basique, avec des individus irresponsables occasionnant sciemment la création d'un monstre, juste pour faire péter les scores sur Internet. Il est question d'amitié (entre Jennifer & Patsy), d'amour (entre Oliver & Warren), de s'inquiéter pour les autres, d'ambition ou tout du moins de projet (pour Oliver Constantin, mais aussi pour Jennifer Walters), d'internet et de scores sur Internet. Mais la scénariste ne surfe pas vraiment sur l'air du temps, car elle donne la préséance aux personnages et à leurs états d'esprit, sans tomber dans la comédie de situation ou le mélodrame. Si She-Hulk apparaît plus que dans le premier tome, le lecteur n'éprouve pas l'impression que la série a changé de ton pour mieux répondre à des attentes présupposées des lecteurs. Comme il est de coutume dans les comics mensuel, le premier dessinateur a laissé la place à un autre : Georges Duarte succède ainsi à Nico Leon. Il reste dans un registre descriptif, avec une forme épurée des dessins, pour un rendu éloigné des comics de superhéros habituel, en phase avec la tonalité de la narration.
Les épisodes 7 & 8 présentent une narration visuelle facile à suivre, pas très dense. Les traits de contour sont fins, y compris pour les visages, avec des expressions pas toujours très nuancées, où flotte une discrète influence manga, bien intégrée dans l'ensemble. L'artiste évite de trop sexualiser les personnages féminins, sauf pour Hellcat, mais le lecteur peut estimer que cela fait partie de sa personnalité. Il fait en sorte de bien définir où se passe chaque séquence, avec un effort sur la décoration intérieure, et sur les façades des bâtiments. Les personnages portent des tenues civiles normales et différenciées. Pour ces 2 épisodes, la narration visuelle présente un bon niveau de savoir-faire, avec une approche qui respecte la tonalité psychologique du récit, sans être vraiment mémorable.
Le lecteur découvre à nouveau une autre équipe artistique pour les épisodes 9 & 10 : Julian Lopez et Francisco Gascón. Le niveau de détails baisse un peu dans ce registre descriptif. Par contre ces artistes jouent sur les variations d'épaisseur des traits de contour, ce qui donne plus de volume aux formes et de relief aux différents plans. Dans le premier épisode, cette équipe reste dans le registre du quotidien pour l'enquête menée par Jennifer Walters en civil, mais en utilisant des angles de vue plus dramatique, en particulier en augmentant le nombre de contreplongée. En cohérence avec le scénario, les dessins reprennent les conventions visuelles des superhéros pour l'épisode 10 puisqu'il s'agit d'un combat physique entre She-Hulk et son adversaire. La narration est compétente, à nouveau sans être mémorable.
Ces 4 épisodes (7 à 10) continuent de suivre Jennifer Walters assimilant progressivement le traumatisme dont elle a souffert, refusant toujours la position de victime et essayant de reprendre les rênes de sa vie. L'intérêt du récit ne réside donc pas dans les rebondissements de l'intrigue ou dans les hauts faits d'un superhéros utilisant ses superpouvoirs, mais dans l'étude de caractère qui est très bien menée. Les dessins permettent de voir ce qui arrive, sans un registre visuel adapté à ce genre de récit, mais qui n'apporte pas de petit supplément d'âme aux personnages. 4 étoiles.
Le tome s'achève avec l'épisode 11 qui constitue une respiration. Jennifer Walters a décidé de passer une soirée romantique, en acceptant l'invitation de Mark, rencontré sur un site Internet. Elle se prépare en écoutant les conseils d'Hellcat, puis se rend au restaurant.
Là encore la réaction du lecteur dépend de ce qu'il attend de la série. S'il attend un épisode classique avec confrontation, il soupire de mécontentement et il y a de grand risque qu'il ne finisse pas la lecture de cet épisode. C'est un troisième dessinateur qui réalise la mise en images, Bachan. Il utilise lui aussi des traits de contours très fins, et réalise des dessins plus épurés que ceux de Georges Duarte, avec une sensibilité de type féminine qui n'est pas toujours convaincante. Mariko Tamaki s'amuse avec un rendez-vous qui se termine en pugilat général dans le restaurant, à nouveau plus intéressée par les sentiments de son héroïne que par l'intrigue. Le résultat génère plusieurs sourire sur visage du lecteur, pour le côté sentimental pas dupe, mais pas cynique pour autant, et pour une comédie légère et un peu trop gratuite. Entre 3 et 4 étoiles pour ce rencard où le cœur de Jennifer Walters n'est pas vraiment, et l'implication de la scénariste non plus.
Ce tome comprend une histoire complète et indépendante de toute autre. Il est paru d'un seul tenant, sans prépublication, édité par First Second Books, en 2014. Cette histoire est l'œuvre de Mariko Tamaki (scénariste) et Jillian Tamaki (dessins). Il s'agit d'un récit de 317 pages, d'un format plus petit qu'un comics, en bleu foncé (en lieu et place du noir) et blanc, avec des tonalités violettes.
Tous les étés, Rose va à Awako Beach, avec ses parent Alice & Evan. Ils louent un chalet d'où l'on peut se rendre à la plage à pied. Rose y retrouve tous les étés Windy de 18 mois sa cadette. Cet été ne déroge pas à la règle. Rose prend plaisir à retrouver sa chambre et se laisser tomber sur le lit. Avec l'autorisation de sa mère, elle prend son vélo pour se rendre au bungalow de Windy où elle salue sa mère Evelyn. Les 2 copines se rendent ensuite à la plage en papotant de la communauté lesbienne où Windy a passé quelques jours avec sa mère, de l'absence de petit copain pour Rose. Puis elles vont acheter des sucreries à la supérette du coin, tenue par un grand adolescent ou un jeune adulte appelé Dunc.
Le séjour se déroule au rythme indolent des vacances : se lever tard et rester au lit pour lire, regarder son père préparer le barbecue, aller à la plage, papoter de tout et de rien avec Windy, de la future taille de leurs seins, retourner acheter des trucs à la supérette, y louer des DVD, essentiellement des films d'horreur, regarder Massacre à la tronçonneuse (1974) chez Windy le soir, pendant que sa mère n'est pas là, etc. Mais Rose est une jeune adolescente sensible aux émotions autour d'elle, et curieuse de la conversation des autres. Sans aller jusqu'à espionner, elle entend des bribes de ci de là. Elle ressent le vague à l'âme de sa mère et la frustration que cela engendre chez son père. Avec Windy, elle se moque des jeunes adultes qui se rassemblent pour glander autour de la supérette, tout en comprenant à demi-mots que l'une des jeunes femmes craint d'être tombée enceinte.
L'éditeur First Second ne publie pas beaucoup de romans graphiques, mais ils sortent tous de l'ordinaire : Red Handed: The fine art of strange crimes de Matt Kindt, The sculptor de Scott McCloud, The fate of the artist d'Eddie Campbell… Le lecteur sait déjà qu'il aura affaire avec un récit qui sort de l'ordinaire de la production. Ensuite il est réalisé par 2 femmes qui sont cousines, ce qui tranche avec la production industrielle des comics, essentiellement masculine. Enfin il a pour thème une tranche de vie, du point de vue d'une jeune adolescente pendant une période de vacances. Dès les premières pages, le lecteur ressent une empathie pour Rose, jeune fille sympathique, curieuse, normale sans agressivité ou traumatisme particulier. Il apprécie également l'ambiance graphique, très prosaïque, sans affèterie.
La première page est déconcertante puisqu'il n'y a que quelques onomatopées, et quelques vagues tâches. La suivante fait tout de suite penser à un manga, une approche graphique de type seinen, avec une pointe de shojo. Effectivement, en page 6, Rose est en train de lire un shojo pendant le trajet en voiture. Contrairement à la plupart des dessinateurs américains, Jillian Tamaki n'applique pas à la lettre les conventions de surface des mangas, mais s'inspire de l'esprit. Elle n'hésite pas à insérer des pages silencieuses, ou à accorder de l'espace sur la page à des petits riens. Elle peut consacrer une double page à Windy en train de danser, une autre aux nuages étirés dans le ciel, une autre au plein soleil. Elle peut aussi consacrer une case à des petits cailloux, une autre à un seau avec des flacons de shampoing flottant sur la mer, une autre à une radio éteinte, etc. Cela s'inspire directement des mangas où les auteurs peuvent s'attarder sur un objet sur lequel se fixe le regard d'un personnage, ou transmettre la sensation qu'il éprouve en entendant le ressac de la mère.
Jillian Tamaki utilise ces outils narratifs graphiques à bon escient sans en abuser. À travers eux, le lecteur ressent le rythme plus calme des vacances, où il est possible de prendre le temps, de se laisser surprendre par l'environnement, son calme et ses caractéristiques. Elle n'en abuse pas car ses moments sont intégrés au récit, et ne deviennent pas un automatisme. Les personnages représentés par l'artiste sont banals et communs, sans être fades. Rose est une jeune adolescente, après une poussée de croissance, assez élancée. Windy est plus dodue, pas encore complètement sortie de l'enfance, et effectivement, avec un petit faible pour les sucreries. La mère de Rose est maigre, son père est bien découplé. La grand-mère de Windy vaut le détour pour sa façon d'être sans gêne et gentiment exigeante. Les jeunes adultes autour de la supérette respirent le plaisir de vivre et un cynisme de façade pour tenter de faire avec les réalités de la vie. Sans chichi ni esbroufe, les cases contiennent de nombreux détails qui font exister cet endroit : les aménagements des chambres et des pièces à vivre, la construction bon marché de la supérette, le désordre dans la chambre de Rose, à l'arrière de la supérette, les canapés un peu effondrés mais très confortables pour se vautrer dessus, les bois alentours et la plage.
Les dessins de Jillian Tamaki contiennent un niveau d'informations visuelles important, avec un trait un peu délié, transcrivant une partie de l'indolence propre aux vacances. Le lecteur se laisse porter par cette tranche de vie sympathique, agréable comme des jours passés à prendre son temps, sans rien d'important à faire, dans un environnement agréable et paisible. Bien sûr, il s'interroge sur ce que les cousines veulent lui raconter mais rien que cette reconstitution habile d'un été tranquille lui apporte une forme de détente et de nostalgie dépourvue de regret, de ces moments si particuliers. Les copines papotent entre elles, et Rose ressent, plus qu'elle n'analyse, le comportement des adultes.
Au travers de la narration, le lecteur ressent bien cette dichotomie, entre les temps passés avec Windy à son rythme en fonction de l'inspiration du moment, et ceux où Rose est amenée à côtoyer des adultes. Il accompagne bien volontiers Rose et Windy dans leur déambulation sur la plage, leurs jeux pour passer le temps, leurs interrogations sur leur corps de femme en devenir, leur regard curieux sur ces étranges adultes. Jillian et Mariko transcrivent ces petits rien avec une justesse de ton qui réchauffe le cœur pour cette insouciance dépourvue de mièvrerie. Ces 2 adolescentes transgressent quelques interdits, sans idée de rébellion, sans volonté de confrontation, juste l'envie de découvrir. Cela prend essentiellement la forme de visionnage de film d'horreur bien gore, sans traumatisme pour le lendemain, mais quand même avec des arrière-pensées sur les horreurs vues.
Le contraste lors des interactions avec les adultes provient du fait qu'il semble alors y avoir un enjeu mal circonscrit, pas complètement intelligible par Rose et Windy lorsqu'ils parlent. Il y a cette histoire de Jennifer enceinte d'un type qui ne veut pas en prendre la responsabilité. Rose est plus ou moins sous le charme de Dunc, grâce à son attitude nonchalante, mais tout en sentant qu'elle n'appartient pas à son monde, qu'elle n'est pas assez grande pour qu'il lui manifeste autre chose que l'intérêt qu'il porte à des enfants. Elle souhaite prendre pied dans son monde si incompréhensible, tout en ressentant que ses tentatives ne seront pas de la bonne nature. De la différence d'âge découle une différence de centres d'intérêt et de façon de voir le monde. Elle préfère de loin la sagesse simple et évidente de Windy, plus compréhensible. Le lecteur se rend alors compte que toutes ces nuances délicates sont montrées avec sensibilité, sans aucun texte explicatif, sans ficelle apparente, avec naturel et simplicité, comme si elles étaient évidentes.
Mariko et Jillian Tamaki font preuve d'une sensibilité encore plus subtile dans les interactions entre Rose et ses parents. Elles montrent avec un naturel confondant à quel point le jeune adolescent peut être mystifié par les remarques les plus anodines de ses parents. Par exemple, Evan (le père) s'éclate à écouter des chansons de Rush, en particulier à suivre le travail du batteur Neil Peart, alors que Rose a du mal à dépasser l'impression bizarre donnée par la voix haut perché de Geddy Lee (ce qui correspond exactement à la première impression lors de la découverte des morceaux de ce groupe). Le lecteur habitué à des récits reposant sur une intrigue est tout de suite accroché par le mystère qui enveloppe le comportement d'Alice, la mère de Rose. À nouveau, les auteures montrent la tension existant entre les époux, faite de petites irritations, de petits heurts de tous les jours. Elles montrent les réactions décalées d'Alice, inexpliquées, une sensibilité plus importante, un caractère déprimé, sans explication toute faite. Rose finit par apprendre ce qui mine ainsi sa mère pendant cet été. Ce n'est pas une révélation tonitruante, ce n'est pas un secret honteux, c'est encore moins un crime. Cette information est délivrée sans effet de manche, naturellement, parce que le temps est venu, en phase avec la tonalité générale de la narration. La fin des vacances arrive, le quotidien reprendra ses droits, et la vie continuera.
En refermant le livre, le lecteur se rend compte qu'il aurait bien aimé passer encore quelques jours (quelques pages) avec Rose. Il se dit que le drame d'Alice tout aussi ordinaire qu'il soit, a été évoqué avec sensibilité et intelligence émotionnelle, que l'absence de sensationnalisme le rend plus concret et touchant. Puis il remarque qu'un autre fil narratif parle de la même question d'un point de vue très différent parce que les circonstances pour les personnages concernés sont différentes (la situation de Jennifer). Ainsi les auteures relient l'universalité de la douleur ressentie par Alice, avec le cas particulier de la vie de chacun pour un événement dépendant de contingences sur lesquelles les individus n'ont aucune prise, qu'ils ne peuvent que subir. Il prend également conscience qu'ils ont lu une histoire racontée à la manière de Rose, avec son état d'esprit, sa maturité de jeune adolescente. Loin d'être réducteur, ce positionnement narratif est un tour de force car il permet de voir le monde par les yeux de Rose, de retrouver une part d'innocence, tout en se rappelant que ce n'est pas synonyme d'égocentrisme ou d'indifférence.
Ce récit tranche sur la production industrielle de bande dessinée, de toutes les manières possibles. Les dessins sont personnels, reflétant la sensibilité des auteures, mais aussi de leur personnage principal. Cette tranche de vie est vécue de manière prosaïque, sans aucun effet dramatisant, mais avec une justesse exceptionnelle. La vie normale conserve toute sa banalité, sans rien perdre de sa diversité et de sa complexité. Le lecteur a l'impression d'avoir retrouvé ses vacances insouciantes de ses jeunes années, sans rien perdre de l'étrangeté du monde des adultes, des événements dont la compréhension reste hors de son atteinte, mais dont les effets émotionnels l'atteignent et l'affectent incidemment. Jillian et Mariko Tamaki racontent avec naturel et aisance une tranche de vie d'une jeune adolescente normale, en en transcrivant toutes les subtilités les plus délicates.
Tous les étés, Rose va à Awako Beach, avec ses parent Alice & Evan. Ils louent un chalet d'où l'on peut se rendre à la plage à pied. Rose y retrouve tous les étés Windy de 18 mois sa cadette. Cet été ne déroge pas à la règle. Rose prend plaisir à retrouver sa chambre et se laisser tomber sur le lit. Avec l'autorisation de sa mère, elle prend son vélo pour se rendre au bungalow de Windy où elle salue sa mère Evelyn. Les 2 copines se rendent ensuite à la plage en papotant de la communauté lesbienne où Windy a passé quelques jours avec sa mère, de l'absence de petit copain pour Rose. Puis elles vont acheter des sucreries à la supérette du coin, tenue par un grand adolescent ou un jeune adulte appelé Dunc.
Le séjour se déroule au rythme indolent des vacances : se lever tard et rester au lit pour lire, regarder son père préparer le barbecue, aller à la plage, papoter de tout et de rien avec Windy, de la future taille de leurs seins, retourner acheter des trucs à la supérette, y louer des DVD, essentiellement des films d'horreur, regarder Massacre à la tronçonneuse (1974) chez Windy le soir, pendant que sa mère n'est pas là, etc. Mais Rose est une jeune adolescente sensible aux émotions autour d'elle, et curieuse de la conversation des autres. Sans aller jusqu'à espionner, elle entend des bribes de ci de là. Elle ressent le vague à l'âme de sa mère et la frustration que cela engendre chez son père. Avec Windy, elle se moque des jeunes adultes qui se rassemblent pour glander autour de la supérette, tout en comprenant à demi-mots que l'une des jeunes femmes craint d'être tombée enceinte.
L'éditeur First Second ne publie pas beaucoup de romans graphiques, mais ils sortent tous de l'ordinaire : Red Handed: The fine art of strange crimes de Matt Kindt, The sculptor de Scott McCloud, The fate of the artist d'Eddie Campbell… Le lecteur sait déjà qu'il aura affaire avec un récit qui sort de l'ordinaire de la production. Ensuite il est réalisé par 2 femmes qui sont cousines, ce qui tranche avec la production industrielle des comics, essentiellement masculine. Enfin il a pour thème une tranche de vie, du point de vue d'une jeune adolescente pendant une période de vacances. Dès les premières pages, le lecteur ressent une empathie pour Rose, jeune fille sympathique, curieuse, normale sans agressivité ou traumatisme particulier. Il apprécie également l'ambiance graphique, très prosaïque, sans affèterie.
La première page est déconcertante puisqu'il n'y a que quelques onomatopées, et quelques vagues tâches. La suivante fait tout de suite penser à un manga, une approche graphique de type seinen, avec une pointe de shojo. Effectivement, en page 6, Rose est en train de lire un shojo pendant le trajet en voiture. Contrairement à la plupart des dessinateurs américains, Jillian Tamaki n'applique pas à la lettre les conventions de surface des mangas, mais s'inspire de l'esprit. Elle n'hésite pas à insérer des pages silencieuses, ou à accorder de l'espace sur la page à des petits riens. Elle peut consacrer une double page à Windy en train de danser, une autre aux nuages étirés dans le ciel, une autre au plein soleil. Elle peut aussi consacrer une case à des petits cailloux, une autre à un seau avec des flacons de shampoing flottant sur la mer, une autre à une radio éteinte, etc. Cela s'inspire directement des mangas où les auteurs peuvent s'attarder sur un objet sur lequel se fixe le regard d'un personnage, ou transmettre la sensation qu'il éprouve en entendant le ressac de la mère.
Jillian Tamaki utilise ces outils narratifs graphiques à bon escient sans en abuser. À travers eux, le lecteur ressent le rythme plus calme des vacances, où il est possible de prendre le temps, de se laisser surprendre par l'environnement, son calme et ses caractéristiques. Elle n'en abuse pas car ses moments sont intégrés au récit, et ne deviennent pas un automatisme. Les personnages représentés par l'artiste sont banals et communs, sans être fades. Rose est une jeune adolescente, après une poussée de croissance, assez élancée. Windy est plus dodue, pas encore complètement sortie de l'enfance, et effectivement, avec un petit faible pour les sucreries. La mère de Rose est maigre, son père est bien découplé. La grand-mère de Windy vaut le détour pour sa façon d'être sans gêne et gentiment exigeante. Les jeunes adultes autour de la supérette respirent le plaisir de vivre et un cynisme de façade pour tenter de faire avec les réalités de la vie. Sans chichi ni esbroufe, les cases contiennent de nombreux détails qui font exister cet endroit : les aménagements des chambres et des pièces à vivre, la construction bon marché de la supérette, le désordre dans la chambre de Rose, à l'arrière de la supérette, les canapés un peu effondrés mais très confortables pour se vautrer dessus, les bois alentours et la plage.
Les dessins de Jillian Tamaki contiennent un niveau d'informations visuelles important, avec un trait un peu délié, transcrivant une partie de l'indolence propre aux vacances. Le lecteur se laisse porter par cette tranche de vie sympathique, agréable comme des jours passés à prendre son temps, sans rien d'important à faire, dans un environnement agréable et paisible. Bien sûr, il s'interroge sur ce que les cousines veulent lui raconter mais rien que cette reconstitution habile d'un été tranquille lui apporte une forme de détente et de nostalgie dépourvue de regret, de ces moments si particuliers. Les copines papotent entre elles, et Rose ressent, plus qu'elle n'analyse, le comportement des adultes.
Au travers de la narration, le lecteur ressent bien cette dichotomie, entre les temps passés avec Windy à son rythme en fonction de l'inspiration du moment, et ceux où Rose est amenée à côtoyer des adultes. Il accompagne bien volontiers Rose et Windy dans leur déambulation sur la plage, leurs jeux pour passer le temps, leurs interrogations sur leur corps de femme en devenir, leur regard curieux sur ces étranges adultes. Jillian et Mariko transcrivent ces petits rien avec une justesse de ton qui réchauffe le cœur pour cette insouciance dépourvue de mièvrerie. Ces 2 adolescentes transgressent quelques interdits, sans idée de rébellion, sans volonté de confrontation, juste l'envie de découvrir. Cela prend essentiellement la forme de visionnage de film d'horreur bien gore, sans traumatisme pour le lendemain, mais quand même avec des arrière-pensées sur les horreurs vues.
Le contraste lors des interactions avec les adultes provient du fait qu'il semble alors y avoir un enjeu mal circonscrit, pas complètement intelligible par Rose et Windy lorsqu'ils parlent. Il y a cette histoire de Jennifer enceinte d'un type qui ne veut pas en prendre la responsabilité. Rose est plus ou moins sous le charme de Dunc, grâce à son attitude nonchalante, mais tout en sentant qu'elle n'appartient pas à son monde, qu'elle n'est pas assez grande pour qu'il lui manifeste autre chose que l'intérêt qu'il porte à des enfants. Elle souhaite prendre pied dans son monde si incompréhensible, tout en ressentant que ses tentatives ne seront pas de la bonne nature. De la différence d'âge découle une différence de centres d'intérêt et de façon de voir le monde. Elle préfère de loin la sagesse simple et évidente de Windy, plus compréhensible. Le lecteur se rend alors compte que toutes ces nuances délicates sont montrées avec sensibilité, sans aucun texte explicatif, sans ficelle apparente, avec naturel et simplicité, comme si elles étaient évidentes.
Mariko et Jillian Tamaki font preuve d'une sensibilité encore plus subtile dans les interactions entre Rose et ses parents. Elles montrent avec un naturel confondant à quel point le jeune adolescent peut être mystifié par les remarques les plus anodines de ses parents. Par exemple, Evan (le père) s'éclate à écouter des chansons de Rush, en particulier à suivre le travail du batteur Neil Peart, alors que Rose a du mal à dépasser l'impression bizarre donnée par la voix haut perché de Geddy Lee (ce qui correspond exactement à la première impression lors de la découverte des morceaux de ce groupe). Le lecteur habitué à des récits reposant sur une intrigue est tout de suite accroché par le mystère qui enveloppe le comportement d'Alice, la mère de Rose. À nouveau, les auteures montrent la tension existant entre les époux, faite de petites irritations, de petits heurts de tous les jours. Elles montrent les réactions décalées d'Alice, inexpliquées, une sensibilité plus importante, un caractère déprimé, sans explication toute faite. Rose finit par apprendre ce qui mine ainsi sa mère pendant cet été. Ce n'est pas une révélation tonitruante, ce n'est pas un secret honteux, c'est encore moins un crime. Cette information est délivrée sans effet de manche, naturellement, parce que le temps est venu, en phase avec la tonalité générale de la narration. La fin des vacances arrive, le quotidien reprendra ses droits, et la vie continuera.
En refermant le livre, le lecteur se rend compte qu'il aurait bien aimé passer encore quelques jours (quelques pages) avec Rose. Il se dit que le drame d'Alice tout aussi ordinaire qu'il soit, a été évoqué avec sensibilité et intelligence émotionnelle, que l'absence de sensationnalisme le rend plus concret et touchant. Puis il remarque qu'un autre fil narratif parle de la même question d'un point de vue très différent parce que les circonstances pour les personnages concernés sont différentes (la situation de Jennifer). Ainsi les auteures relient l'universalité de la douleur ressentie par Alice, avec le cas particulier de la vie de chacun pour un événement dépendant de contingences sur lesquelles les individus n'ont aucune prise, qu'ils ne peuvent que subir. Il prend également conscience qu'ils ont lu une histoire racontée à la manière de Rose, avec son état d'esprit, sa maturité de jeune adolescente. Loin d'être réducteur, ce positionnement narratif est un tour de force car il permet de voir le monde par les yeux de Rose, de retrouver une part d'innocence, tout en se rappelant que ce n'est pas synonyme d'égocentrisme ou d'indifférence.
Ce récit tranche sur la production industrielle de bande dessinée, de toutes les manières possibles. Les dessins sont personnels, reflétant la sensibilité des auteures, mais aussi de leur personnage principal. Cette tranche de vie est vécue de manière prosaïque, sans aucun effet dramatisant, mais avec une justesse exceptionnelle. La vie normale conserve toute sa banalité, sans rien perdre de sa diversité et de sa complexité. Le lecteur a l'impression d'avoir retrouvé ses vacances insouciantes de ses jeunes années, sans rien perdre de l'étrangeté du monde des adultes, des événements dont la compréhension reste hors de son atteinte, mais dont les effets émotionnels l'atteignent et l'affectent incidemment. Jillian et Mariko Tamaki racontent avec naturel et aisance une tranche de vie d'une jeune adolescente normale, en en transcrivant toutes les subtilités les plus délicates.
Comme chaque été, Rose va passer les vacances d'été à Awago Beach avec ses parents. Elle y retrouve sa copine d'enfance Windy, et, ensemble, vont passer leur temps entre discussions, plage, virées à la supérette, visionnage de films d'horreur et observations des jeunes du coin.
On découvre alors une tranche de vie contée et dessinée avec talent, un portrait de pré-ado, au moment du balancement entre enfance et entrée dans l'adolescence. Partagée entre l'envie de retrouver ses jeux d'enfance et l'attirance pour les mystères du monde adulte.
C'est sensible et les dessins sont réussis. Les ambiances ressortent vraiment avec force.
Mais je ne suis pas complètement emballée, gênée par un petit quelque chose que j'ai du mal à définir, peut-être l'aspect un peu trop noir de tout ça, un petit côté glauque et déprimant qui ne me donnent pas trop envie d'encourager les jeunes à lire cette BD.
On découvre alors une tranche de vie contée et dessinée avec talent, un portrait de pré-ado, au moment du balancement entre enfance et entrée dans l'adolescence. Partagée entre l'envie de retrouver ses jeux d'enfance et l'attirance pour les mystères du monde adulte.
C'est sensible et les dessins sont réussis. Les ambiances ressortent vraiment avec force.
Mais je ne suis pas complètement emballée, gênée par un petit quelque chose que j'ai du mal à définir, peut-être l'aspect un peu trop noir de tout ça, un petit côté glauque et déprimant qui ne me donnent pas trop envie d'encourager les jeunes à lire cette BD.
Suite à mon envie de me mettre aux romans graphiques, j'ai pris celui là en tant que 2e lecture dans ce genre.
Les dessins étaient magnifiques, voilà le point fort.
L'histoire était assez intéressante mais ça ne m'a pas tellement marqué. Je pense que d'ici quelques jours j'aurai oublié une bonne partie de ce qui s'est passé, et ça ne me fais rien.
Vais-je pouvoir apprécier des romans graphiques / BD ??
Les dessins étaient magnifiques, voilà le point fort.
L'histoire était assez intéressante mais ça ne m'a pas tellement marqué. Je pense que d'ici quelques jours j'aurai oublié une bonne partie de ce qui s'est passé, et ça ne me fais rien.
Vais-je pouvoir apprécier des romans graphiques / BD ??
Petite déception que cette BD que j'avais découverte lors d'une Masse Critique Babelio et avait de suite noté dans ma wishlist.
Cette bande dessinée raconte l'été de Rose et de Windy, qui ne sont plus tout à fait des enfants mais pas encore des adolescentes. Les sujets abordés ( adolescence, suicide, dépression) auraient pu être intéressants, mais les dialogues souvent vulgaires m'ont dérangés.
Cette bande dessinée raconte l'été de Rose et de Windy, qui ne sont plus tout à fait des enfants mais pas encore des adolescentes. Les sujets abordés ( adolescence, suicide, dépression) auraient pu être intéressants, mais les dialogues souvent vulgaires m'ont dérangés.
Zoé, Dany et Fiona se retrouvent à New York pour y passer quelques jours. Ce moment est une occasion pour elles de s'amuser et de découvrir la ville. Les voilà parties à l’aventure à travers les rues, à visiter des lieux emblématiques, à savourer des pizzas et à faire des rencontres inattendues.
Au fil des jours, les trois jeunes femmes apprennent à se connaître davantage, tout en faisant face à des défis tels que l'acceptation mutuelle, le soutien et la réconciliation.
Ce roman graphique de plus de 400 pages, célèbre l'amitié, la découverte et la liberté, explorant des thèmes comme la fragilité des liens amicaux, l'influence d'autrui, les nouvelles expériences, les relations humaines et les histoires amoureuses.
Après "Cet été là" de Jillian & Mariko Tamaki et "Mes rupture avec Laura Dean" scénarisé par Mariko Tamaki et illustré par @hirosemaryhello, nous sommes ravis de plonger dans l'univers de ce New York, New York qui se révèle être un album immersif aux dialogues naturels et ou l'intimité d'un trio hétéroclite se dévoile avec ses humeurs changeantes, ses rapprochements et les émotions qui en découlent.
Lien : https://www.instagram.com/bd..
Au fil des jours, les trois jeunes femmes apprennent à se connaître davantage, tout en faisant face à des défis tels que l'acceptation mutuelle, le soutien et la réconciliation.
Ce roman graphique de plus de 400 pages, célèbre l'amitié, la découverte et la liberté, explorant des thèmes comme la fragilité des liens amicaux, l'influence d'autrui, les nouvelles expériences, les relations humaines et les histoires amoureuses.
Après "Cet été là" de Jillian & Mariko Tamaki et "Mes rupture avec Laura Dean" scénarisé par Mariko Tamaki et illustré par @hirosemaryhello, nous sommes ravis de plonger dans l'univers de ce New York, New York qui se révèle être un album immersif aux dialogues naturels et ou l'intimité d'un trio hétéroclite se dévoile avec ses humeurs changeantes, ses rapprochements et les émotions qui en découlent.
Lien : https://www.instagram.com/bd..
Cet été là est un roman graphique que j'ai lue il y a déjà quelques semaines. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouver l'histoire très jolie. Les deux fillettes qui ont un écart d'âge assez grand pour les séparer (18 mois quand ont a 11 et 13 ans, ca parait énorme!) se retrouves pourtant avec joie dans cette bulle de bonheur familiale, presque hors du temps.
Comme dit plutôt, j'ai trouver cet immense album très mignon, très jolie. Sans être toute fois boulversée. Avec le recul, je visualise toutefois très mal qui est le public cible pour cette oeuvre de fiction de Jillian et Mariko Tamaki. Les jeunes lecteurs adolescents trouveront ce roman d'un ennui mortel (cela aurait été mon cas, je l'avoue) et pour moi, en tant qu'adulte, je n'y vois qu'une histoire mignonne d'enfant mais sans grand intérêt. Peut-être que c'est les jeunes dans la vingtaine qui apprécieront d'avantage Cet été là, pouvant y retrouver leurs enfance maintenant disparue. Mais pour moi, c'est un peu tombé a plat. Que voulez vous, j'ai surement le coeur sec comme le désert!!
Comme dit plutôt, j'ai trouver cet immense album très mignon, très jolie. Sans être toute fois boulversée. Avec le recul, je visualise toutefois très mal qui est le public cible pour cette oeuvre de fiction de Jillian et Mariko Tamaki. Les jeunes lecteurs adolescents trouveront ce roman d'un ennui mortel (cela aurait été mon cas, je l'avoue) et pour moi, en tant qu'adulte, je n'y vois qu'une histoire mignonne d'enfant mais sans grand intérêt. Peut-être que c'est les jeunes dans la vingtaine qui apprécieront d'avantage Cet été là, pouvant y retrouver leurs enfance maintenant disparue. Mais pour moi, c'est un peu tombé a plat. Que voulez vous, j'ai surement le coeur sec comme le désert!!
Un été comme tous les étés...Rose vient avec ses parents au lac Awago, comme chaque année.
Comme chaque année, elle y retrouve Windy, son amie de vacances.
Mais cette année, les choses sont un peu différentes. Les parents de Rose ont des rapports un peu difficiles sans que la jeune fille comprenne vraiment pourquoi. Et puis il y a ce garçon qui s'occupe du seul drugstore...
Une histoire sympathique, une tranche de vie de cet âge particulier entre l'enfance et l'adolescence. Une époque où les centres d'intérêt changent mais où on n'en a pas toujours vraiment envie...où on veut être considérée comme un adulte mais encore tellement besoin d'être câlinée, entourée.
Une lecture plaisante et bien réalisée mais je ne comprends pas vraiment tout le battage qu'il a généré.
Comme chaque année, elle y retrouve Windy, son amie de vacances.
Mais cette année, les choses sont un peu différentes. Les parents de Rose ont des rapports un peu difficiles sans que la jeune fille comprenne vraiment pourquoi. Et puis il y a ce garçon qui s'occupe du seul drugstore...
Une histoire sympathique, une tranche de vie de cet âge particulier entre l'enfance et l'adolescence. Une époque où les centres d'intérêt changent mais où on n'en a pas toujours vraiment envie...où on veut être considérée comme un adulte mais encore tellement besoin d'être câlinée, entourée.
Une lecture plaisante et bien réalisée mais je ne comprends pas vraiment tout le battage qu'il a généré.
Ce tome contient une histoire complète indépendante de toute autre qui ne nécessite pas de lecture ou de connaissance préalable pour être comprise. Il comprend les 4 épisodes de la minisérie, initialement parus en 2017, écrits par Mariko Tamaki, dessinés par Joëlle Jones, encrés par Jones, à l'exception du premier épisode qui est encré par Sandu Florea, et mis en couleurs par Kelly Fitzpatrick.
Dans un champ, non loin de Midvale, une fusée s'écrase à proximité d'une grange et une voiture s'arrête pour que le couple aille voir de quoi il en retourne. Au temps présent, c'est la photographie de classe pour le livre d'année, alors que c'est le début de l'année. Dolly Ganger est venue avec un teeshirt portant une inscription drôle. Elle enlève sa casquette de baseball avant la photographie, découvrant une belle mèche de cheveux bleus. Jennifer Bard s'attache les cheveux en arrière en conservant sous sweater. Kara Danvers se rend compte qu'elle a un bouton qui commence à pousser au niveau de la mâchoire, sans réussir à le percer. Elles se rendent ensuite toutes les trois au cours de sport, où la coach Stone leur remet une montre connectée pour pouvoir surveiller et enregistrer des paramètres physiologiques. Après le sport, elles se rendent au diner local, l'une pour consommer un bon hamburger, l'autre une salade pour respecter son régime de sportive. Après avoir travaillé ensemble sur leurs devoirs, le temps est venu pour chacune de rentrer chez elle.
Kara rentre à la ferme et retrouve ses parents adoptifs Eliza et Jeremiah Danvers. Son père ne fête pas ses propres anniversaires et a toujours vécu à la ferme. Avant que Kara n'aille finir ses devoirs, il lui demande de venir l'aider dans la grange, pour déplacer un tracteur. Kara le soulève à main nue. Elle jette ensuite un coup d'œil au vaisseau dans lequel elle est arrivée sur Terre frappé d'un emblème qui ressemble à un S dans un pentagone. Elle pense au rêve étrange qu'elle fait chaque nuit, où elle se trouve dans un aéroport ou une gare ferroviaire, et elle regarde l'obscurité à travers une vitre. Elle décide d'aller voler un peu dans le ciel pour prendre l'air. Puis elle revient dans sa chambre et se plonge dans la lecture de L'insoutenable légèreté de l'être (1982) de Milan Kundera. Le matin elle se lève et va percer son bouton dans la salle de bain, avec des résultats peu ragoutants, une façon peu agréable de commencer la journée de ses 16 ans. Le train-train reprend le dessus, avec une journée de cours peu excitante, un peu de sport, et ses mains qui se mettent à luire de manière inopportune dans les vestiaires alors qu'elle s'y trouve seule.
Supergirl avait-elle besoin d'une nouvelle itération de ses origines ? Quoi qu'il en soit, le lecteur a conscience que cette histoire est déconnectée de toute continuité et qu'elle propose une version à prendre pour elle-même, devant justifier son existence, sans rapport avec une série continue, ou des développements ultérieurs. Le lecteur relève le nom des auteures. Mariko Tamaki s'est fait connaitre en tant que co-auteure de l'excellente chronique adolescente This one summer (avec Jilian Tamaki) et une saison très personnelle de She-Hulk. Joëlle Jones a réalisé 2 saisons épatantes de Lady Killer et a participé au mariage Batman Vol. 7: The Wedding écrit par Tom King. Par la force des choses, le personnage de Supergirl étant assez connu, le début du récit passe par toutes les étapes attendues : son arrivée sur Terre (en 1 page), sa relation avec ses parents (un père un peu psychorigide et s'en tenant à des certitudes qu'il a érigées en autant de principes, une mère compréhensive et attentionnée), ses 2 meilleures copines, la vie au lycée, l'utilisation de ses pouvoirs en catimini de peur de la réaction des citoyens lambda, le drame personnel (la mort d'une personne qui lui est chère) qui va déclencher sa vocation de superhéroïne. Mais s'il a succombé à la tentation de ce tome, le lecteur est surtout venu rechercher les particularités des auteures.
Joëlle Jones a donc illustré ces 4 épisodes de 42 pages chacun. Elle a choisi de donner une silhouette d'adolescente longiligne à Kara Danvers, en cohérence totale avec la nature du récit. Elle ne porte aucun costume de superhéros du début jusqu'à la fin, et porte donc des vêtements ordinaires et très fonctionnels : jean, chemisier, pull, débardeur, pyjama très confortable, short et teeshirt pour le sport, basket, blouson. Il n'y a qu'à l'occasion de l'enterrement qu'elle porte une robe noire avec un boléro carmin. Les tenues de ses copines sont tout aussi basiques et normales, Jennifer étant un peu plus affinée que Kara du fait de son régime de sportive et d'une pratique du sport plus intensive. Dolly est un peu plus enrobée du fait de son appréciation pour la nourriture de fastfood. Les autres personnages ont des tenues vestimentaires adaptées à leur âge, salopette et chemise en jean pour le père, robe ample pour la mère, etc. L'artiste sait donner l'impression d'une Amérique rurale, vivant de manière simple, mais sans cette patine intemporelle propre à Ma & Pa Kent figés dans l'Amérique des années 1950. Elle s'investit fortement dans la représentation des différents environnements : gymnase du lycée, piste de course du stade, cuisine un peu encombrée des Danvers, grange avec du matériel agricole, salle de bain à l'aménagement un peu vieillot, salle de cours et vestiaires fonctionnels, cantine impersonnelle, paysages ruraux à base de grands espaces, chantier de construction désaffecté, chambre parentale confortable sans être luxueuse. Les décors sont présents avec une plus grande régularité que dans un comics de superhéros industriel, avec un niveau de détails satisfaisant.
L'enjeu visuel de cette histoire est de montrer une vie quotidienne plausible, sans tomber dans l'image d'Épinal figée dans un passé idéalisé. Kara Danvers est présente sur toutes les pages car le récit se focalise sur elle. Jones sait lui donner des postures naturelles, gracieuses sans donner l'impression d'avoir été piochées dans un magazine de mode. Le lecteur observe une jeune fille naturelle, se déplaçant normalement, avec des réactions émotionnelles à l'intensité cohérente avec son âge. Il voit Kara utiliser discrètement ses pouvoirs, là encore avec un grand naturel, une chose normale pour elle, qui n'est plus sujet à un émerveillement, mais sans qu'elle ne soit blasée pour autant. Joëlle Jones se montre très à l'aise dans les gestes de tous les jours, dans les petits détails du quotidien, dans les différents types de marque d'affection, qui ne sont pas les mêmes entre amies, ou entre une mère et sa fille. Elle met en scène avec le même naturel les scènes d'action : le tracteur soulevé d'une main, l'envol dans le ciel, les manifestations lumineuses corporelles involontaires de Kara, l'affrontement physique contre Tan-On dans le dernier épisode. Le fait que chaque scène ait l'air naturel n'est pas synonyme d'insipidité, loin de là. Le lecteur est régulièrement surpris soit par un dessin (Kara enveloppée dans une couverture de survie, ou en train de percer son bouton), ou par une séquence à la mise en scène très fluide ou au découpage en cases bien pensé.
Le lecteur retrouve toute la sensibilité de Mariko Tamaki, et sa capacité à faire exister ses personnages, sans sensiblerie ni stéréotype émotionnel. Alors qu'elle respecte à la fois les points de passage obligés d'un récit mettant en scène une adolescente dans un milieu rural, et les étapes obligatoires du développement de ses pouvoirs, la scénariste raconte une histoire spécifique, unique du fait de la personnalité de Kara et de son histoire personnelle, inattendue du fait des rebondissements. En effet, soit le lecteur ne connaît pas le personnage et il a tout à découvrir. Soit il connaît déjà le personnage, mais il se rend compte que cette histoire des origines est autonome, sans avoir de compte à rendre à une continuité ou à une autre, ce qui l'autorise à la raconter comme elle l'entend. De fait, il ne s'agit pas du récit habituel, même si Kara vient bien de Krypton et qu'elle dispose des pouvoirs attendus. Sous le charme discret et naturel de Kara, le lecteur partage ses émotions, que ce soit l'amitié avec ses copines qui n'ont rien de pimbêches, d'écervelées ou de cyniques avant l'heure, avec ses parents (sa tendresse pour sa mère, son respect décillé pour son père malgré ses défauts), son deuil pour l'être cher trouvant la mort, sa colère face à la trahison, son espoir dans l'avenir en découvrant un individu disposant de pouvoirs identiques au sien, etc. Comme à son habitude, Mariko Tamaki sait faire exister Kara sous les yeux du lecteur, lui donne vie avec une personnalité propre sans être excentrique ou caricaturale, avec une aisance remarquable.
Bien sûr que SUpergirl n'a pas besoin d'une énième origine secrète pour la mettre à jour dans une continuité percluse d'incohérence. Cela n'enlève rien à la qualité de ce récit qui montre une adolescente passer le cap des 16 ans et commencer à prendre une indépendance, à la fois contrainte par les événements, et à la fois soutenue par ses proches, dans une mise en image très agréable, cohérente avec la vision de la scénariste. Le lecteur prend plaisir à passer ces moments de lecture, avec une demoiselle sympathique sans être nunuche ou déjà adulte, réalisant progressivement que le monde des adultes est plus complexe que celui de l'enfance, promettant des aventures pour un futur qui n'est pas encore déterminé, rempli de potentiels, aussi bien celui de déterminer que faire de ses aptitudes, que rencontrer d'autres personnes partageant ses convictions, ses valeurs, ses centres d'intérêt.
Dans un champ, non loin de Midvale, une fusée s'écrase à proximité d'une grange et une voiture s'arrête pour que le couple aille voir de quoi il en retourne. Au temps présent, c'est la photographie de classe pour le livre d'année, alors que c'est le début de l'année. Dolly Ganger est venue avec un teeshirt portant une inscription drôle. Elle enlève sa casquette de baseball avant la photographie, découvrant une belle mèche de cheveux bleus. Jennifer Bard s'attache les cheveux en arrière en conservant sous sweater. Kara Danvers se rend compte qu'elle a un bouton qui commence à pousser au niveau de la mâchoire, sans réussir à le percer. Elles se rendent ensuite toutes les trois au cours de sport, où la coach Stone leur remet une montre connectée pour pouvoir surveiller et enregistrer des paramètres physiologiques. Après le sport, elles se rendent au diner local, l'une pour consommer un bon hamburger, l'autre une salade pour respecter son régime de sportive. Après avoir travaillé ensemble sur leurs devoirs, le temps est venu pour chacune de rentrer chez elle.
Kara rentre à la ferme et retrouve ses parents adoptifs Eliza et Jeremiah Danvers. Son père ne fête pas ses propres anniversaires et a toujours vécu à la ferme. Avant que Kara n'aille finir ses devoirs, il lui demande de venir l'aider dans la grange, pour déplacer un tracteur. Kara le soulève à main nue. Elle jette ensuite un coup d'œil au vaisseau dans lequel elle est arrivée sur Terre frappé d'un emblème qui ressemble à un S dans un pentagone. Elle pense au rêve étrange qu'elle fait chaque nuit, où elle se trouve dans un aéroport ou une gare ferroviaire, et elle regarde l'obscurité à travers une vitre. Elle décide d'aller voler un peu dans le ciel pour prendre l'air. Puis elle revient dans sa chambre et se plonge dans la lecture de L'insoutenable légèreté de l'être (1982) de Milan Kundera. Le matin elle se lève et va percer son bouton dans la salle de bain, avec des résultats peu ragoutants, une façon peu agréable de commencer la journée de ses 16 ans. Le train-train reprend le dessus, avec une journée de cours peu excitante, un peu de sport, et ses mains qui se mettent à luire de manière inopportune dans les vestiaires alors qu'elle s'y trouve seule.
Supergirl avait-elle besoin d'une nouvelle itération de ses origines ? Quoi qu'il en soit, le lecteur a conscience que cette histoire est déconnectée de toute continuité et qu'elle propose une version à prendre pour elle-même, devant justifier son existence, sans rapport avec une série continue, ou des développements ultérieurs. Le lecteur relève le nom des auteures. Mariko Tamaki s'est fait connaitre en tant que co-auteure de l'excellente chronique adolescente This one summer (avec Jilian Tamaki) et une saison très personnelle de She-Hulk. Joëlle Jones a réalisé 2 saisons épatantes de Lady Killer et a participé au mariage Batman Vol. 7: The Wedding écrit par Tom King. Par la force des choses, le personnage de Supergirl étant assez connu, le début du récit passe par toutes les étapes attendues : son arrivée sur Terre (en 1 page), sa relation avec ses parents (un père un peu psychorigide et s'en tenant à des certitudes qu'il a érigées en autant de principes, une mère compréhensive et attentionnée), ses 2 meilleures copines, la vie au lycée, l'utilisation de ses pouvoirs en catimini de peur de la réaction des citoyens lambda, le drame personnel (la mort d'une personne qui lui est chère) qui va déclencher sa vocation de superhéroïne. Mais s'il a succombé à la tentation de ce tome, le lecteur est surtout venu rechercher les particularités des auteures.
Joëlle Jones a donc illustré ces 4 épisodes de 42 pages chacun. Elle a choisi de donner une silhouette d'adolescente longiligne à Kara Danvers, en cohérence totale avec la nature du récit. Elle ne porte aucun costume de superhéros du début jusqu'à la fin, et porte donc des vêtements ordinaires et très fonctionnels : jean, chemisier, pull, débardeur, pyjama très confortable, short et teeshirt pour le sport, basket, blouson. Il n'y a qu'à l'occasion de l'enterrement qu'elle porte une robe noire avec un boléro carmin. Les tenues de ses copines sont tout aussi basiques et normales, Jennifer étant un peu plus affinée que Kara du fait de son régime de sportive et d'une pratique du sport plus intensive. Dolly est un peu plus enrobée du fait de son appréciation pour la nourriture de fastfood. Les autres personnages ont des tenues vestimentaires adaptées à leur âge, salopette et chemise en jean pour le père, robe ample pour la mère, etc. L'artiste sait donner l'impression d'une Amérique rurale, vivant de manière simple, mais sans cette patine intemporelle propre à Ma & Pa Kent figés dans l'Amérique des années 1950. Elle s'investit fortement dans la représentation des différents environnements : gymnase du lycée, piste de course du stade, cuisine un peu encombrée des Danvers, grange avec du matériel agricole, salle de bain à l'aménagement un peu vieillot, salle de cours et vestiaires fonctionnels, cantine impersonnelle, paysages ruraux à base de grands espaces, chantier de construction désaffecté, chambre parentale confortable sans être luxueuse. Les décors sont présents avec une plus grande régularité que dans un comics de superhéros industriel, avec un niveau de détails satisfaisant.
L'enjeu visuel de cette histoire est de montrer une vie quotidienne plausible, sans tomber dans l'image d'Épinal figée dans un passé idéalisé. Kara Danvers est présente sur toutes les pages car le récit se focalise sur elle. Jones sait lui donner des postures naturelles, gracieuses sans donner l'impression d'avoir été piochées dans un magazine de mode. Le lecteur observe une jeune fille naturelle, se déplaçant normalement, avec des réactions émotionnelles à l'intensité cohérente avec son âge. Il voit Kara utiliser discrètement ses pouvoirs, là encore avec un grand naturel, une chose normale pour elle, qui n'est plus sujet à un émerveillement, mais sans qu'elle ne soit blasée pour autant. Joëlle Jones se montre très à l'aise dans les gestes de tous les jours, dans les petits détails du quotidien, dans les différents types de marque d'affection, qui ne sont pas les mêmes entre amies, ou entre une mère et sa fille. Elle met en scène avec le même naturel les scènes d'action : le tracteur soulevé d'une main, l'envol dans le ciel, les manifestations lumineuses corporelles involontaires de Kara, l'affrontement physique contre Tan-On dans le dernier épisode. Le fait que chaque scène ait l'air naturel n'est pas synonyme d'insipidité, loin de là. Le lecteur est régulièrement surpris soit par un dessin (Kara enveloppée dans une couverture de survie, ou en train de percer son bouton), ou par une séquence à la mise en scène très fluide ou au découpage en cases bien pensé.
Le lecteur retrouve toute la sensibilité de Mariko Tamaki, et sa capacité à faire exister ses personnages, sans sensiblerie ni stéréotype émotionnel. Alors qu'elle respecte à la fois les points de passage obligés d'un récit mettant en scène une adolescente dans un milieu rural, et les étapes obligatoires du développement de ses pouvoirs, la scénariste raconte une histoire spécifique, unique du fait de la personnalité de Kara et de son histoire personnelle, inattendue du fait des rebondissements. En effet, soit le lecteur ne connaît pas le personnage et il a tout à découvrir. Soit il connaît déjà le personnage, mais il se rend compte que cette histoire des origines est autonome, sans avoir de compte à rendre à une continuité ou à une autre, ce qui l'autorise à la raconter comme elle l'entend. De fait, il ne s'agit pas du récit habituel, même si Kara vient bien de Krypton et qu'elle dispose des pouvoirs attendus. Sous le charme discret et naturel de Kara, le lecteur partage ses émotions, que ce soit l'amitié avec ses copines qui n'ont rien de pimbêches, d'écervelées ou de cyniques avant l'heure, avec ses parents (sa tendresse pour sa mère, son respect décillé pour son père malgré ses défauts), son deuil pour l'être cher trouvant la mort, sa colère face à la trahison, son espoir dans l'avenir en découvrant un individu disposant de pouvoirs identiques au sien, etc. Comme à son habitude, Mariko Tamaki sait faire exister Kara sous les yeux du lecteur, lui donne vie avec une personnalité propre sans être excentrique ou caricaturale, avec une aisance remarquable.
Bien sûr que SUpergirl n'a pas besoin d'une énième origine secrète pour la mettre à jour dans une continuité percluse d'incohérence. Cela n'enlève rien à la qualité de ce récit qui montre une adolescente passer le cap des 16 ans et commencer à prendre une indépendance, à la fois contrainte par les événements, et à la fois soutenue par ses proches, dans une mise en image très agréable, cohérente avec la vision de la scénariste. Le lecteur prend plaisir à passer ces moments de lecture, avec une demoiselle sympathique sans être nunuche ou déjà adulte, réalisant progressivement que le monde des adultes est plus complexe que celui de l'enfance, promettant des aventures pour un futur qui n'est pas encore déterminé, rempli de potentiels, aussi bien celui de déterminer que faire de ses aptitudes, que rencontrer d'autres personnes partageant ses convictions, ses valeurs, ses centres d'intérêt.
Un album sensible et touchant qui immerge le lecteur dans l'univers d'une adolescente et de sa copine pendant les vacances d'été à la plage. L'insouciance, donc ? Pas vraiment... Rose est confrontée à des problématiques d'adultes qui la frôlent et la font vaciller vers la jalousie et l'agressivité : la grossesse non désirée d'une jeune fille du coin, et la dépression de sa mère, qu'elle ne comprend plus. Le trait et le ton de cet album reflètent bien l'état d'esprit de l'adolescente, qui pioche des instants de plaisir en regardant des films d'horreur et en mangeant des bonbons avec sa copine, tout en ruminant des pensées sombres dans son coin quand ça ne va pas, quand ça ne va plus.
Le souvenir fugace mais intense d'un été pas comme les autres.
Le souvenir fugace mais intense d'un été pas comme les autres.
Comme chaque été, Rose passe ses vacances en famille à Awago beach. Là, elle y retrouve Windy, sa copine de toujours, et quelques vedettes locales…. Les jours s’égrainent lentement entre jeux, dvd, des rêvasseries d’amours de très jeunes filles. Cette parenthèse estivale met à jours les relations tendues entre ses parents, la difficulté de communiquer et les nombreuses contradictions du monde des adultes.
Quelque part entre le strip américain et le manga japonais, les deux auteurs tricotent une chronique de quelque chose qui serait le dernier été de l’enfance innocente. L’intention est louable, parfois réussite au détour d’une case, d’un geste esquissé et trop vite retenu, pourtant la structure trop fouillis, les dessins qui tiennent souvent du brouillon, ont parasité tout cette lecture et m’ont détourné du sujet et de mon intérêt initial.
Quelque part entre le strip américain et le manga japonais, les deux auteurs tricotent une chronique de quelque chose qui serait le dernier été de l’enfance innocente. L’intention est louable, parfois réussite au détour d’une case, d’un geste esquissé et trop vite retenu, pourtant la structure trop fouillis, les dessins qui tiennent souvent du brouillon, ont parasité tout cette lecture et m’ont détourné du sujet et de mon intérêt initial.
Cet été là est un roman graphique, qui décrit l'été de deux jeunes filles tiraillées entre l'enfance et l'adolescence. Les jeux et les goûter font encore partie de leur quotidien mais l'une d'elle est déjà attirée par les garçons, fascinée par les adolescentes plus âgées.
Les auteurs abordent également d'autres thèmes de société comme la dépression, l'homosexualité, l'adoption.
Bref, un bon roman graphique à conseiller plutôt à des adolescents.
Les auteurs abordent également d'autres thèmes de société comme la dépression, l'homosexualité, l'adoption.
Bref, un bon roman graphique à conseiller plutôt à des adolescents.
Awago Beach, c'est là que Rose passe ses vacances chaque année depuis "peut-être... toujours". Elle y retrouve son amie Windy, un peu plus jeune qu'elle. Cet été marque pour Rose une entrée dans l'adolescence : imperceptiblement, ses centres d'intérêt changent, elle semble lointaine, réfléchit, observe. Elle perçoit les adultes de façon différente, prenant conscience de leurs soucis, s'intéressant à d'autres jeunes.
Entre Rose et Windy, la complicité persiste : plage, vélo, films d'horreur loués en douce, ... Les deux filles sont très attachantes : naïves et curieuses, elles forment un joli tandem.
Jillian et Mariko Tamaki nous offre un bel album, empreint de douceur et de nostalgie. Les illustrations et les jeux de zoom rendent à merveille la magie des vacances, ces instants que l'on sent suspendus, un peu détachés de la réalité.
Lien : http://nahe-lit.blogspot.be/..
Entre Rose et Windy, la complicité persiste : plage, vélo, films d'horreur loués en douce, ... Les deux filles sont très attachantes : naïves et curieuses, elles forment un joli tandem.
Jillian et Mariko Tamaki nous offre un bel album, empreint de douceur et de nostalgie. Les illustrations et les jeux de zoom rendent à merveille la magie des vacances, ces instants que l'on sent suspendus, un peu détachés de la réalité.
Lien : http://nahe-lit.blogspot.be/..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Auteurs proches de Mariko Tamaki
Lecteurs de Mariko Tamaki (1107)Voir plus
Quiz
Voir plus
Grégoire Delacourt ou David Foenkinos
Charlotte ?
Grégoire Delacourt
David Foenkinos
10 questions
52 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur52 lecteurs ont répondu