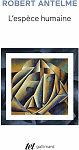Nationalité : France
Né(e) à : Sartène , le 05/01/1917
Mort(e) à : Paris , le 26/10/1990
Ajouter des informations
Né(e) à : Sartène , le 05/01/1917
Mort(e) à : Paris , le 26/10/1990
Biographie :
Robert Antelme est un écrivain, poète et résistant français.
En 1939, il épouse Marguerite Duras qui travaille alors pour une maison d'édition. Leur premier enfant, un garçon, meurt à la naissance en 1942. La même année Marguerite Duras fait la connaissance de Dionys Mascolo qui devient son amant.
Pendant l'Occupation, Marguerite Duras et Robert Antelme sont membres de la Résistance. Leur groupe tombe dans un guet-apens, Marguerite Duras réussit à s'échapper aidée par Jacques Morland (nom de guerre de François Mitterrand), mais Robert Antelme est arrêté et envoyé dans un camp le 1er juin 1944. Après un passage à Buchenwald, il est conduit à Gandersheim, un petit kommando dépendant de Buchenwald.
À la fin de la guerre, François Mitterrand retrouve Robert Antelme dans le camp de Dachau, épuisé et miné par des mois de détention dans des conditions très dures (il souffrait du typhus), et organise son retour à Paris. Marguerite Duras a tiré de cette époque hors norme un récit intitulé La Douleur.
Robert Antelme a publié sur les camps un livre de grande portée, L'Espèce humaine, en 1947. Le livre fut peu lu et presque oublié. Il est dédié à Marie Louise, sa sœur morte en déportation. Robert Antelme y montre des déportés qui conservent leur conscience face aux "pires cruautés humaines".
Robert Antelme fonda, en 1945, avec Marguerite Duras, une maison d'édition, “La cité universelle”. Le couple divorça en 1946, mais ils travaillèrent encore ensemble, comme en 1959 où, à la demande de Raymond Rouleau, il adapta, avec Marguerite Duras, “Les papiers d'Aspern”, pièce de Michael Redgrave, d'après une nouvelle de Henry James. Après la guerre, il continue donc un travail discret dans les milieux littéraires, collabore aux Les Temps modernes et milite au Parti communiste français, dont il est exclu en 1956, après la répression par les troupes du pacte de Varsovie de l'insurrection de Budapest.
Pendant la guerre d'Algérie, Robert Antelme est signataire du Manifeste des 121.
Immobilisé à partir de 1983 par un accident cérébro-vasculaire, Robert Antelme meurt le 26 octobre 1990.
+ Voir plusRobert Antelme est un écrivain, poète et résistant français.
En 1939, il épouse Marguerite Duras qui travaille alors pour une maison d'édition. Leur premier enfant, un garçon, meurt à la naissance en 1942. La même année Marguerite Duras fait la connaissance de Dionys Mascolo qui devient son amant.
Pendant l'Occupation, Marguerite Duras et Robert Antelme sont membres de la Résistance. Leur groupe tombe dans un guet-apens, Marguerite Duras réussit à s'échapper aidée par Jacques Morland (nom de guerre de François Mitterrand), mais Robert Antelme est arrêté et envoyé dans un camp le 1er juin 1944. Après un passage à Buchenwald, il est conduit à Gandersheim, un petit kommando dépendant de Buchenwald.
À la fin de la guerre, François Mitterrand retrouve Robert Antelme dans le camp de Dachau, épuisé et miné par des mois de détention dans des conditions très dures (il souffrait du typhus), et organise son retour à Paris. Marguerite Duras a tiré de cette époque hors norme un récit intitulé La Douleur.
Robert Antelme a publié sur les camps un livre de grande portée, L'Espèce humaine, en 1947. Le livre fut peu lu et presque oublié. Il est dédié à Marie Louise, sa sœur morte en déportation. Robert Antelme y montre des déportés qui conservent leur conscience face aux "pires cruautés humaines".
Robert Antelme fonda, en 1945, avec Marguerite Duras, une maison d'édition, “La cité universelle”. Le couple divorça en 1946, mais ils travaillèrent encore ensemble, comme en 1959 où, à la demande de Raymond Rouleau, il adapta, avec Marguerite Duras, “Les papiers d'Aspern”, pièce de Michael Redgrave, d'après une nouvelle de Henry James. Après la guerre, il continue donc un travail discret dans les milieux littéraires, collabore aux Les Temps modernes et milite au Parti communiste français, dont il est exclu en 1956, après la répression par les troupes du pacte de Varsovie de l'insurrection de Budapest.
Pendant la guerre d'Algérie, Robert Antelme est signataire du Manifeste des 121.
Immobilisé à partir de 1983 par un accident cérébro-vasculaire, Robert Antelme meurt le 26 octobre 1990.
Ajouter des informations
étiquettes
Videos et interviews (3)
Voir plusAjouter une vidéo
Citations et extraits (93)
Voir plus
Ajouter une citation
« Nous sommes au point de ressembler à tout ce qui se bat que pour manger, au point de nous niveler sur une autre espèce, qui ne sera jamais nôtre et vers laquelle on tend ; mais celle-ci qui vit du moins selon la loi authentique — les bêtes ne peuvent pas devenir plus bêtes — apparaît aussi somptueuse que la nôtre « véritable » dont la loi peut être aussi de nous conduire ici. Mais il n’y a pas d’ambigüité, nous restons des hommes, nous ne finirons qu’en hommes. La distance qui nous sépare d’une autre espèce reste intacte, elle n’est pas historique. C’est un rêve SS de croire que nous avons pour mission historique de changer d’espèce, et comme cette mutation se fait trop lentement, ils tuent. Non, cette maladie extraordinaire n’est autre chose qu’un moment culminant de l’histoire des hommes. Et cela peut signifier deux choses : d’abord que l’on fait l’épreuve de la solidité de cette espèce, de sa fixité. Ensuite, que la variété des rapports entre les hommes, leur couleur, leurs coutumes, leur formation en classes masquent une vérité qui apparaît ici éclatante, au bord de la nature, à l’approche de nos limites : il n’y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine. C’est parce que nous sommes des hommes comme eux que les SS seront en définitive impuissants devant nous. C’est parce qu’ils auront tenté de mettre en cause l’unité de cette espèce qu’ils seront finalement écrasés. Mais leur comportement et notre situation ne sont que le grossissement, la caricature extrême — où personne ne veut, ni ne peut sans doute se reconnaître — de comportements, de situations qui sont dans le monde et qui sont même cet ancien « monde véritable » auquel nous rêvons. Tout se passe effectivement là-bas comme s’il y avait des espèces — ou plus exactement comme si l’appartenance à l’espèce n’était pas sûre, comme si l’on pouvait y entrer et en sortir, n’y être qu’à demi ou y parvenir pleinement, ou n’y jamais parvenir même au prix de générations —, la division en races ou en classes étant le canon de l’espèce et entretenant l’axiome toujours prêt, la ligne ultime de défense : « Ce ne sont pas des gens comme nous. »
Eh bien, ici, la bête est luxueuse, l’arbre est la divinité et nous ne pouvons devenir ni la bête ni l’arbre. Nous ne pouvons pas et les SS ne peuvent pas nous y faire aboutir. Et c’est au moment où le masque a emprunté la figure la plus hideuse, au moment où il va devenir notre figure, qu’il tombe. Et si nous pensons alors cette chose qui, d’ici, est certainement la chose la plus considérable que l’on puisse penser : « Les SS ne sont que des hommes comme nous » ; si, entre les SS et nous — c’est-à-dire dans le moment le plus fort de distance entre les êtres, dans le moment où la limite de l’asservissement des uns et la limite de la puissance des autres semblent devoir se figer dans un rapport surnaturel — nous ne pouvons apercevoir aucune différence substantielle en face de la nature et en face de la mort, nous sommes obligés de dire qu’il n’y a qu’une espèce humaine. Que tout ce qui masque cette unité dans le monde, tout ce qui place les êtres dans la situation d’exploités, d’asservis et impliquerait par là même, l’existence de variétés d’espèces, est faux et fou ; et que nous en tenons ici la preuve, et la plus irréfutable preuve, puisque la pire victime ne peut faire autrement que de constater que, dans son pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre qu’une de celles de l’homme : la puissance de meurtre. Il peut tuer un homme, mais il ne peut pas le changer en autre chose. »
Eh bien, ici, la bête est luxueuse, l’arbre est la divinité et nous ne pouvons devenir ni la bête ni l’arbre. Nous ne pouvons pas et les SS ne peuvent pas nous y faire aboutir. Et c’est au moment où le masque a emprunté la figure la plus hideuse, au moment où il va devenir notre figure, qu’il tombe. Et si nous pensons alors cette chose qui, d’ici, est certainement la chose la plus considérable que l’on puisse penser : « Les SS ne sont que des hommes comme nous » ; si, entre les SS et nous — c’est-à-dire dans le moment le plus fort de distance entre les êtres, dans le moment où la limite de l’asservissement des uns et la limite de la puissance des autres semblent devoir se figer dans un rapport surnaturel — nous ne pouvons apercevoir aucune différence substantielle en face de la nature et en face de la mort, nous sommes obligés de dire qu’il n’y a qu’une espèce humaine. Que tout ce qui masque cette unité dans le monde, tout ce qui place les êtres dans la situation d’exploités, d’asservis et impliquerait par là même, l’existence de variétés d’espèces, est faux et fou ; et que nous en tenons ici la preuve, et la plus irréfutable preuve, puisque la pire victime ne peut faire autrement que de constater que, dans son pire exercice, la puissance du bourreau ne peut être autre qu’une de celles de l’homme : la puissance de meurtre. Il peut tuer un homme, mais il ne peut pas le changer en autre chose. »
Belle histoire de surhomme, ensevelie sous les tonnes de cendres d'Auschwitz. On lui avait permis d'avoir une histoire. Il parlait d'amour, et on l'aimait. Les cheveux sur les pieds, le disciple qu'il aimait, la face essuyée...
On ne donne pas les morts à leur mère ici, on tue la mère avec, on mange leur pain, on arrache l'or de leur bouche pour manger plus de pain, on fait du savon avec leur corps. Ou bien on met leur peau sur les abats-jour des femelles SS. Pas de traces de clous sur les abats-jour, seulement des tatouages artistiques.
"Mon père, pourquoi m'avez vous..."
Hurlements des enfants que l'on étouffe. Silence des cendres épandues sur une plaine.
On ne donne pas les morts à leur mère ici, on tue la mère avec, on mange leur pain, on arrache l'or de leur bouche pour manger plus de pain, on fait du savon avec leur corps. Ou bien on met leur peau sur les abats-jour des femelles SS. Pas de traces de clous sur les abats-jour, seulement des tatouages artistiques.
"Mon père, pourquoi m'avez vous..."
Hurlements des enfants que l'on étouffe. Silence des cendres épandues sur une plaine.
C'est Vendredi saint.
Un homme avait accepté la torture et la mort. Un frère.
Il parlait d'amour, et on l'aimait. Les cheveux sur les pieds, les parfums, le disciple qu'il aimait, la face essuyée.......
On ne donne pas les morts à leur mère ici, on tue la mère avec, on mange leur pain, on arrache l'or de leur bouche pour manger plus de pain, on fait du savon avec leur corps.
Ou bien on met leur peau sur les abat-jour des femelles SS. Pas de traces de clous sur les abat-jour, seulement des tatouages artistiques.
" Mon père, pourquoi m'avez-vous..."
Hurlements des enfants que l'on étouffe. Silence des cendres épandues sur une plaine.
Un homme avait accepté la torture et la mort. Un frère.
Il parlait d'amour, et on l'aimait. Les cheveux sur les pieds, les parfums, le disciple qu'il aimait, la face essuyée.......
On ne donne pas les morts à leur mère ici, on tue la mère avec, on mange leur pain, on arrache l'or de leur bouche pour manger plus de pain, on fait du savon avec leur corps.
Ou bien on met leur peau sur les abat-jour des femelles SS. Pas de traces de clous sur les abat-jour, seulement des tatouages artistiques.
" Mon père, pourquoi m'avez-vous..."
Hurlements des enfants que l'on étouffe. Silence des cendres épandues sur une plaine.
Cette guerre ne pouvait pas finir sur une défaite saine.
Il fallait que l'Allemagne se vit pourrir. Le nazisme était une réalité, il devait mettre sa marque sur cette fin.
Il n'y a pas que les blessures fraîches sur la figure ou le corps de leurs soldats, il y a les mouches autour des faces sans chair des nôtres qui pourrissent dans les fossés.
Il fallait que l'Allemagne se vit pourrir. Le nazisme était une réalité, il devait mettre sa marque sur cette fin.
Il n'y a pas que les blessures fraîches sur la figure ou le corps de leurs soldats, il y a les mouches autour des faces sans chair des nôtres qui pourrissent dans les fossés.
Plus on est contesté en tant qu'homme par le SS, plus on a de chances d'être confirmé comme tel. Le véritable risque que l'on court, c'est celui de se mettre à haïr le copain d'envie, d'être trahi par la concupiscence, d'abandonner les autres. Personne ne peut s'en faire relever. Dans ces conditions, il y a des déchéances formelles qui n'entament aucune intégrité et il y aussi des faiblesses d'infiniment plus de portée. On peut se reconnaître à se revoir fouinant comme un chien dans les épluchures pourries. Le souvenir du moment où l'on n'a pas partagé avec un copain ce qui devait l'être, au contraire viendrait à faire douter même du premier acte. L'erreur de conscience n'est pas de "déchoir", mais de perdre de vue que la déchéance doit être de tous et pour tous.
Je rapporte ici ce que j'ai vécu. L'horreur n'y est pas gigantesque. Il n'y avait à Gandersheim ni chambre à gaz, ni crématoire. L'horreur y est obscurité, manque absolu de repère, solitude, oppression incessante, anéantissement lent. Le ressort de notre lutte n'aura été que la revendication forcenée, et presque toujours elle-même solitaire, de rester jusqu'au bout, des hommes.
"C'est un rêve SS de croire que nous avons pour mission historique de changer d'espèce, et comme cette mutation se fait trop lentement, ils tuent. Non, cette maladie extraordinaire n'est autre chose qu'un moment culminant de l’histoire des hommes. Et cela peut signifier deux choses : d'abord que l'on fait l’épreuve de la solidité de cette espèce, de sa fixité. Ensuite, que la variété des rapports entre les hommes, leur couleur, leurs coutumes, leur formation en classes masquent une vérité qui apparaît ici éclatante, au bord de la nature, à l'approche de nos limites : il n'y a pas des espèces humaines, il y a une espèce humaine. C'est parce que nous sommes des hommes comme eux que les SS seront en définitive impuissants devant nous. C'est parce qu'ils auront tenté de mettre en cause l'unité de cette espèce qu'ils seront finalement écrasés."
Page 111
Dans notre réduit, il y a avait du monde autour du petit poêle. Ceusx qui était arrivés les premiers s’étaient immédiatement installés sur les bancs. Chacun tenait son pain dans la main. Quelqu’un dit :
- Avec ça on n’est pas fauché. Un chouette de réveillon ! Ils regardaient le pain par intermittence et semblaient réfléchir. Tous les bancs étaient occupés, je n’ai pas pu m’asseoir. Je me suis collé juste derrière un banc, ma figure recevait en plein la chaleur du poêle. J’ai coupé ma tranche de pain, j’ai étalé un peu de viande hachée dessus, j’ai étendu le bras par-dessus l’épaule d’un copain qui s’est penché sans râler et j’ai posé la tranche sur le poêle. D’autres faisaient la même chose. Le poêle était très chaud. La graisse de la viande rouge a fondu assez vite, et la couche de viande rouge est devenue brune. Le poêle était couvert de tranches. Quelques types se bagarraient pour trouver une petite place pour la leur ; ils poussaient le pain d’un copain qui tolérait, mais lorsqu’ils poussaient un peu trop sa tranche, et la faisait déborder dans le vide, le copain râlait. Il se retournait, dévisageait les autres qui avaient l’air de s’excuser, mais qui maintenaient tout de même leur tranche en place. Celui qui râlait poussait alors la tranche d’un autre pour bien étaler la sienne sur le poêle, cet autre se mettait à râler aussi, le ton montait un peu.
- Tu nous emmerdes, fallait arriver avant. C’est toujours les mêmes qui roupillent et puis après ils veulent passer avant.
- - oh ça va. t’énerve pas, on ne va pas tout de même s’engueuler ce soir.
- - Je t’engueule pas, mais quand même il ne faut pas exagérer
Ca n’allait pas plus loin. Une odeur montait, de boulangerie, de viande grillée, de petit déjeuner de riches. Mais eux, là-bas, s’ils mangeaient du lard, du pain grillé, ne savaient pas comment cela s’était transformé, avait commencé à changer de couleur, à rôtir, et surtout à sentir, à lancer cette puissante odeur. Nous, nous avions touché le pain gris, nous avions coupé une tranche, nous avions nous-même posé la tranche sur le poêle, et maintenant nous regardions le pain se changer en gâteau. Rien ne nous échappait. La viande qui suintait, brillait et dégageait l’odeur terrible de chose à manger. Nous n’avions pas perdu le goût du pain, des pommes de terre qu’on mâche. Mais la chose à manger qui emplit à distance la gorge de son odeur, nous avions oublié ce que ce pouvait être.
J’ai retiré la tranche. Elle était brûlante, c’était une brioche. Plus q ‘un joyau, une chose vivante, une joie. Elle était légèrement gonflée, la graisse de la viande avait pénétré dans la mie, ça luisait. J’ai croqué la première bouchée ; en entrant dans le pain, les dents ont fait un bruit qui m’a rempli les oreilles. C’était une grotte de parfum, de jus, de nourriture. Tout était à manger. La langue, le palais étaient débordés. J’avais peur de perdre quelque chose. Je mâchais, j’en avais partout, sur les lèvres, sur la langue, entre les dents, l’intérieur de ma bouche était une caverne, la nourriture se promenait dedans. J’ai fini par avalé, cela s’est avalé. Quand je n’ai plus rien eu dans la bouche, le vide a été insupportable. Encore, encore, le mot a été fait par la langue et le palais ; encore une bouchée, encore une bouchée, il ne fallait pas que ça s’arrête, la machine à broyer, à sentir, à lécher était en marche. La bouche n’avait jamais éprouvé comme à ce moment -là qu’elle était une chose qui ne pouvait pas être comblé, que rien, ne pouvait lui servir une fois pour toutes, qu’il lui en faudrait toujours.
Chacun mangeait solennellement. Quelques-uns ne voulaient pas prendre de risques ; ils mangeaient le pain froid, tel qu’ils l’avaient reçu. Ils ne voulaient pas changer de monde, ils ne voulaient pas se tenter. Il ne fallait pas ici s’amuser à réveiller tant d’exigences, de goûts enterrés. Manger quelque chose de pareil, il ne pouvait rien y avoir de meilleur. était dangereux. Eux avaient l’air plus détachés ; ils ne coupaient pas leur pain précieusement par tranche, mais par morceaux, au hasard ; ils tenaient leur morceau dans la main comme ils l’auraient fait là-bas le coude appuyé sur le genou, graves, austères.
C’était les dernières bouchées. J’avais trouvé une place sur le banc. Il n’y avait plus qu’à se chauffer, la tête penchée an avant, les mains tendues vers le poêle.
Dans notre réduit, il y a avait du monde autour du petit poêle. Ceusx qui était arrivés les premiers s’étaient immédiatement installés sur les bancs. Chacun tenait son pain dans la main. Quelqu’un dit :
- Avec ça on n’est pas fauché. Un chouette de réveillon ! Ils regardaient le pain par intermittence et semblaient réfléchir. Tous les bancs étaient occupés, je n’ai pas pu m’asseoir. Je me suis collé juste derrière un banc, ma figure recevait en plein la chaleur du poêle. J’ai coupé ma tranche de pain, j’ai étalé un peu de viande hachée dessus, j’ai étendu le bras par-dessus l’épaule d’un copain qui s’est penché sans râler et j’ai posé la tranche sur le poêle. D’autres faisaient la même chose. Le poêle était très chaud. La graisse de la viande rouge a fondu assez vite, et la couche de viande rouge est devenue brune. Le poêle était couvert de tranches. Quelques types se bagarraient pour trouver une petite place pour la leur ; ils poussaient le pain d’un copain qui tolérait, mais lorsqu’ils poussaient un peu trop sa tranche, et la faisait déborder dans le vide, le copain râlait. Il se retournait, dévisageait les autres qui avaient l’air de s’excuser, mais qui maintenaient tout de même leur tranche en place. Celui qui râlait poussait alors la tranche d’un autre pour bien étaler la sienne sur le poêle, cet autre se mettait à râler aussi, le ton montait un peu.
- Tu nous emmerdes, fallait arriver avant. C’est toujours les mêmes qui roupillent et puis après ils veulent passer avant.
- - oh ça va. t’énerve pas, on ne va pas tout de même s’engueuler ce soir.
- - Je t’engueule pas, mais quand même il ne faut pas exagérer
Ca n’allait pas plus loin. Une odeur montait, de boulangerie, de viande grillée, de petit déjeuner de riches. Mais eux, là-bas, s’ils mangeaient du lard, du pain grillé, ne savaient pas comment cela s’était transformé, avait commencé à changer de couleur, à rôtir, et surtout à sentir, à lancer cette puissante odeur. Nous, nous avions touché le pain gris, nous avions coupé une tranche, nous avions nous-même posé la tranche sur le poêle, et maintenant nous regardions le pain se changer en gâteau. Rien ne nous échappait. La viande qui suintait, brillait et dégageait l’odeur terrible de chose à manger. Nous n’avions pas perdu le goût du pain, des pommes de terre qu’on mâche. Mais la chose à manger qui emplit à distance la gorge de son odeur, nous avions oublié ce que ce pouvait être.
J’ai retiré la tranche. Elle était brûlante, c’était une brioche. Plus q ‘un joyau, une chose vivante, une joie. Elle était légèrement gonflée, la graisse de la viande avait pénétré dans la mie, ça luisait. J’ai croqué la première bouchée ; en entrant dans le pain, les dents ont fait un bruit qui m’a rempli les oreilles. C’était une grotte de parfum, de jus, de nourriture. Tout était à manger. La langue, le palais étaient débordés. J’avais peur de perdre quelque chose. Je mâchais, j’en avais partout, sur les lèvres, sur la langue, entre les dents, l’intérieur de ma bouche était une caverne, la nourriture se promenait dedans. J’ai fini par avalé, cela s’est avalé. Quand je n’ai plus rien eu dans la bouche, le vide a été insupportable. Encore, encore, le mot a été fait par la langue et le palais ; encore une bouchée, encore une bouchée, il ne fallait pas que ça s’arrête, la machine à broyer, à sentir, à lécher était en marche. La bouche n’avait jamais éprouvé comme à ce moment -là qu’elle était une chose qui ne pouvait pas être comblé, que rien, ne pouvait lui servir une fois pour toutes, qu’il lui en faudrait toujours.
Chacun mangeait solennellement. Quelques-uns ne voulaient pas prendre de risques ; ils mangeaient le pain froid, tel qu’ils l’avaient reçu. Ils ne voulaient pas changer de monde, ils ne voulaient pas se tenter. Il ne fallait pas ici s’amuser à réveiller tant d’exigences, de goûts enterrés. Manger quelque chose de pareil, il ne pouvait rien y avoir de meilleur. était dangereux. Eux avaient l’air plus détachés ; ils ne coupaient pas leur pain précieusement par tranche, mais par morceaux, au hasard ; ils tenaient leur morceau dans la main comme ils l’auraient fait là-bas le coude appuyé sur le genou, graves, austères.
C’était les dernières bouchées. J’avais trouvé une place sur le banc. Il n’y avait plus qu’à se chauffer, la tête penchée an avant, les mains tendues vers le poêle.
Il y a deux ans ,durant les premiers jours qui ont suivi notre retour , nous avons été , tous je pense , en proie à un véritable délire . Nous voulions parler , être entendus enfin . On nous dit que notre apparence physique était assez éloquente à elle seule . Mais nous revenions juste ,nous ramenions avec nous notre mémoire , notre expérience toute vivante et nous éprouvions un besoin frénétique de la dire telle quelle .Et dès les premiers jours cependant , il nous paraissait impossible de combler la distance que nous découvrions entre le langage dont nous disposions et cette expérience que , pour la plupart , nous étions encore en train de poursuivre dans notre corps . Comment nous résigner à ne pas tenter d'expliquer comment nous en étions venus là ? Nous y étions encore .Et cependant c'était impossible . A peine commencions-nous à raconter , que nous suffoquions . A nous mêmes , ce que nous avions à raconter alors commençait à nous paraître INIMAGINABLE .
(...) on peut dire qu'à l'intérieur de sa condition, et en fonction de ce à quoi il risque d'être soumis, le captif a toujours raison.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Priver de liberté
ivredelivres
23 livres
Auteurs proches de Robert Antelme
Lecteurs de Robert Antelme (781)Voir plus
Quiz
Voir plus
Un couple : un tableau et son musée (n°1/2)
"La Joconde" de Léonard de Vinci :
Musée du Louvre à Paris
Galerie des Offices à Florence
10 questions
216 lecteurs ont répondu
Thèmes :
peinture
, art
, culture généraleCréer un quiz sur cet auteur216 lecteurs ont répondu