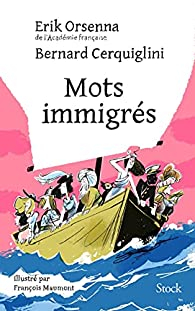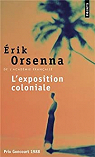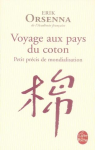Citations sur Mots immigrés (43)
Nous avons longuement évoqué l’arabe ; mais impossible de passer sous silence l’apport de l’hébreu (cidre, manne, scandale), de l’espagnol (hâbleur, escamoter, paëlla, matador), avec ce chef-d’œuvre qu’est la cédille, « petit z » (comment, en restant poli, prononcer sans elle « malfaçon » ?), ou le portugais (caramel, fétiche, marmelade), et le russe (cosaque, oukase, steppe). Et puis les autres langues slaves, car la meringue est polonaise, le robot tchèque, le vampire serbe… Au total, on a recensé plus de cent vingt langues ayant peu ou prou contribué à notre vocabulaire, parfois seulement pour un ou deux mots, souvent venus de très loin. Il est temps de vous dire notre gratitude.
Pour la première fois sont dénoncés les risques pour une langue d’une trop forte vague de mots empruntés sans nécessité. Nous pouvons aussi remercier M. Panache pour cela : bien avant l’heure il nous fait comprendre le ridicule de notre frénésie d’anglicismes.
Nous devons à la vérité de dire que la belle n’y était pas insensible. Sa peau de blonde enchaînait des fards d’anthologie. De crainte d’être accusés de célébrer le harcèlement, revenons à nos moutons. Tout à sa leçon, Mme Indigo n’avait rien remarqué du manège et poursuivait :
– Prenons l’exemple du commerce ; il est éclairant. Commerce des langues, langues du commerce. Dès le xive siècle, les armateurs génois, les commerçants vénitiens, les banquiers lombards avaient supplanté les Arabes dans le contrôle commercial de la Méditerranée : nous leur devons l’escale et la boussole (italien bussola, « petite boîte » où l’on plaçait une aiguille aimantée).
– Prenons l’exemple du commerce ; il est éclairant. Commerce des langues, langues du commerce. Dès le xive siècle, les armateurs génois, les commerçants vénitiens, les banquiers lombards avaient supplanté les Arabes dans le contrôle commercial de la Méditerranée : nous leur devons l’escale et la boussole (italien bussola, « petite boîte » où l’on plaçait une aiguille aimantée).
Votre langue est notre « sœur latine ». Nous ne vous remercierons jamais assez pour vos cadeaux. Jusque vers 1960, c’est l’italien qui a le plus enrichi le français. Dans tous les domaines, et pas des moindres ! La cuisine (pizza, spaghetti, osso buco, mais aussi saucisson, fruits de mer, festin), la musique (allegro, concerto, duo, piano, mais aussi contrebasse, mandoline et violon), l’art (aquarelle, buste, clair-obscur, esquisse, modèle, pastiche, reflet), le confort (appartement, paravent, salon, store, villa), l’élégance (escarpin, lavande, ombrelle, politesse, moustache), sans oublier les jeux amoureux (bagatelle, caresse, caprice, incartade). Savez-vous que Montaigne, le grand Montaigne, découvrit, au cours d’un long voyage en Italie, une pratique d’hygiène qui l’enchanta : d’un tuyau fixé au plafond de l’étuve tombait une délicieuse eau chaude.
L’apport de l’arabe n’est pas un hasard (az-zahr, « jeu de dés »). Alambic nous vient-il de l’arabe al-‘anbîq, « le vase » ? En fait, il l’a emprunté au grec ambix, « vase à distiller ». L’azur vient du persan, via l’arabe et le latin médiéval ; l’orange est un mot sanskrit, devenu persan, puis arabe, puis italien…
On retrouve aisément les emprunts à l’arabe, quand ils sont précédés de l’article al : alambic, alcool, alcôve, algèbre, almanach. Al-karchuf a donné l’italien (lombard) articcioco, où les Français ont entendu artichaut. Et que dire de l’amiral,venu de l’arabe emir al bahr, « prince de la mer », dont les Français n’ont gardé que le début, emir al, « prince de la » ! Il est vrai qu’amiral rejoignait ainsi le maréchal et le sénéchal, d’origine germanique : les forces armées sont cosmopolites !
Notre civilisation n’était pas riche que de savants ; elle florissait par ses artisans. Ainsi, à Cordoue, on travaillait admirablement le cuir, le cordouan, dont le spécialiste était le cordœnnier, bien vite devenu le cordonnier. Du Maroc venaient la peau de chèvre tannée, le maroquin et, plus généralement, l’art de la maroquinerie. Un art de vivre qui impressionnait les Européens : ils en empruntèrent promptement les termes. Les Arabes savaient aussi se loger confortablement (alcôve, baldaquin, divan, sofa, tabouret), prendre soin de leur corps (benjoin, hammam, henné, khôl, laque, massage, musc, santal, talc), se distraire (échecs, guitare, luth, tambour), perdre la tête (alcool, almée, haschich).
L’occupation de l’Espagne par les Arabes fut décisive : au xe siècle, la bibliothèque de Cordoue possédait autant de volumes que la ville comptait d’habitants (400 000) ; tous les savants d’Europe, chrétiens, juifs, arabes, venaient s’y instruire, intégrant à leur idiome les mots du savoir. Les Arabes avaient la passion de nommer, classer, calculer, mesurer. C’est pour cela que vous leur devez alchimie, algèbre, algorithme, arrobase, azimut, chiffre, chimie, nadir, quintal, zéro. La renommée de mes ancêtres astronomes était au zénith.
Vous aurez beau ricaner, madame, vous ne pourrez pas nier cette vérité : le français, c’est moi ! Le mot français, qui désigne à la fois une langue et des habitants, est un dérivé direct du nom de notre tribu, les Francs. En passant, nous vous avons fait cadeau d’un adjectif, franc, qui a signifié « libre », puis « naturel », ensuite « loyal », enfin « sincère ».
Quelle bêtise et quel gâchis d’abandonner le latin classique ! Idiots que vous êtes, n’avez-vous pas compris qu’il offre un second vocabulaire, des termes de science et de technique, de bel autant que de pratique usage. Le grec nous rend le même service (à partir de hippos, « cheval » : hippisme, hippodrome).
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Erik Orsenna (78)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Erik Orsenna, presque...
Erik Orsenna est un pseudonyme ?
vrai
faux
5 questions
107 lecteurs ont répondu
Thème :
Erik OrsennaCréer un quiz sur ce livre107 lecteurs ont répondu