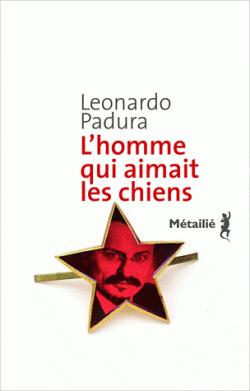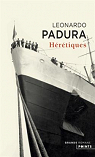Critiques filtrées sur 5 étoiles
Quitter “L'homme qui aimait les chiens”, paru en 2009, c'est achever simultanément trois romans qui sur plus de 700 pages se chevauchent et s'imbriquent les uns dans les autres.
Il faut une passion d'historien, des centaines d'heures de recherche et une plume particulièrement habile pour donner la pleine mesure des purges staliniennes, sujet effrayant s'il en est.
L'auteur cubain Leonardo Padura s'est attaqué à cet Everest d'horreurs, peuplé de vingt millions de morts, en construisant une oeuvre d'une grande originalité sur la forme et suintant la peur de bout en bout.
La trame de son roman s'articule autour de la biographie de trois personnages :
Les deux premiers sont éminemment connus puisqu'il s'agit de Léon Trotski et de son assassin Ramón Mercader.
Le troisième personnage, Iván Cárdenas Maturell, est fictif et exerce la profession de vétérinaire à Cuba. Son talent d'écrivain, tué dans l'oeuf par le régime castriste, est ignoré de tous. A partir de sa rencontre fortuite un jour de 1977 avec le meurtrier de Trotski, il va dans son coin démêler avec obstination l'écheveau des monstruosités inhérentes à l'histoire de l'URSS.
Les dix dernières années de la vie de paria de Trotski sont évoquées avec moult détails. Sont exil de plus de dix ans, décrété par Staline, passe par la Turquie, La France et la Norvège avant de s'achever au Mexique à la Casa Azul appartenant aux peintres Diego Rivera et Frida Kahlo et transformée en camp retranché.
Les grandes lignes de la carrière de Ramón Mercader sont elles aussi brillamment retracées. Combattant dans les rangs des Républicains lors de la guerre civile espagnole puis agent secret au sein du NKVD, c'est lui qui réussit en août 1940 à déjouer la vigilance des gardes du corps de Trotski et à tuer ce dernier d'un violent coup de piolet sur le sommet du crâne.
Un peu comme sur un grand écran divisé en deux parties, le lecteur voit le parcours de vie de la victime et de son meurtrier peu à peu converger vers la forteresse mexicaine : une épopée romanesque d'une grande authenticité.
La fin de vie désabusée de Mercader entre Moscou et La Havane, après vingt années de geôles mexicaines, met l'accent sur la grande désillusion de ce communiste espagnol de la première heure et renvoie le lecteur aux tristes prévisions de Trotski qui sans relâche dénonçait les sombres desseins du camarade Joseph Staline.
Cinq ans avant que n'apparaissent avec Mikhaïl Gorbatchev les mots glasnost et perestroïka, neuf ans avant la chute du mur de Berlin et onze ans avant que ne meurt l'URSS, Jean Ferrat chantait déjà en 1980 l'utopie communiste trahie.
Sa chanson ô combien poignante “Le Bilan” est bien dans le ton du roman “L'homme qui aimait les chiens”. Elle commence ainsi :
“Ah ! ils nous en ont fait avaler des couleuvres
De Prague à Budapest, de Sofia à Moscou
Les staliniens zélés qui mettaient tout en oeuvre
Pour vous faire signer les aveux les plus fous
Vous aviez combattu partout la bête immonde
Des brigades d'Espagne à celles des maquis
Votre jeunesse était l'Histoire de ce monde
Vous aviez nom Kostov ou London ou Slansky…”
Il faut une passion d'historien, des centaines d'heures de recherche et une plume particulièrement habile pour donner la pleine mesure des purges staliniennes, sujet effrayant s'il en est.
L'auteur cubain Leonardo Padura s'est attaqué à cet Everest d'horreurs, peuplé de vingt millions de morts, en construisant une oeuvre d'une grande originalité sur la forme et suintant la peur de bout en bout.
La trame de son roman s'articule autour de la biographie de trois personnages :
Les deux premiers sont éminemment connus puisqu'il s'agit de Léon Trotski et de son assassin Ramón Mercader.
Le troisième personnage, Iván Cárdenas Maturell, est fictif et exerce la profession de vétérinaire à Cuba. Son talent d'écrivain, tué dans l'oeuf par le régime castriste, est ignoré de tous. A partir de sa rencontre fortuite un jour de 1977 avec le meurtrier de Trotski, il va dans son coin démêler avec obstination l'écheveau des monstruosités inhérentes à l'histoire de l'URSS.
Les dix dernières années de la vie de paria de Trotski sont évoquées avec moult détails. Sont exil de plus de dix ans, décrété par Staline, passe par la Turquie, La France et la Norvège avant de s'achever au Mexique à la Casa Azul appartenant aux peintres Diego Rivera et Frida Kahlo et transformée en camp retranché.
Les grandes lignes de la carrière de Ramón Mercader sont elles aussi brillamment retracées. Combattant dans les rangs des Républicains lors de la guerre civile espagnole puis agent secret au sein du NKVD, c'est lui qui réussit en août 1940 à déjouer la vigilance des gardes du corps de Trotski et à tuer ce dernier d'un violent coup de piolet sur le sommet du crâne.
Un peu comme sur un grand écran divisé en deux parties, le lecteur voit le parcours de vie de la victime et de son meurtrier peu à peu converger vers la forteresse mexicaine : une épopée romanesque d'une grande authenticité.
La fin de vie désabusée de Mercader entre Moscou et La Havane, après vingt années de geôles mexicaines, met l'accent sur la grande désillusion de ce communiste espagnol de la première heure et renvoie le lecteur aux tristes prévisions de Trotski qui sans relâche dénonçait les sombres desseins du camarade Joseph Staline.
Cinq ans avant que n'apparaissent avec Mikhaïl Gorbatchev les mots glasnost et perestroïka, neuf ans avant la chute du mur de Berlin et onze ans avant que ne meurt l'URSS, Jean Ferrat chantait déjà en 1980 l'utopie communiste trahie.
Sa chanson ô combien poignante “Le Bilan” est bien dans le ton du roman “L'homme qui aimait les chiens”. Elle commence ainsi :
“Ah ! ils nous en ont fait avaler des couleuvres
De Prague à Budapest, de Sofia à Moscou
Les staliniens zélés qui mettaient tout en oeuvre
Pour vous faire signer les aveux les plus fous
Vous aviez combattu partout la bête immonde
Des brigades d'Espagne à celles des maquis
Votre jeunesse était l'Histoire de ce monde
Vous aviez nom Kostov ou London ou Slansky…”
« D'où m'est venue l'idée que moi, Ivan Cardenas Maturell, je voulais écrire et même peut-être publier ce livre ? D'où avais je sorti que dans une autre vie lointaine, j'avais prétendu et cru être écrivain ? L'unique réponse à ma portée était que cette histoire m'avait poursuivi parce qu'elle avait besoin que quelqu'un l'écrive. Et cette sacrée garce m'avait choisi moi, justement moi ! »
La Havane en 2004. Ivan regarde les fossoyeurs descendre, avec désinvolture, le cercueil d'Ana dans la fosse ouverte. Ana, si essentielle à l'existence d'Ivan. Ana pour qui vivre était devenu un enfer. Ana qui s'était battue jusqu'au bout de ses forces, venait enfin d'obtenir ce qu'elle et lui avait tant souhaité et que murmurait le Pasteur « Repos et Paix ».
C'est toujours Ana qui avec sa force de conviction, après avoir lu les quelques feuillets, qu'Ivan avait écrits sous une subite impulsion, puis mis de côté, sans parvenir vraiment à retranscrire, tétanisé, le souvenir de ces différentes rencontres qui avaient débuté au printemps 1977 avec l'homme qu'Ivan avait surnommé « L'homme qui aimait les chiens ». Donc, Ana lui avait dit « qu'elle ne comprenait pas comment il était possible que lui, justement lui, n'ait pas écrit un livre sur cette histoire que Dieu avait mise sur son chemin. Ivan lui fit la réponse qu'il avait tant de fois éludée mais la seule qu'il pouvait donner « Je ne l'ai pas écrite parce que j'avais peur » !
Léonardo Padura nous offre un livre remarquable que je ne suis pas prête d'oublier. Sous la forme d'un thriller de six cent cinquante pages, il nous raconte l'endoctrinement et la préparation d'un individu éduqué dans le seul but d'assassiner un autre être humain, Lev Davidovitch Trotsky. Ce dernier mourra des suites de cette agression à l'Hôpital de Mexico, le 22 août 1940.
La construction du roman est conçue de façon à ne jamais lasser le lecteur, bien au contraire, celui-ci tourne les pages avec avidité, impatient de découvrir la suite. Les chapitres sont alternatifs et sont divisés en trois récits distincts mais qui finiront pas se recouper. On assiste à l'ascension en politique de Trotsky, puis à son exclusion et enfin à ses différents exils, pourchassés par la haine de Staline. Un autre récit relate l'histoire de Ramon Mercader, recruté par les agents de Moscou, dans le camp républicain lors de la guerre civile espagnole, et l'impact qu'à eu sa mère, Caridad Mercader, sur la destinée de son fils.
Et enfin Ivan, personnage fictif mais essentiel à la narration, cubain, écrivain émasculé par la censure cubaine qui va être amené à rencontrer « L'homme qui aimait les chiens » et qui, pour qui, pourquoi, à force de conversations intimes, gravement malade, va lui confier son histoire. Une histoire faite de haine, de souffrance, de manipulation, de crime, une véritable plongée au coeur des ténèbres, vision sinistre des machinations élaborées par des hommes. Ivan, dans ce Cuba où l'homme est tout particulièrement contrôlé, où la misère se faufile partout, va se sentir étouffer de peur sous le poids de ses révélations.
Et heureusement, il y a les chiens, ce fil rouge qui unit ces hommes. le chien qui est le symbole de la fidélité jusque dans la mort, guide de l'homme pendant le jour jusqu'à la nuit de la mort.
Au cours de son premier voyage au Mexique, l'auteur a visité, à Coyoacan, la maison fortifiée de Lev Davidovitch Bronstein dit « Trotsky ». Devant son ignorance quant à l'histoire de l'ex-dirigeant bolchevick, Léonardo Padura a ressenti le besoin de s'intéresser de plus près à la destinée des acteurs de ce crime.
Bien que ce récit soit basé à la fois sur l'Histoire de l'Union soviétique mais aussi sur certaines supputations, l'auteur ne laisse rien au hasard, tout est parfaitement maîtrisé lorsque l'on s'est intéressé à la personnalité de Staline. La paranoïa, la manipulation, les purges, les procès truqués, tout y est décrit avec précision et clarté. Ce fut un long travail, quinze ans d'étude, de recherches, à la fois pour s'appuyer sur ce que l'on sait avec certitude mais aussi pour envisager un récit spéculatif qui puisse conserver toute sa cohérence dans l'histoire dramatique de l'utopie du XXème siècle. Léonardo Padura s'est aussi appuyé sur la vie de Ramon Mercader racontée par son frère, Luis Mercader, avec l'aide du journaliste German Sanchez.
Au cours de ma lecture, j'ai retrouvé un passage qui fait référence « au complot des blouses blanches », de Jonathan Brent. J'ai ce livre dans ma bibliothèque. J'ai du renoncer à sa lecture tant j'ai trouvé la narration touffue.
On peut aussi retenir la leçon que dégage ce livre, je dirai sa quintessence, « ne jamais perdre son esprit critique ».
Ce fut un réel plaisir que cette lecture, instructive et passionnante, une plongée dans l'enfer de l'Union Soviétique et le mode d'emploi pour créer un assassin convaincu de la nécessité de son crime. Absolument mémorable!
« Ces dix années furent aussi celles qui virent naître et mourir les espoirs de la perestroïka et, pour beaucoup, celles qui plongèrent dans la stupeur, provoquées par les révélations de la glasnost soviétique, par la découverte des vrais visages de personnages comme Ceausescu, et par le changement d'orientation économique de la Chine, avec la divulgation des horreurs de génocide de la Révolution culturelle menée au nom de la pureté marxiste. Ce furent les années d'une rupture historique qui changerait non seulement l'équilibre politique du monde mais jusqu'aux couleurs des cartes géographiques, jusqu'aux vérités philosophiques et, surtout, qui transformerait les hommes. Ces années furent celles où on traversa le pont qui menait de la croyance enthousiaste en une amélioration possible à la déception devant le constat que le grand rêve mortellement touché et qu'en son nom, on avait même commis des génocides, comme dans le Cambodge de Pol Pot. Ce fut le temps ou se concrétisa la grande désillusion ».
La Havane en 2004. Ivan regarde les fossoyeurs descendre, avec désinvolture, le cercueil d'Ana dans la fosse ouverte. Ana, si essentielle à l'existence d'Ivan. Ana pour qui vivre était devenu un enfer. Ana qui s'était battue jusqu'au bout de ses forces, venait enfin d'obtenir ce qu'elle et lui avait tant souhaité et que murmurait le Pasteur « Repos et Paix ».
C'est toujours Ana qui avec sa force de conviction, après avoir lu les quelques feuillets, qu'Ivan avait écrits sous une subite impulsion, puis mis de côté, sans parvenir vraiment à retranscrire, tétanisé, le souvenir de ces différentes rencontres qui avaient débuté au printemps 1977 avec l'homme qu'Ivan avait surnommé « L'homme qui aimait les chiens ». Donc, Ana lui avait dit « qu'elle ne comprenait pas comment il était possible que lui, justement lui, n'ait pas écrit un livre sur cette histoire que Dieu avait mise sur son chemin. Ivan lui fit la réponse qu'il avait tant de fois éludée mais la seule qu'il pouvait donner « Je ne l'ai pas écrite parce que j'avais peur » !
Léonardo Padura nous offre un livre remarquable que je ne suis pas prête d'oublier. Sous la forme d'un thriller de six cent cinquante pages, il nous raconte l'endoctrinement et la préparation d'un individu éduqué dans le seul but d'assassiner un autre être humain, Lev Davidovitch Trotsky. Ce dernier mourra des suites de cette agression à l'Hôpital de Mexico, le 22 août 1940.
La construction du roman est conçue de façon à ne jamais lasser le lecteur, bien au contraire, celui-ci tourne les pages avec avidité, impatient de découvrir la suite. Les chapitres sont alternatifs et sont divisés en trois récits distincts mais qui finiront pas se recouper. On assiste à l'ascension en politique de Trotsky, puis à son exclusion et enfin à ses différents exils, pourchassés par la haine de Staline. Un autre récit relate l'histoire de Ramon Mercader, recruté par les agents de Moscou, dans le camp républicain lors de la guerre civile espagnole, et l'impact qu'à eu sa mère, Caridad Mercader, sur la destinée de son fils.
Et enfin Ivan, personnage fictif mais essentiel à la narration, cubain, écrivain émasculé par la censure cubaine qui va être amené à rencontrer « L'homme qui aimait les chiens » et qui, pour qui, pourquoi, à force de conversations intimes, gravement malade, va lui confier son histoire. Une histoire faite de haine, de souffrance, de manipulation, de crime, une véritable plongée au coeur des ténèbres, vision sinistre des machinations élaborées par des hommes. Ivan, dans ce Cuba où l'homme est tout particulièrement contrôlé, où la misère se faufile partout, va se sentir étouffer de peur sous le poids de ses révélations.
Et heureusement, il y a les chiens, ce fil rouge qui unit ces hommes. le chien qui est le symbole de la fidélité jusque dans la mort, guide de l'homme pendant le jour jusqu'à la nuit de la mort.
Au cours de son premier voyage au Mexique, l'auteur a visité, à Coyoacan, la maison fortifiée de Lev Davidovitch Bronstein dit « Trotsky ». Devant son ignorance quant à l'histoire de l'ex-dirigeant bolchevick, Léonardo Padura a ressenti le besoin de s'intéresser de plus près à la destinée des acteurs de ce crime.
Bien que ce récit soit basé à la fois sur l'Histoire de l'Union soviétique mais aussi sur certaines supputations, l'auteur ne laisse rien au hasard, tout est parfaitement maîtrisé lorsque l'on s'est intéressé à la personnalité de Staline. La paranoïa, la manipulation, les purges, les procès truqués, tout y est décrit avec précision et clarté. Ce fut un long travail, quinze ans d'étude, de recherches, à la fois pour s'appuyer sur ce que l'on sait avec certitude mais aussi pour envisager un récit spéculatif qui puisse conserver toute sa cohérence dans l'histoire dramatique de l'utopie du XXème siècle. Léonardo Padura s'est aussi appuyé sur la vie de Ramon Mercader racontée par son frère, Luis Mercader, avec l'aide du journaliste German Sanchez.
Au cours de ma lecture, j'ai retrouvé un passage qui fait référence « au complot des blouses blanches », de Jonathan Brent. J'ai ce livre dans ma bibliothèque. J'ai du renoncer à sa lecture tant j'ai trouvé la narration touffue.
On peut aussi retenir la leçon que dégage ce livre, je dirai sa quintessence, « ne jamais perdre son esprit critique ».
Ce fut un réel plaisir que cette lecture, instructive et passionnante, une plongée dans l'enfer de l'Union Soviétique et le mode d'emploi pour créer un assassin convaincu de la nécessité de son crime. Absolument mémorable!
« Ces dix années furent aussi celles qui virent naître et mourir les espoirs de la perestroïka et, pour beaucoup, celles qui plongèrent dans la stupeur, provoquées par les révélations de la glasnost soviétique, par la découverte des vrais visages de personnages comme Ceausescu, et par le changement d'orientation économique de la Chine, avec la divulgation des horreurs de génocide de la Révolution culturelle menée au nom de la pureté marxiste. Ce furent les années d'une rupture historique qui changerait non seulement l'équilibre politique du monde mais jusqu'aux couleurs des cartes géographiques, jusqu'aux vérités philosophiques et, surtout, qui transformerait les hommes. Ces années furent celles où on traversa le pont qui menait de la croyance enthousiaste en une amélioration possible à la déception devant le constat que le grand rêve mortellement touché et qu'en son nom, on avait même commis des génocides, comme dans le Cambodge de Pol Pot. Ce fut le temps ou se concrétisa la grande désillusion ».
Ce fut pour moi une agréable et très enrichissante immersion dans la Russie révolutionnaire, la guerre d'Espagne et la Cuba contemporaine au détour du chemin qui retrace les parcours de vie de Léon Trotski et de son assassin, le militant communiste espagnol Ramón Mercader. Il y a aussi de nombreux chiens qui illustrent ces récits dont les deux lévriers barzoïs Ix et Dax, qui témoignent de la douceur des âmes derrière ces personnages engagés dans des luttes fratricides et des causes sinon perdues, entremêlées entre les vérités et les mensonges du régime stalinien et d'une utopie vacillante. En tout cas, je puis attester que ce livre m'a captivée et que je l'aie souvent posé à regret dans la hâte de m'y replonger.
Leonardo Padura délaisse les aventures du lieutenant Mario Conde, héros de nombreux de ses polars cubains (voir le dernier et très bon roman, Les brumes du passé), pour s’attaquer au " couple " Léon Trotsky/ Ramon Mercader, la victime et l’assassin. Un grand roman politique sur la puissance destructrice du mensonge, qui mêle avec art fiction et Histoire.
Autant annoncer tout de suite la couleur : voilà, à mon avis, un roman magistral, long certes, mais qu’on ne peut lâcher. Et pourtant la fin de l’histoire est connue… On dévore, captivé. On ferme le livre hébété, bouleversé, époustouflé. Quelle force, quelle puissance de narration pour un si désespérant pan de l'Histoire ! Padura est décidément un immense conteur.
Mexico, 21 août 1940. Ramon Mercader, militant communiste espagnol devenu agent du NKVD, la police secrète russe, assassine d’un coup de piolet Trotsky, chassé par Staline de l’URSS et vivant en exil au Mexique. Si ce fait est célèbre, on connaît cependant très mal les circonstances qui ont précédé l’assassinat, et on est d’autant plus ignorant de la personnalité de Mercader. Padura entreprend, à travers l’itinéraire croisé de ces deux hommes, de nous raconter leur vie jusqu’à leur rencontre au Mexique, itinéraire dense et riche, qui emporte le lecteur à travers les 660 pages de cet impressionnant roman.
La force de l’auteur réside dans le refus de toute facilité et de tout manichéisme. Il fait intervenir un troisième personnage, Ivan, écrivain cubain qui, à la mort de sa femme en 2004, revient sur sa rencontre, vingt-cinq ans auparavant sur la plage de La Havane, avec un vieil homme étrange qui promenait deux magnifiques lévriers. Or, cet "homme qui aimait les chiens " lui fait d’étranges confidences sur Ramón Mercader , l’assassin de Trotsky. Comment le connaît-il aussi intimement ? Qui est cet homme ?
Les péripéties de la vie de l’écrivain brimé par le régime castriste, l’errance douloureuse de Trotsky à travers le monde, l’enrôlement progressif de Mercadier dans la peau d’un tueur… Les séquences se répondent, elles ne sont pas parallèles mais consécutives les unes des autres. D’où une subtilité certaine dans l’art de manier les concepts politiques, de coucher noir sur blanc des vérités longtemps cachées par les institutions officielles, doublée d’un sens de la narration qui fait que le roman reste très fluide. C’est aussi une réflexion sur la façon dont l’utopie la plus importante du XXème siècle, à savoir le communisme, a été pervertie.
L’homme qui aimait les chiens se présente également comme la restitution littéraire de l’un des crimes les plus révélateurs du monde moderne. C’est un roman puissant, qui dégage pourtant une grande mélancolie : les mensonges éhontés élevés au rang de vérités suscitent rapidement un sentiment de tristesse. Et pourtant, quelle énergie, quel tourbillon de personnages, de lieux , d’intrigues ! Quel foisonnement de détails, quel (colossal) travail de documentation on devine à la lecture de ce roman !
" Qui n’était pas victime, serait complice et même plus, bourreau. La terreur et la répression devenaient la politique d’un gouvernement qui faisait de la persécution et du mensonge des institutions d’Etat et un style de vie pour l’ensemble de la société. Etait-il ainsi que l’on construisait la meilleur société ? "
La peur, terrible, diffuse, tient en effet un rôle important dans toute cette histoire, que ce soit dans l’exil de plus en plus solitaire de Trotsky, dans la montée en puissance de Mercadier, l’agent de l’ombre qui se transforme en un soldat dur et obéissant, ou dans le quotidien sordide d’Ivan, elle est presque un personnage à part entière du roman. Dégoût, compassion, désillusions… Au final, le bilan est amer. Mais le talent de Padura est, lui, incontestable. Un livre monumental et passionnant.
Autant annoncer tout de suite la couleur : voilà, à mon avis, un roman magistral, long certes, mais qu’on ne peut lâcher. Et pourtant la fin de l’histoire est connue… On dévore, captivé. On ferme le livre hébété, bouleversé, époustouflé. Quelle force, quelle puissance de narration pour un si désespérant pan de l'Histoire ! Padura est décidément un immense conteur.
Mexico, 21 août 1940. Ramon Mercader, militant communiste espagnol devenu agent du NKVD, la police secrète russe, assassine d’un coup de piolet Trotsky, chassé par Staline de l’URSS et vivant en exil au Mexique. Si ce fait est célèbre, on connaît cependant très mal les circonstances qui ont précédé l’assassinat, et on est d’autant plus ignorant de la personnalité de Mercader. Padura entreprend, à travers l’itinéraire croisé de ces deux hommes, de nous raconter leur vie jusqu’à leur rencontre au Mexique, itinéraire dense et riche, qui emporte le lecteur à travers les 660 pages de cet impressionnant roman.
La force de l’auteur réside dans le refus de toute facilité et de tout manichéisme. Il fait intervenir un troisième personnage, Ivan, écrivain cubain qui, à la mort de sa femme en 2004, revient sur sa rencontre, vingt-cinq ans auparavant sur la plage de La Havane, avec un vieil homme étrange qui promenait deux magnifiques lévriers. Or, cet "homme qui aimait les chiens " lui fait d’étranges confidences sur Ramón Mercader , l’assassin de Trotsky. Comment le connaît-il aussi intimement ? Qui est cet homme ?
Les péripéties de la vie de l’écrivain brimé par le régime castriste, l’errance douloureuse de Trotsky à travers le monde, l’enrôlement progressif de Mercadier dans la peau d’un tueur… Les séquences se répondent, elles ne sont pas parallèles mais consécutives les unes des autres. D’où une subtilité certaine dans l’art de manier les concepts politiques, de coucher noir sur blanc des vérités longtemps cachées par les institutions officielles, doublée d’un sens de la narration qui fait que le roman reste très fluide. C’est aussi une réflexion sur la façon dont l’utopie la plus importante du XXème siècle, à savoir le communisme, a été pervertie.
L’homme qui aimait les chiens se présente également comme la restitution littéraire de l’un des crimes les plus révélateurs du monde moderne. C’est un roman puissant, qui dégage pourtant une grande mélancolie : les mensonges éhontés élevés au rang de vérités suscitent rapidement un sentiment de tristesse. Et pourtant, quelle énergie, quel tourbillon de personnages, de lieux , d’intrigues ! Quel foisonnement de détails, quel (colossal) travail de documentation on devine à la lecture de ce roman !
" Qui n’était pas victime, serait complice et même plus, bourreau. La terreur et la répression devenaient la politique d’un gouvernement qui faisait de la persécution et du mensonge des institutions d’Etat et un style de vie pour l’ensemble de la société. Etait-il ainsi que l’on construisait la meilleur société ? "
La peur, terrible, diffuse, tient en effet un rôle important dans toute cette histoire, que ce soit dans l’exil de plus en plus solitaire de Trotsky, dans la montée en puissance de Mercadier, l’agent de l’ombre qui se transforme en un soldat dur et obéissant, ou dans le quotidien sordide d’Ivan, elle est presque un personnage à part entière du roman. Dégoût, compassion, désillusions… Au final, le bilan est amer. Mais le talent de Padura est, lui, incontestable. Un livre monumental et passionnant.
Ce livre aurait pu s'appeler Les hommes qui aimaient les chiens, puisque cet amour est un des points communs entre ces trois hommes. Un autre, et le plus important surement, est le rôle joué par la politique dans leur vie, la politique et tout particulièrement le communisme, système de société « en quête d'un rêve d'égalité qui, dans la vie réelle, était devenu le cauchemar de la majorité. »
Ils sont trois dans ce livre, trois narrations qui alternent, chacune centrée sur un de ces hommes.
Il y a Trotski, que l'on suit dans toutes ses années de paria, une des innombrables victimes de Staline. D'abord relégué dans le froid et l'immensité glacée du Kirghizstan, il errera ensuite de pays en pays, rejeté de toutes parts, en butte à l'hostilité des gouvernements et des partis politiques, malgré le rôle qu'il avait joué dans la révolution russe. de la Turquie, à la France, puis la Norvège et enfin le Mexique, chaque fois cantonné dans une maison de plus en plus fortifiée, redoutant de plus en plus l'attentat qui mettra fin à ses jours, mais incapable d'abandonner la politique, incapable de se contenter de sa famille, dont les membres disparaissent un à un, sacrifiés sur l'autel du communisme, victimes de l'acharnement des deux ennemis, Staline et Trotski.
Il y a aussi Ramon Mercader, ou devrais-je dire Jacques Mornard, jeune communiste espagnol, que l'on viendra trouver au milieu des combats pour le mener vers un destin qu'il ne contrôlera pas. Endoctriné en Russie, il deviendra un instrument de mort, incapable d'échapper à son destin. Était-il complètement convaincu de la justesse de son acte ?
« Il vivait pour la foi, l'obéissance et la haine. Rien du reste n'existait si on ne le lui en donnait pas l'ordre. »
Et enfin Ivan, jeune cubain, vivant les années d'instauration du communisme, en attente de jours meilleurs qui ne viendront pas. Il fait des études de lettres, est publié. Tout heureux, il écrira un second livre dont on lui expliquera qu'il ne correspond pas à l'idéologie cubaine, qu'il porte tort au rêve que doit incarner la société cubaine. Ses rêves à lui finiront au placard, oubliée sa vocation :
« Ou alors, je n'y songeais pas parce qu'en réalité, j'avais tellement oublié que j'avais un jour voulu être écrivain que je ne pensais presque plus comme un écrivain. »
Il rencontrera sur une plage déserte de Cuba, un jour d'hiver, un homme accompagné de deux lévriers Barzoï qui lui contera une drôle d'histoire.
Trois histoires qui s'entremêlent, trois histoires d'hommes broyés par le communisme, les deux premiers certainement autant coupables que victimes, le dernier pris dans le désastre qu'a été le régime communiste à Cuba.
Un roman extrêmement documenté, très riche de références historiques notamment sur la vie de Trotski et les purges staliniennes. Cette abondance de faits sur cette période a un peu freiné le début de ma lecture, je trouvais un peu répétitif cette série de procès, de condamnations, d'exécutions, un peu perdue dans cette avalanche de noms, sur une époque que je connaissais mal. Si vous rencontrez ce même sentiment, n'hésitez pas à poursuivre. Passé le premier quart du roman, j'ai été passionnée par ce que je lisais. Passionnée et en même temps, écoeurée, effarée, incrédule.
Comment cela a-t-il été possible ? Comment tant d'hommes et de femmes ont pu si longtemps croire à ce régime, y adhérer, y convertir des milliers d'autres. Ainsi que l'analyse Padura, c'est la peur qui a contribué à maintenir ce régime en place si longtemps, la peur en Russie, mais aussi à Cuba. Ce mot revient si souvent dans ce roman. Imaginez-vous vivre une vie entière dans la peur ?
« le plus terrible était de savoir que ces épurations affectaient l'ensemble de la société soviétique. Comme il fallait s'y attendre dans un État où régnait la terreur verticale et horizontale, la participation des masses à l'épuration avait certainement contribué à sa progression géométrique : il était impossible de lancer une chasse aux sorcières comme celle que vécut l'URSS sans exacerber les plus bas instincts des gens et, surtout, sans que chaque individu ne fût épouvanté à l'idée d'en être victime, pour n'importe quelle raison et même sans raison. La terreur avait eu pour effet de stimuler la jalousie et la vengeance, en créant une atmosphère d'hystérie collective et, pire encore, d'indifférence au destin des autres. L'épuration se nourrissait d'elle-même et, une fois lancée, elle libérait des forces infernales qui l'obligeaient à aller de l'avant et à s'amplifier… »
Un roman qui décrit de façon magistrale cette période et les mécanismes qui ont permis à ces régimes de prospérer. Un roman très riche, dont le souvenir me hantera longtemps.
Merci à HundredDreams (Sandrine) et mcd30 (Marie-Caroline) avec qui j'ai partagé cette lecture. Leur enthousiasme a contribué à me faire franchir le cap un peu difficile pour moi de cette énumération de purges et de procès.
Partant en vacances demain je voulais publier avant. Je serai un peu moins présente sur Babelio tout le mois d'aout. Il y aura quelques critiques, SP oblige, mais je vous lirai moins que d'habitude. Bonnes vacances aux aoutiens, Courage à ceux qui en reviennent.
Ils sont trois dans ce livre, trois narrations qui alternent, chacune centrée sur un de ces hommes.
Il y a Trotski, que l'on suit dans toutes ses années de paria, une des innombrables victimes de Staline. D'abord relégué dans le froid et l'immensité glacée du Kirghizstan, il errera ensuite de pays en pays, rejeté de toutes parts, en butte à l'hostilité des gouvernements et des partis politiques, malgré le rôle qu'il avait joué dans la révolution russe. de la Turquie, à la France, puis la Norvège et enfin le Mexique, chaque fois cantonné dans une maison de plus en plus fortifiée, redoutant de plus en plus l'attentat qui mettra fin à ses jours, mais incapable d'abandonner la politique, incapable de se contenter de sa famille, dont les membres disparaissent un à un, sacrifiés sur l'autel du communisme, victimes de l'acharnement des deux ennemis, Staline et Trotski.
Il y a aussi Ramon Mercader, ou devrais-je dire Jacques Mornard, jeune communiste espagnol, que l'on viendra trouver au milieu des combats pour le mener vers un destin qu'il ne contrôlera pas. Endoctriné en Russie, il deviendra un instrument de mort, incapable d'échapper à son destin. Était-il complètement convaincu de la justesse de son acte ?
« Il vivait pour la foi, l'obéissance et la haine. Rien du reste n'existait si on ne le lui en donnait pas l'ordre. »
Et enfin Ivan, jeune cubain, vivant les années d'instauration du communisme, en attente de jours meilleurs qui ne viendront pas. Il fait des études de lettres, est publié. Tout heureux, il écrira un second livre dont on lui expliquera qu'il ne correspond pas à l'idéologie cubaine, qu'il porte tort au rêve que doit incarner la société cubaine. Ses rêves à lui finiront au placard, oubliée sa vocation :
« Ou alors, je n'y songeais pas parce qu'en réalité, j'avais tellement oublié que j'avais un jour voulu être écrivain que je ne pensais presque plus comme un écrivain. »
Il rencontrera sur une plage déserte de Cuba, un jour d'hiver, un homme accompagné de deux lévriers Barzoï qui lui contera une drôle d'histoire.
Trois histoires qui s'entremêlent, trois histoires d'hommes broyés par le communisme, les deux premiers certainement autant coupables que victimes, le dernier pris dans le désastre qu'a été le régime communiste à Cuba.
Un roman extrêmement documenté, très riche de références historiques notamment sur la vie de Trotski et les purges staliniennes. Cette abondance de faits sur cette période a un peu freiné le début de ma lecture, je trouvais un peu répétitif cette série de procès, de condamnations, d'exécutions, un peu perdue dans cette avalanche de noms, sur une époque que je connaissais mal. Si vous rencontrez ce même sentiment, n'hésitez pas à poursuivre. Passé le premier quart du roman, j'ai été passionnée par ce que je lisais. Passionnée et en même temps, écoeurée, effarée, incrédule.
Comment cela a-t-il été possible ? Comment tant d'hommes et de femmes ont pu si longtemps croire à ce régime, y adhérer, y convertir des milliers d'autres. Ainsi que l'analyse Padura, c'est la peur qui a contribué à maintenir ce régime en place si longtemps, la peur en Russie, mais aussi à Cuba. Ce mot revient si souvent dans ce roman. Imaginez-vous vivre une vie entière dans la peur ?
« le plus terrible était de savoir que ces épurations affectaient l'ensemble de la société soviétique. Comme il fallait s'y attendre dans un État où régnait la terreur verticale et horizontale, la participation des masses à l'épuration avait certainement contribué à sa progression géométrique : il était impossible de lancer une chasse aux sorcières comme celle que vécut l'URSS sans exacerber les plus bas instincts des gens et, surtout, sans que chaque individu ne fût épouvanté à l'idée d'en être victime, pour n'importe quelle raison et même sans raison. La terreur avait eu pour effet de stimuler la jalousie et la vengeance, en créant une atmosphère d'hystérie collective et, pire encore, d'indifférence au destin des autres. L'épuration se nourrissait d'elle-même et, une fois lancée, elle libérait des forces infernales qui l'obligeaient à aller de l'avant et à s'amplifier… »
Un roman qui décrit de façon magistrale cette période et les mécanismes qui ont permis à ces régimes de prospérer. Un roman très riche, dont le souvenir me hantera longtemps.
Merci à HundredDreams (Sandrine) et mcd30 (Marie-Caroline) avec qui j'ai partagé cette lecture. Leur enthousiasme a contribué à me faire franchir le cap un peu difficile pour moi de cette énumération de purges et de procès.
Partant en vacances demain je voulais publier avant. Je serai un peu moins présente sur Babelio tout le mois d'aout. Il y aura quelques critiques, SP oblige, mais je vous lirai moins que d'habitude. Bonnes vacances aux aoutiens, Courage à ceux qui en reviennent.
Quelle meilleure machine à broyer les hommes que les laisser se faire "happer par la fatigue historique et les idéologies perverties » ?
Le roman de Padura en fait la brillante démonstration en entrecroisant trois récits.
- Celui de l'interminable exil de Trotsky et des siens, après la révolution d'octobre, chassés et persécutés partout par la haine de Staline, jusqu'à l'assassinat du leader de la révolution permanente, à Mexico, en 1940.
- Celui du parcours de Ramon Mercader, communiste catalan, meurtri par l'échec de la guerre d'Espagne, préparé et endoctriné par la police secrète soviétique et missionné pour accomplir, précisément, cet assassinat politique télécommandé par le sanguinaire petit père des peuples- et bientôt condamné, lui aussi, à la prison, la proscription, réduit au seul refuge « offert » par l' URSS , une autre prison.
-Celui enfin d'Ivan, journaliste et écrivain raté, confiné dans son île cubaine par la peur, la censure et les menaces, ravagé par les remords de sa propre lâcheté, lui qui avait cru aux lendemains qui chantent promis par le vainqueur barbu de Moncada, Fidel Castro.
Trois hommes, trois périples et pourtant tant de points communs : la naïveté d'avoir cru à l'utopie communiste, la honte d‘être un des rouages de son dévoiement historique, et enfin l'amertume de s'en retrouver la victime, à la fois lucide et bâillonnée.
Reste leur dernier point commun, qui éclaire le titre du livre - tiré d'une nouvelle de Chandler - l'amour des chiens…
Lev, Ramon et Ivan : trois hommes qui aiment les chiens et trouvent dans leur bonté et leur inconditionnelle fidélité une joie et un réconfort que ne leur donne plus la société des hommes…
L'homme qui aimait les chiens, donc, est un roman dense, touffu, passionnant, truffé de personnages historiques bien réels -Dolorès Ibarruri, Orwell, Diego Rivera, Frieda Kalho, André Breton.. et j'en passe- nourri d'événements majeurs de notre histoire – la révolution russe, le stalinisme, les procès de Moscou, la guerre d'Espagne, le lâchage des républicains espagnols par les communistes russes à la manoeuvre, le pacte germano-soviétique, la révolution cubaine, la crise économique, les boat-people pour Miami, les muralistes mexicains, la casa Azul de Rivera et Kahlo….
Mais à cette trame historique, l'auteur a su donner chair et corps en créant de beaux personnages, en particulier les deux principaux protagonistes, Trotsky et Mercader, la victime et son assassin, pour lesquels, étrangement, on ressent empathie et compassion, à les voir harcelés par leurs propres excès, par leurs propres erreurs, progressivement dessillés, de plus en plus humains, de plus en plus attachants, à mesure que le filet autour d'eux se resserre et que leur fin approche.
J'ai aussi été sensible à la présence de grandes ombres littéraires qui veillent comme des divinités tutélaires sur ce beau récit : la « formation » de Ramon fait penser à celle du héros de 1984, il est hanté par l'image de sa démone de mère comme dans un roman de Barbey d'Aurevilly, persécuté par les cris et la morsure de sa victime comme dans un conte d'Edgar Poe, la violence désespérée et les luttes internes et fratricides évoquées dans la guerre d'Espagne renvoient à l'Espoir, le constat désenchanté de l'utopie communiste aux écrits de Claude Roy, la toute-puissance vindicative et paranoïaque de Staline aux récits de Boulgakov…
On dévore- mais il faut avoir le coeur bien accroché : cette balade fait plus de 700 pages et c'est un voyage au pays des illusions perdues !
Une belle construction, habile, parlante, éclairante : avoir confié à un avatar –raté- de lui-même le souci de faire le lien entre les deux récits principaux n'est pas la moindre trouvaille de Leonardo Padura dans cet excellent « pavé » : en effet, Ivan le cubain va être le révélateur qui fera remonter l'image de Trotsky et de son assassin du bain de sang où les plonge la critique historique.
Trotsky et Mercader sortent ainsi des clichés convenus : la mise en abyme romanesque leur redonne à la fois quelque chose de personnel et quelque chose de général qui les rapproche de nous : ils gagnent en individualité et en humanité…
Le roman de Padura en fait la brillante démonstration en entrecroisant trois récits.
- Celui de l'interminable exil de Trotsky et des siens, après la révolution d'octobre, chassés et persécutés partout par la haine de Staline, jusqu'à l'assassinat du leader de la révolution permanente, à Mexico, en 1940.
- Celui du parcours de Ramon Mercader, communiste catalan, meurtri par l'échec de la guerre d'Espagne, préparé et endoctriné par la police secrète soviétique et missionné pour accomplir, précisément, cet assassinat politique télécommandé par le sanguinaire petit père des peuples- et bientôt condamné, lui aussi, à la prison, la proscription, réduit au seul refuge « offert » par l' URSS , une autre prison.
-Celui enfin d'Ivan, journaliste et écrivain raté, confiné dans son île cubaine par la peur, la censure et les menaces, ravagé par les remords de sa propre lâcheté, lui qui avait cru aux lendemains qui chantent promis par le vainqueur barbu de Moncada, Fidel Castro.
Trois hommes, trois périples et pourtant tant de points communs : la naïveté d'avoir cru à l'utopie communiste, la honte d‘être un des rouages de son dévoiement historique, et enfin l'amertume de s'en retrouver la victime, à la fois lucide et bâillonnée.
Reste leur dernier point commun, qui éclaire le titre du livre - tiré d'une nouvelle de Chandler - l'amour des chiens…
Lev, Ramon et Ivan : trois hommes qui aiment les chiens et trouvent dans leur bonté et leur inconditionnelle fidélité une joie et un réconfort que ne leur donne plus la société des hommes…
L'homme qui aimait les chiens, donc, est un roman dense, touffu, passionnant, truffé de personnages historiques bien réels -Dolorès Ibarruri, Orwell, Diego Rivera, Frieda Kalho, André Breton.. et j'en passe- nourri d'événements majeurs de notre histoire – la révolution russe, le stalinisme, les procès de Moscou, la guerre d'Espagne, le lâchage des républicains espagnols par les communistes russes à la manoeuvre, le pacte germano-soviétique, la révolution cubaine, la crise économique, les boat-people pour Miami, les muralistes mexicains, la casa Azul de Rivera et Kahlo….
Mais à cette trame historique, l'auteur a su donner chair et corps en créant de beaux personnages, en particulier les deux principaux protagonistes, Trotsky et Mercader, la victime et son assassin, pour lesquels, étrangement, on ressent empathie et compassion, à les voir harcelés par leurs propres excès, par leurs propres erreurs, progressivement dessillés, de plus en plus humains, de plus en plus attachants, à mesure que le filet autour d'eux se resserre et que leur fin approche.
J'ai aussi été sensible à la présence de grandes ombres littéraires qui veillent comme des divinités tutélaires sur ce beau récit : la « formation » de Ramon fait penser à celle du héros de 1984, il est hanté par l'image de sa démone de mère comme dans un roman de Barbey d'Aurevilly, persécuté par les cris et la morsure de sa victime comme dans un conte d'Edgar Poe, la violence désespérée et les luttes internes et fratricides évoquées dans la guerre d'Espagne renvoient à l'Espoir, le constat désenchanté de l'utopie communiste aux écrits de Claude Roy, la toute-puissance vindicative et paranoïaque de Staline aux récits de Boulgakov…
On dévore- mais il faut avoir le coeur bien accroché : cette balade fait plus de 700 pages et c'est un voyage au pays des illusions perdues !
Une belle construction, habile, parlante, éclairante : avoir confié à un avatar –raté- de lui-même le souci de faire le lien entre les deux récits principaux n'est pas la moindre trouvaille de Leonardo Padura dans cet excellent « pavé » : en effet, Ivan le cubain va être le révélateur qui fera remonter l'image de Trotsky et de son assassin du bain de sang où les plonge la critique historique.
Trotsky et Mercader sortent ainsi des clichés convenus : la mise en abyme romanesque leur redonne à la fois quelque chose de personnel et quelque chose de général qui les rapproche de nous : ils gagnent en individualité et en humanité…
Ce livre est un chef-d'oeuvre. Les personnages sont si finement ciselés qu'on les entends respirer. Cela m'a fait pensé à l'Anna Karénine de Tolstoï où j'arrivais à sentir l'air froid de l'hiver Moscovite rien qu'en lisant. Là c'est pareil on a froid, on a chaud, on se révolte, on se met en colère, on rage.On passe de Cuba, à Madrid, de Moscou à Mexico et L Histoire qui nous paraissait floue devient d'une précision étourdissante. L'auteur va et vient entre les décennies sans aucune lourdeur. Sans difficulté, on suit le flot de l'histoire, les liens qui se tissent entre le présent et le passé. 60 ans sont revisités avec une telle vivacité qu'on prend un plaisir à plonger dans le passé. On a de la tendresse pour un Trosky presque inconnu jusqu'alors et on voudrait avoir deux beaux Barzoï au pelage princier. le voile se lève sur les sommets vertigineux des manipulations politiques d'hier mais sans doute aussi d'aujourd'hui. Tout s'éclaire différemment, la guerre d'Espagne et la débâcle républicaine, les accords Hitler/Staline, la passivité de l'Europe devant l'annexion des pays de l'Est, le martyre des peuples de l'Est, l'avilissement de l'homme par l'homme. Mais la grande force de ce roman c'est qu'il rend sa place à l'individu, à l'être particulier et singulier que les totalitarismes ont toujours tentés, en vain, de détruire. Car dans ce roman on s'attache (ou se détache) à des personnages qui sont d'un grand réalisme psychologique. Évidemment; on sort un peu désabusé de la lecture mais cela assainit. La politique semble être capter par des hommes avides de pouvoir qui se désintéressent de l'individu. Alors comment vivre en société ? le roman livre une des réponse possible page 469 « la véritable grandeur humaine réside dans la pratique de la bonté sans condition, dans la capacité de donner à ceux qui n'ont rien, non pas le superflu mais une partie du peu que nous avons(…) ne pas faire de politique ni prétendre par cet acte à une quelconque prééminence ».
L'homme qui aimait les chiens ! Un titre sans relief, pas vraiment attractif, qui aurait pu me faire passer à côté d'un livre époustouflant : un épais roman historique de sept cent cinquante pages portant sur des événements du vingtième siècle, accrochant comme un thriller, passionnant comme une biographie ; et instructif comme un commentaire politique, car certaines idéologies du vingtième siècle continuent à faire l'objet de débats aujourd'hui, bien que...
Que viennent faire les chiens là-dedans, demandez-vous ? Il y a bien, dans le roman, un personnage auquel le narrateur attribue le qualificatif d'homme qui aimait les chiens… Les autres personnages aimaient aussi les chiens... Parmi tous ces chiens, notons juste les barzoïs, des lévriers russes à poil long, qui furent les mascottes de l'aristocratie tsariste, avant d'accompagner, à leur tour, quelques hauts dignitaires soviétiques. Voilà qui nous permet de situer le coeur stratégique de l'intrigue.
Si c'est bien au Kremlin que l'on tire les ficelles, ce n'est pas à Moscou que se déroule l'essentiel de l'action. La trame romanesque se compose du meurtre annoncé d'un homme en exil, et de la minutieuse préparation psychologique de son assassin, pendant plusieurs années, par un agent des services secrets soviétiques. La narration, qui fait alterner les chapitres sur l'exilé et sur le tueur, est aussi fascinante qu'un roman d'espionnage de John le Carré. Les incertitudes et les rebondissements des derniers jours avant le meurtre, racontés presque heure par heure, sont pétrifiants.
Il s'agit pourtant d'une histoire vraie, largement connue, du moins dans ses grandes lignes : le meurtre au Mexique en 1940 sur ordre de Staline, de Lev Davidovitch Bronstein, plus connu sous le nom de Trotski, par Ramón Mercader, un jeune communiste fanatisé, sélectionné dans les rangs républicains pendant la Guerre d'Espagne et manipulé avec un cynisme absolu.
Que penser des deux protagonistes ? D'un côté, un homme vieillissant en exil, toujours ardent dans ses convictions, mais de plus en plus isolé, ce qui pourrait susciter la compassion ; en fait un fanatique obsessionnel, un idéologue illuminé, obnubilé par sa rancoeur contre Staline, et qui avait montré quelques années plus tôt, à la tête de l'Etat Bolchevique et de l'Armée Rouge, sa capacité à sacrifier cruellement à sa cause des dizaines de milliers d'hommes. de l'autre côté, un jeune Catalan exalté, rêvant d'un paradis sans exploiteurs ni exploités, où règnerait l'égalité et la prospérité ; un homme disposant de réelles qualités, auquel on aura inoculé artificiellement la haine de Trotski, et qui finira par perdre son libre arbitre et donc son âme ; quelques doutes au dernier moment ne le feront pas reculer. le premier perdra la vie, l'autre passera le reste de la sienne à rechercher son âme perdue, mais aucun des deux ne mérite la compassion.
S'il en est un qui mérite la compassion, c'est Iván, un écrivain cubain raté né en 1949, un homme malchanceux qui raconte son histoire personnelle en contrepoint de celle de la traque de Trotski par Ramón Mercader. Iván avait rencontré l'homme qui aimait les chiens, venu finir ses jours à Cuba à la fin des années soixante-dix. C'est ainsi qu'il avait entendu parler de Ramón Mercader. Une belle occasion d'écrire un roman, qu'Iván ne saisira pas, du moins sur le moment. Il ne se sentait pas le courage d'aller à l'encontre des « vérités » décrétées par l'URSS, que le régime castriste soutenait sans réserve, après en avoir adopté le modèle économique et l'orthodoxie politique fondée sur l'impossibilité d'une contestation. Très peu de Cubains savaient d'ailleurs qui avait été Trotski et il était presque impossible de se documenter sur lui. L'île vivait alors des subsides de l'URSS, jusqu'à ce que son effondrement plonge Iván et tous les Cubains dans la misère la plus sombre. Toute la vie d'Iván aura été une chute morale et matérielle, marquée essentiellement par la peur.
La peur ! Pour Iván, c'est l'un des piliers sur lesquels reposent les régimes totalitaires. Une peur de tous les instants, qui s'abat sur le peuple, ainsi astreint à l'obéissance muette, sur les dirigeants, exposés à tout moment à la disgrâce sans raison, et sur Staline lui-même, un assassin qui voyait partout des assassins à faire assassiner. L'autre pilier de ces régimes est le mensonge, la capacité cynique à proférer et diffuser des contre-vérités – on dirait aujourd'hui des fake news – pour instiller la haine.
Comment le système soviétique et ses copies ont perverti une grande utopie ! Quand le ciel aura fini de s'écrouler sur le malheureux Iván, c'est la leçon que tirera son ami Daniel, un autre écrivain cubain, dans lequel on peut voir un double de l'auteur, Leonardo Padura, que l'on reconnaît à sa passion pour le base-ball et que l'on suit dans sa Pontiac modèle 1954.
Leonardo Padura n'a jamais quitté Cuba, son pays, où il vit presque anonymement, ignoré par les médias nationaux assujettis au régime, alors que ses oeuvres sont traduites et diffusées en dix langues de par le monde. Cet homme qui n'a pas peur est un immense romancier.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
Que viennent faire les chiens là-dedans, demandez-vous ? Il y a bien, dans le roman, un personnage auquel le narrateur attribue le qualificatif d'homme qui aimait les chiens… Les autres personnages aimaient aussi les chiens... Parmi tous ces chiens, notons juste les barzoïs, des lévriers russes à poil long, qui furent les mascottes de l'aristocratie tsariste, avant d'accompagner, à leur tour, quelques hauts dignitaires soviétiques. Voilà qui nous permet de situer le coeur stratégique de l'intrigue.
Si c'est bien au Kremlin que l'on tire les ficelles, ce n'est pas à Moscou que se déroule l'essentiel de l'action. La trame romanesque se compose du meurtre annoncé d'un homme en exil, et de la minutieuse préparation psychologique de son assassin, pendant plusieurs années, par un agent des services secrets soviétiques. La narration, qui fait alterner les chapitres sur l'exilé et sur le tueur, est aussi fascinante qu'un roman d'espionnage de John le Carré. Les incertitudes et les rebondissements des derniers jours avant le meurtre, racontés presque heure par heure, sont pétrifiants.
Il s'agit pourtant d'une histoire vraie, largement connue, du moins dans ses grandes lignes : le meurtre au Mexique en 1940 sur ordre de Staline, de Lev Davidovitch Bronstein, plus connu sous le nom de Trotski, par Ramón Mercader, un jeune communiste fanatisé, sélectionné dans les rangs républicains pendant la Guerre d'Espagne et manipulé avec un cynisme absolu.
Que penser des deux protagonistes ? D'un côté, un homme vieillissant en exil, toujours ardent dans ses convictions, mais de plus en plus isolé, ce qui pourrait susciter la compassion ; en fait un fanatique obsessionnel, un idéologue illuminé, obnubilé par sa rancoeur contre Staline, et qui avait montré quelques années plus tôt, à la tête de l'Etat Bolchevique et de l'Armée Rouge, sa capacité à sacrifier cruellement à sa cause des dizaines de milliers d'hommes. de l'autre côté, un jeune Catalan exalté, rêvant d'un paradis sans exploiteurs ni exploités, où règnerait l'égalité et la prospérité ; un homme disposant de réelles qualités, auquel on aura inoculé artificiellement la haine de Trotski, et qui finira par perdre son libre arbitre et donc son âme ; quelques doutes au dernier moment ne le feront pas reculer. le premier perdra la vie, l'autre passera le reste de la sienne à rechercher son âme perdue, mais aucun des deux ne mérite la compassion.
S'il en est un qui mérite la compassion, c'est Iván, un écrivain cubain raté né en 1949, un homme malchanceux qui raconte son histoire personnelle en contrepoint de celle de la traque de Trotski par Ramón Mercader. Iván avait rencontré l'homme qui aimait les chiens, venu finir ses jours à Cuba à la fin des années soixante-dix. C'est ainsi qu'il avait entendu parler de Ramón Mercader. Une belle occasion d'écrire un roman, qu'Iván ne saisira pas, du moins sur le moment. Il ne se sentait pas le courage d'aller à l'encontre des « vérités » décrétées par l'URSS, que le régime castriste soutenait sans réserve, après en avoir adopté le modèle économique et l'orthodoxie politique fondée sur l'impossibilité d'une contestation. Très peu de Cubains savaient d'ailleurs qui avait été Trotski et il était presque impossible de se documenter sur lui. L'île vivait alors des subsides de l'URSS, jusqu'à ce que son effondrement plonge Iván et tous les Cubains dans la misère la plus sombre. Toute la vie d'Iván aura été une chute morale et matérielle, marquée essentiellement par la peur.
La peur ! Pour Iván, c'est l'un des piliers sur lesquels reposent les régimes totalitaires. Une peur de tous les instants, qui s'abat sur le peuple, ainsi astreint à l'obéissance muette, sur les dirigeants, exposés à tout moment à la disgrâce sans raison, et sur Staline lui-même, un assassin qui voyait partout des assassins à faire assassiner. L'autre pilier de ces régimes est le mensonge, la capacité cynique à proférer et diffuser des contre-vérités – on dirait aujourd'hui des fake news – pour instiller la haine.
Comment le système soviétique et ses copies ont perverti une grande utopie ! Quand le ciel aura fini de s'écrouler sur le malheureux Iván, c'est la leçon que tirera son ami Daniel, un autre écrivain cubain, dans lequel on peut voir un double de l'auteur, Leonardo Padura, que l'on reconnaît à sa passion pour le base-ball et que l'on suit dans sa Pontiac modèle 1954.
Leonardo Padura n'a jamais quitté Cuba, son pays, où il vit presque anonymement, ignoré par les médias nationaux assujettis au régime, alors que ses oeuvres sont traduites et diffusées en dix langues de par le monde. Cet homme qui n'a pas peur est un immense romancier.
Lien : http://cavamieuxenlecrivant...
« Ce qui compte c'est le rêve, pas l'homme. »
« L'homme qui aimait les chiens » est un livre historique et politique captivant centré sur l'histoire d'un des assassinats politiques les plus révélateurs du XXème siècle.
Captivant, parce qu'il démêle les dessous de l'assassinat de Trotski dans le contexte très tendu des relations internationales de l'entre-deux-guerres et de la montée des totalitarismes profitant de la crise économique, politique et sociale.
Captivant également parce que Leonardo Padura entrelace la grande et la petite Histoire pour n'en faire qu'une. En effet, son personnage principal, Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain soumis à la dictature de Castro et vétérinaire à La Havane, rencontre durant l'été 77 un vieil homme étrange et solitaire qui se promène sur la plage avec deux magnifiques lévriers barzoïs.
Après plusieurs rencontres fortuites, l'homme va peu à peu se confier sur les événements qui ont conduit au meurtre de Léon Trotski. L'homme semble connaître intimement l'assassin de l'opposant en exil, grande figure de la révolution russe de 1917.
*
L'histoire s'articule autour du destin de trois personnages que L Histoire va lier de manière tragique à travers le temps et l'espace. Un autre point commun qui les relie est leur amour pour les chiens et en particulier les lévriers Barzoïs.
Leonardo Padura entrelace leurs vies en trois brins narratifs qui se superposent à travers plusieurs époques. Par le biais de l'écrivain cubain, les voix du passé forment progressivement une tresse historique complexe autour de la lutte de pouvoir qui a opposé Staline à Trotski. L'Europe y apparaît comme un vaste échiquier où les dirigeants attaquent et contre-attaquent, conspirent et manipulent, s'allient ou éliminent leurs adversaires.
*
Le premier fil est ancré à Cuba comme tous les romans de Leonardo Padura. Il est celui du narrateur du roman, personnage fictif dont j'ai déjà parlé précédemment. S'il peut paraître à première vue moins intéressant, je le trouve au contraire essentiel à plus d'un titre.
Tout d'abord, il est celui qui accole présent et passé, semblant attester qu'avec le passage du temps, les crimes d'hier s'effacent des mémoires collectives mais sans que personne n'en tire la moindre leçon. C'est comme si l'indicible et l'horreur se répétaient inlassablement, impunément.
Ensuite, Iván, en tant qu'écrivain, joue à mon sens le rôle de passeur, de témoin : en effet, la littérature joue un rôle précieux en témoignant d'une époque, en participant à la transmission d'une mémoire historique qui s'efface peu à peu.
De plus, cette partie de l'histoire est plus narrative et moins exigeante, ce qui apporte une respiration appréciable pour le lecteur. Pour autant elle est loin d'être négligeable car Leonardo Padura en profite pour aborder les conséquences de l'assassinat de Trostki à Cuba sous l'ère Castro. Elle nous immerge dans la réalité cubaine. Il évoque ainsi l'homosexualité, la censure littéraire, la pauvreté, le manque de nourriture et de libertés, l'exil, …
Grâce à ce fil ancré dans le présent, l'auteur nous entraîne dans le passé et reconstitue avec beaucoup de talent les vies de Trotski et de Ramon Mercader.
Le côté historique, richement documenté et superbement écrit, est vraiment très réussi : l'auteur est parvenu à rendre le récit passionnant et très instructif.
*
Le second fil développé par l'auteur est donc celui de Liev Davidovich Bronstein, dit Trotski. Déporté aux confins de la Russie orientale, dans les steppes du Kirghizstan, il sera par la suite expulsé de l'Union soviétique avec une partie de sa famille et trouvera finalement refuge au Mexique.
L'ombre menaçante de Staline accompagnera son exil, planant silencieusement au-dessus d'eux près à fondre au moment le plus opportun. Staline, qui tel un chef d'orchestre, impulse sa vision d'un monde centré sur sa personne, qui discrédite inlassablement son infatigable ennemi Trotski, élimine ses adversaires réels ou potentiels, rejetant sur eux ses échecs tout en consolidant par ailleurs sa position dominante dans les jeux de pouvoir.
« … l'histoire ne supporte pas de témoins »
J'ai eu de la compassion pour cet homme seul face à ses tristes années d'exil, ses erreurs passées, l'attente de la mort alors que son entourage est peu à peu décimé ; pour sa femme et ses enfants qui seront tous exécutés sur ordre de Staline. Certains moments de sa vie sont particulièrement touchants, la disparition de ses enfants, son attachement à son lévrier barzoï, sa foi inébranlable.
« L.D. est seul. Nous marchons dans le petit jardin de Coyoacán, et nous sommes entourés de fantômes aux fronts troués… Quand il travaille, je l'entends parfois lancer un soupir et se parler à lui-même à haute voix : ‘Quelle fatigue… je n'en peux plus !' »
« … il devait savoir que, le moment venu, ni l'acier, ni les pierres, ni les gardes ne pourraient le sauver, parce qu'il avait déjà été condamné par l'histoire. »
L'auteur rend bien compte de son statut à la fois de victime mais aussi de bourreau, d'où mes sentiments ambivalents, car il ne faut pas oublier que Trotski fut une des figures de la révolution russe de 1917 ; qu'empli de sa mission révolutionnaire, il fut le principal organisateur de l'Armée rouge et de la répression contre les opposants au régime communiste, n'hésitant pas à institutionnaliser la terreur, à exécuter sans pitié ses adversaires.
*
Parallèlement au difficile parcours du leader révolutionnaire russe, l'auteur retrace dans un troisième et dernier fil, la trajectoire suivie par le meurtrier de Trotski, Ramón Mercader.
Ainsi, on plonge dans la guerre civile espagnole des années 30. Milicien communiste espagnol, on suit son parcours depuis son enfance tout en s'intéressant aux grandes puissances qui attisent les tensions dans le pays et tirent les ficelles du conflit entre républicains et nationalistes dirigés par général Franco.
On lit aussi la manière dont il va être recruté comme combattant de l'idéal soviétique pour devenir par la suite le bras meurtrier de Staline. Véritable caméléon, il adoptera de nombreuses identités pour se rapprocher lentement de sa cible, entrer dans son cercle intime, gagner sa confiance et au final, l'exécuter.
Même si le lecteur connaît par avance fa fin tragique de Trotski, j'ai aimé la tension qu'imprimait l'auteur plus la date fatidique du 21 août 1940 se rapprochait.
*
Les personnages, principaux comme secondaires, sont particulièrement intrigants, fascinants, retors, monstrueux.
Je vous laisse découvrir comment Ramón Mercader a été manipulé, comment sa foi, ses convictions politiques, son besoin de reconnaissance ont été utilisés pour le modeler et en faire une marionnette fière de participer à cette mission d'envergure. Là encore, l'auteur a su montrer comment cet homme s'est retrouvé dans un engrenage meurtrier dont il n'a pu s'échapper et qui a fait de lui à la fois un sauveur, un bourreau et une victime.
« On lui avait tout pris, son nom, son passé, sa volonté, sa dignité. Et finalement pour quoi ? Depuis l'instant où il avait répondu « oui » … Ramón a vécu dans une prison qui l'a poursuivi jusqu'au jour de sa mort. »
*
Même si l'auteur a parfois fait appel à la fiction, surtout en ce qui concerne la vie de Ramón Mercader pour laquelle ne subsistent que peu de documents historiques, il y a en revanche, une justesse et une profondeur dans l'écriture qui m'a plu.
C'est un récit troublant, empreint de nostalgie, hanté par la mort et la peur, nourri de vérités et de mensonges, de combats et de trahisons, de foi aveugle et de sacrifices, d'idéologies et d'arbitraire, de réussites et d'échecs, de rêves et de désillusions, de haine et de peur.
*
L'auteur explore les thèmes de l'histoire du XXème siècle et les crimes des régimes totalitaires, de l'utopie politique jusqu'à la dictature légitimée, de la justification d'actes de barbarie sous couvert de créer un monde plus juste, de l'engagement politique jusqu'à l'endoctrinement, de la solitude et de la peur, de l'amitié et de la trahison, de l'exil et du déracinement.
Il évoque également le lien entre le pouvoir et l'art, thème déjà évoqué il y a peu à propos d'Hitler qui n'hésitait pas, lui non plus, à légitimer son pouvoir et son influence en faisant de l'art un instrument de propagande et d'oppression.
« L'art est une arme de la révolution.. »
*
Pour finir, « L'homme qui aimait les chiens » est un récit superbement écrit, très bien documenté, qui mêle fiction et réalité historique.
Jamais fastidieux ni soporifique, ce récit m'a emportée dans les méandres de l'Histoire. Leonardo Padura est un auteur cubain pour lequel j'ai envie d'approfondir ses textes et ses thématiques.
*****
Cette lecture est le fruit d'une envie de découvrir cet auteur en lecture partagée. Je vous remercie tous pour ces échanges et ces regards entrecroisés qui permettent d'avoir un regard plus profond et nuancé sur les oeuvres.
*****
« L'homme qui aimait les chiens » est un livre historique et politique captivant centré sur l'histoire d'un des assassinats politiques les plus révélateurs du XXème siècle.
Captivant, parce qu'il démêle les dessous de l'assassinat de Trotski dans le contexte très tendu des relations internationales de l'entre-deux-guerres et de la montée des totalitarismes profitant de la crise économique, politique et sociale.
Captivant également parce que Leonardo Padura entrelace la grande et la petite Histoire pour n'en faire qu'une. En effet, son personnage principal, Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain soumis à la dictature de Castro et vétérinaire à La Havane, rencontre durant l'été 77 un vieil homme étrange et solitaire qui se promène sur la plage avec deux magnifiques lévriers barzoïs.
Après plusieurs rencontres fortuites, l'homme va peu à peu se confier sur les événements qui ont conduit au meurtre de Léon Trotski. L'homme semble connaître intimement l'assassin de l'opposant en exil, grande figure de la révolution russe de 1917.
*
L'histoire s'articule autour du destin de trois personnages que L Histoire va lier de manière tragique à travers le temps et l'espace. Un autre point commun qui les relie est leur amour pour les chiens et en particulier les lévriers Barzoïs.
Leonardo Padura entrelace leurs vies en trois brins narratifs qui se superposent à travers plusieurs époques. Par le biais de l'écrivain cubain, les voix du passé forment progressivement une tresse historique complexe autour de la lutte de pouvoir qui a opposé Staline à Trotski. L'Europe y apparaît comme un vaste échiquier où les dirigeants attaquent et contre-attaquent, conspirent et manipulent, s'allient ou éliminent leurs adversaires.
*
Le premier fil est ancré à Cuba comme tous les romans de Leonardo Padura. Il est celui du narrateur du roman, personnage fictif dont j'ai déjà parlé précédemment. S'il peut paraître à première vue moins intéressant, je le trouve au contraire essentiel à plus d'un titre.
Tout d'abord, il est celui qui accole présent et passé, semblant attester qu'avec le passage du temps, les crimes d'hier s'effacent des mémoires collectives mais sans que personne n'en tire la moindre leçon. C'est comme si l'indicible et l'horreur se répétaient inlassablement, impunément.
Ensuite, Iván, en tant qu'écrivain, joue à mon sens le rôle de passeur, de témoin : en effet, la littérature joue un rôle précieux en témoignant d'une époque, en participant à la transmission d'une mémoire historique qui s'efface peu à peu.
De plus, cette partie de l'histoire est plus narrative et moins exigeante, ce qui apporte une respiration appréciable pour le lecteur. Pour autant elle est loin d'être négligeable car Leonardo Padura en profite pour aborder les conséquences de l'assassinat de Trostki à Cuba sous l'ère Castro. Elle nous immerge dans la réalité cubaine. Il évoque ainsi l'homosexualité, la censure littéraire, la pauvreté, le manque de nourriture et de libertés, l'exil, …
Grâce à ce fil ancré dans le présent, l'auteur nous entraîne dans le passé et reconstitue avec beaucoup de talent les vies de Trotski et de Ramon Mercader.
Le côté historique, richement documenté et superbement écrit, est vraiment très réussi : l'auteur est parvenu à rendre le récit passionnant et très instructif.
*
Le second fil développé par l'auteur est donc celui de Liev Davidovich Bronstein, dit Trotski. Déporté aux confins de la Russie orientale, dans les steppes du Kirghizstan, il sera par la suite expulsé de l'Union soviétique avec une partie de sa famille et trouvera finalement refuge au Mexique.
L'ombre menaçante de Staline accompagnera son exil, planant silencieusement au-dessus d'eux près à fondre au moment le plus opportun. Staline, qui tel un chef d'orchestre, impulse sa vision d'un monde centré sur sa personne, qui discrédite inlassablement son infatigable ennemi Trotski, élimine ses adversaires réels ou potentiels, rejetant sur eux ses échecs tout en consolidant par ailleurs sa position dominante dans les jeux de pouvoir.
« … l'histoire ne supporte pas de témoins »
J'ai eu de la compassion pour cet homme seul face à ses tristes années d'exil, ses erreurs passées, l'attente de la mort alors que son entourage est peu à peu décimé ; pour sa femme et ses enfants qui seront tous exécutés sur ordre de Staline. Certains moments de sa vie sont particulièrement touchants, la disparition de ses enfants, son attachement à son lévrier barzoï, sa foi inébranlable.
« L.D. est seul. Nous marchons dans le petit jardin de Coyoacán, et nous sommes entourés de fantômes aux fronts troués… Quand il travaille, je l'entends parfois lancer un soupir et se parler à lui-même à haute voix : ‘Quelle fatigue… je n'en peux plus !' »
« … il devait savoir que, le moment venu, ni l'acier, ni les pierres, ni les gardes ne pourraient le sauver, parce qu'il avait déjà été condamné par l'histoire. »
L'auteur rend bien compte de son statut à la fois de victime mais aussi de bourreau, d'où mes sentiments ambivalents, car il ne faut pas oublier que Trotski fut une des figures de la révolution russe de 1917 ; qu'empli de sa mission révolutionnaire, il fut le principal organisateur de l'Armée rouge et de la répression contre les opposants au régime communiste, n'hésitant pas à institutionnaliser la terreur, à exécuter sans pitié ses adversaires.
*
Parallèlement au difficile parcours du leader révolutionnaire russe, l'auteur retrace dans un troisième et dernier fil, la trajectoire suivie par le meurtrier de Trotski, Ramón Mercader.
Ainsi, on plonge dans la guerre civile espagnole des années 30. Milicien communiste espagnol, on suit son parcours depuis son enfance tout en s'intéressant aux grandes puissances qui attisent les tensions dans le pays et tirent les ficelles du conflit entre républicains et nationalistes dirigés par général Franco.
On lit aussi la manière dont il va être recruté comme combattant de l'idéal soviétique pour devenir par la suite le bras meurtrier de Staline. Véritable caméléon, il adoptera de nombreuses identités pour se rapprocher lentement de sa cible, entrer dans son cercle intime, gagner sa confiance et au final, l'exécuter.
Même si le lecteur connaît par avance fa fin tragique de Trotski, j'ai aimé la tension qu'imprimait l'auteur plus la date fatidique du 21 août 1940 se rapprochait.
*
Les personnages, principaux comme secondaires, sont particulièrement intrigants, fascinants, retors, monstrueux.
Je vous laisse découvrir comment Ramón Mercader a été manipulé, comment sa foi, ses convictions politiques, son besoin de reconnaissance ont été utilisés pour le modeler et en faire une marionnette fière de participer à cette mission d'envergure. Là encore, l'auteur a su montrer comment cet homme s'est retrouvé dans un engrenage meurtrier dont il n'a pu s'échapper et qui a fait de lui à la fois un sauveur, un bourreau et une victime.
« On lui avait tout pris, son nom, son passé, sa volonté, sa dignité. Et finalement pour quoi ? Depuis l'instant où il avait répondu « oui » … Ramón a vécu dans une prison qui l'a poursuivi jusqu'au jour de sa mort. »
*
Même si l'auteur a parfois fait appel à la fiction, surtout en ce qui concerne la vie de Ramón Mercader pour laquelle ne subsistent que peu de documents historiques, il y a en revanche, une justesse et une profondeur dans l'écriture qui m'a plu.
C'est un récit troublant, empreint de nostalgie, hanté par la mort et la peur, nourri de vérités et de mensonges, de combats et de trahisons, de foi aveugle et de sacrifices, d'idéologies et d'arbitraire, de réussites et d'échecs, de rêves et de désillusions, de haine et de peur.
*
L'auteur explore les thèmes de l'histoire du XXème siècle et les crimes des régimes totalitaires, de l'utopie politique jusqu'à la dictature légitimée, de la justification d'actes de barbarie sous couvert de créer un monde plus juste, de l'engagement politique jusqu'à l'endoctrinement, de la solitude et de la peur, de l'amitié et de la trahison, de l'exil et du déracinement.
Il évoque également le lien entre le pouvoir et l'art, thème déjà évoqué il y a peu à propos d'Hitler qui n'hésitait pas, lui non plus, à légitimer son pouvoir et son influence en faisant de l'art un instrument de propagande et d'oppression.
« L'art est une arme de la révolution.. »
*
Pour finir, « L'homme qui aimait les chiens » est un récit superbement écrit, très bien documenté, qui mêle fiction et réalité historique.
Jamais fastidieux ni soporifique, ce récit m'a emportée dans les méandres de l'Histoire. Leonardo Padura est un auteur cubain pour lequel j'ai envie d'approfondir ses textes et ses thématiques.
*****
Cette lecture est le fruit d'une envie de découvrir cet auteur en lecture partagée. Je vous remercie tous pour ces échanges et ces regards entrecroisés qui permettent d'avoir un regard plus profond et nuancé sur les oeuvres.
*****
En 1968, alors que les mouvements contestataires et les manifestations contre l'establishment essaimaient à travers le monde, y compris en Amérique latine, alors que le rock, la mouvance hippie et la contreculture en général influençaient une jeunesse aspirant à plus de liberté et à un nouvel ordre sociétal, à Cuba, déjà, «the dream is over ». Les structures locales du Parti Communiste Cubain (PCC), les Comités de Défense de la Révolution (CDR), la Centrale des Travailleurs de Cuba (CTC), qui s'étaient vu transformer progressivement en organes de contrôle idéologique, dissuadent ses citoyens de se livrer à toute forme de contestation politique; de même pour ce qui est de l'Union Nationale des Écrivains et Artistes de Cuba (UNEAC), qui au départ avait largement soutenu la création artistique et l'émergence de nouveaux talents littéraires dans l'île, muée définitivement en organe de censure : n'y sont désormais publiés que les auteurs certifiés idéologiquement conformes par les éditeurs d'État.
L'année 1968 scelle ainsi la fin définitive du rêve d'une Révolution cubaine dont la réussite et le caractère singulier se devaient non seulement à une adhésion et à une mobilisation massives de la société civile cubaine, mais aussi à une volonté manifeste d'indépendance politique de la part de ses dirigeants vis-à-vis de l'impérialisme pratiqué à large échelle par l'URSS. Si, par la force des choses (et surtout depuis le blocus imposé par les américains), le régime cubain ne pouvait totalement se soustraire à l'ombre du géant soviétique, il cherchait cependant, dans la mesure du possible, à se départir d'une dépendance trop exclusive et tutélaire au Kremlin. Au mois d'août 1968, Cuba, qui avait pourtant tenu à coeur, depuis la prise de pouvoir par les forces révolutionnaires une dizaine d'années plus tôt, de jouer un rôle politique et diplomatique prépondérant au sein du groupe des pays dits non-alignés, apportera son soutien inconditionnel à l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'URSS, suite au printemps de Prague. S'en suivra rapidement la promulgation en interne d'un premier plan de développement s'inspirant directement du modèle économique soviétique, ce qui aura pour conséquence, entre autres, de soumettre irréparablement l'économie cubaine à une dépendance intégrale au bloc communiste durant les deux décennies à venir, et jusqu'à l'effondrement de l'URSS dans les années quatre-vingt-dix, contraignant alors la nation cubaine, exsangue, affamée, démunie, à subir des carences et des privations jamais connues auparavant dans l'île, et condamnant la plupart de ses citoyens à toutes sortes de renoncements, quelquefois aux pires expédients, ou bien à l'exil définitif pour pouvoir survivre.
C'est dans ce contexte, après les ruptures emblématiques survenues donc à la fin des années 60, que le personnage et alter-ego de l'auteur, Iván, après des débuts prometteurs en tant que jeune écrivain, sera profondément marqué par la motion de censure venant frapper son oeuvre. «Nous étions la générations des naïfs, des romantiques qui avaient tout accepté et tout justifié, les yeux tournés vers l'avenir, qui coupèrent la canne à sucre, convaincus qu'ils devaient le faire (…) la génération qui fut la cible des attaques de l'intransigeance sexuelle, religieuse, idéologique, culturelle et même alcoolique, qu'elle endura tout au plus avec un hochement de tête et, bien souvent, sans éprouver le ressentiment ou le désespoir qui mène à la fuite.» Démotivé, désabusé par la tournure prise par les évènements, touché personnellement par la peur qui se faisait de plus en plus présente dans les consciences de son époque et de sa génération, suite aux remontrances et les sanctions effectives dont il avait fait l'objet, Iván finit par renoncer à toute illusion de poursuivre une carrière universitaire et littéraire. Quelques temps après, il trouve un travail de rédacteur dans une revue vétérinaire, se marie, fonde une famille, se résigne.
Un soir de mars 1977, sur la plage de Santa María del Mar, Iván fait la rencontre de celui qu'il surnommera «l'homme qui aimait les chiens», titre d'une des nouvelles du recueil de Raymond Chandler (« Un tueur sous la pluie ») qu'il lisait au moment où il entendit pour la première fois, à quelques mètres de lui, l'homme appeler ses deux magnifiques lévriers russes, «ces barzoïs si prisés» qu'Iván voyait «pour la première fois ailleurs que sur les planches d'un livre ou de la revue vétérinaire». Autour des chiens, se noue un dialogue entre les deux inconnus. Impressionné par l'allure et par les propos de ce personnage atypique dont la présence même à Cuba semble entourée d'une aura de mystère qui l'intrigue de plus en plus, au fil de leurs rencontres sur la plage qu'Iván cherchera à susciter en retournant régulièrement à Santa María del Mar, «l'homme qui aimait les chiens» en viendra petit à petit à lui livrer l'histoire de Ramón Mercader, l'assassin de Trotski. Mercader, côtoyé à plusieurs reprises par Jaime López, l'homme de la plage, à qui le jeune révolutionnaire espagnol responsable de l'assassinat de Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotski, se serait confié sans réserves, finiront tous les deux par se confondre en une seule et même image dans l'esprit d'Iván. La disparition subite et inexpliquée de l'énigmatique personnage, quelques mois après leur première rencontre, le laissera pourtant sans aucune réponse claire aux questions qui continueront à le tarauder pendant plus d'une vingtaine d'années: Qu'est-il arrivé au juste à Ramón Mercader après avoir purgé sa peine de vingt ans de prison au Mexique et avoir été exfiltré vers l'URSS, où Lopez, «l'homme qui aimait les chiens » l'aurait rencontré plus tard? Mais à vrai dire, qui est qui en fin de compte? Mercader et López ne seraient-ils le seul et même homme? Dans ce cas-là, pourquoi s'être confié à lui, Iván, tout en sachant qu'il avait un passé d'écrivain et qu'il avait publié un livre? Et puis, pourquoi en même temps lui avoir fait jurer de ne jamais révéler à personne toute cette histoire?
Malgré tous les écueils concrets auxquels il devrait faire face pour tenter d'assembler les pièces de cet étrange puzzle (d'autant que le régime castriste ayant proscrit tout ce qui avait trait à Trotski, l'oeuvre, la vie même ou la mort de ce dernier étaient à ce moment totalement méconnues et inaccessibles au commun des cubains), malgré également toute l'ambiguïté d'un tel projet (comment écrire sans trahir la promesse faite à l'homme qui aimait les chiens?), malgré, last but not least, lui-même, Iván et le combat intérieur qu'il livre contre ses propres fantômes, l'écrivain sommeillant au fond de lui ne résistera, in fine, à la tentation de s'en emparer et de s'investir dans la reconstruction des parcours tragiques de Trotski et de Ramon Mercader.
Leonardo Padura, situe en 1989, au même moment où tombait le Mur de Berlin, les toutes premières fondations de cet immense édifice que constituerait L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS, qui ne serait pourtant effectivement érigé et publié qu'une vingtaine d'années après. Fruit donc d'une très longue maturation dans l'esprit de son auteur, la pierre inaugurale de ce monument dédié aux ravages abominables provoqués par la plus grandiose et la plus tragique de toutes les utopies du XXème siècle, y fut posée cette même année, à l'occasion du premier voyage au Mexique de Lenardo Padura et à la suite du « choc purement humain, que causa (sa) visite de la maison où avait vécu et était mort Léon Trotski».
Il s'agit bien, en effet, avant tout de matière vive et humaine, personnifiée, incarnée dans des individualités au-delà du rôle supra-humain auquel on avait souhaité les astreindre, mises à l'épreuve de leurs croyances et de leurs doutes face à l'imposture idéologique dont elles ont été victimes. Dans ce roman fleuve à l'architecture complexe, alternant faits historiques et spéculation fictionnelle, trois parcours sont reconstruits parallèlement pour se rejoindre dans un épilogue sublime, bouquet final de vérité et d'humanité : celui de Léon Troski, depuis son exil de l'URSS en 1929, jusqu'à son assassinat au Mexique en 1940, celui de Ramon Mercader, jeune communiste espagnol combattant au sein des forces républicaines durant la guerre civile d'Espagne, embrigadé par les services secrets soviétiques, celui, enfin, d'Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain et double fictionnel de Leonardo Padura, personnage emblématique qui, selon son créateur, «fonctionne aussi comme métaphore d'une génération et comme le résultat prosaïque d'une défaite historique».
Appuyé par un travail de reconstitution historique détaillé, strictement fidèle à la chronologie des évènements, l'auteur, à partir «de ce qui est vérifiable et de ce qui est historiquement possible ou plausible d'après le contexte» tente surtout d'approcher, d'un point de vue essentiellement subjectif, les vicissitudes, les ambigüités, les épreuves psychologiques subies par ses personnages, entraînés dans le drame collectif provoqué par les dérives totalitaires et la débâcle effroyable de trois utopies majeures du XXème siècle : les révolutions russe, espagnole et cubaine .
Le lecteur suit pas à pas, sur près de sept-cents pages, une intrigue dont, après tout, il connaît déjà le dénouement aussi dramatique qu'inutile (d'un point de vue historique, aucun meurtre ne pouvant, bien évidemment, être considéré d'«utilité»). L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS étant un quelque sorte un anti-thriller politique, un roman construit essentiellement à partir de cette atmosphère particulière qui habite l'attente, l'angoisse, la peur, et qui donne une densité particulière au passage du temps, épaisseur toujours extensible par l'alternance irrésolue entre croyance aveugle en l'avenir et clairvoyance intolérable face à l'imminence du désastre, entre sentiments de révolte et de soumission face à des injonctions qui dépassent complètement les individus.
Les longueurs tant redoutées et habituellement honnies (souvent, d'ailleurs, à priori et de manière indiscriminée...) par un grand nombre de lecteurs contemporains, semblent donc constituer ici un élément essentiel à l'approche choisie par l'auteur, un choix de narration délibéré et auquel le lecteur doit pouvoir être en mesure de se laisser porter, grâce notamment à la finesse d'analyse et à la qualité exceptionnelle de la plume déliée et alerte de Leonardo Padura.
En définitive, une lecture aussi instructive d'un point de vue historique que touchante, un récit saisissant, empreint de sensibilité, d'empathie et de compassion pour ses personnages, victimes «happées par la fatigue historique et l'utopie pervertie ». Un grand roman où le mensonge collectif le dispute à la tragédie personnelle. Un auteur doté d'un immense talent de conteur, que je découvre avec ce livre et vers lequel je vais certainement revenir ultérieurement.
L'année 1968 scelle ainsi la fin définitive du rêve d'une Révolution cubaine dont la réussite et le caractère singulier se devaient non seulement à une adhésion et à une mobilisation massives de la société civile cubaine, mais aussi à une volonté manifeste d'indépendance politique de la part de ses dirigeants vis-à-vis de l'impérialisme pratiqué à large échelle par l'URSS. Si, par la force des choses (et surtout depuis le blocus imposé par les américains), le régime cubain ne pouvait totalement se soustraire à l'ombre du géant soviétique, il cherchait cependant, dans la mesure du possible, à se départir d'une dépendance trop exclusive et tutélaire au Kremlin. Au mois d'août 1968, Cuba, qui avait pourtant tenu à coeur, depuis la prise de pouvoir par les forces révolutionnaires une dizaine d'années plus tôt, de jouer un rôle politique et diplomatique prépondérant au sein du groupe des pays dits non-alignés, apportera son soutien inconditionnel à l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'URSS, suite au printemps de Prague. S'en suivra rapidement la promulgation en interne d'un premier plan de développement s'inspirant directement du modèle économique soviétique, ce qui aura pour conséquence, entre autres, de soumettre irréparablement l'économie cubaine à une dépendance intégrale au bloc communiste durant les deux décennies à venir, et jusqu'à l'effondrement de l'URSS dans les années quatre-vingt-dix, contraignant alors la nation cubaine, exsangue, affamée, démunie, à subir des carences et des privations jamais connues auparavant dans l'île, et condamnant la plupart de ses citoyens à toutes sortes de renoncements, quelquefois aux pires expédients, ou bien à l'exil définitif pour pouvoir survivre.
C'est dans ce contexte, après les ruptures emblématiques survenues donc à la fin des années 60, que le personnage et alter-ego de l'auteur, Iván, après des débuts prometteurs en tant que jeune écrivain, sera profondément marqué par la motion de censure venant frapper son oeuvre. «Nous étions la générations des naïfs, des romantiques qui avaient tout accepté et tout justifié, les yeux tournés vers l'avenir, qui coupèrent la canne à sucre, convaincus qu'ils devaient le faire (…) la génération qui fut la cible des attaques de l'intransigeance sexuelle, religieuse, idéologique, culturelle et même alcoolique, qu'elle endura tout au plus avec un hochement de tête et, bien souvent, sans éprouver le ressentiment ou le désespoir qui mène à la fuite.» Démotivé, désabusé par la tournure prise par les évènements, touché personnellement par la peur qui se faisait de plus en plus présente dans les consciences de son époque et de sa génération, suite aux remontrances et les sanctions effectives dont il avait fait l'objet, Iván finit par renoncer à toute illusion de poursuivre une carrière universitaire et littéraire. Quelques temps après, il trouve un travail de rédacteur dans une revue vétérinaire, se marie, fonde une famille, se résigne.
Un soir de mars 1977, sur la plage de Santa María del Mar, Iván fait la rencontre de celui qu'il surnommera «l'homme qui aimait les chiens», titre d'une des nouvelles du recueil de Raymond Chandler (« Un tueur sous la pluie ») qu'il lisait au moment où il entendit pour la première fois, à quelques mètres de lui, l'homme appeler ses deux magnifiques lévriers russes, «ces barzoïs si prisés» qu'Iván voyait «pour la première fois ailleurs que sur les planches d'un livre ou de la revue vétérinaire». Autour des chiens, se noue un dialogue entre les deux inconnus. Impressionné par l'allure et par les propos de ce personnage atypique dont la présence même à Cuba semble entourée d'une aura de mystère qui l'intrigue de plus en plus, au fil de leurs rencontres sur la plage qu'Iván cherchera à susciter en retournant régulièrement à Santa María del Mar, «l'homme qui aimait les chiens» en viendra petit à petit à lui livrer l'histoire de Ramón Mercader, l'assassin de Trotski. Mercader, côtoyé à plusieurs reprises par Jaime López, l'homme de la plage, à qui le jeune révolutionnaire espagnol responsable de l'assassinat de Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotski, se serait confié sans réserves, finiront tous les deux par se confondre en une seule et même image dans l'esprit d'Iván. La disparition subite et inexpliquée de l'énigmatique personnage, quelques mois après leur première rencontre, le laissera pourtant sans aucune réponse claire aux questions qui continueront à le tarauder pendant plus d'une vingtaine d'années: Qu'est-il arrivé au juste à Ramón Mercader après avoir purgé sa peine de vingt ans de prison au Mexique et avoir été exfiltré vers l'URSS, où Lopez, «l'homme qui aimait les chiens » l'aurait rencontré plus tard? Mais à vrai dire, qui est qui en fin de compte? Mercader et López ne seraient-ils le seul et même homme? Dans ce cas-là, pourquoi s'être confié à lui, Iván, tout en sachant qu'il avait un passé d'écrivain et qu'il avait publié un livre? Et puis, pourquoi en même temps lui avoir fait jurer de ne jamais révéler à personne toute cette histoire?
Malgré tous les écueils concrets auxquels il devrait faire face pour tenter d'assembler les pièces de cet étrange puzzle (d'autant que le régime castriste ayant proscrit tout ce qui avait trait à Trotski, l'oeuvre, la vie même ou la mort de ce dernier étaient à ce moment totalement méconnues et inaccessibles au commun des cubains), malgré également toute l'ambiguïté d'un tel projet (comment écrire sans trahir la promesse faite à l'homme qui aimait les chiens?), malgré, last but not least, lui-même, Iván et le combat intérieur qu'il livre contre ses propres fantômes, l'écrivain sommeillant au fond de lui ne résistera, in fine, à la tentation de s'en emparer et de s'investir dans la reconstruction des parcours tragiques de Trotski et de Ramon Mercader.
Leonardo Padura, situe en 1989, au même moment où tombait le Mur de Berlin, les toutes premières fondations de cet immense édifice que constituerait L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS, qui ne serait pourtant effectivement érigé et publié qu'une vingtaine d'années après. Fruit donc d'une très longue maturation dans l'esprit de son auteur, la pierre inaugurale de ce monument dédié aux ravages abominables provoqués par la plus grandiose et la plus tragique de toutes les utopies du XXème siècle, y fut posée cette même année, à l'occasion du premier voyage au Mexique de Lenardo Padura et à la suite du « choc purement humain, que causa (sa) visite de la maison où avait vécu et était mort Léon Trotski».
Il s'agit bien, en effet, avant tout de matière vive et humaine, personnifiée, incarnée dans des individualités au-delà du rôle supra-humain auquel on avait souhaité les astreindre, mises à l'épreuve de leurs croyances et de leurs doutes face à l'imposture idéologique dont elles ont été victimes. Dans ce roman fleuve à l'architecture complexe, alternant faits historiques et spéculation fictionnelle, trois parcours sont reconstruits parallèlement pour se rejoindre dans un épilogue sublime, bouquet final de vérité et d'humanité : celui de Léon Troski, depuis son exil de l'URSS en 1929, jusqu'à son assassinat au Mexique en 1940, celui de Ramon Mercader, jeune communiste espagnol combattant au sein des forces républicaines durant la guerre civile d'Espagne, embrigadé par les services secrets soviétiques, celui, enfin, d'Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain et double fictionnel de Leonardo Padura, personnage emblématique qui, selon son créateur, «fonctionne aussi comme métaphore d'une génération et comme le résultat prosaïque d'une défaite historique».
Appuyé par un travail de reconstitution historique détaillé, strictement fidèle à la chronologie des évènements, l'auteur, à partir «de ce qui est vérifiable et de ce qui est historiquement possible ou plausible d'après le contexte» tente surtout d'approcher, d'un point de vue essentiellement subjectif, les vicissitudes, les ambigüités, les épreuves psychologiques subies par ses personnages, entraînés dans le drame collectif provoqué par les dérives totalitaires et la débâcle effroyable de trois utopies majeures du XXème siècle : les révolutions russe, espagnole et cubaine .
Le lecteur suit pas à pas, sur près de sept-cents pages, une intrigue dont, après tout, il connaît déjà le dénouement aussi dramatique qu'inutile (d'un point de vue historique, aucun meurtre ne pouvant, bien évidemment, être considéré d'«utilité»). L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS étant un quelque sorte un anti-thriller politique, un roman construit essentiellement à partir de cette atmosphère particulière qui habite l'attente, l'angoisse, la peur, et qui donne une densité particulière au passage du temps, épaisseur toujours extensible par l'alternance irrésolue entre croyance aveugle en l'avenir et clairvoyance intolérable face à l'imminence du désastre, entre sentiments de révolte et de soumission face à des injonctions qui dépassent complètement les individus.
Les longueurs tant redoutées et habituellement honnies (souvent, d'ailleurs, à priori et de manière indiscriminée...) par un grand nombre de lecteurs contemporains, semblent donc constituer ici un élément essentiel à l'approche choisie par l'auteur, un choix de narration délibéré et auquel le lecteur doit pouvoir être en mesure de se laisser porter, grâce notamment à la finesse d'analyse et à la qualité exceptionnelle de la plume déliée et alerte de Leonardo Padura.
En définitive, une lecture aussi instructive d'un point de vue historique que touchante, un récit saisissant, empreint de sensibilité, d'empathie et de compassion pour ses personnages, victimes «happées par la fatigue historique et l'utopie pervertie ». Un grand roman où le mensonge collectif le dispute à la tragédie personnelle. Un auteur doté d'un immense talent de conteur, que je découvre avec ce livre et vers lequel je vais certainement revenir ultérieurement.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Leonardo Padura (21)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Quelle guerre ?
Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell
la guerre hispano américaine
la guerre d'indépendance américaine
la guerre de sécession
la guerre des pâtissiers
12 questions
3192 lecteurs ont répondu
Thèmes :
guerre
, histoire militaire
, histoireCréer un quiz sur ce livre3192 lecteurs ont répondu