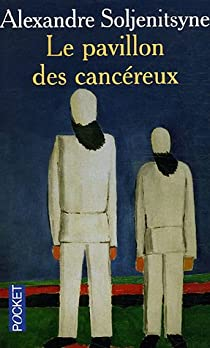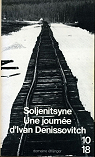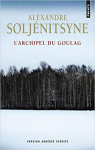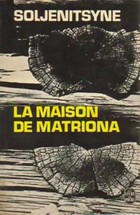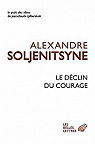Critiques filtrées sur 4 étoiles
Je viens de le finir.
J'avais envie de redécouvrir Soljenitsyne, et c'est par hasard que j'ai pris ce livre là... Ce n'est pas franchement drôle, on s'en doute avec un tel titre,mais qu'elle observation, quel sens de la connaissance humaine.
Je l'ai lu d'une traite avec beaucoup d'intérêt.
L'histoire se déroule principalement dans une chambre où se retrouvent des hommes alités qui souffrent d'un mal que l'on dit incurable. On suit par la narration, les histoires de chacun, les ressentis, les peurs, les espérances, les conflits entre eux.... Mais tout cela est écrit avec beaucoup de réalisme et de précision. L'auteur, se présente sous les traits d'un des personnage principal. C'est très intéressant, c'est aussi une plongée dans l'histoire de la Russie des années 50. C'est aussi un peu autobiographique dans l'histoire de Soljenitsyne.
J'avais envie de redécouvrir Soljenitsyne, et c'est par hasard que j'ai pris ce livre là... Ce n'est pas franchement drôle, on s'en doute avec un tel titre,mais qu'elle observation, quel sens de la connaissance humaine.
Je l'ai lu d'une traite avec beaucoup d'intérêt.
L'histoire se déroule principalement dans une chambre où se retrouvent des hommes alités qui souffrent d'un mal que l'on dit incurable. On suit par la narration, les histoires de chacun, les ressentis, les peurs, les espérances, les conflits entre eux.... Mais tout cela est écrit avec beaucoup de réalisme et de précision. L'auteur, se présente sous les traits d'un des personnage principal. C'est très intéressant, c'est aussi une plongée dans l'histoire de la Russie des années 50. C'est aussi un peu autobiographique dans l'histoire de Soljenitsyne.
"Le pavillon des cancéreux" est un roman incroyable.
Nous sommes dans les années 50 en Russie, dans un hôpital qui accueille des patients atteints du cancer. le lecteur suit la vie des patients, des infirmières et des médecins. Ce qui est formidable ce sont les différents points de vue qui nous sont proposés ( celui des médecins, celui des patients ...) qui nous permettent une réelle immersion dans ce pavillon.
A travers des personnages très bien construits, se posent les questions du droit d'être soigné et a quel prix, des conditions de soin et de travail, des relations entre les patients et les médecins... Les vifs échanges entre les patients permettent de confronter les points de vue sur l'éducation, la politique, le bonheur...
N'ayez pas peur de la longueur, c'est un roman brillant et passionnant !
Nous sommes dans les années 50 en Russie, dans un hôpital qui accueille des patients atteints du cancer. le lecteur suit la vie des patients, des infirmières et des médecins. Ce qui est formidable ce sont les différents points de vue qui nous sont proposés ( celui des médecins, celui des patients ...) qui nous permettent une réelle immersion dans ce pavillon.
A travers des personnages très bien construits, se posent les questions du droit d'être soigné et a quel prix, des conditions de soin et de travail, des relations entre les patients et les médecins... Les vifs échanges entre les patients permettent de confronter les points de vue sur l'éducation, la politique, le bonheur...
N'ayez pas peur de la longueur, c'est un roman brillant et passionnant !
Alexandre Soljenitsyne est une sorte de Zola russe du XXème siècle : sa volonté de documenter un système et une époque est tout à fait comparable à ce que faisait le père des Rougon-Macquart à propos du Second empire en France.
Ici, nous sommes en U.R.S.S. (Union des Républiques Socialistes Soviétiques — 4 mots, 4 mensonges disait Milan Kundera) en 1955. Basé sur sa propre expérience, l'auteur se propose de nous décrire un centre de cancérologie de l'époque, en croisant les regards tant des patients que des soignants.
Pour ce faire, il y a nécessairement un certain nombre de personnages — sans toutefois tomber dans l'excès, en ce sens, le récit est très bien mené — auxquels le lecteur s'identifie plus ou moins. Cependant, dans le choix des personnages principaux suivis, je trouve qu'il y a un petit hiatus.
En effet, si Soljenitsyne n'avait eu pour projet que de nous documenter le fonctionnement d'un établissement de santé provincial, il aurait pu rendre le récit beaucoup plus fort, beaucoup plus poignant, faire ressentir davantage ce que vivent les malades durant leur séjour et ce qu'éprouvent les médecins et infirmières qui s'occupent d'eux.
Mais, à beaucoup d'égard, c'est loin d'être le seul objectif de l'auteur : il souhaite également dénoncer politiquement un système. En somme, j'ai le sentiment que dans ce livre, il court deux lièvres à la fois et je le regrette un peu car, comme dit le proverbe « qui trop embrasse, mal étreint ».
Je m'explique. Dans un premier temps, nous suivons l'arrivée d'un patient au pavillon des cancéreux, dont l'auteur nous dit qu'il se situe dans une zone reculée d'Ouzbékisthan (dans la réalité, Soljenitsyne était au Kazaksthan, à deux pas de la Mongolie). Or, ce patient, Paul Nikolaïevitch Roussanov, alors que nous devrions nourrir une certaine empathie vis-à-vis de lui, est un fervent rouage du système répressif soviétique, un gars qui n'a pas hésité à balancer pas mal de monde, bref, un sale type, qui plus est privilégié du système, le genre de type auquel on a rarement envie d'allouer des kilos d'empathie.
Du point de vue du projet politique du roman, c'est utile, du point de vue psychologique et médical, c'est mal vu, car on se sent loin de ce patient, ce qui lui arrive, au fond de nous, on se dit : « bien fait pour lui ». Il y a un autre patient essentiel dans ce roman, mais on ne découvre que petit à petit qu'il est un personnage principal, si bien que, pour lui aussi, on rate un peu le coche de l'empathie, ça n'est que sur le tard qu'on s'attache un peu à ce personnage. Dommage, d'un point de vue du fonctionnement romanesque, dommage.
Ce personnage, Oleg Filemonovitch Kostoglotov, est un ex-détenu politique et désormais relégué dans cette province reculée. On comprend (mais, là encore, sur le tard) qu'il est le double de l'auteur. Vraiment dommage car ce roman recèle par ailleurs des tonnes de qualités ; j'aurais tellement préféré lire deux romans distincts, l'un centré sur l'expérience de la maladie et du centre médical, l'autre conçu comme une dénonciation politique. Je pense que l'un et l'autre auraient été plus forts respectivement que de façon combinée.
Car il a un talent fou ce Soljenitsyne, je n'ai pas peu de l'affirmer, c'est très bien écrit, ce sont des personnages qui sonnent juste, c'est un regard d'une remarquable acuité, mais je lui adresse un peu le même reproche que celui qu'on pourrait faire à un George Orwell dans son 1984, c'est-à-dire de trop vouloir faire passer ses idées politiques en oubliant qu'un roman est grand justement quand il laisse au lecteur toutes les possibilités interprétatives, quand il est un univers fictif en soi et non un moyen détourné de parler d'une réalité.
Quand on sent trop l'auteur derrière une narration, quand on sent trop qu'on veut nous dire quelque chose, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur cette chose, cela nuit forcément un peu à notre faculté d'immersion et d'identification aux personnages. Or, un roman, qu'on le veuille ou non, c'est d'abord et avant tout ça.
Il y a des réflexions pénétrantes dans ce roman. Je pense notamment au fait que le patient, le sujet, se retrouve ravalé au rang d'objet pour certains médecins. Je pense aussi au côté " honteux " de nommer la maladie ou ses conséquences, qui conduit à de fameux euphémismes ou carrément à une crasse hypocrisie.
La psychologie des patients est assez bien restituée et ça sent vraiment le vécu. Ce que l'auteur fait également très bien, concernant les soignants, c'est de nous les présenter un peu dans leur vie privée, lorsqu'ils quittent les habits blancs du pavillon des cancéreux : il développe admirablement leurs doutes et leurs compétences, leurs charges administratives, etc. C'est particulièrement intéressant, psychologiquement parlant.
Ce qui est parfaitement exécuté également, ce sont les échanges entre patients dans ces grands espaces communs où ils doivent cohabiter dans une certaine promiscuité. L'auteur nous fait bien sentir la lourdeur administrative et les restrictions de liberté à tous les échelons.
Personnellement, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement ce que l'on comprend en filigrane et que l'auteur n'a pas forcément voulu mettre en avant mais qui, avec un regard rétrospectif peut s'avérer édifiant.
En effet, voici un service assez pointu de cancérologie, nous sommes en 1955 et la cheffe de service est une femme, Lioudmila Afanassievna Dontsova. On nous dit qu'elle est particulièrement compétente. Sa seconde est également une femme, Vera Kornilievna Gangart, dont Kostoglotov est secrètement amoureux. L'infirmière, Zoé, la femme de chambre, bref, à peu près tout le service repose uniquement sur des femmes, à l'exception du chirurgien qui est un homme.
Je trouve ça particulièrement édifiant, car, si l'on compare la situation de 1955, dans des pays soi-disant très ouverts comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France, je doute que la proportion de femmes dans un tel service eût été aussi importante et leur grade aussi haut perché. Alors si l'on tempère cette modernité de la condition de la femme en U.R.S.S. par le déficit masculin dû aux pertes énormes de la seconde guerre mondiale, on trouve tout de même une situation intéressante et qui est rarement commentée de ce côté-ci de l'ancien rideau de fer.
En somme, un très bon livre d'après moi, avec juste ce petit regret que l'auteur ait autant cherché à nous fourrer de force son message politique dans le crâne. Mais, vous autres, que vous soyez malades ou bien portants — d'ailleurs tout bien portant n'est-il pas un malade qui s'ignore comme nous l'enseigne Knock ? —, gardez à l'esprit que ceci n'est que mon avis, partial, malade et défectueux par nature comme par conjoncture, c'est-à-dire, pas grand-chose.
Ici, nous sommes en U.R.S.S. (Union des Républiques Socialistes Soviétiques — 4 mots, 4 mensonges disait Milan Kundera) en 1955. Basé sur sa propre expérience, l'auteur se propose de nous décrire un centre de cancérologie de l'époque, en croisant les regards tant des patients que des soignants.
Pour ce faire, il y a nécessairement un certain nombre de personnages — sans toutefois tomber dans l'excès, en ce sens, le récit est très bien mené — auxquels le lecteur s'identifie plus ou moins. Cependant, dans le choix des personnages principaux suivis, je trouve qu'il y a un petit hiatus.
En effet, si Soljenitsyne n'avait eu pour projet que de nous documenter le fonctionnement d'un établissement de santé provincial, il aurait pu rendre le récit beaucoup plus fort, beaucoup plus poignant, faire ressentir davantage ce que vivent les malades durant leur séjour et ce qu'éprouvent les médecins et infirmières qui s'occupent d'eux.
Mais, à beaucoup d'égard, c'est loin d'être le seul objectif de l'auteur : il souhaite également dénoncer politiquement un système. En somme, j'ai le sentiment que dans ce livre, il court deux lièvres à la fois et je le regrette un peu car, comme dit le proverbe « qui trop embrasse, mal étreint ».
Je m'explique. Dans un premier temps, nous suivons l'arrivée d'un patient au pavillon des cancéreux, dont l'auteur nous dit qu'il se situe dans une zone reculée d'Ouzbékisthan (dans la réalité, Soljenitsyne était au Kazaksthan, à deux pas de la Mongolie). Or, ce patient, Paul Nikolaïevitch Roussanov, alors que nous devrions nourrir une certaine empathie vis-à-vis de lui, est un fervent rouage du système répressif soviétique, un gars qui n'a pas hésité à balancer pas mal de monde, bref, un sale type, qui plus est privilégié du système, le genre de type auquel on a rarement envie d'allouer des kilos d'empathie.
Du point de vue du projet politique du roman, c'est utile, du point de vue psychologique et médical, c'est mal vu, car on se sent loin de ce patient, ce qui lui arrive, au fond de nous, on se dit : « bien fait pour lui ». Il y a un autre patient essentiel dans ce roman, mais on ne découvre que petit à petit qu'il est un personnage principal, si bien que, pour lui aussi, on rate un peu le coche de l'empathie, ça n'est que sur le tard qu'on s'attache un peu à ce personnage. Dommage, d'un point de vue du fonctionnement romanesque, dommage.
Ce personnage, Oleg Filemonovitch Kostoglotov, est un ex-détenu politique et désormais relégué dans cette province reculée. On comprend (mais, là encore, sur le tard) qu'il est le double de l'auteur. Vraiment dommage car ce roman recèle par ailleurs des tonnes de qualités ; j'aurais tellement préféré lire deux romans distincts, l'un centré sur l'expérience de la maladie et du centre médical, l'autre conçu comme une dénonciation politique. Je pense que l'un et l'autre auraient été plus forts respectivement que de façon combinée.
Car il a un talent fou ce Soljenitsyne, je n'ai pas peu de l'affirmer, c'est très bien écrit, ce sont des personnages qui sonnent juste, c'est un regard d'une remarquable acuité, mais je lui adresse un peu le même reproche que celui qu'on pourrait faire à un George Orwell dans son 1984, c'est-à-dire de trop vouloir faire passer ses idées politiques en oubliant qu'un roman est grand justement quand il laisse au lecteur toutes les possibilités interprétatives, quand il est un univers fictif en soi et non un moyen détourné de parler d'une réalité.
Quand on sent trop l'auteur derrière une narration, quand on sent trop qu'on veut nous dire quelque chose, et qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur cette chose, cela nuit forcément un peu à notre faculté d'immersion et d'identification aux personnages. Or, un roman, qu'on le veuille ou non, c'est d'abord et avant tout ça.
Il y a des réflexions pénétrantes dans ce roman. Je pense notamment au fait que le patient, le sujet, se retrouve ravalé au rang d'objet pour certains médecins. Je pense aussi au côté " honteux " de nommer la maladie ou ses conséquences, qui conduit à de fameux euphémismes ou carrément à une crasse hypocrisie.
La psychologie des patients est assez bien restituée et ça sent vraiment le vécu. Ce que l'auteur fait également très bien, concernant les soignants, c'est de nous les présenter un peu dans leur vie privée, lorsqu'ils quittent les habits blancs du pavillon des cancéreux : il développe admirablement leurs doutes et leurs compétences, leurs charges administratives, etc. C'est particulièrement intéressant, psychologiquement parlant.
Ce qui est parfaitement exécuté également, ce sont les échanges entre patients dans ces grands espaces communs où ils doivent cohabiter dans une certaine promiscuité. L'auteur nous fait bien sentir la lourdeur administrative et les restrictions de liberté à tous les échelons.
Personnellement, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est justement ce que l'on comprend en filigrane et que l'auteur n'a pas forcément voulu mettre en avant mais qui, avec un regard rétrospectif peut s'avérer édifiant.
En effet, voici un service assez pointu de cancérologie, nous sommes en 1955 et la cheffe de service est une femme, Lioudmila Afanassievna Dontsova. On nous dit qu'elle est particulièrement compétente. Sa seconde est également une femme, Vera Kornilievna Gangart, dont Kostoglotov est secrètement amoureux. L'infirmière, Zoé, la femme de chambre, bref, à peu près tout le service repose uniquement sur des femmes, à l'exception du chirurgien qui est un homme.
Je trouve ça particulièrement édifiant, car, si l'on compare la situation de 1955, dans des pays soi-disant très ouverts comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France, je doute que la proportion de femmes dans un tel service eût été aussi importante et leur grade aussi haut perché. Alors si l'on tempère cette modernité de la condition de la femme en U.R.S.S. par le déficit masculin dû aux pertes énormes de la seconde guerre mondiale, on trouve tout de même une situation intéressante et qui est rarement commentée de ce côté-ci de l'ancien rideau de fer.
En somme, un très bon livre d'après moi, avec juste ce petit regret que l'auteur ait autant cherché à nous fourrer de force son message politique dans le crâne. Mais, vous autres, que vous soyez malades ou bien portants — d'ailleurs tout bien portant n'est-il pas un malade qui s'ignore comme nous l'enseigne Knock ? —, gardez à l'esprit que ceci n'est que mon avis, partial, malade et défectueux par nature comme par conjoncture, c'est-à-dire, pas grand-chose.
C'est un des plus réussi des ouvrages de ce grand polémiste et romancier Russe. le Pavillon des cancéreux raconte les histoires des malades dans un hopital d'Ouzbékistan pour des cancéreux durant les années soixante. Ce roman offre une belle réflexion sur la solitude de l'homme devant la mort et devant la puissance politique. Ce qui surprend c'est le ton plutot joyeux de cet ouvrage.
J'ai adoré globalement les 500 premières pages et j'ai péniblement fini les 200 dernières.
La partie médicale m'a énormément intéressé, les différents destins, les différents tempéraments qui font que chacun vit la maladie différemment. J'ai aussi beaucoup aimé voir le point de vu des médecins, le début de la radiothérapie.
Mais ensuite on tourne en rond, le lecteur s'essouffle et la fin m'a vraiment sembler très très longue...
Le pavillon des cancéreux est un grand roman mais je pense qu'il m'a manqué des connaissances sur l'URSS de l'époque, sur le contexte politique pour vraiment saisir toute l'ampleur de ce roman et toute sa richesse.
La partie médicale m'a énormément intéressé, les différents destins, les différents tempéraments qui font que chacun vit la maladie différemment. J'ai aussi beaucoup aimé voir le point de vu des médecins, le début de la radiothérapie.
Mais ensuite on tourne en rond, le lecteur s'essouffle et la fin m'a vraiment sembler très très longue...
Le pavillon des cancéreux est un grand roman mais je pense qu'il m'a manqué des connaissances sur l'URSS de l'époque, sur le contexte politique pour vraiment saisir toute l'ampleur de ce roman et toute sa richesse.
Après le monde carcéral soviétique (les goulags), voici le système de santé : le pavillon des cancéreux. Paul Roussanov, un fonctionnaire soviétique à Tachkent, une région excentrée, doit être hospitalisé. Eh oui, même les cadres et membres du parti communiste peuvent être victimes de la maladie : le cancer n'épargne personne ! Dans ses premiers jours à l'hôpital, Roussanov regarde de haut les autres patients, des bergers, des ex-prisonniers, la plupart provenant des environs, des ethnies de l'Asie centrale. Aussi, il se montre hautain avec le personnel médical qui est fort occupé. Très rapidement, il se rend compte qu'il n'est qu'un autre numéro parmi tant d'autres malades. Tous sont égaux devant la maladie. Quel choc ! C'est un roman rempli d'ironie.
Dans les pages et les chapitres suivants, le lecteur découvre les compagnons de malchance de Roussanov : le « bandit » Kostoglotov, le vieil ouzbekh Moursalimov, le berger kazakh Eguenbourdiev ainsi que le jeune Diomka, à peine seize ans, et tant d'autres. Chacun souffre à sa façon, essaie de (sur)vivre avec la maladie et de se changer les idées. Pour y arriver, l'un refuse de croire à l'inévitable, un autre cherche le confort dans la vodka ou bien dans la visite tant attendue qui n'arrive jamais. Parfois, la narration s'attarde longuement sur certains d'entre eux. C'est alors que je me rappelle que l'auteur est Alexandre Soljenitsyne. Pour bien présenter son univers, comme il l'a fait avec les goulags et la charachka, il ne peut rester concentré trop longtemps sur les mêmes personnages.
Le grand auteur russe décrit avec réalisme la vie dans un hôpital, les conditions avec lesquelles doivent vivre les patients souffrants de cancer, etc. Certains guérissent et sont renvoyés chez eux, d'autres… eh bien… se font amputer des morceaux ou quittent les pieds davant. Désolant, c'est alors qu'on se rend compte que le corps humain est une chose bien fragile… Il ne faut pas oublier l'équipe médicale, qui fait partie intégrante de cet univers. Médecins et infirmières travaillent de longues heures et ont leurs propres problèmes personnels, expliquant pourquoi certains sont un peu rudes avec les patients. Aussi, tout comme les dirigeants du parti, ces derniers peuvent également se transformer du jour au lendemain en patient, même s'ils refusent de l'admettre.
En lisant le pavillon des cancéreux, il faut s'attendre à une longue histoire (plusieurs, plusieurs centaines de pages). Personnellement, j'éprouve un peu de difficulté à rester concentré surt un pavé quand la narration saute d'un personnage à un autre, sans intrigue principale. Mais bon, je m'y suis attelé. Il faut dire que la maladie, les séjours dans les hôpitaux, la plupart d'entre nous savons un peu c'est quoi – malheureusement – même si nous souhaitons ne jamais avoir à subir cela. Soljenitsyne a réussi à critiquer les revers du système médical soviétique mais également et surtout à raconter des portraits poignants. Et c'est ça qui me l'a fait apprécier. Peut-être lire à petites doses ? Parce qu'il faut bien le lire, du moins, je le recommande. Malgré le propos (et la longueur), c'est une lecture agréable, drôle, émouvante, pas aussi sombre qu'on pourrait l'imaginer.
Dans les pages et les chapitres suivants, le lecteur découvre les compagnons de malchance de Roussanov : le « bandit » Kostoglotov, le vieil ouzbekh Moursalimov, le berger kazakh Eguenbourdiev ainsi que le jeune Diomka, à peine seize ans, et tant d'autres. Chacun souffre à sa façon, essaie de (sur)vivre avec la maladie et de se changer les idées. Pour y arriver, l'un refuse de croire à l'inévitable, un autre cherche le confort dans la vodka ou bien dans la visite tant attendue qui n'arrive jamais. Parfois, la narration s'attarde longuement sur certains d'entre eux. C'est alors que je me rappelle que l'auteur est Alexandre Soljenitsyne. Pour bien présenter son univers, comme il l'a fait avec les goulags et la charachka, il ne peut rester concentré trop longtemps sur les mêmes personnages.
Le grand auteur russe décrit avec réalisme la vie dans un hôpital, les conditions avec lesquelles doivent vivre les patients souffrants de cancer, etc. Certains guérissent et sont renvoyés chez eux, d'autres… eh bien… se font amputer des morceaux ou quittent les pieds davant. Désolant, c'est alors qu'on se rend compte que le corps humain est une chose bien fragile… Il ne faut pas oublier l'équipe médicale, qui fait partie intégrante de cet univers. Médecins et infirmières travaillent de longues heures et ont leurs propres problèmes personnels, expliquant pourquoi certains sont un peu rudes avec les patients. Aussi, tout comme les dirigeants du parti, ces derniers peuvent également se transformer du jour au lendemain en patient, même s'ils refusent de l'admettre.
En lisant le pavillon des cancéreux, il faut s'attendre à une longue histoire (plusieurs, plusieurs centaines de pages). Personnellement, j'éprouve un peu de difficulté à rester concentré surt un pavé quand la narration saute d'un personnage à un autre, sans intrigue principale. Mais bon, je m'y suis attelé. Il faut dire que la maladie, les séjours dans les hôpitaux, la plupart d'entre nous savons un peu c'est quoi – malheureusement – même si nous souhaitons ne jamais avoir à subir cela. Soljenitsyne a réussi à critiquer les revers du système médical soviétique mais également et surtout à raconter des portraits poignants. Et c'est ça qui me l'a fait apprécier. Peut-être lire à petites doses ? Parce qu'il faut bien le lire, du moins, je le recommande. Malgré le propos (et la longueur), c'est une lecture agréable, drôle, émouvante, pas aussi sombre qu'on pourrait l'imaginer.
Avec le pavillon des cancéreux on entre dans l'univers glauque des malades atteints de divers troubles, métastases, tumeurs. Cela se passe en 1955, dans un hôpital de Tachkent, en Russie. Ainsi, on va rencontrer des dizaines de personnages qui nous apparaissent les uns après les autres. On y entre avec l'arrivée de Paul Nikolaievitch Roussanov qui souffre d'une tumeur au cou et qui est en totale admiration avec Staline et se vante d'être entièrement dévoué à sa patrie. L'autre personnage phare du récit, Kostoglotov, qui a plusieurs points en communs avec l'auteur, exilé lui aussi dans un village après plusieurs années de "goulag" et atteint d'une tumeur dont il va miraculeusement se soigner, est un homme de grandes valeurs qui croit en l'amour de son prochain et n'accorde que peu de crédit aux chimères proposées par l'État. On entre donc dans la Russie du siècle dernier avec tous ses excès, sa grandeur, ses injustices et l'amour que portent ses habitants à cette chère patrie.
Au fil des pages, dans l'étroit dortoir où sont alités plusieurs hommes (car le récit se déroule presque totalement dans le pavillon leur étant réservé) on va être témoin de leurs discussions animées sur la Russie d'hier et la jeunesse d'aujourd'hui, le système de santé, les remèdes naturels (champignons, racines), les relations entre docteurs et malades, mais aussi des questions plus philosophiques telles que "qu'est ce qui fait vivre les hommes ?" et "quel est l'endroit de la terre qu'on élit entre tous ?" et enfin des questions sur la mort, bien sûr.
Je dirais que la force de ce roman est de passer au travers beaucoup de sujets assez "lourd" sans pour autant nous lasser. Chaque chapitre apporte de la nouveauté et de la fluidité au récit et nous fait réfléchir. Et tous ces sujets sont traités au cours de dialogues parfois très drôles entre malades qui retrouvent de la fougue à se diputer alors qu'ils sont gravement affaiblis par la maladie. Par contre, nulle intrigue dans ces 722 pages, nul suspense. Que de la rhétorique ! Mais à petites doses, ça fait toujours du bien !
Au fil des pages, dans l'étroit dortoir où sont alités plusieurs hommes (car le récit se déroule presque totalement dans le pavillon leur étant réservé) on va être témoin de leurs discussions animées sur la Russie d'hier et la jeunesse d'aujourd'hui, le système de santé, les remèdes naturels (champignons, racines), les relations entre docteurs et malades, mais aussi des questions plus philosophiques telles que "qu'est ce qui fait vivre les hommes ?" et "quel est l'endroit de la terre qu'on élit entre tous ?" et enfin des questions sur la mort, bien sûr.
Je dirais que la force de ce roman est de passer au travers beaucoup de sujets assez "lourd" sans pour autant nous lasser. Chaque chapitre apporte de la nouveauté et de la fluidité au récit et nous fait réfléchir. Et tous ces sujets sont traités au cours de dialogues parfois très drôles entre malades qui retrouvent de la fougue à se diputer alors qu'ils sont gravement affaiblis par la maladie. Par contre, nulle intrigue dans ces 722 pages, nul suspense. Que de la rhétorique ! Mais à petites doses, ça fait toujours du bien !
A. Soljenitsyne a écrit ce livre alors qu'il était encore presque inconnu. Comme c'est souvent le cas, il y a une part d'autobiographie dans ce roman. On y trouve l'unité de lieu (un hôpital dans l'une des républiques soviétiques), de temps (quelques mois dans les années '50) et d'action (le cancer). Quelques pages évoquent aussi une petite colonie de Russes, relégués dans un trou perdu après un passage dans un camp de travail; c'est une situation que l'auteur a aussi connue.
Soljenitsyne s'ingénie à mettre en scène des personnages très divers, représentant l'ensemble de la société soviétique. Mais deux principaux personnages émergent. Roussanov est un apparatchik communiste important (et convaincu de l'être, certes !); Kostoglotov, surnommé "Grandegueule", est un rude gaillard qui est passé par le Goulag; il est campé sans complaisance, alors qu'il représente certainement l'auteur lui-même.
Les personnages secondaires sont nombreux, ils sont d'âge, d'origine et de mentalité très variés; certains sont attachants. le personnel soignant joue un rôle de premier plan, notamment une doctoresse (Vera). C'est par sa résistance aux propositions de traitement que Kostoglotov noue un lien particulier avec Vera. Mais l'auteur est très pudique à l'égard du sentiment amoureux, a fortiori au sujet du sexe: la relation restera platonique.
Ce que je trouve surtout remarquable, c'est d'évoquer l'immense société soviétique à travers un microcosme bien particulier, aux limites bien définies. Les lecteurs ont donc accès à une Russie qui est complètement obsolète, mais qu'on devrait pourtant conserver en mémoire. Les personnages, quoique très éloignés de ceux que nous côtoyons ici au quotidien, sont intéressants et nous disent souvent quelque chose qui peut nous toucher. La maladie, qui (bon gré mal gré) sert de trait d'union à tous les protagonistes, apparait comme une entité omniprésente et presque "métaphysique" - qui n'empêche pas, cependant, le développement de la vie des individus au quotidien. le contexte politique est essentiel, mais qu'on ne s'attende pas à un réquisitoire anti-communiste. On peut juste imaginer que Soljenitsyne "boit du petit lait" en décrivant l'incrédulité et l'inquiétude de Roussanov au moment où celui-ci apprend le début de la déstalinisation !
Le livre (en deux parties) pourra paraitre un peu long aux lecteurs pressés. En effet, comme tous les autres grands romanciers russes, l'auteur a besoin d'ampleur et d'exhaustivité. Quant à son écriture, elle est très caractéristique: concrète, un peu terre-à-terre, presque sans joliesse de style. Mais en définitive, "Le pavillon des cancéreux" reste une grande oeuvre.
Soljenitsyne s'ingénie à mettre en scène des personnages très divers, représentant l'ensemble de la société soviétique. Mais deux principaux personnages émergent. Roussanov est un apparatchik communiste important (et convaincu de l'être, certes !); Kostoglotov, surnommé "Grandegueule", est un rude gaillard qui est passé par le Goulag; il est campé sans complaisance, alors qu'il représente certainement l'auteur lui-même.
Les personnages secondaires sont nombreux, ils sont d'âge, d'origine et de mentalité très variés; certains sont attachants. le personnel soignant joue un rôle de premier plan, notamment une doctoresse (Vera). C'est par sa résistance aux propositions de traitement que Kostoglotov noue un lien particulier avec Vera. Mais l'auteur est très pudique à l'égard du sentiment amoureux, a fortiori au sujet du sexe: la relation restera platonique.
Ce que je trouve surtout remarquable, c'est d'évoquer l'immense société soviétique à travers un microcosme bien particulier, aux limites bien définies. Les lecteurs ont donc accès à une Russie qui est complètement obsolète, mais qu'on devrait pourtant conserver en mémoire. Les personnages, quoique très éloignés de ceux que nous côtoyons ici au quotidien, sont intéressants et nous disent souvent quelque chose qui peut nous toucher. La maladie, qui (bon gré mal gré) sert de trait d'union à tous les protagonistes, apparait comme une entité omniprésente et presque "métaphysique" - qui n'empêche pas, cependant, le développement de la vie des individus au quotidien. le contexte politique est essentiel, mais qu'on ne s'attende pas à un réquisitoire anti-communiste. On peut juste imaginer que Soljenitsyne "boit du petit lait" en décrivant l'incrédulité et l'inquiétude de Roussanov au moment où celui-ci apprend le début de la déstalinisation !
Le livre (en deux parties) pourra paraitre un peu long aux lecteurs pressés. En effet, comme tous les autres grands romanciers russes, l'auteur a besoin d'ampleur et d'exhaustivité. Quant à son écriture, elle est très caractéristique: concrète, un peu terre-à-terre, presque sans joliesse de style. Mais en définitive, "Le pavillon des cancéreux" reste une grande oeuvre.
J'admets qu'au moment de commencer ce livre, j'éprouvais quelque appréhension : en effet, 760 pages de souffrances en huis clos (me disais-je) ont de quoi apeurer.
Mais fort heureusement, je me trompais fort, dans le sens où je n'ai absolument pas été démoralisé par les évènements. Non qu'iceux fussent particulièrement guillerets, bien au contraire, mais Soljenitsyne à la subtilité de ne pas insister trop lourdement sur l'horreur de la situation des différents personnages.
Ces derniers sont assez nombreux et très diversifiés. Beaucoup d'entre eux sont adroitement développés, et quasiment aucun ne m'a énervé (je déteste trouver les personnages énervants alors qu'ils ne sont pas censés l'être).
Soljenitsyne exprime de façon intéressante la façon d'appréhender la maladie de chaque patient, en s'attardant sur 2 ou 3 d'entre eux.
Mais l'on ne suit pas seulement les états d'âmes des malades : certains membres du personnel médical (principalement des femmes) sont également détaillés avec une grande attention.
Le scénario en lui-même est quelque peu particulier : on se croirait presque dans un documentaire, où les journalistes suivraient les protagonistes du pavillon dans une période de temps donnée. A ceci près que Soljenitsyne prend un soin particulier à exposer les pensées de ses malheureux héros.
De plus, quelques réflexions philosophiques ou politiques font leur apparition tout au long du récit.
Concernant le style d'écriture : ce roman est à mon avis très bien écrit mais sobre.
Il n'y a pas de chichis ou de sentimentalisme gnangnan, mais pas non plus d'humour. En revanche il y a un peu d'amour (Толстой, Толстой !!), mais bien dosé.
Je conseille donc fortement la lecture de cette oeuvre qui fait réfléchir, en dépit de sa longueur un peu trop élevée à mon goût.
Mais fort heureusement, je me trompais fort, dans le sens où je n'ai absolument pas été démoralisé par les évènements. Non qu'iceux fussent particulièrement guillerets, bien au contraire, mais Soljenitsyne à la subtilité de ne pas insister trop lourdement sur l'horreur de la situation des différents personnages.
Ces derniers sont assez nombreux et très diversifiés. Beaucoup d'entre eux sont adroitement développés, et quasiment aucun ne m'a énervé (je déteste trouver les personnages énervants alors qu'ils ne sont pas censés l'être).
Soljenitsyne exprime de façon intéressante la façon d'appréhender la maladie de chaque patient, en s'attardant sur 2 ou 3 d'entre eux.
Mais l'on ne suit pas seulement les états d'âmes des malades : certains membres du personnel médical (principalement des femmes) sont également détaillés avec une grande attention.
Le scénario en lui-même est quelque peu particulier : on se croirait presque dans un documentaire, où les journalistes suivraient les protagonistes du pavillon dans une période de temps donnée. A ceci près que Soljenitsyne prend un soin particulier à exposer les pensées de ses malheureux héros.
De plus, quelques réflexions philosophiques ou politiques font leur apparition tout au long du récit.
Concernant le style d'écriture : ce roman est à mon avis très bien écrit mais sobre.
Il n'y a pas de chichis ou de sentimentalisme gnangnan, mais pas non plus d'humour. En revanche il y a un peu d'amour (Толстой, Толстой !!), mais bien dosé.
Je conseille donc fortement la lecture de cette oeuvre qui fait réfléchir, en dépit de sa longueur un peu trop élevée à mon goût.
L'action débute en 1955, soit deux ans après la mort de Staline, et se situe dans le bâtiment numéro 13 d'un hôpital, où sont soignés les malades atteints d'un cancer. Dans ce pavillon des cancéreux, divers personnages sont contraints de cohabiter; de partager leurs souffrances, leurs inquiétudes et leurs espoirs. Tout les sépare pourtant, en particulier Roussanov, cadre zélé du parti communiste, et Kostoglotov, un relégué autorisé à quitter le camp où il était prisonnier pour venir se soigner. Autour d'eux gravitent de nombreux autres protagonistes, malades, médecins et infirmières, qui n'ont rien en commun mais partagent cette lutte contre la maladie. Une lutte qui les place sur un pied d'égalité, au-delà de leurs oppositions sociales ou idéologiques. Et qui va les amener à considérer leur vie autrement, à se concentrer sur l'essentiel, à apprendre ou réapprendre à s'émerveiller devant des choses simples.
La suite sur mon blog...
Lien : http://tassedethe.unblog.fr/..
La suite sur mon blog...
Lien : http://tassedethe.unblog.fr/..
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Alexandre Soljenitsyne (75)
Voir plus
Quiz
Voir plus
La littérature russe
Lequel de ses écrivains est mort lors d'un duel ?
Tolstoï
Pouchkine
Dostoïevski
10 questions
439 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature russeCréer un quiz sur ce livre439 lecteurs ont répondu