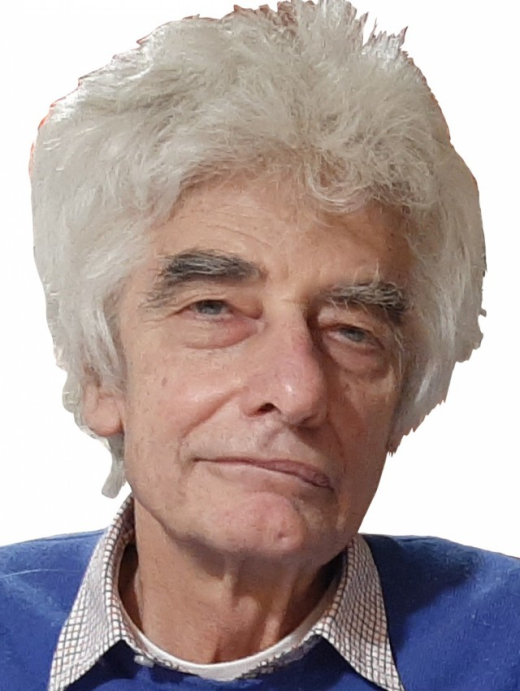Résumé : le banquet est un ouvrage écrit classiquement sous forme de dialogue. Socrate est invité à un banquet avec d'autres personnalités, où aidé par le jus de dyonisos ils échangent par tour de parole sur la question “qu’est-ce que l’amour?”.
Le mot de la fin : Je l’ai lu tellement de fois que je ne peux pas être concise, à chaque fois, je cherche et interprète en fonction de ma problématique du moment qui m’a ramenée à ce livre. Voici un humble retour sur ce qui est ressorti cette fois-ci.
Aristophane présente pour la première fois son mythe. La légende que les hommes ont été séparés par les Dieux par pécher d’orgueil. Ils sont ainsi condamnés à se chercher toute leur vie.
Les humains sont voués à chercher leur moitié toute leur vie. On peut ici appliquer notre cher Freud. Le bébé étant issus de sa mère, subit une première fois cette séparation de corps alors même qu’il arrive au monde avec le fardeau de devoir trouver sa moitié.
Après la période de la naissance et le complexe d’œdipe passé, arrive l’adolescence et alors les êtres humains prépubères n’ont qu’une obsession, l’accouplement, la découverte de la sexualité et du partenaire aimé.
Notons la pluralité sexuée du discours d’Aristophane qui intègre les relations hétéros et homosexuelles. L’amour, sa recherche et sa passion n’est pas réservée à une typologie de sexualité. Tous les types d’êtres existants aiment, sont voués à aimer et qui ils veulent (à méditer en ces temps sombres pour la tolérance).
L’adolescent donc, chercherait littéralement sa moitié. L’amour à cette époque est une obsession. Un moyen d’accéder à une vie future, la clé, la porte d’accès vers l’avenir. Sans trouver sa moitié il n’y avait pas moyen d’avance. Le but premier et ultime était la recherche de l’amour. On peut voir dans ce phénomène, différents aspects sociologiques et culturels, ainsi que familiaux sans aucun doute. Toutefois malgré des espoirs infondés, avec la conscience que c’était perdu d’avance, certain pour ne pas dire beaucoup, optent pour une passion sans romantisme, avec beaucoup de rationalité et indubitablement beaucoup d’amour également.
Aristophane avait donc raison et en même temps profondément tort. En inscrivant cette théorie de la recherche de notre moitié on part comme incomplet. Cette incomplétude est ancrée dans notre société et dans nos mœurs ce qui induit le processus de l’adolescence et approuve la théorie de notre cher philosophe grec.
En revanche, une fois l’être aimé trouvé, il y a cette période de perdition de l’identité. Deux moitiés indépendantes tout en étant interdépendantes perdent leur incomplète individualité, mais leur individualité quand même, en se retrouvant. Après une période de quelques années. Les cicatrices brûlantes de la passion ayant entraînées la fusion, se refroidissent. Comme tout corps greffé, un système de protection et de rejet apparaît. On recherche alors notre individualité. Mais comment faire pour la trouver quand celle-ci n’a jamais eu véritablement le temps de s'exprimer? étant tout d’abord étouffée par l’identification parentale, puis noyé dans la recherche de l’être aimé pour finir totalement effacé par cette nouvelle identité, le Nous, de ce couple tant recherché ?
Peut-être est-ce en deux moitiés ayant déjà trouvé leur complétude qui peut ressortir cette identité, une fois le poids de cette recherche initiale retombée? Mais alors faut-il se séparer de notre moitié originelle pour ne finir qu’une moitié pour toujours incomplète avec une plaie sinon saignante, visible et cautérisée? ou se vouer à cette existence diluée mais sans blessure ( tout du moins visible)? Ou alors simplement prendre ce que l’autre fait ressortir sans se perdre dans des sentiments voués à l’échec car au fond elle ne vous l’apporte pas cette identité, elle vous aide simplement à la faire ressortir par un regard extérieur?
Lien : http://www.lesmiscellaneesde..
J'ai trouvé ce texte rempli de discours fort pompeux qui, au final, sont vides et dépourvus de signification.
J'ai infiniment préféré d'autres textes de Platon à celui-ci ; une grande partie m'ont semblé tout à l'opposé, ils m'ont semblé être l'œuvre d'un homme qui réfléchit sur le monde qui l'entoure. En revanche, ici, nous avons là un dialogue dans lequel, me semble-t-il, Platon fit comme les orateurs qu'il a dénoncé dans l'"Euthydème", un discours vide, sans intérêt, et, de ce livre, sous-titré "De l'amour", l'affection amoureuse est justement la grande absente. Ces discours pleins de pompe, n'ont, à mon sens, rien à voir avec l'amour.
J'ai donc été déçu par ce dialogue socratique.
L’atmosphère festive où se déroule la discussion donne au lecteur une impression de fraîcheur et de légèreté, alors qu’il assiste à une discussion portant sur des sujets parmi les plus graves et les plus sérieux, comme l’amour, le sens de la vie, le Beau et le Bien. De plus, comme on le dit avec tant de justesse depuis si longtemps « In vino veritas ». Chacun des convives (exception faite de Socrate dont l’esprit est toujours le plus libre), l’esprit délié par le vin s’y exprimera en toute franchise et avec plus de souplesse et d’ingéniosité qu’il le ferait habituellement.
Dans la continuité de l’Apologie, Platon présente à son banquet un Socrate parfaitement chaste qui ne corrompt en rien la jeunesse. Bien au contraire, l’interruption de la discussion par Alcibiade permet de montrer toute la fausseté de cette accusation faite contre Socrate à son procès, puisque ce dernier, dédaignant même le corps du plus joli des jeunes hommes d’Athènes, n’a jamais fait mine de séduire les jeunes gens que pour leur faire accoucher de leurs meilleures possibilités spirituelles et morales.
Sur le plan du discours, Platon réalise aussi sur son lecteur le même phénomène maïeutique que Socrate pratiquait dans les rues de sa cité. Il sait que personne ne peut s’élever à la moralité si elle est présentée directement, mais qu’en appâtant habilement le lecteur avec des discours esthétiques et légers, l’amour du Bien viendra couronner le tout d’une manière toute naturelle. Son apparent éloge du dionysiaque se transforme ainsi insensiblement et d’autant plus sûrement en un triomphe complet des principes apolliniens.
Quel admirable réussite que ce Banquet!
Platon demeure d’ailleurs le seul auteur de l’Antiquité dont l’œuvre entière nous soit parvenue (dans la mesure, évidemment où l’on met de côté les hypothèses sur une œuvre ésotérique qui n’aurait été distribuée qu’entre les seuls murs de l’Académie).
Véritable étoile au ciel de la philosophie, mais aussi de la moralité et de l’art, Platon reste éternellement présent, depuis le moment où il a dicté ou écrit lui-même ses dialogues, en passant par les multiples mains des copistes et traducteurs, puis par les presses d’imprimerie jusqu’aux formats numériques, d’environ 380 avant le Christ jusqu’à aujourd’hui, presque 2500 ans plus tard, il continue encore et toujours à servir aussi magnifiquement de point repère dans l’horizon spirituel humain.
Socrate et quelques amis à lui décident de discourir sur le sujet de l'amour. Les uns après les autres, ils apportent leur pierre à l'édifice et l'on découvre toutes les facettes que peut avoir ce mot et ce que chacun projette sur ce sujet.
Lu parce qu'on me l'a conseillé, j'ai été étonnée par la richesse de ce court texte qui apporte des éclairages extrêmement intéressants et très peu dépassés si l'on enlève le peu d'esprit que l'on accorde aux femmes .
Un texte qu'il me faudra relire car s'il est court il est dense .
Lien : http://theetlivres.eklablog...
Il s'agit à mes yeux, d'un écrit vide, pompeux, plein de discours pompeux et inintéressants.
Quant au discours sur l'amour, il est inexistant. Il s'agit ici de déterminer la nature exacte du dieu Eros ( ce qui n'est pas, m'est avis, d'un intérêt certain ) et il est plus question du dieu de l'amour que de l'amour en lui-même.
Bref, un dialogue qui n'est pas, m'est avis, d'un fort grand intérêt.
Tandis que certains le scindent en deux, que d'autres imaginent "l'androgyne" comme être premier, Socrate se remémore quant à lui une discussion avec Diotime.
Récit riche et bien écrit, dans une ambiance théâtrale et indolente qui rappelle les clichés des riches philosophes athéniens, le Banquet de Platon est une plongée bienvenue dans la littérature grecque, et un texte plus qu'intéressant en ce qui concerne la définition de l'Amour, ce grand mal (ou non ?) qui poursuit tout homme.
Platon produit de plus un texte court et non rébarbatif, qui se lit rapidement sans oppresser le lecteur.
Voilà la pensée que j’ai eu en lisant Le Banquet de Platon. Ce bouquin nous vient d’Athènes et a été écrit en 380 av.J-C. Il a donc… 2400 ans, rien que ça ! Et pourtant, il a traversé les années, les générations et les époques sans perdre une once de sens. C’est vous dire combien cette oeuvre relève d’un véritable génie de la langue. Et même si l’on n’adhère pas à la philosophie platonicienne ( qui peut avoir un peu vieillie, mais n’en reste pas moins un socle en béton dans l’art de la philosophie), toute personne se posant des questions sur l’Amour, le Beau, le sens de la vie, le Bien et le Mal aura plaisir à lire cet ouvrage.
Ici, nous sommes amenés dans un banquet grec organisé par Agathon pour fêter une victoire poétique. Une bande de copains est réunie (tous assez connus dans la philosophie et la poésie grecque) et, au lieu de juste faire la fête et boire comme des éponges (ils sont visiblement déjà tous en gueule de bois de la veille), ils s’accordent pour ne boire que raisonnablement et faire de ce rassemblement un moment d’échange constructif. La règle est simple : chacun, à son tour, doit faire l’éloge de l’Amour. Au fil des discours, nous sommes transposés dans la vision que chaque orateur se fait de l’amour et de son origine (céleste et viscérale : d’où vient que l’on aime ?).
C’est non seulement un classique de la littérature mais c’est aussi une oeuvre philosophique particulièrement intéressante. On accroche à toutes les éloges, de manière différente, plus ou moins selon les points de vues, les légendes et les images employées. On aborde l’Eros vulgaire et l’Eros céleste, la sexualité et l’homosexualité, la passion, le besoin de rechercher son « âme soeur », d’enfanter ou de créer. On y retrouve le célèbre « mythe d’Aristophane » ou mythe des androgynes et on traverse une rhétorique ponctuée de sophismes qui ne peuvent pas nous laisser de marbre.
Phèdre a, pour moi, trois degrés de lecture;
le premier : Prendre l'histoire comme elle est, c'est-à-dire, Socrate rencontre son ami Phèdre, sortant de chez Lysias, lui parle du discours sur l'amour de ce dernier. Et ils finissent tous les deux à débattre sur ce sujet.
Le deuxième : Prendre uniquement en compte les différents discours sur l'amour.
Le troisième : C'est aussi une leçon sur la forme de la rhétorique et sur l'écriture.
Je pense, pour finir, que le meilleur moyen de faire comprendre sa philosophie est de passer par une histoire.
Un éloge de l'amour lyrique, exalté, très allégorique, souvent excessif, un peu inégal par moments.
Le discours (indirect) de Diotime m'a semblé le plus intéressant car, contrairement aux panégyriques des autres personnages, il est nuancé et même subversif en comparaison. Diotime décrit l'amour non comme une sorte de perfection absolue mais comme une dualité écartelée entre la beauté, et la pauvreté, l'exigence et la rudesse. Cette définition me semble bien plus correspondre à la réalité que les louanges ingénues des autres convives.
Il est par ailleurs extrêmement intéressant de retrouver dans ce texte qui date tout de même du IVème siècle avant J.-C. autant d'idées qui deviendront typiquement chrétiennes sur l'amour, la transcendance, l'immortalité etc.
La base de réflexion par Socrate, l'amour désir de quelque chose qui nous manque (le bon, la beauté), peut paraître un peu simpliste mais l'idée amène à une réflexion riche et féconde. Comme à l'habitude, c'est de la discussion qu'émerge une pensée plus riche, et non de l'exposé d'une thèse. Seulement, à la différence de nombre d'autres dialogues, ce n'est pas ici par la dialectique directe - questions-réponses - que Platon procède mais plutôt par celle des discours prononcés par les différents convives : plutôt que de contredire les discours de chacun, Socrate incorpore des éléments de chacun à son propre discours, par l'intermédiaire du discours féminin de Diotime (volonté de ne pas brusquer ses interlocuteurs ; discours d'autorité en faisant intervenir le féminin), tout en leur donnant un sens plus cohérent.
Phèdre parlait de la volonté de devenir meilleur pour plaire à l'être aimé ; Aristophane parlait d'un besoin de compléter sa nature - le féminin ou le masculin - caractérisée par un manque ; Éryximaque distinguait le vrai amour comme celui dans lequel il y a volonté d'élévation, d'enrichissement pour l'esprit… Ainsi, les strates de l'amour selon Socrate/Diotime vont du corps à l'âme, à l'idée de beau. À chaque stade, il y a généralisation et extraction de l'essence du beau : d'un corps attirant à la beauté corporelle de l'homme, de l'observation des hommes, de leurs actions, à l'amour pour une âme, à la beauté de l'âme humaine, aux sciences des hommes, puis à la science du beau et du bon. L'amour est ainsi un processus d'apprentissage qui mène vers le bon/le beau. En partant d'un individu, l'amour nous amène à chercher ce qui est bon chez cette personne, puis en général partout, jusque dans la nature…
Remarquons également que cette recherche ou cet apprentissage progressif de l'amour amène à « faire des discours », ce que répète plusieurs fois Socrate/Diotime. S'agit-il de se déclarer, d'exprimer le bien et le beau par le détour, par le support d'un objet avant de pouvoir s'en extraire ? En tout cas, l'amour amène à l'apprentissage et cet apprentissage passe par la parole, ce qui est le propre de la méthode socratique.
En cela, Platon a parfaitement appliqué le principe dialectique pour aborder ce thème de l'amour. Ici, on peut même parler de polyphonie, et un tel sujet méritait bien-sûr autre chose qu'une suite de questions-réponses comme dans une partie des œuvres de Platon. Il fallait davantage de poésie pour rendre hommage à l'amour comme le font les personnages. Platon donne donc de la poésie dans les discours des uns, naïve et lyrique chez Phèdre, provocation presque chez Éxymarque, images de la mythologie et comique chez Aristophane, biologie et académisme chez Agathon…. Mais c'est surtout dans la montée progressive vers l'extase philosophique du discours de Diotime, comme un étourdissement spirituel. Platon ne manque pas non plus de mettre en scène la poésie de l'amour : la présence de Diotime – une des seules figures féminines de l'oeuvre de Platon… - le retard de Socrate au banquet pour cause de réflexion philosophique en cours ; le badinage des uns et des autres ; l'atmosphère festive, la présence en arrière-plan de vin, de danse, de musique… ; la fin où tous s'endorment sauf Socrate qui reste en veille philosophique, comme si l'élévation spirituelle de la discussion continuait de le maintenir dans l'admiration de la beauté.
Enfin, les mots d'Alcibiade visent à montrer que Socrate, contrairement à l'idée reçue d'un esprit pur dénué de sentiments, est bien l'amoureux dans toute sa puissance et dans tout son accomplissement, celui qui a parcouru tous les niveaux de l'amour, dépassant l'intérêt pour le corps (Alcibiade le dit), puis même pour l'âme individuelle, pour s'intéresser à l'homme, aux sciences et surtout à la science du beau et du bon dans son essence, et cet amour se matérialise chez lui par la volonté d'apprendre des autres et de déclencher en eux l'envie d'apprendre.
Lien : https://leluronum.art.blog/2..
Les convives de l’auteur dramatique Agathon exposent leur avis sur l’Amour à travers une joute oratoire au cours d’un dîner arrosé. Phèdre se lance dans une apologie du grand et antique Eros. Pausanias distingue deux Amours, un noble et un vulgaire, Eryximaque différencie lui aussi les deux Aphrodite et étend sa théorie à des considérations physiciennes, artistiques, médicales d’harmonie universelle. Pour Agathon, l’Amour est, contrairement à ce qu’en dit Phèdre, le plus jeune des dieux, et inspire création poétique, convivialité et sociabilité. Enfin Socrate s’emploie à convaincre les autres des vertus de l’amour « platonique », celui de l’absolu. Je passe sur le discours d’Alcibiade, saoul, qui refusera de parler de l’Amour mais fera un éloge de Socrate.
Mais c’est surtout le discours d'Aristophane qui m’a laissé le plus de souvenirs. Il raconte comment l’ancêtre des hommes était autrefois double, deux corps ne faisant qu’un avec deux têtes, huit membres et deux sexes. Ces êtres pouvaient être composés de deux hommes, un homme et une femme ou deux femmes. Pour affaiblir ces êtres, Zeus les a divisés en deux, avec l’aide d’Apollon, et les a ainsi condamnés à rechercher sans cesse leur moitié. La quête de l'amour... De nos jours où nombre de discussions font débats et polémiques sur les thèmes de l’homosexualité, l’intervention d’Aristophane trouve un écho fort moderne.
À mon avis, un grand texte fondateur. De tous les dialogues platoniciens, « Le banquet » est l'un des plus accessibles et celui qu’il faut lire pour comprendre les sources de notre manière de concevoir le monde.
.
Nous sommes à Athènes, en moins 416.
Pour fêter une victoire poétique, Agathon propose un "banquet". Socrate doit venir, suivre Aristodème, mais c'est un coquin, il arrive quand il lui sied. Le thème de discussion du banquet, qui est en fait une libation, est : "Apologie d'Eros".
Des éloges, certains sont surprenants, sont prononcés par Phèdre, Pausanias, Eryximaque, Aristophane et Socrate. Ce dernier ne fait que citer Diotime.
.
Les discours, faisant différentes hypothèses sur l'essence d'Eros, ne m'ont pas convaincus. Ils sont trop grandiloquents. Celui de Diotime/Socrate nous enferme dans une prison trop restreinte, à mon avis.
.
Mais qui était Diotime, pour avoir impressionné Socrate, le philosophe qui se joue de tout le monde ?
Tiens, après Hannah Arendt, encore une philosophe que je découvre ! Diotime est une prêtresse dans cette petite cité-Etat de Mantinée, dans le Péloponnèse... Mais l’authenticité de Diotime est sujet à discussion. En plus des arguments cités, je pense trop reconnaître la maïeutique célèbre de Socrate dans son discours quand il "entortille" Agathon pour le manipuler.
.
Par delà ces prises de parole, je suis frappé par la pédérastie libre qui règne dans l'Athènes antique intellectuelle. Pédérastie qui célèbre l'amour du beau, glorifié comme philosophie.
Celui-ci adore me traumatiser à coups de classiques philosophique…quel sadique ! (en fait c’est mon cousin préféré, mais chuuute *_*)
Bon, j’en reviens à mon philosophe Grec.
Nous suivons Socrate et son élève Eryximaque dans un débat ayant pour thème : l’Amour.
Ce livre est un grand classique d’environ 224 pages. Mais plus j’en lisais, plus il y en avait…
Résultat, migraine carabinée et crise existentielle. O_O
Pour moi et ma culture générale.
Lien : http://audreybookoverlife.ov..
La renommée et la qualité du banquet ne sont pas usurpées.
Il m'a happé alors que je l'ai commencé tièdement.
Sa forme et la camaraderie qui s'en dégage le classe à part des autres dialogues socratiques.
Ne vous privez pas du plaisir de le lire.
Normandie : 1870
"Pendant plusieurs jours de suite des lambeaux d’armée en déroute avaient traversé la ville. Ce n’était point de la troupe, mais des hordes débandées. Les hommes avaient la barbe longue et sale, des uniformes en guenilles, et ils avançaient d’une allure molle, sans drapeau, sans régiment. […] Les Prussiens allaient entrer dans Rouen, disait-on." [...] Il y avait cependant quelque chose dans l'air, quelque chose de subtil et d'inconnu, une atmosphère étrangère intolérable, comme une odeur répandue, l'odeur de l'invasion. Elle emplissait les demeures et les places publiques, changeait le goût des aliments, donnait l'impression d'être en voyage, très loin, chez des tribus barbares et dangereuses." La débandade de l'armée française, l'occupation prussienne en Normandie, le cortège des horreurs de la guerre de 1870 servent de motif à de nombreux contes et nouvelles de Maupassant où sa férocité s'exerce avec maestria dans la plus connue et réussie de toutes dont le titre est le sobriquet de l'héroïne principale : "Boule de Suif". Mais quel est l'état-civil de Boule de suif dans le récit ? 👩🦰👩🦰👩🦰
18 lecteurs ont répondu