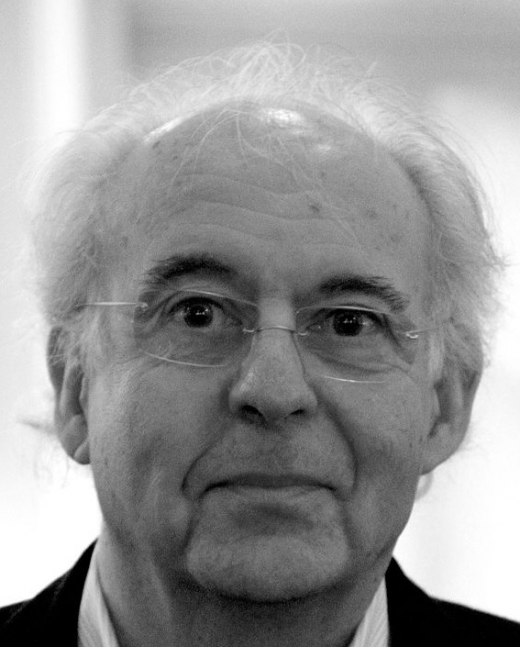Citations de Roger-Pol Droit (353)
La philo-bonheur n’a que des certitudes. Elle est assurée que tous les humains aspirent au bonheur plus que tout, et convaincue que la philosophie, mieux que tout, peut les y conduire. Ces évidences constituent les piliers sur lesquels elle croit pouvoir tenir.
Le sage échappe au malheur, certes, mais aussi au bonheur. Il se soustrait aux deux, se tient ailleurs. Tout à fait ailleurs, en réalité. Il y a même bien plus de distance entre le « bonheur » supposé du sage et ce que le commun des mortels rêve d’atteindre comme bonheur qu’entre le malheur et le bonheur des hommes ordinaires.
Parmi les écoles de sagesse, celle des stoïciens est sans conteste celle qui a le plus abondamment décrit la vie intime du sage, sa manière spécifique de vouloir, de juger, de décider, de se souvenir. Leurs analyses concernant ce que peut le sage, ce qu’il éprouve (ou n’éprouve pas), les manières dont il pense, etc. sont d’une précision et d’une minutie qui donnent l’impression que le moindre détail a été scruté.
Platon, Aristote, la plupart des Grecs, ont en effet conçu la sagesse comme l’horizon ultime vers lequel la philosophie chemine, qu’elle s’efforce d’atteindre. Plus encore, les écoles de sagesse de l’Antiquité (épicuriens, stoïciens, cyniques, sceptiques, nous venons de les rencontrer) ont élevé la figure du sage à la hauteur d’un idéal suprême. Le but du philosophe : devenir sage.
Ce qui a été acquis peut être perdu, indéfiniment. Ce qui a été édifié peut se voir détruit, brutalement. Un malheur toujours peut surgir, venir frapper. L’équilibre du bonheur reste, par nature, vulnérable, fragile, exposé à périr d’un instant à l’autre. Tout bonheur, dans cette représentation antique, est un château de cartes. Sauf le bonheur du sage !
Aujourd’hui, mon bonheur ne concerne d’abord que moi. C’est une affaire privée, personnelle, subjective. Cela n’implique pas obligatoirement que l’égoïsme en soit la forme unique. Elle est prépondérante, cela va sans dire.
Il va de soi que le destin, heureux ou malheureux, demeurait avant tout celui d’un individu. C’était bien telle personne que l’on pouvait dire heureuse, et non telle autre. Mais cette trajectoire singularisée ne pouvait être considérée comme « bonheur » qu’à la condition impérative de s’inclure dans un tout, de s’insérer dans un ensemble.
Accéder au bonheur ne signifiait donc pas épanouir sa personne, développer son individualité – isolément, indépendamment du reste du monde, pour son propre compte. C’était au contraire sortir de soi, quitter sa place, la contempler du dehors, saisir son inclusion dans un tout : se voir comme un musicien dans l’orchestre, une touche dans le tableau, un rôle dans le théâtre de l’Univers.
Nous voulons le bonheur, nous avons du mal à l’atteindre, et nous serions assez stupides pour ne pas mettre résolument nos pas dans ceux des philosophes qui se sont consacrés – des vies entières, des siècles durant, en cohortes serrées –, à s’exercer à l’apprivoiser ? Ne sommes-nous pas, au contraire, incroyablement chanceux, de pouvoir nous servir, nous aussi, des millénaires plus tard, de ces merveilles amoncelées ?
L’expression de « chasse au bonheur », que l’on trouve chez Stendhal, n’est pas de son invention. Ce n’est pas une création du XIXe siècle. Aristote, dans Les Politiques, écrivait déjà : « Les peuples partant chacun à la chasse au bonheur d’une manière différente et avec des moyens différents, ils créent les divers modes de vie et les diverses constitutions » (VII, 8, 5)
La philosophie antique examine donc le bonheur, si l’on ose dire, sous toutes les coutures. Elle élabore des tests pour le mettre à l’épreuve, le passe au crible, le dissèque, le cartographie. Elle invente à profusion règles, expériences, exercices, entraînements pour être sûre, autant que faire se peut, de ne pas le rater…
La philosophie antique examine donc le bonheur, si l’on ose dire, sous toutes les coutures. Elle élabore des tests pour le mettre à l’épreuve, le passe au crible, le dissèque, le cartographie. Elle invente à profusion règles, expériences, exercices, entraînements pour être sûre, autant que faire se peut, de ne pas le rater…
Aristote, dans plusieurs ouvrages, et longuement dans l’Éthique à Nicomaque, se préoccupe, lui aussi, du bonheur. Il explique, entre autres, qu’on sait seulement à la toute fin de son parcours si un homme a vraiment mené ou non une vie heureuse. Il confirme que le plaisir ne saurait suffire à définir le bonheur ni à le faire exister : la contemplation du vrai par la part intellectuelle de notre âme constitue le seul bien durable où peut s’accomplir le meilleur de l’humain.
Aristote ne privilégie pourtant pas un intellectualisme pur au détriment des conditions concrètes de l’existence : pour être heureux, à l’entendre, il faut aussi une famille aimante, des amis sincères, un peu d’aisance, une bonne réputation, autant d’éléments extérieurs à l’individu.
Aristote ne privilégie pourtant pas un intellectualisme pur au détriment des conditions concrètes de l’existence : pour être heureux, à l’entendre, il faut aussi une famille aimante, des amis sincères, un peu d’aisance, une bonne réputation, autant d’éléments extérieurs à l’individu.
D’une certaine manière, tout le monde le sait. Ce n’est pas une découverte : le bonheur des Anciens n’est pas le nôtre. Celui des classiques n’est pas celui des romantiques. Un utopiste du XIXe siècle vise un bonheur sans grand rapport avec celui d’un marxiste, d’un freudien, d’un nietzschéen, qui ont chacun en tête une conception différente… Tous utilisent le même terme, mais il renvoie à des conceptions ou des réalités dissemblables.
Chaque être humain désirant plus que tout être heureux, et la philosophie, comme par miracle, étant en mesure de combler ce désir essentiel, vital, primordial, il devient inéluctable de conclure que chaque être humain doit philosopher, afin d’obtenir, à coup sûr, ce qu’il convoite plus que tout !
Ce que tout le monde veut, la philosophie le peut !
1. Tous les humains désirent le bonheur ;
2. Or la philosophie permet d’atteindre le bonheur ;
3. Donc tous les humains ont besoin de la philosophie.
Voilà la Sainte Trinité que les nouveaux prêtres adorent ! Elle exprime, sous la forme la plus simple, l’essentiel du dispositif. Bien sûr, on ne la rencontre jamais exposée sous cette forme nue et dépouillée. Pourtant, c’est bien l’enchaînement de ces trois prétendues évidences qui constitue le socle de l’opération « philo-clé-du-bonheur ».
2. Or la philosophie permet d’atteindre le bonheur ;
3. Donc tous les humains ont besoin de la philosophie.
Voilà la Sainte Trinité que les nouveaux prêtres adorent ! Elle exprime, sous la forme la plus simple, l’essentiel du dispositif. Bien sûr, on ne la rencontre jamais exposée sous cette forme nue et dépouillée. Pourtant, c’est bien l’enchaînement de ces trois prétendues évidences qui constitue le socle de l’opération « philo-clé-du-bonheur ».
. Le bonheur se construirait ainsi par l’intermédiaire d’un site de rencontres, supposé scientifiquement fondé sur un profilage psychogénétique, selon des procédures rationnelles... Peu importe que l’on en rie ou que l’on en frémisse. L’important, pour l’instant, est d’avoir clairement entrevu ceci : bonheur, autrefois, n’était que hasard, bonheur, aujourd’hui, n’existerait que sans lui.
L’objectif n’est plus de se soustraire au hasard pour construire son bonheur. Il est désormais d’éliminer le hasard pour construire enfin un monde supposé intégralement et définitivement heureux. L’horizon rêvé est celui où le hasard sera maîtrisé, contrôlé, donc purement et simplement anéanti.
À défaut de pouvoir modifier le destin, faute de pouvoir en finir avec le hasard, on va s’employer à en déconnecter le bonheur. Les accidents de la vie, bons ou mauvais, pourront perdurer. Les événements de l’histoire, bénéfiques ou destructeurs, pourront se poursuivre et se succéder.
L’allemand a conservé une relation analogue en utilisant le même terme Glück pour dire « la chance » comme pour dire « le bonheur ». Il en va de même en anglais où le lien est évident entre happiness (bonheur) et le verbe to happen, désignant ce qui arrive, advient, ce qui se produit selon le cours immaîtrisable des événements.
Ce lien premier entre bonheur et hasard est donc bien attesté dans les langues européennes. Partout, l’idée de départ est semblable : les événements qui nous satisfont, nous rendent joyeux, nous procurent du plaisir, viennent par eux-mêmes, comme ils veulent, non pas quand nous le voulons, ni selon nos actions. Nous n’avons donc aucun pouvoir sur notre bonheur...
Ce lien premier entre bonheur et hasard est donc bien attesté dans les langues européennes. Partout, l’idée de départ est semblable : les événements qui nous satisfont, nous rendent joyeux, nous procurent du plaisir, viennent par eux-mêmes, comme ils veulent, non pas quand nous le voulons, ni selon nos actions. Nous n’avons donc aucun pouvoir sur notre bonheur...
Bonheur, en grec ancien, peut se dire eutuchia, où se discerne déjà exactement ce que dira, bien des siècles plus tard, le mot français. « Eu » est en effet la marque du bon et du bien (eu-phonique, eu-rythmique, etc.) et tuchè signifie le hasard, la chance. Un autre terme grec peut servir à désigner le bonheur, eudaïmonia (d’où provient eudémonisme = doctrine du bonheur, de la vie heureuse). Lui aussi contient le préfixe « eu », mais il l’accole à la représentation des puissances divines, des forces à l’œuvre dans les existences humaines, celles des « démons ».
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Vive la philosophie
petitsoleil
13 livres

Courts Toujours
Kickou
21 livres

Il était une fois... L'enfance
Alzie
51 livres
Auteurs proches de Roger-Pol Droit
Lecteurs de Roger-Pol Droit (710)Voir plus
Quiz
Voir plus
Jérusalem dans la culture
L'Entrée du Christ à Jérusalem est un tableau peint en 1897 représentant l'entrée de Jésus à Jérusalem juché sur un âne blanc. Il est l'oeuvre du peintre: (Indice: Académique)
Théodore Géricault,
Jean-Léon Gérôme
Paul Gauguin
12 questions
25 lecteurs ont répondu
Thèmes :
israël
, Israéliens
, jerusalem
, littérature
, adapté au cinéma
, cinema
, culture générale
, orient
, judaisme
, ville sainte
, peinture
, Arts et beaux livres
, beaux-artsCréer un quiz sur cet auteur25 lecteurs ont répondu