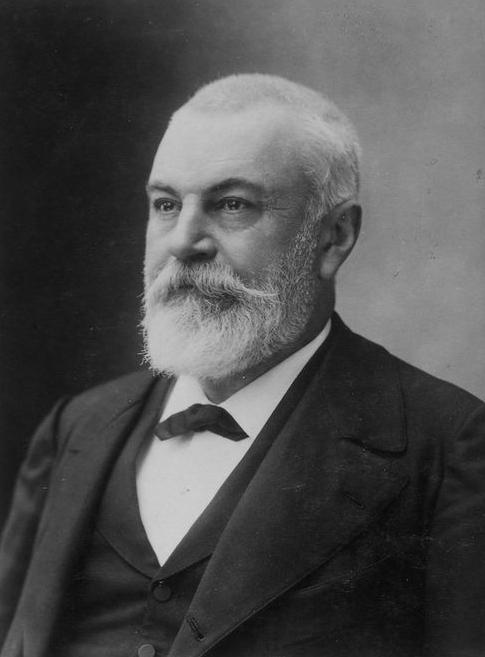Citations de Yves Guyot (30)
— il n’y a rien à faire !
— Mais si ! Dit l’opinion publique : en Angleterre, aux Etats-Unis, il y a, par exemple, la liberté de la presse, de réunion, d’association.
— Non, dit l’Etat.
— Mais vous la réclamiez, monsieur Emile Ollivier, quand vous étiez dans l’opposition ; mais vous l’avez réclamée, monsieur Thiers, dans votre discours sur les libertés nécessaires.
L’Etat répond :
— Cela est bon en théorie, mais non pas en pratique.
Qu’est-ce qu’une théorie ?
« Une théorie, c’est un ensemble de règles pratiques », a dit Kant.
Tout est théorie. Vous vous mouchez d’après une théorie.
Vous tenez votre fourchette d’après une théorie.
Quand vous dites : cela est bon en théorie et mauvais en pratique, cela prouve simplement que vous avez deux théories : une bonne que vous n’appliquez pas, et une mauvaise que vous appliquez sans oser la reconnaître.
— Mais si ! Dit l’opinion publique : en Angleterre, aux Etats-Unis, il y a, par exemple, la liberté de la presse, de réunion, d’association.
— Non, dit l’Etat.
— Mais vous la réclamiez, monsieur Emile Ollivier, quand vous étiez dans l’opposition ; mais vous l’avez réclamée, monsieur Thiers, dans votre discours sur les libertés nécessaires.
L’Etat répond :
— Cela est bon en théorie, mais non pas en pratique.
Qu’est-ce qu’une théorie ?
« Une théorie, c’est un ensemble de règles pratiques », a dit Kant.
Tout est théorie. Vous vous mouchez d’après une théorie.
Vous tenez votre fourchette d’après une théorie.
Quand vous dites : cela est bon en théorie et mauvais en pratique, cela prouve simplement que vous avez deux théories : une bonne que vous n’appliquez pas, et une mauvaise que vous appliquez sans oser la reconnaître.
Ordre public : c’est bientôt dit ; c’est un de ces grands mots que chacun répète, en croyant les comprendre. Mais quand on l’arrache de l’abstraction où il fait si bon effet, pour le voir, dans la pratique, à l’état concret, que devient-il ?
Les rédacteurs du Code civil avaient rencontré ces mots dans la vieille doctrine juridique. De définition, point. Ces mots comportent certaines prohibitions, voilà tout.
Au point de vue politique, l’ordre public, pour Louis XIV, c’était le respect de sa volonté. Quiconque y mettait obstacle était ennemi de l’ordre public (…)
L’ordre public, c’était le salut de l’Empereur. Sous la Restauration, ce fut le salut du roi.
Avec le prince Louis Napoléon, ce fut le coup d’Etat : « je suis sorti de la légalité pour rentrer dans le droit » ; ce fut la loi de sûreté générale, en vertu de laquelle le ministère de l’intérieur disait aux préfets : « il me faut tant de proscrits par département. » Napoléon III pouvait ensuite s’écrier fièrement : — l’ordre, j’en réponds !
Ce fut pour la grande cause de l’ordre qu’on fusilla et emprisonna et déporta en masse en 1871 (…)
Tous les ministres continuent de parler au nom de l’ordre. Ce mot est d’autant plus commode que, comme à celui de Dieu, chacun lui donne l’interprétation qui lui convient (…)
Si l’on s’avise de leur dire que l’ordre entrevu à travers tous ces actes paraît une chose assez monstrueuse, ils vont répondront légèrement, en pirouettant sur le talon et en haussant les épaules : — « on ne fait pas d’omelette sans casser les oeufs ». De sorte que, logiquement, la formule pour faire de l’ordre, dans la cuisine politique, consiste en ceci : savoir casser des hommes. La police tient la queue de la poêle, étant instituée pour assurer l’ordre public.
Les rédacteurs du Code civil avaient rencontré ces mots dans la vieille doctrine juridique. De définition, point. Ces mots comportent certaines prohibitions, voilà tout.
Au point de vue politique, l’ordre public, pour Louis XIV, c’était le respect de sa volonté. Quiconque y mettait obstacle était ennemi de l’ordre public (…)
L’ordre public, c’était le salut de l’Empereur. Sous la Restauration, ce fut le salut du roi.
Avec le prince Louis Napoléon, ce fut le coup d’Etat : « je suis sorti de la légalité pour rentrer dans le droit » ; ce fut la loi de sûreté générale, en vertu de laquelle le ministère de l’intérieur disait aux préfets : « il me faut tant de proscrits par département. » Napoléon III pouvait ensuite s’écrier fièrement : — l’ordre, j’en réponds !
Ce fut pour la grande cause de l’ordre qu’on fusilla et emprisonna et déporta en masse en 1871 (…)
Tous les ministres continuent de parler au nom de l’ordre. Ce mot est d’autant plus commode que, comme à celui de Dieu, chacun lui donne l’interprétation qui lui convient (…)
Si l’on s’avise de leur dire que l’ordre entrevu à travers tous ces actes paraît une chose assez monstrueuse, ils vont répondront légèrement, en pirouettant sur le talon et en haussant les épaules : — « on ne fait pas d’omelette sans casser les oeufs ». De sorte que, logiquement, la formule pour faire de l’ordre, dans la cuisine politique, consiste en ceci : savoir casser des hommes. La police tient la queue de la poêle, étant instituée pour assurer l’ordre public.
Les gouvernements ont volontiers une tendance à traiter les individus comme autrefois les médecins traitaient leurs malades.
Ils croient que la fréquente saignée est un remède souverain.
Ils ont peur de la vigueur de leurs sujets : l’activité, l’intelligence de ceux-ci représentent le mal à leurs yeux, car elles sont la force ; et les gouvernements autoritaires ne sont forts que de la faiblesse des peuples.
Ils croient que la fréquente saignée est un remède souverain.
Ils ont peur de la vigueur de leurs sujets : l’activité, l’intelligence de ceux-ci représentent le mal à leurs yeux, car elles sont la force ; et les gouvernements autoritaires ne sont forts que de la faiblesse des peuples.
On habille un morceau de bois, on le couvre de soie, de médailles, d'ornements d'or, on le met dans une niche ; des gens font brûler des cierges devant lui, lui adressent des prières, lui demandent fortune, santé, bonheur, pluie ou beau temps : c'est le fétichisme !
Adorer un nom, un homme à cheval, à panaches, à passementeries, et croire qu'il est capable, par un pouvoir magique, de faire le bonheur d'un peuple, de créer de la richesse, de concilier les économies et les dépenses, de résoudre toutes les questions qu'il ne connaît pas : c'est la forme politique du fétichisme.
Elle s'est appelée le bonapartisme.
Elle s'appelle le boulangisme.
Non seulement ces mots ont de commun les lettres initiales et finales, mais ils représentent le même esprit.
(Extrait de sa brochure sur le Boulangisme publiée en 1888)
Adorer un nom, un homme à cheval, à panaches, à passementeries, et croire qu'il est capable, par un pouvoir magique, de faire le bonheur d'un peuple, de créer de la richesse, de concilier les économies et les dépenses, de résoudre toutes les questions qu'il ne connaît pas : c'est la forme politique du fétichisme.
Elle s'est appelée le bonapartisme.
Elle s'appelle le boulangisme.
Non seulement ces mots ont de commun les lettres initiales et finales, mais ils représentent le même esprit.
(Extrait de sa brochure sur le Boulangisme publiée en 1888)
A l’intérieur du lycée, l’obéissance passive : nul bruit du dehors ne doit y pénétrer ; on se lève au son du tambour, on mange, on s’amuse, on travaille au son éternel du tambour : l’étude est une compagnie de discipline ; le pion un sergent, sinon un argousin : la discipline est dure, triste, silencieuse : l’esprit se replie sur lui-même dans une sorte d’engourdissement ; et la préparation au baccalauréat développant la mémoire et excluant le jugement, il en résulte qu’au bout de huit ans, le lycée verse dans la société de petits perroquets pouvant enfiler des mots sans en comprendre le sens, mais incapables de voir et de penser par eux-mêmes.
Alors le jeune homme entre la société avec les idées de Plutarque et de Quinte-Curce, mêlées de réminiscences catholiques, et, ainsi préparé, choisit sa carrière.
Alors le jeune homme entre la société avec les idées de Plutarque et de Quinte-Curce, mêlées de réminiscences catholiques, et, ainsi préparé, choisit sa carrière.
L'administration actuelle est plus terrible peut-être que celle de l'ancien régime.
Elle veut éviter le bruit, le scandale, mais vous broyer en douceur et d'une manière polie, d'autant plus irrésistible.
Vous avez vu un de ces effroyables marteaux-pilons, pesant des milliers de tonnes, écraser une noisette, tranquillement, juste à point. La noisette n'en est pas moins écrasée.
De même, le chef-d'oeuvre de l'administration est d'écraser les individus, les pauvres diables, d'une façon décente, sans qu'ils puissent crier ou du moins sans que le public entende leurs cris.
Elle les écrase, dans les voitures cellulaires, avec des menottes fines, mais qui n'entrent que mieux dans les chairs, à huis clos, dans des cellules silencieuses, coûtant fort cher et admirablement aménagées par des philanthropes dont l'idéal est de fabriquer des tombeaux pour les vivants ; et, non seulement des murs épais, des portes solides et matelassées, des toitures qui ressemblent à des couvercles de coffres recouvrent tout cela, mais encore un tas de prétextes humanitaires, doucereux, d'hypocrisies intéressées, dissimulent ces horreurs.
L'esprit inquisiteur a changé de forme, mais il existe toujours.
(Remarque personnelle : cela me fait penser à la citation de Colbert, mais qui elle s'appliquait qu'à la fiscalité : "L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris.”)
Elle veut éviter le bruit, le scandale, mais vous broyer en douceur et d'une manière polie, d'autant plus irrésistible.
Vous avez vu un de ces effroyables marteaux-pilons, pesant des milliers de tonnes, écraser une noisette, tranquillement, juste à point. La noisette n'en est pas moins écrasée.
De même, le chef-d'oeuvre de l'administration est d'écraser les individus, les pauvres diables, d'une façon décente, sans qu'ils puissent crier ou du moins sans que le public entende leurs cris.
Elle les écrase, dans les voitures cellulaires, avec des menottes fines, mais qui n'entrent que mieux dans les chairs, à huis clos, dans des cellules silencieuses, coûtant fort cher et admirablement aménagées par des philanthropes dont l'idéal est de fabriquer des tombeaux pour les vivants ; et, non seulement des murs épais, des portes solides et matelassées, des toitures qui ressemblent à des couvercles de coffres recouvrent tout cela, mais encore un tas de prétextes humanitaires, doucereux, d'hypocrisies intéressées, dissimulent ces horreurs.
L'esprit inquisiteur a changé de forme, mais il existe toujours.
(Remarque personnelle : cela me fait penser à la citation de Colbert, mais qui elle s'appliquait qu'à la fiscalité : "L'art de l'imposition consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris.”)
Lettre LXXVI - La paix et la guerre
- En France, quand nous avons fait une sottise, c’est une raison pour la continuer. Question d’amour propre national ! On nous reproche d’être légers. Quelle erreur ! Aucun peuple n’a peut-être jamais commis de fautes plus lourdes et ne s’est plus acharné à les alourdir. Nous ne cédons qu’à l’écrasement final.
Sur les 37 M° de français, toutes les femmes veulent la paix ; les enfants peuvent jouer au soldat, mais ont peur de la guerre quand ils savent ce que c’est ; les vieillards ne demandent qu’à mourir tranquilles ; les paysans, au nombre de 19 M°, n’ont d’autre politique que d’arrondir leur terre ; commerçants, industriels, veulent faire leurs affaires que trouble toujours la moindre aventure extérieure ; les bourgeois désirent payer le moins d’impôts possibles et ont, autant que Panurge, les coups en exécration.
Comment se fait-il donc que tous ces gens qui s’entendent si bien pour la paix, aient eu pour Dieu Napoléon et l’aient suivi jusqu’à Waterloo ? Son neveu était lui-même si étonné de ce phénomène que, tout en se déguisant en général, il eut soin d’inscrire sur son drapeau : « l’Empire, c’est la paix ! »
Il fit la guerre. La république déclare aussi qu’elle était la paix. Mais pour les hommes d’Etat français, il paraît que la paix est beaucoup plus difficile à conserver que la guerre à engager. Dès qu’elle fut débarrassée de ses ennemis intérieurs, ses gouvernants se dirent : - Maintenant, allons chercher des ennemis extérieurs et faisons la guerre ! M. Jules Ferry eut l’honneur d’inaugurer cette politique en 1881 et il l’a continué.
(…)
Que font, au contraire, les hommes politiques français ? Le commandant Rivière est tué pour avoir outrepassé ses ordres. Aussitôt, il faut venger Rivière ! On vote d’enthousiasme, sans examiner les conséquences de l’aventure, l’utilité de la présence des français à Tonkin. L’expédition du Tonkin est engagée et pour venger un mort, on se prépare à faire tuer beaucoup d’autres de nos compatriotes.
Le pays n’a pas d’enthousiasme ; mais les hommes politiques, les journaux de toutes nuances n’osent pas examiner froidement la questions ; ils craignent de choquer une opinion publique qui, de son côté, craint de se manifester. Ils s’entendent pour dissimuler, sous une hypocrisie dite patriotique, son blâme, ses appréhensions et la véritable solution. De là, la faiblesse de l’opposition et le triomphe du gouvernement ! Elle n’a pas le courage civique de détruire les sophismes de celui-ci, parce qu’elles croit qu’ils flattent des préjugés.
- En France, quand nous avons fait une sottise, c’est une raison pour la continuer. Question d’amour propre national ! On nous reproche d’être légers. Quelle erreur ! Aucun peuple n’a peut-être jamais commis de fautes plus lourdes et ne s’est plus acharné à les alourdir. Nous ne cédons qu’à l’écrasement final.
Sur les 37 M° de français, toutes les femmes veulent la paix ; les enfants peuvent jouer au soldat, mais ont peur de la guerre quand ils savent ce que c’est ; les vieillards ne demandent qu’à mourir tranquilles ; les paysans, au nombre de 19 M°, n’ont d’autre politique que d’arrondir leur terre ; commerçants, industriels, veulent faire leurs affaires que trouble toujours la moindre aventure extérieure ; les bourgeois désirent payer le moins d’impôts possibles et ont, autant que Panurge, les coups en exécration.
Comment se fait-il donc que tous ces gens qui s’entendent si bien pour la paix, aient eu pour Dieu Napoléon et l’aient suivi jusqu’à Waterloo ? Son neveu était lui-même si étonné de ce phénomène que, tout en se déguisant en général, il eut soin d’inscrire sur son drapeau : « l’Empire, c’est la paix ! »
Il fit la guerre. La république déclare aussi qu’elle était la paix. Mais pour les hommes d’Etat français, il paraît que la paix est beaucoup plus difficile à conserver que la guerre à engager. Dès qu’elle fut débarrassée de ses ennemis intérieurs, ses gouvernants se dirent : - Maintenant, allons chercher des ennemis extérieurs et faisons la guerre ! M. Jules Ferry eut l’honneur d’inaugurer cette politique en 1881 et il l’a continué.
(…)
Que font, au contraire, les hommes politiques français ? Le commandant Rivière est tué pour avoir outrepassé ses ordres. Aussitôt, il faut venger Rivière ! On vote d’enthousiasme, sans examiner les conséquences de l’aventure, l’utilité de la présence des français à Tonkin. L’expédition du Tonkin est engagée et pour venger un mort, on se prépare à faire tuer beaucoup d’autres de nos compatriotes.
Le pays n’a pas d’enthousiasme ; mais les hommes politiques, les journaux de toutes nuances n’osent pas examiner froidement la questions ; ils craignent de choquer une opinion publique qui, de son côté, craint de se manifester. Ils s’entendent pour dissimuler, sous une hypocrisie dite patriotique, son blâme, ses appréhensions et la véritable solution. De là, la faiblesse de l’opposition et le triomphe du gouvernement ! Elle n’a pas le courage civique de détruire les sophismes de celui-ci, parce qu’elles croit qu’ils flattent des préjugés.
Puis le médecin entra dans son cabinet.
Une jeune jeune femme, traînant par le bras un petit garçon de sept à huit ans, le suivit.
— Eh bien, qu'est-ce qu'il a, le Durand ?
— Voilà le petit, il n'a que huit ans, et il ne porte pas son âge ; voyez-vous, c'est dur pour lui de passer huit heures par jour à traîner quatre pattes, avec une chaîne passée entre les jambes, des courriaux qui pèsent bien lourd et par des chemins raboteux... il a les reins a vif.
— Voyons ça !
La femme Durand enleva la chemise noire de l'enfant et découvrit autour des reins une plaie telle qu’en fait le collier aux épaules des chevaux.
— Allons ! allons ! Faudra du repos ! Ça ne sera rien, voyez-vous, il ne faut pas se plaindre.
(…)
Le défilé continua. Il y avait des jeunes filles qui s'étaient blessées en alimentant les gueulards des hauts-fourneau.
Le doux médecin leur démontra qu'elles étaient bien heureuses de travailler à la surface du sol et non dans les profondeurs des mines ; qu'en Angleterre et en Belgique des jeunes filles y travaillaient encore comme des hommes ; que leur travail, du reste, était une excellente gymnastique. Il fallait seulement avoir la force de le supporter, sinon il vous tuait ; voilà tout.
(…)
C’était ce jour là que devaient être réglées les pensions.
Le malheureux Jacques Brunehaut s’appuya sur le bras de sa femme, et en se traînant se rendit dans le cabinet où l’attendait M. De Torgnac comme délégué par M. Macreux à l’administration de la caisse de secours.
- Eh bien ! Votre situation est réglée. Voici : vous aurez encore pendant un mois un franc par jour : au bout de ce temps, vous n’aurez plus le droit qu’à votre pension.
Elle sera de soixante-seize francs par an.
- Mais, Monsieur, dit le malheureux Jacques Brunehaut, comment voulez-vous que je vive avec ça ? C’est la mort pour ma femme, pour mes trois petits enfants, pour moi ! Je ne pourrai plus jamais travailler à la mine. Voyez mes mains, elles sont toutes tordues, déchiquetées, je ne suis plus maître de mes doigts ; je n’ai plus de reins… Les jambes plies sous moi.
Le malheureux pleurait ; ces larmes sortant de ces yeux dont les paupières avaient été brûlées, ce visage tout couturé de cicatrices, ces mains difformes implorant pitié ; ces jambes tordues, près de s’agenouiller afin de demander la vie pour sa femme et ses petits enfants ; cette femme jeune qui sanglotait : ces trois petits enfants dont un sur les bras : M de Torgnac regarda et vit tout cela à travers son lorgnon d’or.
- C’est inutile de pleurer, c’est comme ça, dit-il, et rien ne pourrait y changer quelque chose. Vous avez quitté deux fois la mine pour voir si ailleurs vous seriez mieux. Vous avez perdu vos deux premières mises à la société de secours. Voilà trois ans seulement que vous êtes revenu. Nous avons même un peu forcé le prorata de votre mise. Vous n’avez rien à réclamer. Finissons-en.
(…)
- François Pichot disparu, pas de femme, pas d’enfants ; rien à donner, dit M de Torgnac en lisant un papier. Pierre Pichot ; aveugle, bien ; une jambe tordue, ne pouvant plus guère servir, dix-neuf ans ; mise à la caisse de secours depuis l’âge de quatorze ans : cela fait quatre ans ; incapacité absolue de travail, cela fait cent francs par an.
- Que voulez-vous qu’il fasse avec cent francs ? Dit Jérôme Pichot, laissant tomber ses bras de stupéfaction.
- Eh bien ! Ça le regarde, reprit M. De Torgnac, en fixant son lorgnon d’or impassible sur Jérôme Pichot.
- Mais pensez donc, Monsieur ; sur douze enfants, j’en ai quatre qui sont morts à la peine. Sauf l’aîné, malheureusement tous ressemblent à leur mère qui n’est point forte, au lieu de me ressembler à moi, ajouta Jérôme Pichot, en donnant sur sa large poitrine un coup de poing qui résonna profondément. La mine est trop dure pour eux.
- Eh bien ! Que voulez-vous dire ?
- Eh bien, je disais donc : il sait bien que nous le garderons, mais nous n’avons déjà point trop pour nous. Et quand nous serons morts, que voulez-vous qu’il devienne avec ses cent francs ?
- M de Torgnac haussa les épaules. Ça le regarde.
- François mort, Pierre aveugle, Mathurin malade, Julie Bossue, quatre morts à la peine, Joseph pris au sort à l’armée. Eh bien ! Je dirai : tant mieux pour ceux qui sont morts, tant mieux pour ceux qui meurent ; au moins c’est fini.
- C’est toujours une ressource qu’on a sous la main, dit M de Torgnac en allumant un cigare et en haussant les épaules.
(…)
- Charles Lebrun, dit M de Torgnac, âgé de vingt-deux ans. Une jambe perdue par suite d’imprudence, étant descendu sans ordre dans le puits du Diable. Indemnité de cent francs une fois donnée.
- Quoi ? Dit Charles Lebrun, se demandant s’il avait bien compris.
- Eh bien, quoi ? J’ai dit que l’administration de la société de secours veut bien vous donner cent francs. C’est pure gracieuseté de sa part, car elle ne vous doit rien. Pour qu’elle vous dût quelque chose, il faudrait que votre incapacité de travail résultât du travail lui-même. Or, elle résulte simplement de votre imprudence.
Mais c’était pour secourir les camarades, dit Charles Lebrun, continuant d’essayer de comprendre.
- Vous n’aviez pas d’ordres. (…)
- Mais, Monsieur, pensez donc, ma mère n’avait que moi. Elle n’a plus de forces. Elle ne peut plus travailler ! Que voulez-vous que nous devenions ?
Moi je ne veux rien du tout, devenez ce que vous voudrez.
La vieille mère de Charles Lebrun joignit les mains.
- Oh ! Mon dieu, je vous en prie…Allons, allons, la paix !
Une jeune jeune femme, traînant par le bras un petit garçon de sept à huit ans, le suivit.
— Eh bien, qu'est-ce qu'il a, le Durand ?
— Voilà le petit, il n'a que huit ans, et il ne porte pas son âge ; voyez-vous, c'est dur pour lui de passer huit heures par jour à traîner quatre pattes, avec une chaîne passée entre les jambes, des courriaux qui pèsent bien lourd et par des chemins raboteux... il a les reins a vif.
— Voyons ça !
La femme Durand enleva la chemise noire de l'enfant et découvrit autour des reins une plaie telle qu’en fait le collier aux épaules des chevaux.
— Allons ! allons ! Faudra du repos ! Ça ne sera rien, voyez-vous, il ne faut pas se plaindre.
(…)
Le défilé continua. Il y avait des jeunes filles qui s'étaient blessées en alimentant les gueulards des hauts-fourneau.
Le doux médecin leur démontra qu'elles étaient bien heureuses de travailler à la surface du sol et non dans les profondeurs des mines ; qu'en Angleterre et en Belgique des jeunes filles y travaillaient encore comme des hommes ; que leur travail, du reste, était une excellente gymnastique. Il fallait seulement avoir la force de le supporter, sinon il vous tuait ; voilà tout.
(…)
C’était ce jour là que devaient être réglées les pensions.
Le malheureux Jacques Brunehaut s’appuya sur le bras de sa femme, et en se traînant se rendit dans le cabinet où l’attendait M. De Torgnac comme délégué par M. Macreux à l’administration de la caisse de secours.
- Eh bien ! Votre situation est réglée. Voici : vous aurez encore pendant un mois un franc par jour : au bout de ce temps, vous n’aurez plus le droit qu’à votre pension.
Elle sera de soixante-seize francs par an.
- Mais, Monsieur, dit le malheureux Jacques Brunehaut, comment voulez-vous que je vive avec ça ? C’est la mort pour ma femme, pour mes trois petits enfants, pour moi ! Je ne pourrai plus jamais travailler à la mine. Voyez mes mains, elles sont toutes tordues, déchiquetées, je ne suis plus maître de mes doigts ; je n’ai plus de reins… Les jambes plies sous moi.
Le malheureux pleurait ; ces larmes sortant de ces yeux dont les paupières avaient été brûlées, ce visage tout couturé de cicatrices, ces mains difformes implorant pitié ; ces jambes tordues, près de s’agenouiller afin de demander la vie pour sa femme et ses petits enfants ; cette femme jeune qui sanglotait : ces trois petits enfants dont un sur les bras : M de Torgnac regarda et vit tout cela à travers son lorgnon d’or.
- C’est inutile de pleurer, c’est comme ça, dit-il, et rien ne pourrait y changer quelque chose. Vous avez quitté deux fois la mine pour voir si ailleurs vous seriez mieux. Vous avez perdu vos deux premières mises à la société de secours. Voilà trois ans seulement que vous êtes revenu. Nous avons même un peu forcé le prorata de votre mise. Vous n’avez rien à réclamer. Finissons-en.
(…)
- François Pichot disparu, pas de femme, pas d’enfants ; rien à donner, dit M de Torgnac en lisant un papier. Pierre Pichot ; aveugle, bien ; une jambe tordue, ne pouvant plus guère servir, dix-neuf ans ; mise à la caisse de secours depuis l’âge de quatorze ans : cela fait quatre ans ; incapacité absolue de travail, cela fait cent francs par an.
- Que voulez-vous qu’il fasse avec cent francs ? Dit Jérôme Pichot, laissant tomber ses bras de stupéfaction.
- Eh bien ! Ça le regarde, reprit M. De Torgnac, en fixant son lorgnon d’or impassible sur Jérôme Pichot.
- Mais pensez donc, Monsieur ; sur douze enfants, j’en ai quatre qui sont morts à la peine. Sauf l’aîné, malheureusement tous ressemblent à leur mère qui n’est point forte, au lieu de me ressembler à moi, ajouta Jérôme Pichot, en donnant sur sa large poitrine un coup de poing qui résonna profondément. La mine est trop dure pour eux.
- Eh bien ! Que voulez-vous dire ?
- Eh bien, je disais donc : il sait bien que nous le garderons, mais nous n’avons déjà point trop pour nous. Et quand nous serons morts, que voulez-vous qu’il devienne avec ses cent francs ?
- M de Torgnac haussa les épaules. Ça le regarde.
- François mort, Pierre aveugle, Mathurin malade, Julie Bossue, quatre morts à la peine, Joseph pris au sort à l’armée. Eh bien ! Je dirai : tant mieux pour ceux qui sont morts, tant mieux pour ceux qui meurent ; au moins c’est fini.
- C’est toujours une ressource qu’on a sous la main, dit M de Torgnac en allumant un cigare et en haussant les épaules.
(…)
- Charles Lebrun, dit M de Torgnac, âgé de vingt-deux ans. Une jambe perdue par suite d’imprudence, étant descendu sans ordre dans le puits du Diable. Indemnité de cent francs une fois donnée.
- Quoi ? Dit Charles Lebrun, se demandant s’il avait bien compris.
- Eh bien, quoi ? J’ai dit que l’administration de la société de secours veut bien vous donner cent francs. C’est pure gracieuseté de sa part, car elle ne vous doit rien. Pour qu’elle vous dût quelque chose, il faudrait que votre incapacité de travail résultât du travail lui-même. Or, elle résulte simplement de votre imprudence.
Mais c’était pour secourir les camarades, dit Charles Lebrun, continuant d’essayer de comprendre.
- Vous n’aviez pas d’ordres. (…)
- Mais, Monsieur, pensez donc, ma mère n’avait que moi. Elle n’a plus de forces. Elle ne peut plus travailler ! Que voulez-vous que nous devenions ?
Moi je ne veux rien du tout, devenez ce que vous voudrez.
La vieille mère de Charles Lebrun joignit les mains.
- Oh ! Mon dieu, je vous en prie…Allons, allons, la paix !
La vieille politique de conquête semble avoir repris une nouvelle impulsion en Europe depuis 1866 : la Prusse ouvre cette ère avec Sadowa ; elle continue avec l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine.
L'Autriche prend à son tour la Bosnie et l'Herzégovine.
La Russie projette des postes de Cosaques jusqu'aux portes de l'Inde.
L'Angleterre s'empare de Chypre (...)
La France, vaincue d'hier, proclame, elle aussi, la sainteté de la conquête, la mission civilisatrice du vainqueur, et se met en train de protéger, à coup de canon, la Tunisie, Madagascar et le Tonkin.
L'Italie est furieuse de notre annexion de la Tunisie, quoique toutes les améliorations que nous pourrons y faire doivent surtout profiter à ses nationaux, puisqu'on y compte huit italiens au moins contre 2 français ; cette annexion la jette dans l'alliance Austro-Allemande.
Elle veut aussi, elle, quelque chose, n'importe quoi, mais elle veut avoir sa colonie. Elle tripote à Tripoli ; et enfin, elle va triomphalement s'échouer dans la mer Rouge, comme si, avant de songer à aller coloniser les autres continents, elle ne ferait pas bien de coloniser la Calabre, et comme si elle n'avait pas assez de la malaria, sans aller chercher entre les maladies du climat torride !
M. de Bismarck joue au Napoléon à l'égard de l'Angleterre, et il a l'habilité de nous mettre dans son jeu (...)
Chaque peuple européen semble pris d'une gloutonnerie d'autruche ; il avale tout, pourvu qu'il avale, rochers arides, marécages où ne se récoltent que des fièvres paludéennes, territoires sans eau, populations qui résistent, peu importe ! Il se précipite sur tout, sans s'inquiéter de la digestion ; mais ce prurit d'annexions coloniales, cette agitation rapace indiquent un état mental peu rassurant. Les territoires des indigènes n'ayant donné à chacun que des déceptions, on voudra essayer du territoire du voisin. Un choc en Afrique, en Asie, en Océanie peut faire éclater une conflagration européenne, d'un jour à l'autre, au gré d'une diplomatie autocratique dont les peuples ne connaissent ni les trames ni les desseins ; qui, pour des intérêts dynastiques, peut provoquer des conflits même contre la volonté et les intérêts des peuples qu'elle prétend représenter.
Est-ce que la guerre n'a pas été considérée par tous les despotes, comme un moyen de grouper leurs peuples autour d'eux et de supprimer les questions intérieures ? Est-ce qu'un homme d'état embarrassé ne peut pas lâcher la guerre, comme on ouvre une soupape ? Est-ce que pour les politiques qui considèrent que la force des gouvernements est surtout composée de la faiblesse des gouvernés, la guerre n'est pas la saignée de Purgon pour la médecine antiphlogistique ?
L'Autriche prend à son tour la Bosnie et l'Herzégovine.
La Russie projette des postes de Cosaques jusqu'aux portes de l'Inde.
L'Angleterre s'empare de Chypre (...)
La France, vaincue d'hier, proclame, elle aussi, la sainteté de la conquête, la mission civilisatrice du vainqueur, et se met en train de protéger, à coup de canon, la Tunisie, Madagascar et le Tonkin.
L'Italie est furieuse de notre annexion de la Tunisie, quoique toutes les améliorations que nous pourrons y faire doivent surtout profiter à ses nationaux, puisqu'on y compte huit italiens au moins contre 2 français ; cette annexion la jette dans l'alliance Austro-Allemande.
Elle veut aussi, elle, quelque chose, n'importe quoi, mais elle veut avoir sa colonie. Elle tripote à Tripoli ; et enfin, elle va triomphalement s'échouer dans la mer Rouge, comme si, avant de songer à aller coloniser les autres continents, elle ne ferait pas bien de coloniser la Calabre, et comme si elle n'avait pas assez de la malaria, sans aller chercher entre les maladies du climat torride !
M. de Bismarck joue au Napoléon à l'égard de l'Angleterre, et il a l'habilité de nous mettre dans son jeu (...)
Chaque peuple européen semble pris d'une gloutonnerie d'autruche ; il avale tout, pourvu qu'il avale, rochers arides, marécages où ne se récoltent que des fièvres paludéennes, territoires sans eau, populations qui résistent, peu importe ! Il se précipite sur tout, sans s'inquiéter de la digestion ; mais ce prurit d'annexions coloniales, cette agitation rapace indiquent un état mental peu rassurant. Les territoires des indigènes n'ayant donné à chacun que des déceptions, on voudra essayer du territoire du voisin. Un choc en Afrique, en Asie, en Océanie peut faire éclater une conflagration européenne, d'un jour à l'autre, au gré d'une diplomatie autocratique dont les peuples ne connaissent ni les trames ni les desseins ; qui, pour des intérêts dynastiques, peut provoquer des conflits même contre la volonté et les intérêts des peuples qu'elle prétend représenter.
Est-ce que la guerre n'a pas été considérée par tous les despotes, comme un moyen de grouper leurs peuples autour d'eux et de supprimer les questions intérieures ? Est-ce qu'un homme d'état embarrassé ne peut pas lâcher la guerre, comme on ouvre une soupape ? Est-ce que pour les politiques qui considèrent que la force des gouvernements est surtout composée de la faiblesse des gouvernés, la guerre n'est pas la saignée de Purgon pour la médecine antiphlogistique ?
Lettre X - Contradiction - l’émigration spontanée
L’Etat fait de grands sacrifices pour encourager l’émigration ; mais en même temps, la loi militaire défend au français, sous peine d’être traité comme déserteur, de sortit de son pays avant l’âge de 40 ans. C’est un peu tard.
Il y a des gens à esprit mal fait, basques ou français du Midi, qui ne veulent point aller au Sénégal, ni à la Guyane, ni même en Algérie ; mais qui, sans subventions, sans encouragements d’aucune sorte de la part du gouvernement, vont à Buenos-Aires, s’y installent, y font souche, tout en gardant leur langue maternelle, et entretiennent avec la France un commerce dont nous verrons plus loin l’importance. Cette émigration spontanée a crée dans cette partie de l’Amérique du Sud, en dehors du climat torride, un noyau de 100.000 français ; ils ne demandent pas de conquête ; ils ne demandent pas d’intervention armée ; ils ne coûtent rien au budget de la métropole.
Si l’émigration est une bonne chose, ces gens nous semblent des colons modèles. Il n’y a qu’à les laisser faire.
On les laisse faire, seulement si un des ces hommes revient en France, un peu en retard pour son tirage au sort, il est mis en prison et jugé. J’ai vu le cas.
Il est vrai que ce cas ne s’est, parait-il, présenté qu’une fois : les français partis pour Buenos-Aires se soucient peu de traverser l’Océan pour venir échouer à la prison du Cherche-Midi.
Mais alors la plupart deviennent des déserteurs. S’ils remettent le pied sur le sol de leur pays, ils sont soumis aux terribles pénalités qui atteignent les réfractaires. La loi française les oblige donc à se tenir écartés et éloignés à tout jamais de la France. Elle coupe le lien qui les y rattachait.
Il en est de même pour les émigrants qui vont aux Etats-Unis.
Si le Parlement avait dépensé la moitié du temps qu’ont pris les discussions relatives à Madagascar seulement à résoudre cette difficulté, il eût fait plus pour « l’expansion de la race française », qu’en votant tous les crédits que lui coûte, depuis seulement un an, notre fameuse « politique coloniale ! »
L’Etat fait de grands sacrifices pour encourager l’émigration ; mais en même temps, la loi militaire défend au français, sous peine d’être traité comme déserteur, de sortit de son pays avant l’âge de 40 ans. C’est un peu tard.
Il y a des gens à esprit mal fait, basques ou français du Midi, qui ne veulent point aller au Sénégal, ni à la Guyane, ni même en Algérie ; mais qui, sans subventions, sans encouragements d’aucune sorte de la part du gouvernement, vont à Buenos-Aires, s’y installent, y font souche, tout en gardant leur langue maternelle, et entretiennent avec la France un commerce dont nous verrons plus loin l’importance. Cette émigration spontanée a crée dans cette partie de l’Amérique du Sud, en dehors du climat torride, un noyau de 100.000 français ; ils ne demandent pas de conquête ; ils ne demandent pas d’intervention armée ; ils ne coûtent rien au budget de la métropole.
Si l’émigration est une bonne chose, ces gens nous semblent des colons modèles. Il n’y a qu’à les laisser faire.
On les laisse faire, seulement si un des ces hommes revient en France, un peu en retard pour son tirage au sort, il est mis en prison et jugé. J’ai vu le cas.
Il est vrai que ce cas ne s’est, parait-il, présenté qu’une fois : les français partis pour Buenos-Aires se soucient peu de traverser l’Océan pour venir échouer à la prison du Cherche-Midi.
Mais alors la plupart deviennent des déserteurs. S’ils remettent le pied sur le sol de leur pays, ils sont soumis aux terribles pénalités qui atteignent les réfractaires. La loi française les oblige donc à se tenir écartés et éloignés à tout jamais de la France. Elle coupe le lien qui les y rattachait.
Il en est de même pour les émigrants qui vont aux Etats-Unis.
Si le Parlement avait dépensé la moitié du temps qu’ont pris les discussions relatives à Madagascar seulement à résoudre cette difficulté, il eût fait plus pour « l’expansion de la race française », qu’en votant tous les crédits que lui coûte, depuis seulement un an, notre fameuse « politique coloniale ! »
Lettre LXX - L’expansion de la race française
Lettre adressée à l'auteur :
"Alors les français resteront toujours enfermés en France ? Comme notre population ne s’accroit que très lentement, nous sommes condamnés à disparaître et notre langue avec nous ? Que deviendra l’humanité sans nous ?"
(…)
Les auteurs de la locution « expansion de la race française » n’oublient q’un détail : c’est qu’il n’y a pas de race française ; nous sommes un mélange de toutes sortes d’éléments. Ces croisements divers nous ont donné des aptitudes et des caractères multiples : un provençal, un normand, un bas-breton… réunis font un français ; et certes ce sont des unités d’un ordre différent.
(…)
Le croisement. Cette idée choque les gens qui font de la race une entité inébranlable ; mais les faits prouvent que le métissage, dans beaucoup d’occasions, a un plein succès.
(…)
Si le mariage est le plus grand instrument d’assimilation, notre code civil défend de s’en servir, en dehors de certaines formes. Nous croyons qu’il a dit le dernier mot, le considérant comme un dogme. Quiconque ne se marie dans ses formes commet une hérésie, une impiété, dont le châtiment retombe sur sa femme et ses enfants.
Le statut personnel de l’arabe est le grand obstacle à son assimilation aux français, et, en réalité, il n’y a qu’une question : on veut qu’il se marie à notre manière. Cependant le mariage arabe n’est-il pas meilleur que le mariage français ? Il n’établit pas la distinction qui existe chez nous entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Le droit musulman considère que tous les enfants se font de la même manière.
Les prêtres, les missionnaires viennent ajouter leur orthodoxie à l’orthodoxie légale. Au Sénégal, les unions temporaires entre blancs, négresses et signâmes étaient des faits acceptés, donnaient lieu à un contrat, analogue au concubinat Romain ou Japonais (…)
Pour répandre notre « race française », il n’y a cependant qu’un moyen : c’est de faire des enfants.
(…)
Au lieu de mettre notre politique coloniale sous le patronage du Dieu des armées, il faudrait la placer sous le patronage de Pan (divinité grecque liée à la fécondité et la sexualité), lui donner le Phallus pour symbole et Rabelais pour grand prêtre. Utile Dulci (« l’utile avec le doux »)
Lettre adressée à l'auteur :
"Alors les français resteront toujours enfermés en France ? Comme notre population ne s’accroit que très lentement, nous sommes condamnés à disparaître et notre langue avec nous ? Que deviendra l’humanité sans nous ?"
(…)
Les auteurs de la locution « expansion de la race française » n’oublient q’un détail : c’est qu’il n’y a pas de race française ; nous sommes un mélange de toutes sortes d’éléments. Ces croisements divers nous ont donné des aptitudes et des caractères multiples : un provençal, un normand, un bas-breton… réunis font un français ; et certes ce sont des unités d’un ordre différent.
(…)
Le croisement. Cette idée choque les gens qui font de la race une entité inébranlable ; mais les faits prouvent que le métissage, dans beaucoup d’occasions, a un plein succès.
(…)
Si le mariage est le plus grand instrument d’assimilation, notre code civil défend de s’en servir, en dehors de certaines formes. Nous croyons qu’il a dit le dernier mot, le considérant comme un dogme. Quiconque ne se marie dans ses formes commet une hérésie, une impiété, dont le châtiment retombe sur sa femme et ses enfants.
Le statut personnel de l’arabe est le grand obstacle à son assimilation aux français, et, en réalité, il n’y a qu’une question : on veut qu’il se marie à notre manière. Cependant le mariage arabe n’est-il pas meilleur que le mariage français ? Il n’établit pas la distinction qui existe chez nous entre les enfants légitimes et les enfants naturels. Le droit musulman considère que tous les enfants se font de la même manière.
Les prêtres, les missionnaires viennent ajouter leur orthodoxie à l’orthodoxie légale. Au Sénégal, les unions temporaires entre blancs, négresses et signâmes étaient des faits acceptés, donnaient lieu à un contrat, analogue au concubinat Romain ou Japonais (…)
Pour répandre notre « race française », il n’y a cependant qu’un moyen : c’est de faire des enfants.
(…)
Au lieu de mettre notre politique coloniale sous le patronage du Dieu des armées, il faudrait la placer sous le patronage de Pan (divinité grecque liée à la fécondité et la sexualité), lui donner le Phallus pour symbole et Rabelais pour grand prêtre. Utile Dulci (« l’utile avec le doux »)
Lettre LXVI - La force et le droit
- Qu’on me range dans la catégorie des rêveurs et des sentimentaux ; je ne prends souci de cette accusation ; je prétends que ce ne sont pas vos concepts de bouledogues qui pourront donner de l’influence à votre parti, lui acquérir des sympathies, grouper des adhérents autour de lui.
Vous parlez de la mission civilisatrice de la France ! Elle l’a remplie quand, au soleil de 89, elle a crié à tous les peuples : liberté ! Elle l’a remplie en évoquant en face du droit divin le droit de l’homme. Elle doit continuer à la remplir en affirmant la nécessité de la justice ; c’est le rôle magnétique vers lequel doivent s’orienter toutes nos aspirations et nos revendications ; c’est l’idéal toujours de plus en plus élevé ; de plus en plus lumineux, vers lequel, nous républicains, nous libres penseurs nous français, nous devons nous efforcer de guider l’humanité !
- Qu’on me range dans la catégorie des rêveurs et des sentimentaux ; je ne prends souci de cette accusation ; je prétends que ce ne sont pas vos concepts de bouledogues qui pourront donner de l’influence à votre parti, lui acquérir des sympathies, grouper des adhérents autour de lui.
Vous parlez de la mission civilisatrice de la France ! Elle l’a remplie quand, au soleil de 89, elle a crié à tous les peuples : liberté ! Elle l’a remplie en évoquant en face du droit divin le droit de l’homme. Elle doit continuer à la remplir en affirmant la nécessité de la justice ; c’est le rôle magnétique vers lequel doivent s’orienter toutes nos aspirations et nos revendications ; c’est l’idéal toujours de plus en plus élevé ; de plus en plus lumineux, vers lequel, nous républicains, nous libres penseurs nous français, nous devons nous efforcer de guider l’humanité !
Lettre LXIII - La guerre et le libre échange
- Nous voulons faire, à grands frais, des colonies, pour nous procurer à bon marché des objets que nous frappons de droits de douanes à la frontière parce que d’autres nous les offrent, sans frais, à un prix que nous trouvons trop bas !
Dans cette conception du commerce, le peuple Européen, qui prétend ouvrir les nouveaux continents à la civilisation, veut s’en attribuer le monopole : les indigènes, les colons ne doivent acheter et ne vendre qu’à lui. C’est le vieux système mercantile que M. Faure s’est efforcé de restaurer. La politique coloniale a sa logique.
Alors, il faut conquérir le peuple afin de s’assurer de sa clientèle.
Cela coûte cher.
De 1725 à 1769, la compagnie des Indes avait coûté à la France 376 Millions sans que jamais elle eût pu payer ses actionnaires du produit de son commerce (…)
Les compagnies des Indes se ruinaient ; celles qui faisaient le commerce avec la Chine s’enrichissaient (…) Pourquoi ? C’est que celles-ci n’avaient que leurs frais de navigation et n’avaient pas à entretenir de soldats et d’armée.
Éclairés par cette expérience, les anglais se sont bien gardés d’essayer de conquérir, dans ce siècle, quelque province de Chine ou de l’Indo-Chine. Ils se sont bornés à occuper le rocher de Hong-Kong de 8 000 hectares, la superficie de Paris, séparé de la terre ferme. Il leur sert de station et d’entrepôt, avec 665 hommes en tout pour faire la police. En 1883, ce port a reçu 5.3 M de tonneaux, plus que Marseille !
Les Portugais ont su conserver le monopole du commerce de la côte d’Afrique en établissant simplement de petits comptoirs tandis qu’ils s’étaient ruinés en jouant dans l’Inde le rôle de conquérants.
Les Hollandais y réussissaient, au contraire, en se bornant à faire des contrats avec les marchands indigènes, sans bâtir de factoreries dispendieuses.
Dans ce système, l’Européen n’a pas la responsabilité de l’admiration de peuples étrangers ; il n’a pas à les soumettre à des formes politiques incompatibles avec leur état social ; il ne prend la responsabilité ni de leur conservation ni de leur destruction.
Nous, au contraire, nous voulons dépenser 120 millions dans un chemin de fer au Sénégal ; nous faisons des expéditions onéreuses pour : « être les premiers maîtres du Niger afin d’empêcher toute autre nation de s’établir sur ses rives » l’Allemagne achète, de son côté, tous les terrains qu’elle trouve plus ou moins disponibles sur les côtes ouest et est de l’Afrique.
(…)
Les partisans de la politique coloniale se donnent beaucoup de mal pour s’annexer quelques millions d’hectares de territoire malsain, quelques milliers de gens sans industrie, sans pouvoir d’achat, alors qu’au point de vue l’échange, des débouchés, il leur suffirait de supprimer leur tarif de douanes pour s’annexer le monde !
- Nous voulons faire, à grands frais, des colonies, pour nous procurer à bon marché des objets que nous frappons de droits de douanes à la frontière parce que d’autres nous les offrent, sans frais, à un prix que nous trouvons trop bas !
Dans cette conception du commerce, le peuple Européen, qui prétend ouvrir les nouveaux continents à la civilisation, veut s’en attribuer le monopole : les indigènes, les colons ne doivent acheter et ne vendre qu’à lui. C’est le vieux système mercantile que M. Faure s’est efforcé de restaurer. La politique coloniale a sa logique.
Alors, il faut conquérir le peuple afin de s’assurer de sa clientèle.
Cela coûte cher.
De 1725 à 1769, la compagnie des Indes avait coûté à la France 376 Millions sans que jamais elle eût pu payer ses actionnaires du produit de son commerce (…)
Les compagnies des Indes se ruinaient ; celles qui faisaient le commerce avec la Chine s’enrichissaient (…) Pourquoi ? C’est que celles-ci n’avaient que leurs frais de navigation et n’avaient pas à entretenir de soldats et d’armée.
Éclairés par cette expérience, les anglais se sont bien gardés d’essayer de conquérir, dans ce siècle, quelque province de Chine ou de l’Indo-Chine. Ils se sont bornés à occuper le rocher de Hong-Kong de 8 000 hectares, la superficie de Paris, séparé de la terre ferme. Il leur sert de station et d’entrepôt, avec 665 hommes en tout pour faire la police. En 1883, ce port a reçu 5.3 M de tonneaux, plus que Marseille !
Les Portugais ont su conserver le monopole du commerce de la côte d’Afrique en établissant simplement de petits comptoirs tandis qu’ils s’étaient ruinés en jouant dans l’Inde le rôle de conquérants.
Les Hollandais y réussissaient, au contraire, en se bornant à faire des contrats avec les marchands indigènes, sans bâtir de factoreries dispendieuses.
Dans ce système, l’Européen n’a pas la responsabilité de l’admiration de peuples étrangers ; il n’a pas à les soumettre à des formes politiques incompatibles avec leur état social ; il ne prend la responsabilité ni de leur conservation ni de leur destruction.
Nous, au contraire, nous voulons dépenser 120 millions dans un chemin de fer au Sénégal ; nous faisons des expéditions onéreuses pour : « être les premiers maîtres du Niger afin d’empêcher toute autre nation de s’établir sur ses rives » l’Allemagne achète, de son côté, tous les terrains qu’elle trouve plus ou moins disponibles sur les côtes ouest et est de l’Afrique.
(…)
Les partisans de la politique coloniale se donnent beaucoup de mal pour s’annexer quelques millions d’hectares de territoire malsain, quelques milliers de gens sans industrie, sans pouvoir d’achat, alors qu’au point de vue l’échange, des débouchés, il leur suffirait de supprimer leur tarif de douanes pour s’annexer le monde !
XXXII -
De 1815 à 1870, les hommes de tous les partis, les orateurs du gouvernement et même de l’opposition paraphrasaient à La Tribune avec conviction la « Gesta Dei per Francos. » = La france était le peuple élu de Dieu ; De Dieu, elle tenait sa mission. Il eût fallu être bien difficile pour ne pas se contenter d’une explication aussi claire.
Mais depuis, Dieu a perdu son prestige. Ce petit mot n’est plus suffisant pour servir de bouche-trou au vide des affirmations.
Maintenant, on se borne à affirmer que la France remplit : « sa mission civilisatrice », en annonçant les Howas comme des lapins et en faisant servir de cibles les prisonniers Chinois.
Mais si Dieu n’est plus là pour vous donner votre « mission civilisatrice », de qui tenez-vous votre mandat ? Où est-il ?
Vous répondez que « cette mission incombe à tous les peuples d’une civilisation supérieure » et spécialement à la France qui a une civilisation supérieure à toutes les civilisations supérieures.
Mais quelle civilisation supérieure prétendez-vous importer ? Sous quelle forme se manifeste-t-elle auprès des autres peuples ?
Est-ce la douceur ou la férocité que vous allez leur enseigner ? Laquelle de ces deux qualités est l’apanage de la civilisation supérieure ? Si vous répondez que c’est la douceur, l’humanité, la solidarité humaine, tous vos actes démentent vos paroles. Si c’est la férocité, alors la plupart des peuples à l’égard desquels vous prétendez exercer votre mission civilisatrice, n’avaient pas besoin de vos leçons.
Est-ce le respect de la propriété ? Vous commencez par les dépouiller, vous ne savez que mettre à leur égard la fameuse définition du Proudhon : - la propriété, c’est le vol !
Est-ce la chasteté ? (…)
Est-ce la justice ? (…)
XXXIII - Un féodal -
- L’indigène est tenu à obéir à toutes les volontés du conquérant ; le conquérant n’est tenu à remplir aucun de ses engagements envers lui. Telle est la loi, fille légitime des arrangements qui, au moyen âge, réglaient en Europe les rapports du serf et du seigneur.
Vous croyez que le seigneur du XIIIème siècle a disparu, parce que vous ne voyez plus son donjon qu’en ruines, son heaume et son haubert que dans les musées ou chez les marchands de curiosité, ses armoiries que dans les livres illustrés.
Erreur ! Allez sur la place du Gouvernement à Alger.
Vous retrouverez sa survivance mentale chez ce Français, en veston, qui prend son absinthe, en lisant un journal et en fumant une cigarette.
Cependant, il est républicain, très républicain, plus avancé que vous, plus avancé que qui que ce soit. Il est partisan du suffrage universel, mais à la condition que lui et ses (...) concitoyens accaparent tous les votes et que les indigènes n’aient que le droit d’obéir, de payer et de taire. Il est partisan de la liberté : mais il faut une main de fer pour tenir les Arabes.
Il est partisan de l’égalité : mais à la condition que les indigènes paient seuls l’impôt, soient soumis à des lois exceptionnelles et qu’il puisse les exproprier pour ses convenances personnelles. Il est partisan de la fraternité : mais à l’égard des indigènes, il n’y a qu’une seule politique, c’est « la politique à coups de trique. »
Maintenant, ne lui faites pas l’injure de mettre en doute son républicanisme ; il se fâcherait et il aurait raison. Il est tout aussi républicain que vous, plus républicain que vous, mais il l’est autrement.
De 1815 à 1870, les hommes de tous les partis, les orateurs du gouvernement et même de l’opposition paraphrasaient à La Tribune avec conviction la « Gesta Dei per Francos. » = La france était le peuple élu de Dieu ; De Dieu, elle tenait sa mission. Il eût fallu être bien difficile pour ne pas se contenter d’une explication aussi claire.
Mais depuis, Dieu a perdu son prestige. Ce petit mot n’est plus suffisant pour servir de bouche-trou au vide des affirmations.
Maintenant, on se borne à affirmer que la France remplit : « sa mission civilisatrice », en annonçant les Howas comme des lapins et en faisant servir de cibles les prisonniers Chinois.
Mais si Dieu n’est plus là pour vous donner votre « mission civilisatrice », de qui tenez-vous votre mandat ? Où est-il ?
Vous répondez que « cette mission incombe à tous les peuples d’une civilisation supérieure » et spécialement à la France qui a une civilisation supérieure à toutes les civilisations supérieures.
Mais quelle civilisation supérieure prétendez-vous importer ? Sous quelle forme se manifeste-t-elle auprès des autres peuples ?
Est-ce la douceur ou la férocité que vous allez leur enseigner ? Laquelle de ces deux qualités est l’apanage de la civilisation supérieure ? Si vous répondez que c’est la douceur, l’humanité, la solidarité humaine, tous vos actes démentent vos paroles. Si c’est la férocité, alors la plupart des peuples à l’égard desquels vous prétendez exercer votre mission civilisatrice, n’avaient pas besoin de vos leçons.
Est-ce le respect de la propriété ? Vous commencez par les dépouiller, vous ne savez que mettre à leur égard la fameuse définition du Proudhon : - la propriété, c’est le vol !
Est-ce la chasteté ? (…)
Est-ce la justice ? (…)
XXXIII - Un féodal -
- L’indigène est tenu à obéir à toutes les volontés du conquérant ; le conquérant n’est tenu à remplir aucun de ses engagements envers lui. Telle est la loi, fille légitime des arrangements qui, au moyen âge, réglaient en Europe les rapports du serf et du seigneur.
Vous croyez que le seigneur du XIIIème siècle a disparu, parce que vous ne voyez plus son donjon qu’en ruines, son heaume et son haubert que dans les musées ou chez les marchands de curiosité, ses armoiries que dans les livres illustrés.
Erreur ! Allez sur la place du Gouvernement à Alger.
Vous retrouverez sa survivance mentale chez ce Français, en veston, qui prend son absinthe, en lisant un journal et en fumant une cigarette.
Cependant, il est républicain, très républicain, plus avancé que vous, plus avancé que qui que ce soit. Il est partisan du suffrage universel, mais à la condition que lui et ses (...) concitoyens accaparent tous les votes et que les indigènes n’aient que le droit d’obéir, de payer et de taire. Il est partisan de la liberté : mais il faut une main de fer pour tenir les Arabes.
Il est partisan de l’égalité : mais à la condition que les indigènes paient seuls l’impôt, soient soumis à des lois exceptionnelles et qu’il puisse les exproprier pour ses convenances personnelles. Il est partisan de la fraternité : mais à l’égard des indigènes, il n’y a qu’une seule politique, c’est « la politique à coups de trique. »
Maintenant, ne lui faites pas l’injure de mettre en doute son républicanisme ; il se fâcherait et il aurait raison. Il est tout aussi républicain que vous, plus républicain que vous, mais il l’est autrement.
Lettre VIII - Les encouragements à l’émigration
En France, circulent, règnent deux opinions courantes, contradictoires, mais n’en forment qu’une : les français ne font pas assez d’enfants ; on ne sait que faire de ceux qui sont faits.
De là cette conclusion, donnée quotidiennement par des gens sérieux : la nécessité pour les parents de faire des enfants et pour le gouvernement de s’en débarrasser, une fois faits, en les expédiant dans des pays lointains, soit de gré ou de force.
(…)
Toutes nos colonies, sauf l’Algérie et la Nouvelle-Calédonie, situés dans le climat torride, sont des pompes aspirantes pour nos compatriotes. Elles absorbent toutes les vies qu’on leur livre ; elles ne rendent rien.
Des gens, le ventre à table, les pieds au feu, tranquillement à Paris, enflent la voix en parlant des colonies, écrivent, discutent, et se gardent bien de s’éloigner du rayon de l’Opéra, mais ils éprouvent une profonde indignation contre leurs compatriotes qui refusent d’aller y mourir.
Eh ! Mais, usez-en vous-mêmes ! Passez les premiers, messieurs !
Ils préfèrent ressasser leur formule : — Nécessité des colonies pour l’expansion de la race française.
Les faits leurs répondent : - le résultat de la politique coloniale française est une consommation de français.
Ce qui est grave, c’est que ces partisans de la politique coloniale, - envoient dans ces foyers d’infection, non seulement des dupes séduites par leurs belles promesses, mais nos marins, nos soldats qui ne sont pas libres d’accepter ou de refuser, ceux qui ayant eu la malchance de tomber sur les premiers numéros du tirage au sort, sont incorporés dans l’infanterie de marine.
Ils y partent vigoureux, ils en reviennent anémiques, souvent atteints pour toujours, incapables de rentrer utilement dans la vie civile, à charge à eux-mêmes, aux leurs, à tout le monde, réduits dans leur misère, à envier le sort de ceux dont ils ont laissé les cadavres derrière eux.
En nouvelle Calédonie, le français peut vivre ; mais la Nouvelle-Calédonie est un petit territoire qui, les Canaques non compris, ne pourra jamais absorber que quelques dizaines de milliers de colons.
Reste donc l’Algérie : 193 000 français depuis 34 ans, la plupart y vivant directement ou indirectement aux dépens du contribuable français : émigrants factices !
Prenez une balance : dans un plateau, les vies humaines absorbées par la conquête de l’Algérie ; dans l’autre plateau, les français produits par l’Algérie. Le premier tombera sous le fardeau ; le second restera presque vide.
Les partisans de la politique coloniale en chambre auront beau répéter avec leur suffisance habituelle : - nécessité des colonies pour l’expansion de la race française !
Leur politique n’a qu’un nom : - c’est la politique de croque-morts !
Le journal officiel devrait ouvrir une rubrique : offres et demande pour les suicides.
Chaque année compte de 5 à 6.000 suicides en France, une vingtaine par jour. En dehors de ceux qui ont accompli l’acte, il y a une foule d’individus qui pensent à se tuer, mais qui ayant l’appréhension de l’asphyxie, de la noyade, du coup de couteau ou du coup de pistolet, remettent toujours au lendemain ; gens passifs qui attendent la mort, mais n’ont pas le courage de la provoquer. Ce sont là des éléments sérieux pour le recrutement de l’émigration aux colonies.
L’administration des colonies est une concurrence de l’administration des pompes funèbres, avec cette supériorité : ce sont des vivants qu’elle enterre !
En France, circulent, règnent deux opinions courantes, contradictoires, mais n’en forment qu’une : les français ne font pas assez d’enfants ; on ne sait que faire de ceux qui sont faits.
De là cette conclusion, donnée quotidiennement par des gens sérieux : la nécessité pour les parents de faire des enfants et pour le gouvernement de s’en débarrasser, une fois faits, en les expédiant dans des pays lointains, soit de gré ou de force.
(…)
Toutes nos colonies, sauf l’Algérie et la Nouvelle-Calédonie, situés dans le climat torride, sont des pompes aspirantes pour nos compatriotes. Elles absorbent toutes les vies qu’on leur livre ; elles ne rendent rien.
Des gens, le ventre à table, les pieds au feu, tranquillement à Paris, enflent la voix en parlant des colonies, écrivent, discutent, et se gardent bien de s’éloigner du rayon de l’Opéra, mais ils éprouvent une profonde indignation contre leurs compatriotes qui refusent d’aller y mourir.
Eh ! Mais, usez-en vous-mêmes ! Passez les premiers, messieurs !
Ils préfèrent ressasser leur formule : — Nécessité des colonies pour l’expansion de la race française.
Les faits leurs répondent : - le résultat de la politique coloniale française est une consommation de français.
Ce qui est grave, c’est que ces partisans de la politique coloniale, - envoient dans ces foyers d’infection, non seulement des dupes séduites par leurs belles promesses, mais nos marins, nos soldats qui ne sont pas libres d’accepter ou de refuser, ceux qui ayant eu la malchance de tomber sur les premiers numéros du tirage au sort, sont incorporés dans l’infanterie de marine.
Ils y partent vigoureux, ils en reviennent anémiques, souvent atteints pour toujours, incapables de rentrer utilement dans la vie civile, à charge à eux-mêmes, aux leurs, à tout le monde, réduits dans leur misère, à envier le sort de ceux dont ils ont laissé les cadavres derrière eux.
En nouvelle Calédonie, le français peut vivre ; mais la Nouvelle-Calédonie est un petit territoire qui, les Canaques non compris, ne pourra jamais absorber que quelques dizaines de milliers de colons.
Reste donc l’Algérie : 193 000 français depuis 34 ans, la plupart y vivant directement ou indirectement aux dépens du contribuable français : émigrants factices !
Prenez une balance : dans un plateau, les vies humaines absorbées par la conquête de l’Algérie ; dans l’autre plateau, les français produits par l’Algérie. Le premier tombera sous le fardeau ; le second restera presque vide.
Les partisans de la politique coloniale en chambre auront beau répéter avec leur suffisance habituelle : - nécessité des colonies pour l’expansion de la race française !
Leur politique n’a qu’un nom : - c’est la politique de croque-morts !
Le journal officiel devrait ouvrir une rubrique : offres et demande pour les suicides.
Chaque année compte de 5 à 6.000 suicides en France, une vingtaine par jour. En dehors de ceux qui ont accompli l’acte, il y a une foule d’individus qui pensent à se tuer, mais qui ayant l’appréhension de l’asphyxie, de la noyade, du coup de couteau ou du coup de pistolet, remettent toujours au lendemain ; gens passifs qui attendent la mort, mais n’ont pas le courage de la provoquer. Ce sont là des éléments sérieux pour le recrutement de l’émigration aux colonies.
L’administration des colonies est une concurrence de l’administration des pompes funèbres, avec cette supériorité : ce sont des vivants qu’elle enterre !
Lettre XI - Le système pneumatique
Il y a donc des français qui émigrent, mais les partisans de la politique coloniale trouvent qu’ils ne sont pas en assez grand nombre.
Divers moyens peuvent être employés pour provoquer l’émigration : les persécutions religieuses ont toujours eu beaucoup de succès. Exemples : la Révocation de l’Edit de Nantes (…)
Les persécutions politiques réussissent aussi. La loi contre les émigrés provoqua l’émigration, au lieu de les arrêter. Après la Commune, il y eut un mouvement d’émigration d’ouvriers français.
La misère n’est pas toujours un mobile suffisant. Si mal qu’on se trouve dans un pays, il faut avoir conservé assez d’énergie pour essayer d’aller chercher le mieux ailleurs, et pour s’arracher à tous ces liens qui attachent l’homme au milieu dans lequel il est né, a été élevé et a vécu.
(…)
Quels sont donc les motifs qui font considérer les partisans de la politique coloniale l’émigration comme un bien ?
Est-ce parce que le pays est trop peuplé ?
(…)
Avant de songer à fonder des colonies de peuplement, il faudrait donc d’abord peupler la France.
(…)
La loi d’Achille Guillard n’est donc pas exacte. Il ne suffit pas de dépeupler un pays pour augmenter sa population, en rendant un plus grand stock de subsistances disponibles. C’est appliquer à la sociologie, la vieille théorie des médecins de Molière, la nécessité de la fréquente saignée. Elle n’aboutit qu’à l’anémie et à l’épuisement.
(...)
La natalité de la France est de 80% en dessous de celle de la Prusse. Il y a cependant plus de subsistances disponibles en France qu’en Prusse.
Lettre XII - L’onglée et la fièvre
Edmond About, dans un discours qu’il a prononcé en décembre 1884, comme président de la société de colonisation, plaignait les pauvres gens qui, dans nos climats humides et froids, ont l’onglée, pas de feu, pas de gite, et souhaitait les envoyer dans les pays chauds où il entrevoyait pour eux la vie d’Adam avant la pomme dans le paradis terrestre.
(…)
Si Edmond About avait lu les comptes rendues du congrès des médecins des colonies à Amsterdam, il aurait vu qu'entre ses rêves philanthropiques et la réalité, il y avait de la distance (...)
Mais (...) Mieux vaut avoir l’onglée à Paris que la fièvre et la dysenterie sous le soleil du Sénégal ou de la Guyane.
Lettre XIII - L’argument du sybaritisme et de la lâcheté
Je reçois plusieurs lettres indignées qui peuvent se résumer ainsi :
« La thèse que vous soutenez, c’est la politique de la lâcheté. Ce qui nous perd en France, c’est le bien-être matériel, l’abus des jouissance. On y est trop riche, trop heureux. Nous en sommes arrivés à inspirer de la jalousie à tous les autres peuples. Si nous nous abolissons dans le repos, si nous ne faisons pas d’efforts énergiques, nous sommes condamnés à la destruction, à la désagrégation, à la décomposition, à la pourriture. Voulez-vous donc faire de nous une nation de sybarites ?
Le sybaritisme est relatif ; et jusqu’à présent, si des particuliers ont pu en abuser, on ne peut dire qu’il ait gâté la masse du genre humain, dont les 3.4 manquent de ce qu’un petit bourgeois français considère comme le strict nécessaire.
(…)
Vous considérez les aventures coloniales comme nécessaires pour entretenir l’esprit héroïque chez les français ; mais tous les médecins vous diront que l’héroïsme n’a jamais résisté à la dysenterie, et dans nos aventures coloniales, c’est notre gain le plus sûr, quoique, modestement, il ne figure pas sur le programme.
Jacques Bonhomme (M. Tout le monde) a montré, plus que tout autre peut-être, qu’il pouvait porter l’héroïsme militaire au plus haut point. Il n’a pas besoin de colonies pour faire cette démonstration : les champs de bataille de l’Europe suffisent.
Il a prouvé que cet héroïsme lui était aussi facile que l’intrépidité à un bouledogue. Ce qui lui a manqué et ce qui lui manque encore : c’est l’héroïsme civil. Ce n’est pas la politique coloniale qui lui donnera cette vertu.
Il y a donc des français qui émigrent, mais les partisans de la politique coloniale trouvent qu’ils ne sont pas en assez grand nombre.
Divers moyens peuvent être employés pour provoquer l’émigration : les persécutions religieuses ont toujours eu beaucoup de succès. Exemples : la Révocation de l’Edit de Nantes (…)
Les persécutions politiques réussissent aussi. La loi contre les émigrés provoqua l’émigration, au lieu de les arrêter. Après la Commune, il y eut un mouvement d’émigration d’ouvriers français.
La misère n’est pas toujours un mobile suffisant. Si mal qu’on se trouve dans un pays, il faut avoir conservé assez d’énergie pour essayer d’aller chercher le mieux ailleurs, et pour s’arracher à tous ces liens qui attachent l’homme au milieu dans lequel il est né, a été élevé et a vécu.
(…)
Quels sont donc les motifs qui font considérer les partisans de la politique coloniale l’émigration comme un bien ?
Est-ce parce que le pays est trop peuplé ?
(…)
Avant de songer à fonder des colonies de peuplement, il faudrait donc d’abord peupler la France.
(…)
La loi d’Achille Guillard n’est donc pas exacte. Il ne suffit pas de dépeupler un pays pour augmenter sa population, en rendant un plus grand stock de subsistances disponibles. C’est appliquer à la sociologie, la vieille théorie des médecins de Molière, la nécessité de la fréquente saignée. Elle n’aboutit qu’à l’anémie et à l’épuisement.
(...)
La natalité de la France est de 80% en dessous de celle de la Prusse. Il y a cependant plus de subsistances disponibles en France qu’en Prusse.
Lettre XII - L’onglée et la fièvre
Edmond About, dans un discours qu’il a prononcé en décembre 1884, comme président de la société de colonisation, plaignait les pauvres gens qui, dans nos climats humides et froids, ont l’onglée, pas de feu, pas de gite, et souhaitait les envoyer dans les pays chauds où il entrevoyait pour eux la vie d’Adam avant la pomme dans le paradis terrestre.
(…)
Si Edmond About avait lu les comptes rendues du congrès des médecins des colonies à Amsterdam, il aurait vu qu'entre ses rêves philanthropiques et la réalité, il y avait de la distance (...)
Mais (...) Mieux vaut avoir l’onglée à Paris que la fièvre et la dysenterie sous le soleil du Sénégal ou de la Guyane.
Lettre XIII - L’argument du sybaritisme et de la lâcheté
Je reçois plusieurs lettres indignées qui peuvent se résumer ainsi :
« La thèse que vous soutenez, c’est la politique de la lâcheté. Ce qui nous perd en France, c’est le bien-être matériel, l’abus des jouissance. On y est trop riche, trop heureux. Nous en sommes arrivés à inspirer de la jalousie à tous les autres peuples. Si nous nous abolissons dans le repos, si nous ne faisons pas d’efforts énergiques, nous sommes condamnés à la destruction, à la désagrégation, à la décomposition, à la pourriture. Voulez-vous donc faire de nous une nation de sybarites ?
Le sybaritisme est relatif ; et jusqu’à présent, si des particuliers ont pu en abuser, on ne peut dire qu’il ait gâté la masse du genre humain, dont les 3.4 manquent de ce qu’un petit bourgeois français considère comme le strict nécessaire.
(…)
Vous considérez les aventures coloniales comme nécessaires pour entretenir l’esprit héroïque chez les français ; mais tous les médecins vous diront que l’héroïsme n’a jamais résisté à la dysenterie, et dans nos aventures coloniales, c’est notre gain le plus sûr, quoique, modestement, il ne figure pas sur le programme.
Jacques Bonhomme (M. Tout le monde) a montré, plus que tout autre peut-être, qu’il pouvait porter l’héroïsme militaire au plus haut point. Il n’a pas besoin de colonies pour faire cette démonstration : les champs de bataille de l’Europe suffisent.
Il a prouvé que cet héroïsme lui était aussi facile que l’intrépidité à un bouledogue. Ce qui lui a manqué et ce qui lui manque encore : c’est l’héroïsme civil. Ce n’est pas la politique coloniale qui lui donnera cette vertu.
Juste cette après-midi-là, je travaillais, heureusement pour moi, dans une galerie latérale qui monte presque comme une échelle.
Tout d'un coup, je me sens renversé, roulé, emporté, heurté contre les parois de la galerie, comme par un tourbillon.
J'essaye de m'accrocher... il me semblait que je tombais au fond du grand puits... Non, que je me disais pourtant, et, au moment où je me disais cela, je vois passer devant moi une langue de feu, et puis toute la galerie devient feu, et c'est dans du feu que je tourbillonne maintenant… Est-ce que je serais tombé jusqu'en enfer, que je me dis, après être tombé dans le puits ? Puis j'entends un bruit un vacarme, un écroulement comme des myriades de coups de canon, de coups de tonnerre, et quelque chose encore de plus fort... On eût dit que la terre s'ouvrait...
Je continuais à rouler au milieu du feu, de la fumée qui m'aveuglait et m'asphyxiait.
J'entrevoyais les galeries qui se crevassaient, les pierres qui tombaient, qui se brisaient... Je me remis un peu ; Je vis bien ce que c'était ! Je dis : Je suis bien heureux d'en être quitte, mais ce sera pour plus tard ; et je pensais à ma femme et à mes trois petits enfants.
J'entends toujours les explosions du grisou, les éboulements, puis le clapotement de l’eau.
« Allons, me dis-je, les digues sont brisées ; je ne suis pas brûlé mais je serai noyé. » Comme j’essayais de reconnaître où j’étais après un pareil étourdissement, nos lampes étaient brisées et éteintes, cela va sans dire, je sens une jambe qui remue.
- Qui est là ? Dis-je.
- C’est moi, François Pichot.
- et moi, Jacques Brunehaut.
- Viens donc, l’eau arrive.
- Je ne peux pas, je n’ai plus de jambes ; il me semble que je suis scié en deux.
Je veux le toucher ; mais alors je m’aperçois que mes mains me brûlent comme du feu et aussi ma figure.
Allons, me dis-je, je dois être un joli garçon. Je m’enveloppe une main avec mon mouchoir. Je veux le prendre.
- Hola ! Là ! La ! Crie-t-il, non, laisse-moi.
Mais l’eau monte… Entends-tu son clapotement ?
Je suis sûr qu’elle est tout près.
- J’aime mieux mourir. Sauve-toi, laisse-moi.
Mais non, je ne laisserai pas comme ça un camarade.
Je me penche, je veux le tâter !… Je sens une poutre qui pesait sur lui en travers… C’était elle qui le coupait comme ça… je la soulève ! Mes mains me faisaient si grand mal que mes dents se serraient à se briser. Patatras, voilà un éboulée,nt ! Et la poutre retombe plus lourdement sur lui.
Et François Pichot qui crie :
- Laisse-moi ! Laisse-moi ! Oh ! Mon dieu !… Mon Dieu !… tue-moi ! … Tue-moi !… Mes reins, mes jambes, je suis scié ! Aoh !
Et il râlait.
L’eau montait. J’en avais jusqu’à mi-jambe ! Je ne pouvais plus rien pour lui, je tâchais de m’orienter et de m’éloigner… Au milieu des éboulements, des détonations du grisou et de l’air comprimé par l’eau, j’entendais encore sa voix qui criait.
Le frisson me passait à travers le corps ; et je me disais : « Tu vas peut-être bientôt en dire autant, et je voyais comme dans un rêve ma femme et mes trois petits enfants qui m’attendaient. Je heurte un autre homme ; celui-là ne remuait plus. Je le secoue, il ne dit rien. Je le prends par un bras et je le traine en le heurtant aux poutres, aux pierres, à l’angle des galeries… De temps en temps je roulais sur lui ; et il me semblait qu’il m’éteignait comme pour m’emporter avec lui dans la mort… Allons ! Je tombe une dernière fois.
- Hola ! Là ! Crie une voix.
- Qui est là ? C’est moi ! Pierre Pichot.
- Qu’as-tu, toi ?
- Moi, oh ! Je n’en sais rien ! J’ai une jambe qui plie sous moi et mon frère François ?
- As-tu vu mon frère ? Me dit-il.
- Viens toujours, allons, viens !
- Qui est-ce qui râle donc si fort ?
Je ne lui dis pas que c’était son frère.
Je lâche mon mort ou celui qui en faisait mine, et je prends Pierre Pichot dans mes bras. Il était lourd sans que ça parût… Et l’eau montait !… C’est qu’il fallait se presser… Puis je m’y reconnaissais plus. Aux angles des galeries, les cheveux m’en dressaient sur la tête ! Si j’allais me tromper !… heureusement que je connais bien la mine et que du premier coup je m’étais dit :
"Il faut tâcher d’aller au fond de la galerie Sainte-marie."
Je portais toujours le paquet… Glouglou ! Faisait l’eau. Et puis, il y avait des éboulements, des explosions… l’eau arrivait vite.. j’en avais déjà jusqu’à mi-jambe, de temps en temps je glissais sur quelque chose de mou.
Allons ! Que je me disais ! Voilà un camarade qui a son affaire finie…
Je tombais, je me relevais, je tombais encore, je me revenais, et chaque fois que je tombais, je pensais à ma femme et mes trois petits enfants. Me vois arrivé…. Bon ! Il y a un éboulement ! Ah ! Dame ! Là, je crus que c’était fini. Je n’avais plus la force de porter le camarade. Je tâte… Je tâte… L’eau montait… Je la sentais au ventre… Elle montait vite… Pas une minute à perdre, ou c’était fini… A force de tâter, je trouve un trou.
Allons ! Dis-je ! Faut espérer.
Je m’écorche la tête. Je sens des clous qui me raclent comme une herse, je m’enfonce, je pousse toujours ; j’étouffais, j’étais serré comme dans un étau et l’étau semblait se serrer toujours plus fort… Je pousse toujours, j’y laisse de ma peau, mes vêtements accrochés, ça ne fait rien… Quand je me sens dégagé, je dis :
Il faut sauver le camarade.
Il criait de l’autre côté :
- L’eau monte ! L’eau monte !… Je vais me noyer…
- Ne m’abandonne pas ! Oh ! Je t’en prie ! Emporte-moi.
- Oui ! Oui ! Sois tranquille.
Puis je me rengage, par la tête cette fois, dans le trou ; je sens les clous, les éclisses de bois… Est-ce que je sais, moi ! Et mes mains qui me causaient ! Celles là, par exemple, je ne les sentais plus. Je croyais avoir à la place deux charbons en feu. Je le tire par le bras, je tâche de le guider… C’est qu’il y avait sa mauvaise jambe… il n’était point commode… Je tire dessus, mais c’est bien une autre chanson maintenant !
"- Non ! Non ! Laisse-moi mourir !.. J’aime mieux mourir ! Holà ! Là ! Mais tu veux donc m’assassiner !"
Et j’étais obligé de tirer de toutes mes forces. A un moment il me semble que ma main droite s’est arrachée de mon poignet. Je sens comme un fer chaud me traverser… J’en grince des dents à les casser et je pousse un cri si lugubre qu’il me fait peur… C’était lui qui m’avait mordu pour se débarrasser de moi.
"- Ah ! Tu ne veux pas te sauver !" Que je lui dis. (…)
Il me sembla que le gouffre m’attirait, que tous les fantômes que je voyais se jetaient sur moi et pesaient sur mes épaules, et courbaient ma tête et saisissaient mes membres. Je fis un effort désespéré. Il s’accrocha à mon genou, puis à ma ceinture.
Mais ce qu’il y avait de plus terrible, c’est que nous n’étions pas seuls. Nous voyions partout des esprits. Vous savez, il y en a dans la mine, et qui sont jaloux. Dans le noir qui nous entourait, il nous semblait que les formes noires de spectres, des têtes de morts, des démons bien plus terribles que ceux qu’on voit dans les églises nous entouraient, s’asseyaient entre nous, nous pressaient entre leurs bras monstrueux et nous entraînaient. (…)
A un moment, une voix cria :
J’ai faim ! Je veux te manger.
Je me sentis alors saisi par un homme qui me mordait à l’épaule. Je me débattis, mais il me tenait avec une énergie telle que je ne pouvais pas me débarrasser de lui. Il enfonçait toujours ses dents dans ma chair. Mes mains n’avaient plus de force… Je crus mon dernier moment arrivé. Il y eut une mêlée, je roulais par terre avec lui… Je me sentis dégagé tout à coup ; je ne sais pas comment… je crois qu’il était mort.
De temps, en temps, il y en avait un qui disait d’une voix sourde :
Il faut nous en aller.
Où ?
Où ? Répondait-on avec le délire de la fièvre. Et alors on entendait des soupirs, des gémissements, des grincements de dents, des cris inarticulés. On sentait des corps se mouvoir et tout retombait dans l’immobilité et dans le silence.
Tout d'un coup, je me sens renversé, roulé, emporté, heurté contre les parois de la galerie, comme par un tourbillon.
J'essaye de m'accrocher... il me semblait que je tombais au fond du grand puits... Non, que je me disais pourtant, et, au moment où je me disais cela, je vois passer devant moi une langue de feu, et puis toute la galerie devient feu, et c'est dans du feu que je tourbillonne maintenant… Est-ce que je serais tombé jusqu'en enfer, que je me dis, après être tombé dans le puits ? Puis j'entends un bruit un vacarme, un écroulement comme des myriades de coups de canon, de coups de tonnerre, et quelque chose encore de plus fort... On eût dit que la terre s'ouvrait...
Je continuais à rouler au milieu du feu, de la fumée qui m'aveuglait et m'asphyxiait.
J'entrevoyais les galeries qui se crevassaient, les pierres qui tombaient, qui se brisaient... Je me remis un peu ; Je vis bien ce que c'était ! Je dis : Je suis bien heureux d'en être quitte, mais ce sera pour plus tard ; et je pensais à ma femme et à mes trois petits enfants.
J'entends toujours les explosions du grisou, les éboulements, puis le clapotement de l’eau.
« Allons, me dis-je, les digues sont brisées ; je ne suis pas brûlé mais je serai noyé. » Comme j’essayais de reconnaître où j’étais après un pareil étourdissement, nos lampes étaient brisées et éteintes, cela va sans dire, je sens une jambe qui remue.
- Qui est là ? Dis-je.
- C’est moi, François Pichot.
- et moi, Jacques Brunehaut.
- Viens donc, l’eau arrive.
- Je ne peux pas, je n’ai plus de jambes ; il me semble que je suis scié en deux.
Je veux le toucher ; mais alors je m’aperçois que mes mains me brûlent comme du feu et aussi ma figure.
Allons, me dis-je, je dois être un joli garçon. Je m’enveloppe une main avec mon mouchoir. Je veux le prendre.
- Hola ! Là ! La ! Crie-t-il, non, laisse-moi.
Mais l’eau monte… Entends-tu son clapotement ?
Je suis sûr qu’elle est tout près.
- J’aime mieux mourir. Sauve-toi, laisse-moi.
Mais non, je ne laisserai pas comme ça un camarade.
Je me penche, je veux le tâter !… Je sens une poutre qui pesait sur lui en travers… C’était elle qui le coupait comme ça… je la soulève ! Mes mains me faisaient si grand mal que mes dents se serraient à se briser. Patatras, voilà un éboulée,nt ! Et la poutre retombe plus lourdement sur lui.
Et François Pichot qui crie :
- Laisse-moi ! Laisse-moi ! Oh ! Mon dieu !… Mon Dieu !… tue-moi ! … Tue-moi !… Mes reins, mes jambes, je suis scié ! Aoh !
Et il râlait.
L’eau montait. J’en avais jusqu’à mi-jambe ! Je ne pouvais plus rien pour lui, je tâchais de m’orienter et de m’éloigner… Au milieu des éboulements, des détonations du grisou et de l’air comprimé par l’eau, j’entendais encore sa voix qui criait.
Le frisson me passait à travers le corps ; et je me disais : « Tu vas peut-être bientôt en dire autant, et je voyais comme dans un rêve ma femme et mes trois petits enfants qui m’attendaient. Je heurte un autre homme ; celui-là ne remuait plus. Je le secoue, il ne dit rien. Je le prends par un bras et je le traine en le heurtant aux poutres, aux pierres, à l’angle des galeries… De temps en temps je roulais sur lui ; et il me semblait qu’il m’éteignait comme pour m’emporter avec lui dans la mort… Allons ! Je tombe une dernière fois.
- Hola ! Là ! Crie une voix.
- Qui est là ? C’est moi ! Pierre Pichot.
- Qu’as-tu, toi ?
- Moi, oh ! Je n’en sais rien ! J’ai une jambe qui plie sous moi et mon frère François ?
- As-tu vu mon frère ? Me dit-il.
- Viens toujours, allons, viens !
- Qui est-ce qui râle donc si fort ?
Je ne lui dis pas que c’était son frère.
Je lâche mon mort ou celui qui en faisait mine, et je prends Pierre Pichot dans mes bras. Il était lourd sans que ça parût… Et l’eau montait !… C’est qu’il fallait se presser… Puis je m’y reconnaissais plus. Aux angles des galeries, les cheveux m’en dressaient sur la tête ! Si j’allais me tromper !… heureusement que je connais bien la mine et que du premier coup je m’étais dit :
"Il faut tâcher d’aller au fond de la galerie Sainte-marie."
Je portais toujours le paquet… Glouglou ! Faisait l’eau. Et puis, il y avait des éboulements, des explosions… l’eau arrivait vite.. j’en avais déjà jusqu’à mi-jambe, de temps en temps je glissais sur quelque chose de mou.
Allons ! Que je me disais ! Voilà un camarade qui a son affaire finie…
Je tombais, je me relevais, je tombais encore, je me revenais, et chaque fois que je tombais, je pensais à ma femme et mes trois petits enfants. Me vois arrivé…. Bon ! Il y a un éboulement ! Ah ! Dame ! Là, je crus que c’était fini. Je n’avais plus la force de porter le camarade. Je tâte… Je tâte… L’eau montait… Je la sentais au ventre… Elle montait vite… Pas une minute à perdre, ou c’était fini… A force de tâter, je trouve un trou.
Allons ! Dis-je ! Faut espérer.
Je m’écorche la tête. Je sens des clous qui me raclent comme une herse, je m’enfonce, je pousse toujours ; j’étouffais, j’étais serré comme dans un étau et l’étau semblait se serrer toujours plus fort… Je pousse toujours, j’y laisse de ma peau, mes vêtements accrochés, ça ne fait rien… Quand je me sens dégagé, je dis :
Il faut sauver le camarade.
Il criait de l’autre côté :
- L’eau monte ! L’eau monte !… Je vais me noyer…
- Ne m’abandonne pas ! Oh ! Je t’en prie ! Emporte-moi.
- Oui ! Oui ! Sois tranquille.
Puis je me rengage, par la tête cette fois, dans le trou ; je sens les clous, les éclisses de bois… Est-ce que je sais, moi ! Et mes mains qui me causaient ! Celles là, par exemple, je ne les sentais plus. Je croyais avoir à la place deux charbons en feu. Je le tire par le bras, je tâche de le guider… C’est qu’il y avait sa mauvaise jambe… il n’était point commode… Je tire dessus, mais c’est bien une autre chanson maintenant !
"- Non ! Non ! Laisse-moi mourir !.. J’aime mieux mourir ! Holà ! Là ! Mais tu veux donc m’assassiner !"
Et j’étais obligé de tirer de toutes mes forces. A un moment il me semble que ma main droite s’est arrachée de mon poignet. Je sens comme un fer chaud me traverser… J’en grince des dents à les casser et je pousse un cri si lugubre qu’il me fait peur… C’était lui qui m’avait mordu pour se débarrasser de moi.
"- Ah ! Tu ne veux pas te sauver !" Que je lui dis. (…)
Il me sembla que le gouffre m’attirait, que tous les fantômes que je voyais se jetaient sur moi et pesaient sur mes épaules, et courbaient ma tête et saisissaient mes membres. Je fis un effort désespéré. Il s’accrocha à mon genou, puis à ma ceinture.
Mais ce qu’il y avait de plus terrible, c’est que nous n’étions pas seuls. Nous voyions partout des esprits. Vous savez, il y en a dans la mine, et qui sont jaloux. Dans le noir qui nous entourait, il nous semblait que les formes noires de spectres, des têtes de morts, des démons bien plus terribles que ceux qu’on voit dans les églises nous entouraient, s’asseyaient entre nous, nous pressaient entre leurs bras monstrueux et nous entraînaient. (…)
A un moment, une voix cria :
J’ai faim ! Je veux te manger.
Je me sentis alors saisi par un homme qui me mordait à l’épaule. Je me débattis, mais il me tenait avec une énergie telle que je ne pouvais pas me débarrasser de lui. Il enfonçait toujours ses dents dans ma chair. Mes mains n’avaient plus de force… Je crus mon dernier moment arrivé. Il y eut une mêlée, je roulais par terre avec lui… Je me sentis dégagé tout à coup ; je ne sais pas comment… je crois qu’il était mort.
De temps, en temps, il y en avait un qui disait d’une voix sourde :
Il faut nous en aller.
Où ?
Où ? Répondait-on avec le délire de la fièvre. Et alors on entendait des soupirs, des gémissements, des grincements de dents, des cris inarticulés. On sentait des corps se mouvoir et tout retombait dans l’immobilité et dans le silence.
C'était Fanny qui pleurait. Ses sanglots redoublèrent.
— Mon père !… Mes frères !…
— Ton père, tes frères ! Rien ne prouve qu'il leur soit arrivé malheur ? Allons, va dans tu chambre et reviens vite. Fanny sortit accompagnée de (…)
— Voilà les préjugés de convention, dit M. Macreux, en allumant un cigare et en haussant les épaules. Je croyais pourtant les avoir fait détruire en elle jusqu’au dernier. Pas du tout. On parle d'un accident de mine, et parce que son père est mineur, elle pleure ! Et ce père, elle ne l'a pas vu depuis dix ans, elle n'en a jamais entendu parler. Il ne compte pour rien dans sa vie. C’est moi qui suis tout pour elle ; et elle pleure ! C'est idiot ! insista M. Onésime Macreux, pour bien s'affirmer à lui-même la réalité de ce fait, vraiment incroyable.
- Ah ! C'est la fille d'un mineur on ne le dirait pas… Dit M. Alcide Foureton avec l'indiscrétion d'un reporter.
- On ne le dirait pas ?
- Non, reprit M. Alcide Foureton, riant de sa propre naïveté... mais elle est très distinguée.
- Oh ! dit M. Onésime Macreux, avec celte large indiscrétion que lui donnait son tempérament et sous laquelle il cachait ses combinaisons les plus profondes. Le secret est bien simple. La mère était une très jolie femme, bien desséchée maintenant par la misère, mariée à un nommé Jérôme Pichot, brave homme, mais brute. Fanny a cinq ou six ans ressemblait à sa mère, était frêle, toute mignonne sous ses haillons, avait de beaux yeux bleus, un petit air futé. Je dis : Tiens ! tiens ! Ça pourrait peut-être réussir. Je préviens la maman que je trouve sa petite gentille et que je me charge de son éducation, que je veux l'élever comme une demoiselle On me remercie comme si j'étais le bon Dieu. Est-ce que je ne viens pas de faire un miracle ! Le papa approuve. Et puis voilà papa et maman qui se rengorgent, qui font les fiers, les crânes… Ah ! Ah ! La petite est élevée comme une demoiselle. Ça va bien. La petite pousse sous mon oeil paresseuse et mignonne comme une chatte, montrant les meilleures dispositions à apprendre l’art de plaire, du reste jolie ; elle embellit et se perfectionne… Papa, maman, demeurent dans leurs huttes comme des rats dans leurs trous. Personne ne s’en occupe plus. Ils font bien quelques simagrées, pleurent, réclament, mais je m’en moque. J’ai soin qu’ils ne sachent pas où est la petite fille, et la petite fille ne se souvient plus de son ancienne vie que comme d’un mauvais rêve. De temps en temps, je vais voir ma petite plante pousser dans la serre chaude où je l’ai fait soigneusement élever. Elle grandit, elle s’épanouit, elle est en bouton, et au moment où le bouton va devenir fleur, je le cueille. Oh ! Du reste, j’y mets des formes. Longtemps à l’avance, je l’y fais préparer par une honorables institutrice, et j’attends ce moment favorable pour la transporter ici, où, depuis six mois, elle fleurit sans avoir d’autre souci que de m’être agréable. Et encore, je suis trop occupé pour qu’elle ait besoin de le prendre tous les jours, ajouta-t-il avec un large rire cynique ; et ça parle de son père avant même qu’il soit question de sa mort !
et le père ? Reprit M. De la Portebatte.
Le père, je ne l’ai même pas renvoyé ; il a fait une demi-douzaine d’enfants ; c’est une bonne brute, travaillant dur, mais buvant…
Ah ! L’ivrognerie ! L’ivrognerie ! Voilà ce qui perd les ouvriers, constata M. Myopron, économiste officiel, en avalant un verre de porto.
Vous avez bien raison… tout ça grouille dans la misère… Une ou deux fois j’ai voulu, par pitié, leur voir en aide. Ça a fait les fiers, je vous demande un peu. Ce Jérôme Pichot ne s’est-il pas avisé deux ou trois fois de vouloir savoir où elle était ?… Ah ! Ah ! Je lui ai montré la porte, et je lui ai dit : Comment, triple niais, tu te plains d’avoir une bouche de moins à nourrir et qu’une de tes filles soit élevée dans du coton.
— Mon père !… Mes frères !…
— Ton père, tes frères ! Rien ne prouve qu'il leur soit arrivé malheur ? Allons, va dans tu chambre et reviens vite. Fanny sortit accompagnée de (…)
— Voilà les préjugés de convention, dit M. Macreux, en allumant un cigare et en haussant les épaules. Je croyais pourtant les avoir fait détruire en elle jusqu’au dernier. Pas du tout. On parle d'un accident de mine, et parce que son père est mineur, elle pleure ! Et ce père, elle ne l'a pas vu depuis dix ans, elle n'en a jamais entendu parler. Il ne compte pour rien dans sa vie. C’est moi qui suis tout pour elle ; et elle pleure ! C'est idiot ! insista M. Onésime Macreux, pour bien s'affirmer à lui-même la réalité de ce fait, vraiment incroyable.
- Ah ! C'est la fille d'un mineur on ne le dirait pas… Dit M. Alcide Foureton avec l'indiscrétion d'un reporter.
- On ne le dirait pas ?
- Non, reprit M. Alcide Foureton, riant de sa propre naïveté... mais elle est très distinguée.
- Oh ! dit M. Onésime Macreux, avec celte large indiscrétion que lui donnait son tempérament et sous laquelle il cachait ses combinaisons les plus profondes. Le secret est bien simple. La mère était une très jolie femme, bien desséchée maintenant par la misère, mariée à un nommé Jérôme Pichot, brave homme, mais brute. Fanny a cinq ou six ans ressemblait à sa mère, était frêle, toute mignonne sous ses haillons, avait de beaux yeux bleus, un petit air futé. Je dis : Tiens ! tiens ! Ça pourrait peut-être réussir. Je préviens la maman que je trouve sa petite gentille et que je me charge de son éducation, que je veux l'élever comme une demoiselle On me remercie comme si j'étais le bon Dieu. Est-ce que je ne viens pas de faire un miracle ! Le papa approuve. Et puis voilà papa et maman qui se rengorgent, qui font les fiers, les crânes… Ah ! Ah ! La petite est élevée comme une demoiselle. Ça va bien. La petite pousse sous mon oeil paresseuse et mignonne comme une chatte, montrant les meilleures dispositions à apprendre l’art de plaire, du reste jolie ; elle embellit et se perfectionne… Papa, maman, demeurent dans leurs huttes comme des rats dans leurs trous. Personne ne s’en occupe plus. Ils font bien quelques simagrées, pleurent, réclament, mais je m’en moque. J’ai soin qu’ils ne sachent pas où est la petite fille, et la petite fille ne se souvient plus de son ancienne vie que comme d’un mauvais rêve. De temps en temps, je vais voir ma petite plante pousser dans la serre chaude où je l’ai fait soigneusement élever. Elle grandit, elle s’épanouit, elle est en bouton, et au moment où le bouton va devenir fleur, je le cueille. Oh ! Du reste, j’y mets des formes. Longtemps à l’avance, je l’y fais préparer par une honorables institutrice, et j’attends ce moment favorable pour la transporter ici, où, depuis six mois, elle fleurit sans avoir d’autre souci que de m’être agréable. Et encore, je suis trop occupé pour qu’elle ait besoin de le prendre tous les jours, ajouta-t-il avec un large rire cynique ; et ça parle de son père avant même qu’il soit question de sa mort !
et le père ? Reprit M. De la Portebatte.
Le père, je ne l’ai même pas renvoyé ; il a fait une demi-douzaine d’enfants ; c’est une bonne brute, travaillant dur, mais buvant…
Ah ! L’ivrognerie ! L’ivrognerie ! Voilà ce qui perd les ouvriers, constata M. Myopron, économiste officiel, en avalant un verre de porto.
Vous avez bien raison… tout ça grouille dans la misère… Une ou deux fois j’ai voulu, par pitié, leur voir en aide. Ça a fait les fiers, je vous demande un peu. Ce Jérôme Pichot ne s’est-il pas avisé deux ou trois fois de vouloir savoir où elle était ?… Ah ! Ah ! Je lui ai montré la porte, et je lui ai dit : Comment, triple niais, tu te plains d’avoir une bouche de moins à nourrir et qu’une de tes filles soit élevée dans du coton.
Lettre LXXV - La politique intensive et la politique extensive
(Comparant l’agriculture et la politique coloniale)
De même, il y a deux politiques : - la politique extensive ou « politique coloniale » ; elle laisse en friche les terrains à cultiver en France ; elle va faire des ports, des canaux, des chemins de fer sur tous les points du monde, tandis qu’elle n’a pas d’argent pour outiller nos ports, uniformiser nos canaux, achever nos chemins de fer ; elle veut nous créer des débouchés chez des gens qui n’ont pas d’argent ou n’ont pas de besoin de nos marchandises ; elle ferme les nôtres par des tarifs de transport trop élevés et elle a eu soin de nous isoler par des tarifs de douanes qui, en fermant nos portes, empêchent forcément aussi bien la sortie que l’entrée ; elle est très préoccupée de civiliser les Cochinchinois ; mais elle manque d’argent pour payer les instituteurs ; elle commence tout sans rien achever ; elle est affairée et ahurie ; elle masque toutes ses fautes derrière le patriotisme. Pour elle, le drapeau de la France n’est qu’un cache-pot !
Il y a, au contraire, une politique préoccupée de faire de la France la nation la mieux outillée du monde ; de répartir les impôts qui nous écrasent proportionnellement aux ressources de chacun, tandis qu’actuellement ils sont progressifs à rebours. Elle pense que le rayon d’expansion du commerce extérieur est en raison de l’intensité de la production intérieure. Elle sait, par expérience, que les guerres commerciales ont toujours tourné contre le but de ceux qui les avaient entreprises. Elle pense que notre civilisation présente encore trop de lacunes pour que nous ayons le droit de forcer des gens à s’y plier, sous la menace de nos obus. (…) Au lieu de faire la police du Tonkin, elle désire établir une bonne police à Paris.
(Comparant l’agriculture et la politique coloniale)
De même, il y a deux politiques : - la politique extensive ou « politique coloniale » ; elle laisse en friche les terrains à cultiver en France ; elle va faire des ports, des canaux, des chemins de fer sur tous les points du monde, tandis qu’elle n’a pas d’argent pour outiller nos ports, uniformiser nos canaux, achever nos chemins de fer ; elle veut nous créer des débouchés chez des gens qui n’ont pas d’argent ou n’ont pas de besoin de nos marchandises ; elle ferme les nôtres par des tarifs de transport trop élevés et elle a eu soin de nous isoler par des tarifs de douanes qui, en fermant nos portes, empêchent forcément aussi bien la sortie que l’entrée ; elle est très préoccupée de civiliser les Cochinchinois ; mais elle manque d’argent pour payer les instituteurs ; elle commence tout sans rien achever ; elle est affairée et ahurie ; elle masque toutes ses fautes derrière le patriotisme. Pour elle, le drapeau de la France n’est qu’un cache-pot !
Il y a, au contraire, une politique préoccupée de faire de la France la nation la mieux outillée du monde ; de répartir les impôts qui nous écrasent proportionnellement aux ressources de chacun, tandis qu’actuellement ils sont progressifs à rebours. Elle pense que le rayon d’expansion du commerce extérieur est en raison de l’intensité de la production intérieure. Elle sait, par expérience, que les guerres commerciales ont toujours tourné contre le but de ceux qui les avaient entreprises. Elle pense que notre civilisation présente encore trop de lacunes pour que nous ayons le droit de forcer des gens à s’y plier, sous la menace de nos obus. (…) Au lieu de faire la police du Tonkin, elle désire établir une bonne police à Paris.
Lettre XVIII - La politique coloniale et les gouvernements de discussion
On se rappelle la dépêche supposée en 1870 ; l’invention du prétendu outrage commis par le roi de Prusse à l’égard de l’ambassadeur français ; et il n’y avait ni dépêche, ni outrage !
Lord Beaconsfield veut engager l’Angleterre dans la guerre de l’Afghanistan : il emploie le même procédé (…) Il entraîne la nation dans une expédition qui a coûté 500 M° à l’Angleterre, beaucoup de morts, qui a dû se terminer par une évacuation et qui lui vaut actuellement une guerre possible avec la Russie.
Sir Bartle Frère est envoyé dans le sud de l’Afrique ; il y porte deux passions : la propagation de l’Evangile et l’extension du territoire britannique. Il engage l’Angleterre dans la guerre des Zoulous et des Boërs et crée une question d’Afrique, malgré l’opinion publique.
Combien y a-t-il d’Anglais qui sachent aujourd’hui pourquoi leur armée se bat en Egypte ? (…)
Un Etat imprévoyant et qui n’a pas un crédit très solide, emprunte. Il trouve deux genres de souscripteurs : les naïfs qui n’examinent pas si le taux de l’intérêt compense le risque à courir ; les malins, qui tâchent ensuite d’écouler le plus de titres possible entre les mains de ces naïfs. Puis viennent les échéances. Le débiteur ne remplit pas ses engagements. Baisse, mécontentement.
(…)
Que fait donc le gouvernement ? Il ne protège pas ses nationaux ! Il abandonne leurs intérêts ! Il les livres à ces bandits !
(…)
L’opinion publique s’échauffe peu à peu en entendant répéter ces clameurs avec tant d’unanimité.
(…)
Et puis, de tous ces bouillonnements, de coups en dessous, de cette mise en scène, de cette fermentation, jaillit l’huissier à envoyer au débiteur insolvable.
Cet huissier a un pantalon ou une veste rouges, un képi, porte un fusil sur l’épaule pour instrumenter et son exploit s’appelle l’expédition de Tunis ou l’expédition d’Egypte.
Le contribuable en paye les frais avec le sang de son fils et l’argent de ses impôts : il eût mieux valu pour lui
« Où sont les électeurs et les élus qui ont la prétention d’avoir une idée nette sur les motifs réels des expéditions de Madagascar, du Sénégal et du Tonkin ?
Comment une chambre de députés peut-elle se prononcer en connaissance de cause, quand à tout instant le ministère répète :
« Si vous saviez ce que je sais, mais je ne pas vous le dire ! »
Le 10 décembre 1883, le ministre déclare à la tribune qu’on n’occupera que le Delta du Tonkin, puis nous en arrivions à l’occupation totale du Tonkin, puis à la guerre avec la Chine (…)
Puis les gens se tuent réciproquement sans savoir pourquoi, et les gens, qui les font tuer, n’en savent pas davantage.
(…)
On avait cru prendre des précautions pour empêcher le gouvernement de jamais engager le pays dans la guerre malgré lui, en inscrivant dans la Constitution l’article 9 : « on ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des deux chambres. »
Depuis 1881, nous avons été engagés dans 3 guerres: l’expédition de Tunisie, l’expédition de Madagascar, l’expédition du Tonkin et de Chine ! Et les deux chambres n’ont été consultés que pour des demandes de crédits, destinés à ratifier le fait accompli »
Pour escamoter la constitution, le gouvernement se sert de mots, comme « état de représailles » et de « rétorsion »
On se rappelle la dépêche supposée en 1870 ; l’invention du prétendu outrage commis par le roi de Prusse à l’égard de l’ambassadeur français ; et il n’y avait ni dépêche, ni outrage !
Lord Beaconsfield veut engager l’Angleterre dans la guerre de l’Afghanistan : il emploie le même procédé (…) Il entraîne la nation dans une expédition qui a coûté 500 M° à l’Angleterre, beaucoup de morts, qui a dû se terminer par une évacuation et qui lui vaut actuellement une guerre possible avec la Russie.
Sir Bartle Frère est envoyé dans le sud de l’Afrique ; il y porte deux passions : la propagation de l’Evangile et l’extension du territoire britannique. Il engage l’Angleterre dans la guerre des Zoulous et des Boërs et crée une question d’Afrique, malgré l’opinion publique.
Combien y a-t-il d’Anglais qui sachent aujourd’hui pourquoi leur armée se bat en Egypte ? (…)
Un Etat imprévoyant et qui n’a pas un crédit très solide, emprunte. Il trouve deux genres de souscripteurs : les naïfs qui n’examinent pas si le taux de l’intérêt compense le risque à courir ; les malins, qui tâchent ensuite d’écouler le plus de titres possible entre les mains de ces naïfs. Puis viennent les échéances. Le débiteur ne remplit pas ses engagements. Baisse, mécontentement.
(…)
Que fait donc le gouvernement ? Il ne protège pas ses nationaux ! Il abandonne leurs intérêts ! Il les livres à ces bandits !
(…)
L’opinion publique s’échauffe peu à peu en entendant répéter ces clameurs avec tant d’unanimité.
(…)
Et puis, de tous ces bouillonnements, de coups en dessous, de cette mise en scène, de cette fermentation, jaillit l’huissier à envoyer au débiteur insolvable.
Cet huissier a un pantalon ou une veste rouges, un képi, porte un fusil sur l’épaule pour instrumenter et son exploit s’appelle l’expédition de Tunis ou l’expédition d’Egypte.
Le contribuable en paye les frais avec le sang de son fils et l’argent de ses impôts : il eût mieux valu pour lui
« Où sont les électeurs et les élus qui ont la prétention d’avoir une idée nette sur les motifs réels des expéditions de Madagascar, du Sénégal et du Tonkin ?
Comment une chambre de députés peut-elle se prononcer en connaissance de cause, quand à tout instant le ministère répète :
« Si vous saviez ce que je sais, mais je ne pas vous le dire ! »
Le 10 décembre 1883, le ministre déclare à la tribune qu’on n’occupera que le Delta du Tonkin, puis nous en arrivions à l’occupation totale du Tonkin, puis à la guerre avec la Chine (…)
Puis les gens se tuent réciproquement sans savoir pourquoi, et les gens, qui les font tuer, n’en savent pas davantage.
(…)
On avait cru prendre des précautions pour empêcher le gouvernement de jamais engager le pays dans la guerre malgré lui, en inscrivant dans la Constitution l’article 9 : « on ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des deux chambres. »
Depuis 1881, nous avons été engagés dans 3 guerres: l’expédition de Tunisie, l’expédition de Madagascar, l’expédition du Tonkin et de Chine ! Et les deux chambres n’ont été consultés que pour des demandes de crédits, destinés à ratifier le fait accompli »
Pour escamoter la constitution, le gouvernement se sert de mots, comme « état de représailles » et de « rétorsion »
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur
Lecteurs de Yves Guyot (7)Voir plus
Quiz
Voir plus
Le livre de la jungle de Rudyard Kipling
Par qui Mowgli a t-il été adopté ?
Baloo l'ours
Bagheera la panthère noire
Raksha la louve
Shere Khan le tigre
38 questions
221 lecteurs ont répondu
Thème :
Rudyard KiplingCréer un quiz sur cet auteur221 lecteurs ont répondu