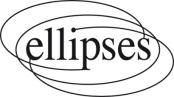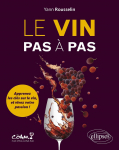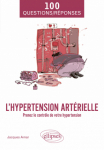Livres populaires du moment
voir plus
Dernières parutions
voir le calendrier des sorties

La methode pour ecrire un roman - toutes les cles pour creer une histoire et la structurer
Ségolène Chailley

Espagnol. grammaire en cartes mentales avec exercices corriges et commentes [b1-c1 - 2e edition rev
Anzemberger/poux

Don't get it wrong! - les principales erreurs grammaticales et lexicales a eviter. b1-b2
Daniel Gandrillon
Collections de Ellipses
Dernières critiques
Cette pièce de théâtre très plaisante est accessible à tout le monde. Le Jeu de l'amour et du hasard est la pièce qui m'a réellement fait aimer le théâtre classique. Ce qui est intéressant, c'est le fait que Marivaux fasse discuter ses personnages pour montrer ce qu'il dénonce (comme beaucoup de dramaturges d'ailleurs): les mœurs de la société de son temps avec le patriarcat, le mariage forcé, l'esclavage etc.
C'est une histoire captivantes, facile à lire et à comprendre sans prise de tête. Je recommande cette pièce de théâtre !
Bonne lecture à ceux qui vont la lire ou la relire !
C'est une histoire captivantes, facile à lire et à comprendre sans prise de tête. Je recommande cette pièce de théâtre !
Bonne lecture à ceux qui vont la lire ou la relire !
"Jane Eyre" ... Je connais depuis une éternité. Enfin, c'est à moitié vrai ce que je dis car j'avais reçu un livre appelé Jane Eyre dans une édition "enfantine" qui n'était que l'adaptation du vrai roman. Mais j'adorais ... Ce n'est que vers vingt ans que je me suis procuré une première édition complète dans "le livre de poche" remplacée par une deuxième plus récente chez GF (traduction Marion Gilbert et Madeleine Duvivier) ainsi que la version originale (chez Oxford's Classics). Et j'ai pu constater des différences, des simplifications assez mineures toutefois quand même entre GF et la version originale. Et j'ai toujours et encore adoré. Et aujourd'hui où je viens de finir de relire le roman (en français …), je ressens toujours cette même émotion.
J'entends d'ici certains commentateurs experts me rétorquer (avec sûrement un brin de gentille ironie) : mais comment est-ce possible, Jean ? Jane Eyre avait la foi vissée au corps, celle qui déplace les montagnes ! Eh bien oui, je suis pris en flagrant délit de contradiction ! D'ailleurs, réglons ce problème tout de suite en disant que je "sais" remettre les choses dans le contexte de l'époque d'une religion anglicane très développée et ancrée dans les mentalités, d'autant que les pasteurs pouvaient créer une famille et qu'une possibilité et non des moindres pour une jeune fille était de devenir l'épouse d'un pasteur. De plus , Jane Eyre n'avait guère dans ses moments les plus critiques que cet horizon-là, cet idéal-là pour se raccrocher aux branches ou demander de l'aide, ce que je peux parfaitement concevoir et admettre.
Je mets souvent en perspective les deux romans de Charlotte et Emily Brontë à savoir Jane Eyre et Wutherings Heights où les deux héros ou héroïne, Jane et Heathcliff, finalement, ont des destins qui se ressemblent. Même si j'aime aussi beaucoup le roman d'Emily, car j'aime beaucoup le personnage sauvage de Heathcliff, je donnerai toujours la préférence au roman de Charlotte Brontë car elle accorde à Jane et à Rochester (le pendant d'Heathcliff) la possibilité d'accéder au bonheur.
C'est curieux de voir que les deux héroïnes Catherine Earnshaw et Jane Eyre ont des comportements face à Heathcliff et Rochester assez analogues. De voir aussi que Heathcliff et Rochester sont des hommes, un peu brut de fonderie, analogues aussi.
Là où diffèrent les deux romans, c'est que "Jane Eyre" est un chemin initiatique qui forge, à la dure, le caractère de Jane et lui donnera le courage d'affronter, avec succès, les obstacles, nombreux, de sa route.
D'ailleurs, le roman "Jane Eyre", qui, comme tout le monde sait, est construit comme une autobiographie, est saisissant dans l'évolution du ton employé par la romancière, entre la petite fille du début à la femme qui a gagné son pouvoir de décision ou son autonomie à la fin en passant par l'étape d'institutrice de la pupille de Rochester.
Le personnage de Jane évolue tout au long du roman mais le caractère fondamental, lui, reste inchangé : aucune compromission que ce soit par amour ou par haine ou pour obtenir un quelconque avantage. Aucune vanité.
Les évocations des personnages qu'il s'agisse d'Helene Burns ou de Rochester sont très réussies. Rochester en homme viril, pas beau, soupe au lait mais capable de douceur et de tendresse.
Est-ce que vous me trouvez beau ? Non ! répondra Jane.
L'opposition Rochester /Saint-John Rivers est tout aussi saisissante dans la bouche de Jane. Saint-John est beau, séduisant, fin, intellectuellement brillant mais pourvu d'une âme calculatrice et froide : Jane ne peut l'aimer comme un mari. Alors qu'on sent que Rochester est humain, incandescent, chaud comme la braise.
La beauté de l'homme au sens esthétique du terme n'est pas dans les critères de choix de Charlotte Brontë : la beauté de Saint-John et de Blanche Ingram masque les vraies personnalités qui peuvent se trouver vaniteuses ou frivoles ou insensibles.
Il y a des passages qui confinent au merveilleux, par exemple l'amitié entre Jane et Helene Burns ou la première rencontre entre Jane et Rochester sur la route verglacée. Sans oublier, bien entendu le bouleversant retour de Jane à la fin et sa délicatesse et son empathie absolues face à Rochester. Ah, j'oubliais aussi l'amusante scène où Rochester se déguise en bohémienne ... Ces passages-là, je les lis lentement pour mieux les absorber et je prends même plaisir à les relire (au cas fort improbable où je n'aurais pas tout-à-fait compris et où j'aurais sauté une ligne).
Je ne sais pas si je l'ai dit mais j'aime beaucoup ce livre, me replonger régulièrement dans son atmosphère, m'imprégner et me substituer aux personnages du roman.
J'entends d'ici certains commentateurs experts me rétorquer (avec sûrement un brin de gentille ironie) : mais comment est-ce possible, Jean ? Jane Eyre avait la foi vissée au corps, celle qui déplace les montagnes ! Eh bien oui, je suis pris en flagrant délit de contradiction ! D'ailleurs, réglons ce problème tout de suite en disant que je "sais" remettre les choses dans le contexte de l'époque d'une religion anglicane très développée et ancrée dans les mentalités, d'autant que les pasteurs pouvaient créer une famille et qu'une possibilité et non des moindres pour une jeune fille était de devenir l'épouse d'un pasteur. De plus , Jane Eyre n'avait guère dans ses moments les plus critiques que cet horizon-là, cet idéal-là pour se raccrocher aux branches ou demander de l'aide, ce que je peux parfaitement concevoir et admettre.
Je mets souvent en perspective les deux romans de Charlotte et Emily Brontë à savoir Jane Eyre et Wutherings Heights où les deux héros ou héroïne, Jane et Heathcliff, finalement, ont des destins qui se ressemblent. Même si j'aime aussi beaucoup le roman d'Emily, car j'aime beaucoup le personnage sauvage de Heathcliff, je donnerai toujours la préférence au roman de Charlotte Brontë car elle accorde à Jane et à Rochester (le pendant d'Heathcliff) la possibilité d'accéder au bonheur.
C'est curieux de voir que les deux héroïnes Catherine Earnshaw et Jane Eyre ont des comportements face à Heathcliff et Rochester assez analogues. De voir aussi que Heathcliff et Rochester sont des hommes, un peu brut de fonderie, analogues aussi.
Là où diffèrent les deux romans, c'est que "Jane Eyre" est un chemin initiatique qui forge, à la dure, le caractère de Jane et lui donnera le courage d'affronter, avec succès, les obstacles, nombreux, de sa route.
D'ailleurs, le roman "Jane Eyre", qui, comme tout le monde sait, est construit comme une autobiographie, est saisissant dans l'évolution du ton employé par la romancière, entre la petite fille du début à la femme qui a gagné son pouvoir de décision ou son autonomie à la fin en passant par l'étape d'institutrice de la pupille de Rochester.
Le personnage de Jane évolue tout au long du roman mais le caractère fondamental, lui, reste inchangé : aucune compromission que ce soit par amour ou par haine ou pour obtenir un quelconque avantage. Aucune vanité.
Les évocations des personnages qu'il s'agisse d'Helene Burns ou de Rochester sont très réussies. Rochester en homme viril, pas beau, soupe au lait mais capable de douceur et de tendresse.
Est-ce que vous me trouvez beau ? Non ! répondra Jane.
L'opposition Rochester /Saint-John Rivers est tout aussi saisissante dans la bouche de Jane. Saint-John est beau, séduisant, fin, intellectuellement brillant mais pourvu d'une âme calculatrice et froide : Jane ne peut l'aimer comme un mari. Alors qu'on sent que Rochester est humain, incandescent, chaud comme la braise.
La beauté de l'homme au sens esthétique du terme n'est pas dans les critères de choix de Charlotte Brontë : la beauté de Saint-John et de Blanche Ingram masque les vraies personnalités qui peuvent se trouver vaniteuses ou frivoles ou insensibles.
Il y a des passages qui confinent au merveilleux, par exemple l'amitié entre Jane et Helene Burns ou la première rencontre entre Jane et Rochester sur la route verglacée. Sans oublier, bien entendu le bouleversant retour de Jane à la fin et sa délicatesse et son empathie absolues face à Rochester. Ah, j'oubliais aussi l'amusante scène où Rochester se déguise en bohémienne ... Ces passages-là, je les lis lentement pour mieux les absorber et je prends même plaisir à les relire (au cas fort improbable où je n'aurais pas tout-à-fait compris et où j'aurais sauté une ligne).
Je ne sais pas si je l'ai dit mais j'aime beaucoup ce livre, me replonger régulièrement dans son atmosphère, m'imprégner et me substituer aux personnages du roman.
Terre des Hommes est un essai autobiographique dans lequel Saint-Exupéry aborde ses valeurs humanistes, à travers une série d’histoires de ses voyages, lorsqu’il était aviateur pour l’Aéropostale. Dans divers chapitres, avec une forme sobrement poétique, il relate d’abord les exploits des pionniers de l’aviation comme ceux de Mermoz ou Guillaumet, prêts à mettre en péril leur vie contre des conditions météorologiques dangereuses, pour ouvrir la voie à des nouvelles routes aériennes. L’écrivain en profite pour méditer sur le progrès technologique, dont celui de l’avion, qu’il voit comme un outil pour servir les hommes et non comme une fin en soi. Pour lui, l’Homme est trop obnubilé par un progrès excessif et à tendance à oublier son essence. Aussi, qu’importe le perfectionnement de la machine, l’homme est en conflit permanent avec les éléments fondamentaux, rappelant les diverses réflexions sur le rapport animiste entre le pilote et la planète, car vu du ciel, on retrouve une nature primitive et originelle, tout comme les Hommes que l’on voit différemment.
Plus le fil du livre se suit dans une capsule sensorielle où les réflexions se mêlent avec une mosaïque émotionnelle, plus la notion d’espace-temps devient floue, car l’écriture nous absorbe dans une douceur philosophique et méditative qui ne prend plus en compte les notions de lieux et de temps. C’est le cas lorsque l’auteur, en Argentine, se voit accueillir dans une maison de fermier et voit la vie simple, digne et douce que la famille mène. Un havre de paix qui se transforme toujours en désert, et ce motif du désert est central dans le livre comme le démontre toute la survie de Saint-Exupery dans un désert après un accident. Gagné par la faim, la soif et le désespoir, il comprend ce qu’est la solitude, ne plus croire en rien, être au bord de la mort et du néant intérieur. Sauvé par un Bédouin, l’auteur consacre aussi ses interrogations sur le mode de vie des peuples autochtones, sur leur notion de liberté, de religion et leur sens de la vie.
Au fond, l’écrivain se demande ce qu’est un homme et quelle est sa vérité. C’est à travers cette philosophie et cette fable de la terre qu’il déroule ses notions de camaraderie et d’amitié, d’héroïsme et de responsabilité, mais surtout de l’inflexibilité exigeante des relations qu’il faut garder pour survivre et qu'il n'y est pas de Mozart assassiné, c'est-à-dire d'enfant vivant dans la misère sociale et n'ayant pas la chance de devenir un grand Homme.
Plus le fil du livre se suit dans une capsule sensorielle où les réflexions se mêlent avec une mosaïque émotionnelle, plus la notion d’espace-temps devient floue, car l’écriture nous absorbe dans une douceur philosophique et méditative qui ne prend plus en compte les notions de lieux et de temps. C’est le cas lorsque l’auteur, en Argentine, se voit accueillir dans une maison de fermier et voit la vie simple, digne et douce que la famille mène. Un havre de paix qui se transforme toujours en désert, et ce motif du désert est central dans le livre comme le démontre toute la survie de Saint-Exupery dans un désert après un accident. Gagné par la faim, la soif et le désespoir, il comprend ce qu’est la solitude, ne plus croire en rien, être au bord de la mort et du néant intérieur. Sauvé par un Bédouin, l’auteur consacre aussi ses interrogations sur le mode de vie des peuples autochtones, sur leur notion de liberté, de religion et leur sens de la vie.
Au fond, l’écrivain se demande ce qu’est un homme et quelle est sa vérité. C’est à travers cette philosophie et cette fable de la terre qu’il déroule ses notions de camaraderie et d’amitié, d’héroïsme et de responsabilité, mais surtout de l’inflexibilité exigeante des relations qu’il faut garder pour survivre et qu'il n'y est pas de Mozart assassiné, c'est-à-dire d'enfant vivant dans la misère sociale et n'ayant pas la chance de devenir un grand Homme.
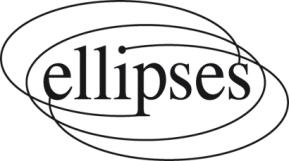
Etiquettes
voir plus