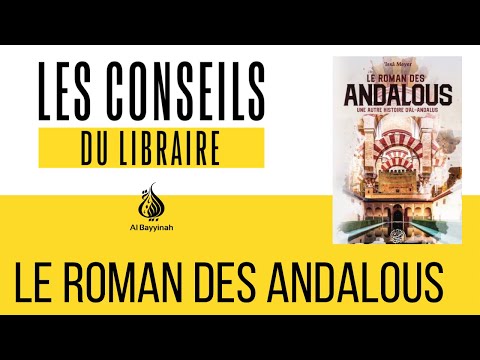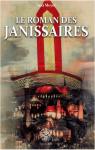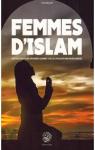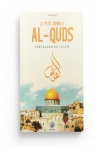'Issâ Meyer
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Note moyenne : /5 (sur 0 notes)
Résumé :
Précurseur de l’activisme médiatique panislamiste, le prince libanais Shakîb Arslân (1869-1946) savait mieux créer la polémique, émouvoir et sensibiliser que personne : journaliste militant, homme de lettres engagé, poète à ses heures perdues et diplomate ou conspirateur à l’occasion, cet éternel révolté que l’on surnommait Amîr al-Bayân, « le Prince de l’Éloquence », a mis sa vie tout entière au service d’une mission transcendante qui lui a valu de passer les derni... >Voir plus
Citations et extraits (4)
Ajouter une citation
Il est une autre cause dans laquelle il était impossible que Shakîb Arslân ne s’implique pas, tant elle était — hier comme aujourd’hui — d’une actualité brûlante : la question palestinienne. (...) Ici comme ailleurs, pour Shakîb Arslân, qui s’empare de la question à pleines mains après l’échec de la révolte syrienne, la solution ne peut être que globale et, bien entendu, panislamique. D’article en dossier et de diatribe en pamphlet, il répète à qui veut l’entendre la devise de son ami Muhibb al-Dîn al-Khâtib : « Le monde musulman est la Palestine, et la Palestine est le monde musulman. »
« J’ai dit, et je continue à dire, écrit-il quelques années plus tard, que le problème palestinien n’est pas seulement le problème des Arabes de Palestine ou du monde arabe : c’est une calamité générale pour l’ensemble du monde musulman. »
L’obligation morale de défendre la Palestine — symbole s’il en est de la menace globale qui pèse sur l’Islam — relève ainsi de la responsabilité de l’ensemble des musulmans de l’Atlantique au Pacifique, martèle-t-il sans relâche. (...) La cause palestinienne est, pour lui, l'exemple s’il en est de l’hypocrisie occidentale et de l’inversion des valeurs : « Ce qui est incroyable, c’est que la morale politique de l’Europe baisse à ce point et s’avilisse jusqu’au degré de considérer l’injustice comme une œuvre sublime d’humanité et les usurpations flagrantes comme des actes de justice glorieuse. »
Comme dans l’affaire du dahir berbère, il cherche à comprendre, expliquer, vulgariser les ressorts plus larges de l’affaire. Il est ainsi parmi les premiers à percevoir la nature fondamentalement expansionniste du sionisme, la détermination totale de ses dirigeants et militants, et l’importance cruciale de la démographie dans la lutte : « Une fois qu’ils auront une majorité, c’en est fini pour les Arabes », prédit-il ainsi à juste titre. Un homme aussi éveillé que lui sur la nature profonde de l’impérialisme ne pouvait non plus ignorer la dimension géopolitique du projet sioniste : à ses yeux, cet État en devenir, créé, armé et financé par l’Occident, coupera littéralement le monde arabe et musulman en deux (…).
« J’ai dit, et je continue à dire, écrit-il quelques années plus tard, que le problème palestinien n’est pas seulement le problème des Arabes de Palestine ou du monde arabe : c’est une calamité générale pour l’ensemble du monde musulman. »
L’obligation morale de défendre la Palestine — symbole s’il en est de la menace globale qui pèse sur l’Islam — relève ainsi de la responsabilité de l’ensemble des musulmans de l’Atlantique au Pacifique, martèle-t-il sans relâche. (...) La cause palestinienne est, pour lui, l'exemple s’il en est de l’hypocrisie occidentale et de l’inversion des valeurs : « Ce qui est incroyable, c’est que la morale politique de l’Europe baisse à ce point et s’avilisse jusqu’au degré de considérer l’injustice comme une œuvre sublime d’humanité et les usurpations flagrantes comme des actes de justice glorieuse. »
Comme dans l’affaire du dahir berbère, il cherche à comprendre, expliquer, vulgariser les ressorts plus larges de l’affaire. Il est ainsi parmi les premiers à percevoir la nature fondamentalement expansionniste du sionisme, la détermination totale de ses dirigeants et militants, et l’importance cruciale de la démographie dans la lutte : « Une fois qu’ils auront une majorité, c’en est fini pour les Arabes », prédit-il ainsi à juste titre. Un homme aussi éveillé que lui sur la nature profonde de l’impérialisme ne pouvait non plus ignorer la dimension géopolitique du projet sioniste : à ses yeux, cet État en devenir, créé, armé et financé par l’Occident, coupera littéralement le monde arabe et musulman en deux (…).
Abdülhamid II est le premier grand héros de Shakîb Arslân — le modèle, à ses yeux, du souverain musulman engagé et énergique. «L’éloge reconnaissant est le droit du calife, qui est un ornement pour la religion et pour le monde », écrit ainsi Shakîb Arslân dès 1892 dans l’une des nombreuses qasîdas poétiques qu’il dédie à son sultan. Comme lui, il perçoit tout à fait le prégnant danger d’isolement et d’occupation étrangère qui pèse sur l’Empire ottoman, déjà passablement amputé par les puissances européennes au cours des décennies précédentes ; comme lui, il pense que le califat doit être renforcé, non par une adoption intégrale du modèle occidental, mais par une régénération de l’Islam et une réaffirmation concrète de la solidarité musulmane.
La grande affaire du règne d’Abdülhamid II est en effet le panislamisme, qui prend en terre ottomane le nom d’Ittihad-i Islam, élevé au rang de doctrine officielle de l’empire ; et cette vision du monde exercera une telle influence sur la pensée et les sentiments de Shakîb Arslân qu’il convient ici de l’évoquer plus longuement. Conscient de la position affaiblie de son État, le 34e souverain de la dynastie osmanienne comprend que la seule force susceptible d’unir les peuples disparates de ses domaines — et au-delà — est l’Islam. Turcs, Arabes, Kurdes, Albanais et autres : c’est autour de son autorité politique et spirituelle de Commandeur des Croyants qu’il cherche à rassembler ses sujets musulmans, en opposition à toute forme de sécularisme ou de nationalisme ethnique.
Au «principe des nationalités » cher à l’Europe occidentale, il oppose ainsi cette « nation de la Foi » qu’est la Umma. (...) Mais le renouveau islamique esquissé par Abdülhamid ne s’appuie pas que sur l’idéologie et la spiritualité : s’il rejette les ingérences étrangères et l’occidentalisation de la société perçue comme une trahison du caractère profond de l’empire, le sultan est loin d’être un autocrate obtus qui se désintéresse des dernières innovations technologiques et organisationnelles venues d’Europe. Son règne est donc aussi celui de la modernisation et du développement (…).
La grande affaire du règne d’Abdülhamid II est en effet le panislamisme, qui prend en terre ottomane le nom d’Ittihad-i Islam, élevé au rang de doctrine officielle de l’empire ; et cette vision du monde exercera une telle influence sur la pensée et les sentiments de Shakîb Arslân qu’il convient ici de l’évoquer plus longuement. Conscient de la position affaiblie de son État, le 34e souverain de la dynastie osmanienne comprend que la seule force susceptible d’unir les peuples disparates de ses domaines — et au-delà — est l’Islam. Turcs, Arabes, Kurdes, Albanais et autres : c’est autour de son autorité politique et spirituelle de Commandeur des Croyants qu’il cherche à rassembler ses sujets musulmans, en opposition à toute forme de sécularisme ou de nationalisme ethnique.
Au «principe des nationalités » cher à l’Europe occidentale, il oppose ainsi cette « nation de la Foi » qu’est la Umma. (...) Mais le renouveau islamique esquissé par Abdülhamid ne s’appuie pas que sur l’idéologie et la spiritualité : s’il rejette les ingérences étrangères et l’occidentalisation de la société perçue comme une trahison du caractère profond de l’empire, le sultan est loin d’être un autocrate obtus qui se désintéresse des dernières innovations technologiques et organisationnelles venues d’Europe. Son règne est donc aussi celui de la modernisation et du développement (…).
L’amour du Maroc pour toi est devenu une évidence que tous ceux qui s’intéressent au Maroc peuvent aisément percevoir, affirmera à Arslân son ami Muhammad Dâwûd dans un éloquent témoignage de cette influence. C’est le moindre de nos devoirs à l’égard d’un homme des plus nobles qui a consacré sa vie à défendre ce qu’il y a de plus sacré pour nous, Marocains, à savoir la victoire de l’Islam, la dignité de l’arabisme, la lutte contre les injustes agresseurs et la mise en échec de la brutale politique des colonisateurs.
Au cours de la période-charnière qui sépare les deux guerres mondiales, Arslân, qui commente avec passion toutes les questions qui touchent le monde musulman, s’intéresse naturellement au sort de l’Afrique du Nord qui étouffe sous le joug français et aux oppositions qui se développent à sa domination. (...) C’est au Maroc que l’activisme international de Shakîb Arslân va trouver son expression la plus brillante. Quoiqu’affaibli par la dette et les troubles internes, le pays, rappelons-le, a été l’un des derniers du monde musulman à tomber sous la coupe de l’Europe : ce n’est qu’en mars 1912, sous la menace des troupes de Lyautey rassemblées autour de sa capitale, que le sultan ‘Abd al-Hafîz a été contraint de signer le traité de Fès qui plaçait son État sous protectorat français ; et depuis, les émeutes de Fès (1912), la guerre des Zayanes dans le Moyen Atlas (1914- 21) ou l’insurrection rifaine d’al-Khattâbî (1921-26) ont montré que le Maroc n’était guère disposé à tolérer très longtemps l’occupation étrangère. Portée par cette insoumission chronique et la fierté d’une histoire millénaire aux mille et une puissantes dynasties, une nouvelle génération de citadins marocains engagés se lève dès le milieu des années 1920 à Fès, Rabat ou Tétouan : influencés tant par des sentiments nationalistes que par le réformisme islamique et la Salafiyya, ils fondent un réseau éducatif d’écoles libres hors du contrôle français et des sociétés politiques secrètes qui visent autant à poser les bases de l’indépendance qu’à régénérer la société par un retour aux valeurs authentiques de l’Islam.
Au cours de la période-charnière qui sépare les deux guerres mondiales, Arslân, qui commente avec passion toutes les questions qui touchent le monde musulman, s’intéresse naturellement au sort de l’Afrique du Nord qui étouffe sous le joug français et aux oppositions qui se développent à sa domination. (...) C’est au Maroc que l’activisme international de Shakîb Arslân va trouver son expression la plus brillante. Quoiqu’affaibli par la dette et les troubles internes, le pays, rappelons-le, a été l’un des derniers du monde musulman à tomber sous la coupe de l’Europe : ce n’est qu’en mars 1912, sous la menace des troupes de Lyautey rassemblées autour de sa capitale, que le sultan ‘Abd al-Hafîz a été contraint de signer le traité de Fès qui plaçait son État sous protectorat français ; et depuis, les émeutes de Fès (1912), la guerre des Zayanes dans le Moyen Atlas (1914- 21) ou l’insurrection rifaine d’al-Khattâbî (1921-26) ont montré que le Maroc n’était guère disposé à tolérer très longtemps l’occupation étrangère. Portée par cette insoumission chronique et la fierté d’une histoire millénaire aux mille et une puissantes dynasties, une nouvelle génération de citadins marocains engagés se lève dès le milieu des années 1920 à Fès, Rabat ou Tétouan : influencés tant par des sentiments nationalistes que par le réformisme islamique et la Salafiyya, ils fondent un réseau éducatif d’écoles libres hors du contrôle français et des sociétés politiques secrètes qui visent autant à poser les bases de l’indépendance qu’à régénérer la société par un retour aux valeurs authentiques de l’Islam.
Le succès inattendu de la campagne marocaine contre le dahir berbère ne passe évidemment pas inaperçu chez le voisin algérien, où une jeune organisation récemment fondée, l’Association des oulémas algériens, cherche précisément à faire reculer la France sur les aspects les plus problématiques de son ingérence et à restaurer l’indépendance, sinon du pays, du moins du culte musulman. Un homme hors du commun est à l’origine de ce mouvement qui prendra bientôt une telle ampleur que nul ne pourra l’ignorer : ‘Abd al-Hamîd ibn Bâdîs (1889-1940), savant à la fois réformateur et conservateur, penseur original et éducateur de toute une génération qui s’imposera comme le patriarche du nationalisme culturel algérien et du renouveau islamique dans le pays. Aux yeux de ce théoricien pour qui l’Algérie est à la fois foncièrement distincte de la France et partie prenante d’un grand ensemble arabo-musulman, Shakîb Arslân est autant un modèle de jeunesse qu’un allié naturel : c’est par ses activités à l’AEMNA et surtout ses articles dans la presse égyptienne qu’il s’est fait connaître en Algérie, où les oulémas réformistes n’ont d’alors d’yeux que pour l’Orient et se prennent de passion pour tout ce qui pourra assouvir leur soif d’arabité.
Dans son journal al-Shihâb, Ibn Bâdîs partage ainsi avec délectation les articles du Prince de l’Éloquence, rédigés dans le plus bel arabe classique qui soit, et entame une correspondance suivie avec le célèbre activiste. Plus idéologue que fin tacticien politique, l’érudit Ibn Bâdîs se nourrit grandement des conseils stratégiques de l’expérimenté Libanais, notamment vis-à-vis d’une scène politique européenne dont il sous-estime l’ampleur de la sournoiserie, tandis qu’Arslân fait pénétrer en Algérie les nouvelles, idées et évolutions en tout genre du Caire ou de Damas dont les Algériens sont si friands et s’inspirent pour leur propre renaissance. En commun, les deux hommes ont presque tout (…).
Dans son journal al-Shihâb, Ibn Bâdîs partage ainsi avec délectation les articles du Prince de l’Éloquence, rédigés dans le plus bel arabe classique qui soit, et entame une correspondance suivie avec le célèbre activiste. Plus idéologue que fin tacticien politique, l’érudit Ibn Bâdîs se nourrit grandement des conseils stratégiques de l’expérimenté Libanais, notamment vis-à-vis d’une scène politique européenne dont il sous-estime l’ampleur de la sournoiserie, tandis qu’Arslân fait pénétrer en Algérie les nouvelles, idées et évolutions en tout genre du Caire ou de Damas dont les Algériens sont si friands et s’inspirent pour leur propre renaissance. En commun, les deux hommes ont presque tout (…).
Videos de 'Issâ Meyer (2)
Voir plusAjouter une vidéo
Présentation du livre par Thomas Sibille de la Librairie al-Bayyinah "Le Roman des Andalous" de Issâ Meyer aux Editions Ribât.
Livres les plus populaires de la semaine
Voir plus
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de 'Issâ Meyer (6)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Bestiaire
La panthère ...
des Baskerville
des neiges
de Vatanen
13 questions
559 lecteurs ont répondu
Thèmes :
littérature française
, romans policiers et polars
, bestiaire
, littérature étrangère
, nouvellesCréer un quiz sur ce livre559 lecteurs ont répondu