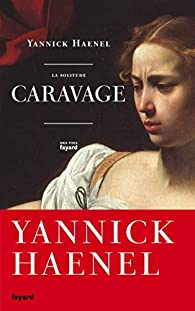Citations sur La solitude Caravage (220)
"Vie intérieure", "vie spirituelle" sont des vieux mots qui désignent, malgré leur caducité, l'accès à cette révélation, toujours brûlante, qu'il existe un plan où chaque instant, vécu ou non par les humains, est décisif. Où l'on écoute une parole qui peut prendre la forme d'un silence.
D’ailleurs, ses premiers biographes, Mancini, Baglione, Bellori, qui l’avaient plus ou moins connu, étaient avant tout des rivaux vexés, c’est à-dire des ennemis, qui mirent sournoisement du sable dans l’engrenage de sa postérité en l’accusant de « déprécier la majesté de l’art », de « mépriser les belles choses » pour s’adonner à « l’imitation des choses viles ».
Ce triple zèle dans la malveillance contribua à officialiser la mauvaise réputation d’un Caravage qui n’eut jamais aucun défenseur, et dont la postérité fut ainsi biaisée d’entrée de jeu ; on lui attribua en effet un nombre exagéré de tableaux (et parmi eux, la moindre scène de beuverie, la moindre trivialité noirâtre) afin de réduire son génie en le diluant dans une abondance médiocre. Ainsi, contrairement à la plupart des grands peintres, qui bénéficient traditionnellement des vertus de l’hagiographie, fut-il privé de reconnaissance : on l’oublia pendant deux siècles.
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, grâce à des peintres comme Courbet et Manet, qui rouvrent nos yeux à la vérité d’un monde débarrassé de tout idéalisme, que nous sommes redevenus capables de voir sa peinture, et qu’en toute logique il recommence à exister à nos yeux. Mais Élie Faure en parle à peine dans son immense et géniale Histoire de l’art ; André Malraux, dans Les Voix du silence en fait quant à lui un simple précurseur de Georges de La Tour ; et même Georges Bataille, qui a pourtant écrit un livre fulgurant sur Manet, et dont l’œuvre entière s’ouvre à cet abîme où art, extase et sacré récusent le « cauchemar global de la société », ignore le Caravage. Même Les Larmes d’Éros, son dernier livre, où se trouvent stockées les images de la culture occidentale qui font coïncider ce qu’il nomme la « vie religieuse » avec cette « pleine violence qui joue à l’instant où la mort ouvre la gorge de la victime », oublie le Caravage, alors qu’un tableau comme Judith décapitant Holopherne, sans parler des représentations de David et Goliath ou de la tête de Méduse auraient sans nul doute, s’il les avait connus, passionné cet amateur d’Éros cruel qu’est Bataille (et s’il me plaît à moi d’imaginer la rencontre entre Bataille et le Caravage, alors ce livre en sera l’impossible document).
Ce triple zèle dans la malveillance contribua à officialiser la mauvaise réputation d’un Caravage qui n’eut jamais aucun défenseur, et dont la postérité fut ainsi biaisée d’entrée de jeu ; on lui attribua en effet un nombre exagéré de tableaux (et parmi eux, la moindre scène de beuverie, la moindre trivialité noirâtre) afin de réduire son génie en le diluant dans une abondance médiocre. Ainsi, contrairement à la plupart des grands peintres, qui bénéficient traditionnellement des vertus de l’hagiographie, fut-il privé de reconnaissance : on l’oublia pendant deux siècles.
Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle, grâce à des peintres comme Courbet et Manet, qui rouvrent nos yeux à la vérité d’un monde débarrassé de tout idéalisme, que nous sommes redevenus capables de voir sa peinture, et qu’en toute logique il recommence à exister à nos yeux. Mais Élie Faure en parle à peine dans son immense et géniale Histoire de l’art ; André Malraux, dans Les Voix du silence en fait quant à lui un simple précurseur de Georges de La Tour ; et même Georges Bataille, qui a pourtant écrit un livre fulgurant sur Manet, et dont l’œuvre entière s’ouvre à cet abîme où art, extase et sacré récusent le « cauchemar global de la société », ignore le Caravage. Même Les Larmes d’Éros, son dernier livre, où se trouvent stockées les images de la culture occidentale qui font coïncider ce qu’il nomme la « vie religieuse » avec cette « pleine violence qui joue à l’instant où la mort ouvre la gorge de la victime », oublie le Caravage, alors qu’un tableau comme Judith décapitant Holopherne, sans parler des représentations de David et Goliath ou de la tête de Méduse auraient sans nul doute, s’il les avait connus, passionné cet amateur d’Éros cruel qu’est Bataille (et s’il me plaît à moi d’imaginer la rencontre entre Bataille et le Caravage, alors ce livre en sera l’impossible document).
Nous sommes dans le sépulcre, les murs très hauts sont enduits d’ombre et, dans le fond du tableau, l’immensité d’une porte noire ouvre à la mort ou au salut. Deux hommes soulèvent la dalle et sortent le corps de Lazare que le bras du Christ ressuscite. L’espace tout entier, occupé par une foule en cascade d’où émergent des visages grimaçants, semble chavirer au cœur de la béance entre vie et mort, que le bras du Christ va réparer.
Toute la composition tient par la rencontre miraculeuse entre la ligne horizontale formée, comme dans La Vocation de saint Matthieu, par le bras tendu du Christ, et le corps nu, dépouillé de son suaire et de ses bandelettes, de Lazare, dont la rigidité cadavérique forme une croix qui annonce celle sur laquelle le Christ, à son tour, mourra et sera ressuscité.
Entre le Christ et le corps de Lazare soutenu par ses deux sœurs, un homme dont le visage est tourné vers le Christ (alors que tous les autres personnages regardent en direction de Lazare) semble couper la trajectoire résurrectionnelle ; il est au milieu du tableau, et sans prendre part à l’événement, encore moins à la stupéfaction générale, il s’avance vers le Christ.
Le contraste entre les deux est flagrant : autant le visage de cet homme est couvert de lumière, au point qu’on lui dirait le visage brûlé, autant le Christ disparaît dans l’ombre.
Cet homme, c’est le Caravage. Il s’est peint là, à quelques centimètres du Christ ; ses mains sont jointes et touchent presque celle de Jésus tendue vers Lazare qui va reprendre vie.
Que se passe-t-il exactement entre eux deux ?
De quelle nature relève cet échange ? Y a-t-il même échange, ou un simple côtoiement ? On a la sensation que cet homme au visage en feu remonte le cours de l’action, comme s’il voulait accéder à la source même de ce geste christique — ou lui demander quelque chose : une bénédiction ? Un pardon ? L’amour se tient ainsi debout dans la grâce ; on ne sait s’il la regarde ou la reçoit. En un sens, la lumière dorée qui baigne le visage du Caravage ne peut provenir que du Christ, lequel s’est vidé de sa lueur et demeure dans l’ombre ; une ligne verticale coupe la tête du Caravage, exactement positionnée entre la lumière et les ténèbres. Le Caravage est plus près que jamais du Christ, son visage est comme brûlé par la lumière évangélique, ses mains sont jointes, mais il est à côté. Sans doute ne sera-t-il pas possible de s’avancer plus dans la lumière : rien n’est plus tragique que de voir ce petit espace brûlant et rouge qui le sépare encore du Christ. Cet espace est le nôtre : c’est là que nous vivons, dans les quelques centimètres où s’approche et s’éloigne la possibilité du salut ; ces quelques centimètres sont notre lopin intime, celui dans lequel nous tournons en rond dans le feu qui nous consume et peut nous détruire aussi bien que nous illuminer ; où nos désirs, à force de se creuser, ouvrent peut-être une tombe au lieu de trouver l’issue.
Toute la composition tient par la rencontre miraculeuse entre la ligne horizontale formée, comme dans La Vocation de saint Matthieu, par le bras tendu du Christ, et le corps nu, dépouillé de son suaire et de ses bandelettes, de Lazare, dont la rigidité cadavérique forme une croix qui annonce celle sur laquelle le Christ, à son tour, mourra et sera ressuscité.
Entre le Christ et le corps de Lazare soutenu par ses deux sœurs, un homme dont le visage est tourné vers le Christ (alors que tous les autres personnages regardent en direction de Lazare) semble couper la trajectoire résurrectionnelle ; il est au milieu du tableau, et sans prendre part à l’événement, encore moins à la stupéfaction générale, il s’avance vers le Christ.
Le contraste entre les deux est flagrant : autant le visage de cet homme est couvert de lumière, au point qu’on lui dirait le visage brûlé, autant le Christ disparaît dans l’ombre.
Cet homme, c’est le Caravage. Il s’est peint là, à quelques centimètres du Christ ; ses mains sont jointes et touchent presque celle de Jésus tendue vers Lazare qui va reprendre vie.
Que se passe-t-il exactement entre eux deux ?
De quelle nature relève cet échange ? Y a-t-il même échange, ou un simple côtoiement ? On a la sensation que cet homme au visage en feu remonte le cours de l’action, comme s’il voulait accéder à la source même de ce geste christique — ou lui demander quelque chose : une bénédiction ? Un pardon ? L’amour se tient ainsi debout dans la grâce ; on ne sait s’il la regarde ou la reçoit. En un sens, la lumière dorée qui baigne le visage du Caravage ne peut provenir que du Christ, lequel s’est vidé de sa lueur et demeure dans l’ombre ; une ligne verticale coupe la tête du Caravage, exactement positionnée entre la lumière et les ténèbres. Le Caravage est plus près que jamais du Christ, son visage est comme brûlé par la lumière évangélique, ses mains sont jointes, mais il est à côté. Sans doute ne sera-t-il pas possible de s’avancer plus dans la lumière : rien n’est plus tragique que de voir ce petit espace brûlant et rouge qui le sépare encore du Christ. Cet espace est le nôtre : c’est là que nous vivons, dans les quelques centimètres où s’approche et s’éloigne la possibilité du salut ; ces quelques centimètres sont notre lopin intime, celui dans lequel nous tournons en rond dans le feu qui nous consume et peut nous détruire aussi bien que nous illuminer ; où nos désirs, à force de se creuser, ouvrent peut-être une tombe au lieu de trouver l’issue.
Je m’arrête un instant à Messine, face à La Résurrection de Lazare. On est en 1609. Le Caravage approfondit une solitude qui le dépouille ; il s’abîme dans une obscurité qui se resserre sur son souffle ; on dirait qu’il disparaît : d’ailleurs on ne sait plus rien sur lui -où vit-il ? avec qui parle-t-il ? Le Caravage rejoint son propre mystère. C’est la nuit, et il peint : sa main, dans l’ombre, trace de brusques lueurs qui, en fouillant l’épaisseur du péché, scintillent à la recherche de la grâce.
Il arrive qu’à force de regarder des peintures on se mette à voir quelque chose de très simple ; et que cette simplicité se change en lumière.
Depuis que je m’aventure à écrire sur la vie et l’art du Caravage — depuis qu’avec ce livre je me suis mis à chercher dans la matière de la peinture une vérité qui pourrait se dire —, je suis guetté par un mouvement qui abandonne mes phrases en même temps qu’il les appelle : elles semblent partir dans des directions qui m’échappent, et je ne les reconnais pas toujours ; mais je les laisse faire, car il me vient avec elles l’espérance qu’en se perdant elles parviennent à s’éclairer d’une lumière qui n’est pas seulement raisonnable, à glisser vers je ne sais quoi de plus ouvert que leur sens, à entrer dans un pays plus inconnu encore que la poésie, où la vérité fait des apparitions étranges, comme s’il existait encore autre chose que la nuit et le jour, un temps qui échappe à leur contradiction, qui n’a rien à voir avec leur succession, qui défait le visible en même temps que l’invisible.
La peinture a lieu ici, à ce point d’éclat où l’on ne s’appartient plus, où le Caravage échappe non seulement à ses bourreaux, à ses ennemis, aux chevaliers de l’Ordre, à la mort qui le condamne et prend chaque jour une forme différente, mais aussi à ses mécènes, à ses amis, à ses amours, à tous ceux qu’il connaît à Rome, à Malte, à Syracuse ou à Naples, à tous ceux qu’il ne connaît pas et dont il redoute les désirs et le ressentiment.
Là, le visible s’efface ; et ne dépend plus de rien, ni du temps ni de l’espace, ni des histoires personnelles ni d’aucune conception sur l’art. La peinture et le mystère se rejoignent, comme ils se sont rejoints un jour sur un mur de la grotte de Lascaux, comme ils continuent à coïncider par fois, follement, sans qu’on puisse savoir pourquoi ni comment.
La solitude du Caravage réside dans cet emportement qui l’amène à vivre la peinture comme un moyen pour atteindre le mystère ; et à vivre le mystère comme un moyen pour atteindre la peinture. Ce mystère serait-il le nom de quelque chose de plus grand que nous, ou le rien à quoi nos vies sont mêlées et vers quoi elles se compriment, il n’affirme de toute façon qu’une chose qui manque. Parfois, rien n’est plus clair.
Alors voici :à force de regarder la peinture du Caravage et de m’interroger sur son expérience intérieure, sur la nature de son angoisse, sur la progression du péché dans sa vie et l’intensité de ce qui, à la fois, le sépare et le rapproche de la lumière, je me suis aperçu que de tableau en tableau, centimètre après centimètre, il se rapprochait du Christ.
L’histoire du rapport entre le Caravage et le Christ mériterait la matière d’un livre entier ; en un sens, c’est l’objet de celui-ci -mais il n’est pas si facile d’y accéder :un tel objet ne peut être abordé qu’à travers les tours et détours d’une passion, elle-même hésitante et emportée, timide et contradictoire, qui avance et recule, s’enflamme, se refroidit — s’interroge : il faut du temps, des phrases, et la capacité de convertir la pensée qui vient de ces phrases et de ce temps en une expérience, c’est-à-dire un récit.
Autrement dit, il faut en passer par de la littérature :elle seule, aujourd’hui que l’ensemble des savoirs s’est rendu disponible à travers l’instantanéité d’un réseau planétaire qui égalise tous les discours et les réduit à déferler sous la forme d’une communication dévitalisée, se concentre sur la possibilité de sa solitude ;elle seule, par l’attention qu’elle ne cesse de développer à l’égard de ce qui rend si difficile l’usage du langage, donne sur l’abîme ; elle seule prend le temps de déployer une parole qui cherche et qui soit susceptible, à travers ses enveloppements, de faire face au néant, de détecter des brèches, de susciter des passages, de trouver des lumières.
Au fil des années, le Caravage se rapproche du Christ :on le mesure en observant l’évolution de leur distance dans les tableaux. En 1599, ils ne sont pas encore dans le même cadre : alors que Jésus se tient dans La Vocation de saint Matthieu, le Caravage est dans Le Martyre, le tableau d’en face — il est présent, d’une manière douloureuse, aux côtés du crime, plutôt que dans l’aura de la vocation. On a vu qu’il se contente de lancer, d’une toile à l’autre, un regard angoissé, honteux et peut-être défiant au Christ. L’innocence est impossible ; le Caravage est enfoncé dans l’épaisseur du péché ; et pourtant, il n’a pas encore tué.
À peine quatre ans plus tard, en 1603, le voici de plain-pied avec Jésus : il est présent dans la scène de L’Arrestation du Christ, ce tableau saisissant, plein de tumulte et de cris nocturnes, qu’on peut voir à la National Gallery de Dublin, où, dans une extraordinaire mêlée à sept personnages comprimés dans un étau de ténèbres, des soldats en armure s’emparent du Christ que Judas, aux traits déformés par la laideur morale, vient de trahir.
Tandis que le Christ, mains jointes et la tête enveloppée d’un large pan de manteau rouge qui protège sa lumière intérieure comme un dôme angélique, détourne son regard de ses agresseurs avec une douceur affligée, quelqu’un, isolé à droite du tableau et qui ne fait partie ni de la troupe des soldats ni de celle des apôtres, émerge de la masse en s’efforçant d’éclairer la scène à l’aide d’une lanterne qu’il lève au-dessus des têtes ; son visage est fatigué, mais il est dans la lumière, le regard tourné vers le Christ dont il essaie de s’approcher : c’est lui, c’est le Caravage. Le sens de cette métaphore est clair : par son art, le peintre s’efforce de se rendre présent aux temps sacrés, il éclaire le monde depuis l’invisible auquel l’ouvre la peinture ; mais on peut penser que, avec son visage levé avidement vers la scène, le Caravage fait plus qu’éclairer son atelier mental. Ses yeux tourmentés et sa bouche ouverte expriment une attente, comme si le Caravage cherchait avant tout à se rapprocher du Christ. Mais le salut n’est pas à sa portée : entre le Christ et lui, l’espace est bloqué (par des corps, par les fautes du Caravage) — la distance est encore grande entre les deux.
Et nous voici donc en 1609, en Sicile, à Messine : le Caravage est condamné à mort par le pape, recherché par l’Ordre de Malte, cerné par une vendetta personnelle ; il se cache et il peint - il n’y a pas plus seul au monde que lui.
En six ans, il a énormément peint le Christ, on se souvient, entre autres, des deux Flagellation. Voici qu’à grands traits ocre, rouges et noirs, négligeant désormais le détail des carnations pour approfondir avec plus d’intensité l’espace dramatique où entre vie et mort s’agitent les humains, il se consacre à ce qui est peut-être son plus grand tableau, le plus audacieux : La Résurrection de Lazare.
Il arrive qu’à force de regarder des peintures on se mette à voir quelque chose de très simple ; et que cette simplicité se change en lumière.
Depuis que je m’aventure à écrire sur la vie et l’art du Caravage — depuis qu’avec ce livre je me suis mis à chercher dans la matière de la peinture une vérité qui pourrait se dire —, je suis guetté par un mouvement qui abandonne mes phrases en même temps qu’il les appelle : elles semblent partir dans des directions qui m’échappent, et je ne les reconnais pas toujours ; mais je les laisse faire, car il me vient avec elles l’espérance qu’en se perdant elles parviennent à s’éclairer d’une lumière qui n’est pas seulement raisonnable, à glisser vers je ne sais quoi de plus ouvert que leur sens, à entrer dans un pays plus inconnu encore que la poésie, où la vérité fait des apparitions étranges, comme s’il existait encore autre chose que la nuit et le jour, un temps qui échappe à leur contradiction, qui n’a rien à voir avec leur succession, qui défait le visible en même temps que l’invisible.
La peinture a lieu ici, à ce point d’éclat où l’on ne s’appartient plus, où le Caravage échappe non seulement à ses bourreaux, à ses ennemis, aux chevaliers de l’Ordre, à la mort qui le condamne et prend chaque jour une forme différente, mais aussi à ses mécènes, à ses amis, à ses amours, à tous ceux qu’il connaît à Rome, à Malte, à Syracuse ou à Naples, à tous ceux qu’il ne connaît pas et dont il redoute les désirs et le ressentiment.
Là, le visible s’efface ; et ne dépend plus de rien, ni du temps ni de l’espace, ni des histoires personnelles ni d’aucune conception sur l’art. La peinture et le mystère se rejoignent, comme ils se sont rejoints un jour sur un mur de la grotte de Lascaux, comme ils continuent à coïncider par fois, follement, sans qu’on puisse savoir pourquoi ni comment.
La solitude du Caravage réside dans cet emportement qui l’amène à vivre la peinture comme un moyen pour atteindre le mystère ; et à vivre le mystère comme un moyen pour atteindre la peinture. Ce mystère serait-il le nom de quelque chose de plus grand que nous, ou le rien à quoi nos vies sont mêlées et vers quoi elles se compriment, il n’affirme de toute façon qu’une chose qui manque. Parfois, rien n’est plus clair.
Alors voici :à force de regarder la peinture du Caravage et de m’interroger sur son expérience intérieure, sur la nature de son angoisse, sur la progression du péché dans sa vie et l’intensité de ce qui, à la fois, le sépare et le rapproche de la lumière, je me suis aperçu que de tableau en tableau, centimètre après centimètre, il se rapprochait du Christ.
L’histoire du rapport entre le Caravage et le Christ mériterait la matière d’un livre entier ; en un sens, c’est l’objet de celui-ci -mais il n’est pas si facile d’y accéder :un tel objet ne peut être abordé qu’à travers les tours et détours d’une passion, elle-même hésitante et emportée, timide et contradictoire, qui avance et recule, s’enflamme, se refroidit — s’interroge : il faut du temps, des phrases, et la capacité de convertir la pensée qui vient de ces phrases et de ce temps en une expérience, c’est-à-dire un récit.
Autrement dit, il faut en passer par de la littérature :elle seule, aujourd’hui que l’ensemble des savoirs s’est rendu disponible à travers l’instantanéité d’un réseau planétaire qui égalise tous les discours et les réduit à déferler sous la forme d’une communication dévitalisée, se concentre sur la possibilité de sa solitude ;elle seule, par l’attention qu’elle ne cesse de développer à l’égard de ce qui rend si difficile l’usage du langage, donne sur l’abîme ; elle seule prend le temps de déployer une parole qui cherche et qui soit susceptible, à travers ses enveloppements, de faire face au néant, de détecter des brèches, de susciter des passages, de trouver des lumières.
Au fil des années, le Caravage se rapproche du Christ :on le mesure en observant l’évolution de leur distance dans les tableaux. En 1599, ils ne sont pas encore dans le même cadre : alors que Jésus se tient dans La Vocation de saint Matthieu, le Caravage est dans Le Martyre, le tableau d’en face — il est présent, d’une manière douloureuse, aux côtés du crime, plutôt que dans l’aura de la vocation. On a vu qu’il se contente de lancer, d’une toile à l’autre, un regard angoissé, honteux et peut-être défiant au Christ. L’innocence est impossible ; le Caravage est enfoncé dans l’épaisseur du péché ; et pourtant, il n’a pas encore tué.
À peine quatre ans plus tard, en 1603, le voici de plain-pied avec Jésus : il est présent dans la scène de L’Arrestation du Christ, ce tableau saisissant, plein de tumulte et de cris nocturnes, qu’on peut voir à la National Gallery de Dublin, où, dans une extraordinaire mêlée à sept personnages comprimés dans un étau de ténèbres, des soldats en armure s’emparent du Christ que Judas, aux traits déformés par la laideur morale, vient de trahir.
Tandis que le Christ, mains jointes et la tête enveloppée d’un large pan de manteau rouge qui protège sa lumière intérieure comme un dôme angélique, détourne son regard de ses agresseurs avec une douceur affligée, quelqu’un, isolé à droite du tableau et qui ne fait partie ni de la troupe des soldats ni de celle des apôtres, émerge de la masse en s’efforçant d’éclairer la scène à l’aide d’une lanterne qu’il lève au-dessus des têtes ; son visage est fatigué, mais il est dans la lumière, le regard tourné vers le Christ dont il essaie de s’approcher : c’est lui, c’est le Caravage. Le sens de cette métaphore est clair : par son art, le peintre s’efforce de se rendre présent aux temps sacrés, il éclaire le monde depuis l’invisible auquel l’ouvre la peinture ; mais on peut penser que, avec son visage levé avidement vers la scène, le Caravage fait plus qu’éclairer son atelier mental. Ses yeux tourmentés et sa bouche ouverte expriment une attente, comme si le Caravage cherchait avant tout à se rapprocher du Christ. Mais le salut n’est pas à sa portée : entre le Christ et lui, l’espace est bloqué (par des corps, par les fautes du Caravage) — la distance est encore grande entre les deux.
Et nous voici donc en 1609, en Sicile, à Messine : le Caravage est condamné à mort par le pape, recherché par l’Ordre de Malte, cerné par une vendetta personnelle ; il se cache et il peint - il n’y a pas plus seul au monde que lui.
En six ans, il a énormément peint le Christ, on se souvient, entre autres, des deux Flagellation. Voici qu’à grands traits ocre, rouges et noirs, négligeant désormais le détail des carnations pour approfondir avec plus d’intensité l’espace dramatique où entre vie et mort s’agitent les humains, il se consacre à ce qui est peut-être son plus grand tableau, le plus audacieux : La Résurrection de Lazare.
J’aimerais parler de l’expérience intérieure du Caravage ; pas seulement du feu qui anime son esprit, mais de ce qui a lieu lorsqu’il peint :de la vérité qui s’allume dès qu’un homme comme lui avance son pinceau vers une toile.
Les nuits blanches, les coups de foudre, l’exigence et les idées fixes, le désir sexuel, le vertige des trouvailles, les victoires secrètes, les milliers d’heures à regarder la toile, la rage et le découragement, l’obscurité soudaine et les sauts d’harmonie inouïs, les crises, les maladies, la torpeur, la frénésie, les engouements et l’endurance, la fatigue, les cauchemars, la peur d’être damné, la peur d’être tué, la violence physique, l’ardeur mystique, la rigueur de l’étude, le désir de perfection, l’ivresse et les débordements, l’amour extrême et l’extrême solitude : tout cela est-il racontable ?
Il y a une phrase du grand penseur franciscain Jean Duns Scot que je me répète depuis des années, et à laquelle je mesure tout : « Être une personne, c’est connaître la dernière des solitudes. » S’il y a quelqu’un sur cette terre qui a connu la dernière des solitudes, c’est bien le Caravage.
La vie des peintres est souvent tragique, parce qu’elle rejoue celle de la matière, qui crée des mondes et se décompose ; celle du Caravage est violente, brève, rapide : né en 1571, mort en 1610, il ne vit que trente-neuf ans. Originaire de Lombardie, dans le Nord de l’Italie, il se déplace sans cesse : Rome, Naples, puis Malte et la Sicile, et de nouveau Naples. En un peu plus de quinze ans, il peint une soixantaine de tableaux qui changent l’histoire du monde, séjourne plusieurs fois en prison (parfois, s’en évade) et, après avoir tué un homme, endure la vie des fugitifs. Protégé par une famille noble (selon certains historiens, il en serait peut-être un membre illégitime), aidé par des cardinaux et de nombreux mécènes qui collectionnent ses œuvres, son succès est aussi fulgurant que sa vie malheureuse.
On dit qu’il était irascible, impulsif, arrogant ; et qu’il ne cessait de se battre. Il fut le peintre le mieux payé de son temps ; et comme tel fut la proie de rivalités incessantes ; on le jalousait, il répliquait violemment ; on s’arrangea pour que la postérité réduisît son talent ; il surclassait ses collègues et choquait le goût de l’époque ; ses tableaux furent parfois décrochés des églises ; il fut souvent malade, blessé, fiévreux ; et s’il lui arriva d’être hébergé dans un palais, il préférait la vie des tavernes, le désordre des bouges et la fréquentation des putains à celle des prélats (il savait séduire aussi bien les uns que les autres) ; malgré son succès, et l’argent qu’il tirait de ses tableaux, il mourut pauvre, malade, absolument seul, comme u n misérable (ainsi son cadavre fut-il jeté dans une fosse commune).
On ne possède aucune lettre de lui, juste une signature, mêlée au sang de Jean-Baptiste, au bas d’un grand tableau qu’on peut admirer dans la cathédrale de La Valette, à Malte, où il vécut entre 1607 et 1608.
Il était le contemporain de Shakespeare, de Cervantes et de Monteverdi ; il peignait sans dessiner au préalable (et lui seul procédait ainsi) ; son atelier était entièrement noir, et ses modèles, trouvés dans la rue, se tenaient dans la pénombre ; il aimait les couteaux, les poignards, les épées :se vouer aux formes qui se disputent les ténèbres et la lumière implique d’être tranchant.
C’est le seul peintre de cette ampleur à avoir commis un crime ; et Stendhal, fasciné pourtant par les homicides, et grand connaisseur de la peinture italienne, y voit une raison pour le trouver négligeable. Mais beaucoup d’autres l’ont trouvé gênant, excessif, déplorable — Nicolas Poussin ne déclarait-il pas que le Caravage était venu pour « détruire la peinture » ? (On a découvert depuis que Poussin, en secret, en était admiratif et avait scrupuleusement copié La Mort de la Vierge.)
Les nuits blanches, les coups de foudre, l’exigence et les idées fixes, le désir sexuel, le vertige des trouvailles, les victoires secrètes, les milliers d’heures à regarder la toile, la rage et le découragement, l’obscurité soudaine et les sauts d’harmonie inouïs, les crises, les maladies, la torpeur, la frénésie, les engouements et l’endurance, la fatigue, les cauchemars, la peur d’être damné, la peur d’être tué, la violence physique, l’ardeur mystique, la rigueur de l’étude, le désir de perfection, l’ivresse et les débordements, l’amour extrême et l’extrême solitude : tout cela est-il racontable ?
Il y a une phrase du grand penseur franciscain Jean Duns Scot que je me répète depuis des années, et à laquelle je mesure tout : « Être une personne, c’est connaître la dernière des solitudes. » S’il y a quelqu’un sur cette terre qui a connu la dernière des solitudes, c’est bien le Caravage.
La vie des peintres est souvent tragique, parce qu’elle rejoue celle de la matière, qui crée des mondes et se décompose ; celle du Caravage est violente, brève, rapide : né en 1571, mort en 1610, il ne vit que trente-neuf ans. Originaire de Lombardie, dans le Nord de l’Italie, il se déplace sans cesse : Rome, Naples, puis Malte et la Sicile, et de nouveau Naples. En un peu plus de quinze ans, il peint une soixantaine de tableaux qui changent l’histoire du monde, séjourne plusieurs fois en prison (parfois, s’en évade) et, après avoir tué un homme, endure la vie des fugitifs. Protégé par une famille noble (selon certains historiens, il en serait peut-être un membre illégitime), aidé par des cardinaux et de nombreux mécènes qui collectionnent ses œuvres, son succès est aussi fulgurant que sa vie malheureuse.
On dit qu’il était irascible, impulsif, arrogant ; et qu’il ne cessait de se battre. Il fut le peintre le mieux payé de son temps ; et comme tel fut la proie de rivalités incessantes ; on le jalousait, il répliquait violemment ; on s’arrangea pour que la postérité réduisît son talent ; il surclassait ses collègues et choquait le goût de l’époque ; ses tableaux furent parfois décrochés des églises ; il fut souvent malade, blessé, fiévreux ; et s’il lui arriva d’être hébergé dans un palais, il préférait la vie des tavernes, le désordre des bouges et la fréquentation des putains à celle des prélats (il savait séduire aussi bien les uns que les autres) ; malgré son succès, et l’argent qu’il tirait de ses tableaux, il mourut pauvre, malade, absolument seul, comme u n misérable (ainsi son cadavre fut-il jeté dans une fosse commune).
On ne possède aucune lettre de lui, juste une signature, mêlée au sang de Jean-Baptiste, au bas d’un grand tableau qu’on peut admirer dans la cathédrale de La Valette, à Malte, où il vécut entre 1607 et 1608.
Il était le contemporain de Shakespeare, de Cervantes et de Monteverdi ; il peignait sans dessiner au préalable (et lui seul procédait ainsi) ; son atelier était entièrement noir, et ses modèles, trouvés dans la rue, se tenaient dans la pénombre ; il aimait les couteaux, les poignards, les épées :se vouer aux formes qui se disputent les ténèbres et la lumière implique d’être tranchant.
C’est le seul peintre de cette ampleur à avoir commis un crime ; et Stendhal, fasciné pourtant par les homicides, et grand connaisseur de la peinture italienne, y voit une raison pour le trouver négligeable. Mais beaucoup d’autres l’ont trouvé gênant, excessif, déplorable — Nicolas Poussin ne déclarait-il pas que le Caravage était venu pour « détruire la peinture » ? (On a découvert depuis que Poussin, en secret, en était admiratif et avait scrupuleusement copié La Mort de la Vierge.)
C’est le monde entier, ce sont des poires, des figues, des prunes, des iris, des œillets, des jasmins, du genêt, de la vigne, des gouttes de rosée, la corde cassée d’un luth, un miroir et une carafe, une corbeille débordant de raisins, un garçonnet en chemise blanche qui pèle un fruit, un sabre taché de sang, des couteaux, des violons, tout un monde rouge et torturé qui étincelle ; et voici d’autres lumières, d’autres ombres, saint Paul désarçonné, Isaac le couteau sous la gorge, un Baptiste buvant à la fontaine et Salomé portant sa tête dans un plat, Jean-Baptiste, encore lui, hilare et jeune, enlaçant un bouc, puis une tablée de joueurs de cartes agitée de tricheurs, des pèlerins, des apôtres, des fossoyeurs, des bourreaux, quelques anges qui sourient, une croix, des culs, des seins, des épaules dénudées, des lèvres qui séduisent, une diseuse de bonne aventure, une petite sainte en pleurs, des reflets qui vous ouvrent au ciel, au dieu qui resplendit ou qui s’éteint, des éclats de ciel noir, des éclats de ciel rouge, des éclats de rien, une perle nouée d’un papillon noir, un flacon abandonné, un collier, des brocarts bleus et verts, des robes de courtisanes, des bergers, des Bacchus repus et charmeurs, et mêlés à la Passion du Christ des trognes de bourreaux qui s’acharnent, grimacent et flagellent, des ermites qui écrivent, un crâne à la main, drapés de rouge, des ramures d’automne desséchées jaune et ocre, un bouc, un agneau, un âne et des molènes, une Vierge qui endort l’Enfant au son du violon d’un ange, un petit gobelet qui rappelle le baptême où je n’en finis plus de boire en rêve, une jeune larme qui coule sur la joue d’une Madeleine inconsolable, quelques boutons de nacre, une écuelle et des ombres violettes, des bouches qui crient, du sang qui coule, des chapeaux à plumes qui flamboient et des pourpoints rayés de jaune, des gants percés, des cartes biseautées, des têtes empanachées, des têtes coupées, de belles dames au regard qui fuit, des vauriens grimés en petits dieux, l’un arborant une couronne de lauriers, une coupe de vin noir à la main, l’autre le visage vert d’un Bacchus malade, un autre encore mordu par un lézard, et qui geint comme un petit porc, et de nouveau le rondouillard, avec son air vicieux d’empereur dans l’orgie, et de nouveau la splendeur qui vous chavire, le Christ mort et pourtant plus vivant que nous tous, et l’œil d’Isaac effaré sous le couteau, et l’ombre insensée, la clarté qui tue, un tabouret qui vacille au bord du vide sous le poids de Matthieu écrivant son Évangile, et lorsqu’on ferme les yeux, tous les détails qui vibrent et glissent d’un tableau vers l’autre, la vision qui se brouille juste avant la joie, et voici, dans un éclair, abrupte comme une apparition, la Vierge allongée, morte, au-dessous d’un drap rouge où s’enveloppe en silence le nom secret de toute présence, ses pieds nus qui dépassent, fragiles, comme en lévitation, et le baquet au bas du lit où l’on devine l’éponge, l’eau usée, la merde, le crâne de Goliath, le reflet de Narcisse, David torse nu brandissant la tête du Caravage, le cri rond de Méduse, la croupe blanche d’un cheval, des pieds sales, des ongles noirs, la roue dentée de Catherine, le corps percé du Christ, un serpent écrasé, un ange au sexe heureux, de nouveau des saints qui écrivent, et le Christ à la colonne, le Christ capturé, le Christ couronné, le Christ renié par Pierre, flagellé, déposé au tombeau, et son bras levé vers Matthieu qui sépare la lumière et les ténèbres, qui conçoit comme un peintre la matière des choses, un mélange, une pâte, un prisme, et avec les couleurs voici de nouveau le visible en extase, la joie d’un Amour victorieux, la main de sainte Ursule caressant la flèche qui la transperce, saint François s’évanouissant entre les bras d’un ange, puis de nouveau Isaac, Salomé, Judith, la Vierge et l’Enfant, Jean-Baptiste, des draps rouges, des draps blancs, un crâne et des feuillages, la chair qui en jouissant éclaire notre vertige, une pluie dorée imprégnant un corsage, une semence inconnue qui se mêle aux pigments et fait naître la peinture ;et à travers tous ces corps, toutes ces choses, une seule lumière, discrète, insistante, sacrée, qui prend mille apparences et ne brille que pour vous, l’éclat de l’être l’aimé qui s’annonce et disparaît en silence, comme font les dieux, les déesses, et qui, en se dissipant dans la fatigue de cette nuit, vous comble, comme le plus réussi des baisers.
Est-ce que nous répondons vraiment à la parole ? Est-ce que nous vivons selon la vérité ? La peinture du Caravage mène à ce point où il n’est plus possible de se mentir. C’est un point où l’on est enfin vivant, où la source existe infiniment — et à chaque instant. Où plus rien ne nous sépare du temps. Où celui-ci se donne à nous, et où nous nous donnons à lui. La peinture et la littérature existent là.
Je m’arrête. Lorsqu’ils disaient adieu à un être aimé, les Romains ouvraient une fenêtre et d’une voix forte, afin qu’on l’entende jusqu’aux collines, scandaient trois fois son nom : Caravaggio ! Caravaggio ! Caravaggio !
Je m’arrête. Lorsqu’ils disaient adieu à un être aimé, les Romains ouvraient une fenêtre et d’une voix forte, afin qu’on l’entende jusqu’aux collines, scandaient trois fois son nom : Caravaggio ! Caravaggio ! Caravaggio !
Depuis Dostoïevski, nous savons que le crime ne s'arrête pas à l'acte, mais que la vie d'un criminel en fuite est déjà son châtiment : celui qui tue un homme pour s'en débarrasser ne fait plus que vivre avec lui.
Le Caravage peint ici un vieil homme au visage las, au corps un peu flasque, aux mains toutes calleuses, un pauvre vieux absolument pas idéalisé, sans auréole ni regard chaviré ni angelots qui tournoieraient pour son salut, un vieillard vêtu d'un simple pagne blanc qui lui ceint les hanches, livré à la dureté sans horizon d'un monde rempli intégralement par la tâche de le faire mourir, et dont le regard à demi clos se perd vers la vie qui le lâche, vers le rien.
Le grand projet occidental des Temps modernes, en assurant à l'Homme la maîtrise technique sur l'entièreté du monde, a consisté à évacuer tout ce qui menace son règne, c'est à dire à refouler le sacré.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Yannick Haenel (20)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les écrivains et le suicide
En 1941, cette immense écrivaine, pensant devenir folle, va se jeter dans une rivière les poches pleine de pierres. Avant de mourir, elle écrit à son mari une lettre où elle dit prendre la meilleure décision qui soit.
Virginia Woolf
Marguerite Duras
Sylvia Plath
Victoria Ocampo
8 questions
1754 lecteurs ont répondu
Thèmes :
suicide
, biographie
, littératureCréer un quiz sur ce livre1754 lecteurs ont répondu