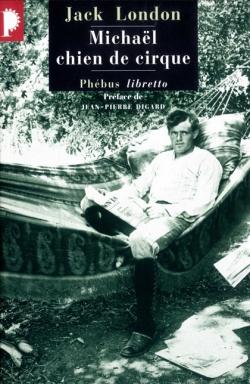>
Critique de Erik35
ULTIME COMBAT.
Pour que les choses soient claires : Non ! Encore non ! Définitivement non ! Et moins encore que ne le pouvait être son ouvrage précédent, Jerry, chien des îles, déjà excessivement sombre et déprimé, ce roman, intitulé en américain "Michaël, frère de Jerry", le dernier que Jack London aura eu le temps de rédiger intégralement avant son décès anticipé, mais qui ne sera édité qu'à titre posthume, n'est pas, n'a jamais voulu être - sauf à en donner des versions totalement édulcorées et très "choisies"-, ne sera jamais un "Roman pour la Jeunesse". C'est même pour ainsi dire tout le contraire de ce que l'on peut imaginer en matière de littérature pour les plus jeunes.
De même, malgré un titre plus que douteux - voir au-dessus -, en terme de traduction de l'américain vers le français (merci aux éditeurs du début du XXème siècle, assez peu regardant en la matière), Michaël, chien de cirque parle, en réalité, très peu de cirque, mais beaucoup de misère, de souffrance, de bêtise, de bestialité. Les amateurs de traditions circassiennes - en dehors de l'évocation finale de quelques unes des pires en matière de dressage - en seront pour leur frais.
Ceci posé, il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet...
A la fin du précédent volume, Jerry, chien des îles, conçu comme la première partie d'un dyptique consacré à la condition animale, nous avions donc laissé Jerry entre les mains câlines et précautionneuses du couple Kennan (portrait édulcoré et fantasmé de Jack et Charmian London eux-mêmes), tandis que son frère Michaël, le plus joueur et remuant des deux, se retrouve confié au capitaine d'un véritable négrier, les éleveurs de ces deux Irish Terriers les ayant purement et simplement dressés à garder des esclaves noirs... Mais ce capitaine oublie fort opportunément notre héros à quatre pattes sur la plage de la dernière île où il a amarré son navire, ce qui permettra au brave Dag Daughtry, steward de son état et grand buveur devant l'éternel - il lui faut ses douze choppes quotidiennes minimum, sans quoi il fait un scandale, où qu'il se trouve -. Mais de boire de telles quantités de bière coûte cher et il lui faut souvent trouver des expédients. L'homme est brave, a-t-on déjà dit, et cette bonhomie se double d'un don assez fabuleux avec la gent animale. Ainsi est-il le fournisseur plus ou moins attitré d'autres amoureux des bêtes de compagnie (jamais il ne vendrait un animal à un mauvais maître), mais lorsque l'on passe son temps à naviguer, difficile d'avoir son propre élevage. Alors... Notre homme est-il un peu voleur, et pas que sur les bords. Bien entendu, il se trouve, chaque fois, d'excellentes raisons pour pratiquer cet art. En l'occurrence, il serait absolument stupide, criminel même, d'abandonner à son triste sort un si beau représentant de la race Irish. Ni une, ni deux, le jeune Michael se fait alpaguer - en douceur et délicatesse - par le marin, qui l'apprivoise incontinent et fini même par s'y attacher au point d'être totalement incapable de s'en séparer. Bien entendu, moult aventures attendent notre chien en compagnie de son nouveau maître et de son quasi esclave "nègre", un autochtone des îles Salomon que Daughtry a sauvé alors que le "sauvage" allait se faire tailler en pièce sur la plage par deux frères armés de sagaies et souhaitant ainsi venger la mort de leur porc préféré... Ce que ni ce noir, répondant au sobriquet de Kwaque, ni son "maître" ne savent c'est que l'aborigène est atteint d'une des formes de cette maladie fatale, atroce et progressive : la lèpre...
Nos trois héros - du moins, soyons honnêtes : nos deux héros, plus un noir. le racisme étant alors encore plus prégnant que de nos jours, et London n'échappait malheureusement pas à cette forme hideuse d'idéologie, basée sur de pseudo-sciences, et malgré toutes les autres qualités que l'on peut lui attribuer par ailleurs -, nos personnages, donc, passent d'un navire à un autre (parce que l'ancien maître de Michael a retrouvé sa trace), et ils se retrouvent sur un voilier partant à la recherche d'un fabuleux trésor, promis par un vieux marinier extraordinaire à trois hommes vils, assoiffés par l'or, et sans âme ou peu s'en faut, surtout l'un d'entre eux, un usurier juif énorme et totalement infatué de sa personne. le marinier et le steward vont finir par se lier d'une franche et noble amitié au point que le vieillard lui avouera l'absence total du fameux trésor ! Cependant, l'usurier pique deplus en plus de colères soudaines, au fur et à mesure de l'infructuosité de leurs recherches, au point que celui-ci va finir par provoquer un accident aussi stupide que monstrueux. Référence-révérence à peine cachée à Moby Dick que l'auteur affectionnait, London va faire tuer par ce sale type, de manière absolument gratuite et à la carabine, un baleineau, sa mère cherchant aussitôt à tromper son désespoir en faisant couler, coup boutoir après coup de boutoir, le voilier. L'équipage et nos héros s'en sortent indemne et finissent par se retrouver à bord d'un paquebot où ils deviennent de véritables stars, Michaël ayant un véritable don de chanteur canin lorsque son maître entonne des airs populaires de l'époque.
De fil en aiguille, nos compères se retrouvent à San Francisco où Daughtry utilise - sans jamais en abuser - des talents de son compagnon à poils durs pour parvenir à nourrir et loger tout le monde. Hélas, un médecin célèbre mais véreux ainsi qu'un jeune dresseur de chien sans sentiment vont finir, l'un d'abord, le second ensuite, par parvenir à se saisir de notre infortuné canidé.
C'est à partir de ce moment que tout va de mal en pis pour Michaël. En plus de la perte définitive de son maître adoré - mis à l'enfermement à vie dans la léproserie de San Francisco, en compagnie de Kwaque -, il se retrouve entre les mains du pire dresseur de la côte est, où il est envoyé sans ménagement. Nous sommes alors à plus des deux-tiers du roman de London, mais c'est un pur enfer animalier qu'il décrit alors. Rien n'y échappe : mauvais traitements, bastonnades, abandons, travaux et répétitions sas fin, et souvent jusqu'à ce que mort s'en suive. Encore notre ami poilu a-t-il, vaguement, la chance d'être chez un dresseur qui nourrit et entretient convenablement, bien que sans le moindre sentiment ni la moindre tendresse, ses bêtes. Parce que le portrait d'autres dresseurs que London nous dresse est souvent à la limite de l'insupportable. Il n'empêche : celui qui a kidnappé Michaël et qui en connaissait les talents n'a rien eu le temps d'en dire à son propre maître, et trouve la fort mauvaise idée de mourir accidentellement avant de s'en expliquer. Harry Collins, le grand dresseur de l'est va donc chercher, par toutes sortes de moyens plus affligeants et douloureux les uns que les autres, à découvrir le secret du chien. En vain. Jusqu'à un hasard des plus fortuits. Dès lors, il va être confié à un autre dresseur, ni bon, ni mauvais, une sorte d'âme morte pour lui-même et donc pour tout ce qui peut vivre alentour. Là, hasard inouï, il va être reconnu pour le frère de Jerry par le fameux couple de la fin du volume précédent. Et comme pour ce premier des deux romans, London va y insérer une très claire référence à son chef d'oeuvre Croc-Blanc, faisant retrouver l'aboiement par deux fois à un Michael qui avait perdu cette manifestation de joie ou de mise en garde à force de mauvais traitements. Mieux, comme le Croc-Blanc des débuts, il va sauver son maître des griffes d'un abominable assassin.
A lire ce -long- résumé, on ne peut sentir à quel point ce récit, pourtant émaillé de moments emplis de douce jovialité, de pointes d'humour même, est sombre et terriblement désabusé. Depuis 1913, London essuie échecs sur échecs, à l'exemple de ses (terrifiants) Mutinés de l'Elseneur. le Vagabond des Etoiles, qui est pourtant, sans aucun conteste, l'un de ses textes les plus beaux et aboutis, ne rencontre pas son public, sans doute plus intéressé par les remous internationaux qui agitent l'Europe. Il y a aussi la destruction - possiblement meurtrière - de la maison qu'il avait intégralement conçue. Par ailleurs, le torchon brûle entre les socialistes américains, qu'il accuse d'être trop timorés, et lui. Il y a enfin la maladie et la drogue (des dérivés de l'opium) pour essayer de supporter la douleur. L'alcool aussi, toujours, plus que jamais.
Jack London n'a encore que trente-neuf ans lorsqu'il achève cet ultime roman, il ne lui reste plus qu'une année tout juste à vivre, et l'on sent à quel point il est devenu un homme au bord du gouffre, revenu d'à peu près tout, croyant de moins en moins à des lendemains qui pourraient chanter. Sans doute s'est-il aussi embourgeoisé, lui qui a toujours honni cette race d'êtres humains se croyant "arrivé" alors qu'elle est au mieux futile et égoïste, au pire une monstruosité froide. Alors, London essaie encore de croire en quelques hommes épars, que la maladie du pouvoir et de l'or n'ont pas encore atteint. Mais pour le reste, il n'a plus que dégoût et même mépris. A commencer, peut-être, pour lui-même. Mais l'on ne se nomme pas Jack London sans combattre jusqu'au bout. Et cet ultime combat, ce sera celui de la cause animale, une cause qu'il a toujours défendue, lui qui aimait tant les bêtes, sauvages ou domestiques. Il faut le voir dans son ranch de la"Vallée de la Lune", prendre ses porcs à bras le corps, leur prodiguant caresses viriles et chatouillis plein d'amour ! Et il en était de même avec tous les animaux qu'il put posséder, détestant plus que tout les représentations animalières et ces scènes de dressage où l'homme et l'animal ne sont supposés faire qu'un. Lui, l'homme des coulisses et le grand reporter accompli savait que, bien souvent, trop souvent, il n'en était rien, que l'animal n'était qu'un vulgaire gagne-pain, éminemment remplaçable et de préférence à vil prix.
Il parait qu'après a publication de ce véritable pamphlet anti dressage, l'année après son décès, une flopée d'associations "Jack London" défendant la cause animale virent le jour aux Etats-Unis. Dans le même temps, le Ku-Klux-Klan continuait à imposer sa loi de feu et d'airain dans les états du vieux sud, la ségrégation avait encore de beaux jours devant elle, et la situation des noirs américains était, globalement, désastreuse. Rapprocher ces deux faits sans rapport direct peut sembler choquant. Pourtant, ils ont parfaitement coexisté, car lorsqu'une certaine forme d'animalisme prend le pas sur un humanisme ouvert, universel et tolérant, on comprend que l'essentielle protection de nos amis et compagnons à poils ou à plumes peut cacher la forêt des pires crimes de l'humanité contre elle-même. C'est aussi cela, la leçon parfaitement involontaire de ce London totalement désabusé. Mais c'est aussi pour tous ces défauts, ces luttes perdues d'avance, ces retournements, ces combats incertains et fous, qu'il demeure, à l'aube du XXIème siècle, l'un des plus grands génies romanesques de tous les temps.
Pour que les choses soient claires : Non ! Encore non ! Définitivement non ! Et moins encore que ne le pouvait être son ouvrage précédent, Jerry, chien des îles, déjà excessivement sombre et déprimé, ce roman, intitulé en américain "Michaël, frère de Jerry", le dernier que Jack London aura eu le temps de rédiger intégralement avant son décès anticipé, mais qui ne sera édité qu'à titre posthume, n'est pas, n'a jamais voulu être - sauf à en donner des versions totalement édulcorées et très "choisies"-, ne sera jamais un "Roman pour la Jeunesse". C'est même pour ainsi dire tout le contraire de ce que l'on peut imaginer en matière de littérature pour les plus jeunes.
De même, malgré un titre plus que douteux - voir au-dessus -, en terme de traduction de l'américain vers le français (merci aux éditeurs du début du XXème siècle, assez peu regardant en la matière), Michaël, chien de cirque parle, en réalité, très peu de cirque, mais beaucoup de misère, de souffrance, de bêtise, de bestialité. Les amateurs de traditions circassiennes - en dehors de l'évocation finale de quelques unes des pires en matière de dressage - en seront pour leur frais.
Ceci posé, il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet...
A la fin du précédent volume, Jerry, chien des îles, conçu comme la première partie d'un dyptique consacré à la condition animale, nous avions donc laissé Jerry entre les mains câlines et précautionneuses du couple Kennan (portrait édulcoré et fantasmé de Jack et Charmian London eux-mêmes), tandis que son frère Michaël, le plus joueur et remuant des deux, se retrouve confié au capitaine d'un véritable négrier, les éleveurs de ces deux Irish Terriers les ayant purement et simplement dressés à garder des esclaves noirs... Mais ce capitaine oublie fort opportunément notre héros à quatre pattes sur la plage de la dernière île où il a amarré son navire, ce qui permettra au brave Dag Daughtry, steward de son état et grand buveur devant l'éternel - il lui faut ses douze choppes quotidiennes minimum, sans quoi il fait un scandale, où qu'il se trouve -. Mais de boire de telles quantités de bière coûte cher et il lui faut souvent trouver des expédients. L'homme est brave, a-t-on déjà dit, et cette bonhomie se double d'un don assez fabuleux avec la gent animale. Ainsi est-il le fournisseur plus ou moins attitré d'autres amoureux des bêtes de compagnie (jamais il ne vendrait un animal à un mauvais maître), mais lorsque l'on passe son temps à naviguer, difficile d'avoir son propre élevage. Alors... Notre homme est-il un peu voleur, et pas que sur les bords. Bien entendu, il se trouve, chaque fois, d'excellentes raisons pour pratiquer cet art. En l'occurrence, il serait absolument stupide, criminel même, d'abandonner à son triste sort un si beau représentant de la race Irish. Ni une, ni deux, le jeune Michael se fait alpaguer - en douceur et délicatesse - par le marin, qui l'apprivoise incontinent et fini même par s'y attacher au point d'être totalement incapable de s'en séparer. Bien entendu, moult aventures attendent notre chien en compagnie de son nouveau maître et de son quasi esclave "nègre", un autochtone des îles Salomon que Daughtry a sauvé alors que le "sauvage" allait se faire tailler en pièce sur la plage par deux frères armés de sagaies et souhaitant ainsi venger la mort de leur porc préféré... Ce que ni ce noir, répondant au sobriquet de Kwaque, ni son "maître" ne savent c'est que l'aborigène est atteint d'une des formes de cette maladie fatale, atroce et progressive : la lèpre...
Nos trois héros - du moins, soyons honnêtes : nos deux héros, plus un noir. le racisme étant alors encore plus prégnant que de nos jours, et London n'échappait malheureusement pas à cette forme hideuse d'idéologie, basée sur de pseudo-sciences, et malgré toutes les autres qualités que l'on peut lui attribuer par ailleurs -, nos personnages, donc, passent d'un navire à un autre (parce que l'ancien maître de Michael a retrouvé sa trace), et ils se retrouvent sur un voilier partant à la recherche d'un fabuleux trésor, promis par un vieux marinier extraordinaire à trois hommes vils, assoiffés par l'or, et sans âme ou peu s'en faut, surtout l'un d'entre eux, un usurier juif énorme et totalement infatué de sa personne. le marinier et le steward vont finir par se lier d'une franche et noble amitié au point que le vieillard lui avouera l'absence total du fameux trésor ! Cependant, l'usurier pique deplus en plus de colères soudaines, au fur et à mesure de l'infructuosité de leurs recherches, au point que celui-ci va finir par provoquer un accident aussi stupide que monstrueux. Référence-révérence à peine cachée à Moby Dick que l'auteur affectionnait, London va faire tuer par ce sale type, de manière absolument gratuite et à la carabine, un baleineau, sa mère cherchant aussitôt à tromper son désespoir en faisant couler, coup boutoir après coup de boutoir, le voilier. L'équipage et nos héros s'en sortent indemne et finissent par se retrouver à bord d'un paquebot où ils deviennent de véritables stars, Michaël ayant un véritable don de chanteur canin lorsque son maître entonne des airs populaires de l'époque.
De fil en aiguille, nos compères se retrouvent à San Francisco où Daughtry utilise - sans jamais en abuser - des talents de son compagnon à poils durs pour parvenir à nourrir et loger tout le monde. Hélas, un médecin célèbre mais véreux ainsi qu'un jeune dresseur de chien sans sentiment vont finir, l'un d'abord, le second ensuite, par parvenir à se saisir de notre infortuné canidé.
C'est à partir de ce moment que tout va de mal en pis pour Michaël. En plus de la perte définitive de son maître adoré - mis à l'enfermement à vie dans la léproserie de San Francisco, en compagnie de Kwaque -, il se retrouve entre les mains du pire dresseur de la côte est, où il est envoyé sans ménagement. Nous sommes alors à plus des deux-tiers du roman de London, mais c'est un pur enfer animalier qu'il décrit alors. Rien n'y échappe : mauvais traitements, bastonnades, abandons, travaux et répétitions sas fin, et souvent jusqu'à ce que mort s'en suive. Encore notre ami poilu a-t-il, vaguement, la chance d'être chez un dresseur qui nourrit et entretient convenablement, bien que sans le moindre sentiment ni la moindre tendresse, ses bêtes. Parce que le portrait d'autres dresseurs que London nous dresse est souvent à la limite de l'insupportable. Il n'empêche : celui qui a kidnappé Michaël et qui en connaissait les talents n'a rien eu le temps d'en dire à son propre maître, et trouve la fort mauvaise idée de mourir accidentellement avant de s'en expliquer. Harry Collins, le grand dresseur de l'est va donc chercher, par toutes sortes de moyens plus affligeants et douloureux les uns que les autres, à découvrir le secret du chien. En vain. Jusqu'à un hasard des plus fortuits. Dès lors, il va être confié à un autre dresseur, ni bon, ni mauvais, une sorte d'âme morte pour lui-même et donc pour tout ce qui peut vivre alentour. Là, hasard inouï, il va être reconnu pour le frère de Jerry par le fameux couple de la fin du volume précédent. Et comme pour ce premier des deux romans, London va y insérer une très claire référence à son chef d'oeuvre Croc-Blanc, faisant retrouver l'aboiement par deux fois à un Michael qui avait perdu cette manifestation de joie ou de mise en garde à force de mauvais traitements. Mieux, comme le Croc-Blanc des débuts, il va sauver son maître des griffes d'un abominable assassin.
A lire ce -long- résumé, on ne peut sentir à quel point ce récit, pourtant émaillé de moments emplis de douce jovialité, de pointes d'humour même, est sombre et terriblement désabusé. Depuis 1913, London essuie échecs sur échecs, à l'exemple de ses (terrifiants) Mutinés de l'Elseneur. le Vagabond des Etoiles, qui est pourtant, sans aucun conteste, l'un de ses textes les plus beaux et aboutis, ne rencontre pas son public, sans doute plus intéressé par les remous internationaux qui agitent l'Europe. Il y a aussi la destruction - possiblement meurtrière - de la maison qu'il avait intégralement conçue. Par ailleurs, le torchon brûle entre les socialistes américains, qu'il accuse d'être trop timorés, et lui. Il y a enfin la maladie et la drogue (des dérivés de l'opium) pour essayer de supporter la douleur. L'alcool aussi, toujours, plus que jamais.
Jack London n'a encore que trente-neuf ans lorsqu'il achève cet ultime roman, il ne lui reste plus qu'une année tout juste à vivre, et l'on sent à quel point il est devenu un homme au bord du gouffre, revenu d'à peu près tout, croyant de moins en moins à des lendemains qui pourraient chanter. Sans doute s'est-il aussi embourgeoisé, lui qui a toujours honni cette race d'êtres humains se croyant "arrivé" alors qu'elle est au mieux futile et égoïste, au pire une monstruosité froide. Alors, London essaie encore de croire en quelques hommes épars, que la maladie du pouvoir et de l'or n'ont pas encore atteint. Mais pour le reste, il n'a plus que dégoût et même mépris. A commencer, peut-être, pour lui-même. Mais l'on ne se nomme pas Jack London sans combattre jusqu'au bout. Et cet ultime combat, ce sera celui de la cause animale, une cause qu'il a toujours défendue, lui qui aimait tant les bêtes, sauvages ou domestiques. Il faut le voir dans son ranch de la"Vallée de la Lune", prendre ses porcs à bras le corps, leur prodiguant caresses viriles et chatouillis plein d'amour ! Et il en était de même avec tous les animaux qu'il put posséder, détestant plus que tout les représentations animalières et ces scènes de dressage où l'homme et l'animal ne sont supposés faire qu'un. Lui, l'homme des coulisses et le grand reporter accompli savait que, bien souvent, trop souvent, il n'en était rien, que l'animal n'était qu'un vulgaire gagne-pain, éminemment remplaçable et de préférence à vil prix.
Il parait qu'après a publication de ce véritable pamphlet anti dressage, l'année après son décès, une flopée d'associations "Jack London" défendant la cause animale virent le jour aux Etats-Unis. Dans le même temps, le Ku-Klux-Klan continuait à imposer sa loi de feu et d'airain dans les états du vieux sud, la ségrégation avait encore de beaux jours devant elle, et la situation des noirs américains était, globalement, désastreuse. Rapprocher ces deux faits sans rapport direct peut sembler choquant. Pourtant, ils ont parfaitement coexisté, car lorsqu'une certaine forme d'animalisme prend le pas sur un humanisme ouvert, universel et tolérant, on comprend que l'essentielle protection de nos amis et compagnons à poils ou à plumes peut cacher la forêt des pires crimes de l'humanité contre elle-même. C'est aussi cela, la leçon parfaitement involontaire de ce London totalement désabusé. Mais c'est aussi pour tous ces défauts, ces luttes perdues d'avance, ces retournements, ces combats incertains et fous, qu'il demeure, à l'aube du XXIème siècle, l'un des plus grands génies romanesques de tous les temps.