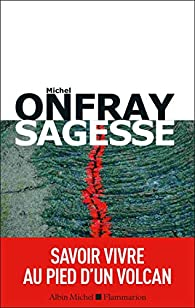>
Critique de Laumness
Voilà un essai qui contient de bons principes et des passages instructifs, mais dont le résultat n'est pas à la hauteur des ambitions, de ce qu'on est en droit d'attendre d'un livre de sagesse, et dont la lecture s'avère assez souvent irritante du fait d'interprétations contestables, voire fallacieuses.
L'intention première de Michel Onfray est louable : mettre en relief la philosophie romaine en tant qu'école de vertu, par l'évocation de diverses figures qui incarnent de nobles qualités, à savoir le courage, la volonté, la loyauté, la fidélité, la frugalité, la dignité, toutes les valeurs grâce auxquelles un individu peut se tenir débout, droit, en marche vers la grandeur. À la différence de la philosophie grecque, jugée plus spéculative ou métaphysique, la philosophie romaine se veut une pratique des vertus, ce dernier mot désignant en latin les qualités viriles, propres à l'homme, faisant de lui un être qui travaille à l'accomplissement de son humanité par l'exercice de ces qualités qui ne sont pas des possessions, mais des biens immatériels. Chez ce peuple de guerriers, le sens de l'honneur commande de ne pas se refuser au combat, mais d'y mettre toute son ardeur, sous peine d'être déshonoré et acculé à la honte et même au suicide. La belle vertu qu'est la fides, mot dont sont dérivés en français la foi, la fidélité et la confiance et que Cicéron place au coeur de l'amitié véritable, est une qualité hautement estimée, un lien invisible entre seuls les gens de bien, et elle n'est pas dissociable du respect de la parole donnée, car la parole engage dès lors qu'elle est expression de l'être. Les Romains dignes d'admiration sont aussi des personnes vivant dans la sobriété, non affalés sur des coussins lors de banquets à la Pétrone, et sachant manier aussi bien le glaive que les instruments utiles à la culture des champs. Il faut reconnaître à Michel Onfray une démarche qui ne manque pas de volonté de grandeur, parce que les modèles donnés restent, après deux millénaires, des exemples à méditer et imiter. En effet, rien ne forme mieux une personne que le récit de la vie d'hommes et de femmes illustres, parfois connus pour un seul geste, mais un geste qui revêt une valeur d'édification, sans moraline ni catéchisme. Il faut aussi reconnaître que l'auteur a un certain talent de conteur et d'historien lorsqu'il narre les épisodes de la vie de Caton l'Ancien, de Scaevola, des Gracques... Son ouvrage se révèle à mes yeux le plus intéressant dans ces parties narratives et historiques et dans les portraits, servant d'intermèdes, des principaux philosophes romains : Cicéron, Lucrèce, Sénèque (les pages décrivant sa « double vie » sont assez savoureuses), Marc Aurèle, Épictète, Plutarque et Lucien de Samosate (quoique ces derniers aient écrit en grec…). Aujourd'hui, comme hier, l'importance des Romains est majeure en termes de modèle de civilisation et de noblesse individuelle et devrait justifier l'étude rigoureuse de leur culture, leur droit et leur langue : ce devrait être au programme de toutes les bonnes écoles, quoi qu'en pensent nos ministres et experts en management.
Cet essai, qui débute par le souvenir de l'éruption du Vésuve en guise d'allégorie nous invitant à savoir vivre au pied d'un volcan, du péril et de la destruction, est construit en trois grandes parties, intitulées « Soi – Une éthique de la dignité », « Les Autres – Une morale de l'humanité » et « le Monde – Une écosophie des choses », parties elles-mêmes divisées en plusieurs chapitres dont les titres sont formés d'un verbe seul : « Penser », « Exister », « Contempler », « Rire », etc. Chaque chapitre s'appuie sur l'histoire d'une grande figure romaine pour donner matière à des réflexions philosophiques, par exemple le viol de Lucrèce pour mettre en exergue la vengeance en lien avec la quête d'honneur familial et de pureté retrouvée. Il peut sembler très ambitieux de vouloir traiter autant de sujets (l'amitié, l'amour, le suicide, la mort, la consolation, la croyance, l'action politique, etc.) en seulement une vingtaine de pages par thème. Si l'ambition est de dresser un vaste panorama des attributs de la sagesse, l'impression regrettable est de survoler ce qui ne peut être envisagé avec superficialité, ce qui mérite d'être approfondi pas nécessairement en noircissant des pages et en publiant cinq ou six livres par an, mais en creusant plus encore des questions essentielles avant de partager les fruits de sa recherche philosophique – et la profondeur ne dédaigne pas la concision. Michel Onfray semble avoir écrit plus pour des étudiants et des amateurs de philosophie que pour de fins lettrés et de vrais philosophes, d'où des répétitions, des explicitations didactiques et des lourdeurs de style ; et sa thèse selon laquelle le judéo-christianisme a mis fin aux vertus romaines et qu'il importe de renouer avec celles-ci pour sortir du nihilisme pourrait s'énoncer comme je viens de le faire, sans besoin de l'assener jusqu'à la rendre indigeste, d'autant qu'elle est fausse – j'y reviendrai.
Sans commenter tous les chapitres, dont certains sont convaincants, en particulier ceux sur les rapports entre maître et discipline, sur la réflexion et sur la vieillesse, je souhaite pointer quelques éléments d'une philosophie matérialiste qui suscitent chez moi de sérieuses réserves, pour ne pas dire une opposition franche. S'agissant du suicide, Michel Onfray relate les fins – en fait ordonnées par le régime – de Socrate et de Sénèque pour illustrer combien la mort volontaire peut être un acte maîtrisé par la raison, un choix d'homme libre non soumis à des passions du moment telles une rupture amoureuse ou une blessure narcissique, qu'il qualifie de « prétextes futiles » pour se suicider. Et si le suicide – non ordonné, car ce serait un meurtre – était la marque d'un échec personnel, d'un manque de courage et d'espoir ? Et si c'était une mauvaise solution dans tous les cas ? L'essayiste le présente comme une possibilité tout à fait compréhensible dès lors qu'il procède d'une « réflexion sainement conduite et mûrie avec le temps ». Quoi d'étonnant, alors, si, dans un autre chapitre, il parle d'un monde contenant plus de maux et de vices que de bien et de réjouissances, et si la procréation équivaut généralement à mettre au monde un malheureux, tiré du néant et qui retournera au néant ? « Ne pas faire d'enfant ne relève donc ni de l'égoïsme ni de l'individualisme mais de l'altruisme : il s'agit d'éviter d'infliger de la souffrance et de la douleur à autrui, de le préserver de façon radicale de la négativité du monde en ne l'y exposant jamais puisqu'on en a le choix ; il suffit de faire fonctionner sa raison et son intelligence. » Il est vrai que les philosophes ont rarement des enfants de chair ; ils mettent plus souvent leur puissance dans les oeuvres de l'esprit. Michel Onfray se veut pareillement plus éclairé sur le monde que la majorité des gens pris dans des fictions lorsqu'il regarde la passion amoureuse comme un risque de naufrage de la raison et comme une simple combinaison chimique, la fameuse ruse de la Nature dont parlait Schopenhauer en vue de la reproduction de l'espèce ; et, en homme plus intelligent, il lui préfère ce qu'il appelle le véritable amour, c'est-à-dire une construction voulue sur le long terme, après avoir pesé les qualités et les défauts du partenaire, l'important étant là encore l'acte de volonté. On ne s'étonnera donc pas que la contemplation résulte pour lui d'une faculté, chez les « âmes bien nées », à percevoir « une volonté de puissance qui fait naître une immense quiétude » et des « preuves de l'existence de soi ».
Tout est ainsi ramené à hauteur d'homme, qui s'attribue la grandeur, la force, l'intelligence… L'homme, cette poussière pensante dans l'univers, ne tolère pas que la contemplation des espaces infinis, effrayants pour certains, ne soit pas la preuve de la puissance de sa raison, l'attestation de son élan vital – une représentation comme une autre, une pure subjectivité. L'homme, dans ses fanfaronnades, veut s'attribuer la gloire d'apprécier la beauté des cieux, et il ne veut pas entendre que cette beauté est peut-être la preuve de l'existence de Dieu. Non ! s'écrie Onfray, qui revendique son athéisme et se veut, à la suite de Nietzsche dont il reprend les mêmes concepts, le pourfendeur des arrière-mondes et le destructeur des Idées platoniciennes, de la Beauté, du Bien, du Vrai… Autant de fables, dit-il ! Lui est un esprit supérieur, qui sait distinguer le vrai du faux. Il n'est pas question d'accepter que l'homme ne maîtrise pas tout, ne comprend pas tout, ne possède pas tout, et qu'au contraire la beauté ne lui appartient pas, qu'elle est d'essence immatérielle, divine diront d'aucuns, et que l'amour échappe peut-être à notre volonté et que là est sa beauté, quand il nous bouleverse radicalement et nous appelle à l'infini, nous faisant goûter à l'éternité, non par un règlement de l'imagination, mais par une expérience très sensible. Et il arrive aussi que deux personnes s'aiment suffisamment fort pour que le fruit de leur amour soit un enfant, qu'ils désirent élever en lui transmettant leur passion pour la vie, qui peut être belle, noble et merveilleuse en dépit des souffrances dans le monde et dans l'existence individuelle, la grandeur résidant alors dans le dépassement des souffrances et la poursuite d'une vie passionnée. Et cette vie peut être enrichie par l'âme d'un être cher qui s'est suicidé, parce que l'expérience de l'amour, du grand amour, fait sentir que l'âme est immortelle. Et les Romains aussi éprouvaient un désir d'éternité, ainsi qu'en témoignent Horace et Virgile, très peu évoqués dans cet ouvrage Sagesse. Et Nietzsche lui-même savait qu'il est des choses éternelles…
L'écueil d'avoir des disciples est de voir sa pensée édulcorée, déformée ou ramassée en quelques formules qui lui font perdre sa substance. Il en va ainsi de Michel Onfray, disciple de Nietzsche, qui savait qu'un philosophe a une responsabilité envers l'humanité et qu'il doit être très prudent et avisé dans ses propos, pour ne pas détruire n'importe comment, pour ne pas exercer de mauvaise influence sur des générations entières. Un philosophe comme Nietzsche reste extrêmement pertinent à bien des égards, mais il se trompe au moins dans un domaine, dans son interprétation selon laquelle le judéo-christianisme est un nihilisme, et, de là, Onfray martèle qu'il faut une morale sans dieu dans l'ère postchrétienne. Sauf qu'un monde sans dieu quel qu'il soit, sans transcendance et sans spiritualité, est un monde privé de verticalité, dans lequel l'homme ne peut pas s'élever au-delà de ses propres repères, de son petit intellect, un monde dans lequel le « surhomme » n'est pas possible et où une « haute civilisation » à la romaine est dépouillée de son énergie. Pourquoi Rome a-t-elle périclité ? La question hantait déjà les Romains avant Jésus Christ. Tite-Live écrivait, au moment des décennies de crise ayant vu la fin de la République et le début de l'Empire, que Rome en était arrivée à un stade où elle ne supportait plus même de remède à ses maux. Quels sont ces maux ? Montesquieu, par exemple, s'est intéressé à cette question fascinante sur la grandeur et la chute des Romains. Les facteurs de décadence sont multiples, ils sont notamment moraux : les moeurs se sont relâchées, l'avidité et la corruption se sont développées, les puissances mauvaises se sont propagées, parmi lesquelles le goût du pouvoir et l'égoïsme sans frein au détriment de la piété envers les ancêtres, de l'intérêt public et de la vertu comme fondement d'une République. le nihilisme est provoqué par une perte des valeurs qui constituaient le sens de la vie individuelle et collective ; il s'accompagne d'un déchaînement de « passions » mauvaises, et il fallait que les Romains se soient déjà effondrés moralement et spirituellement pour que le christianisme devienne religion d'empire, non comme un symptôme d'effondrement, mais comme un moyen de remettre un peu de vertu dans la machine et comme une subversion du message du Christ, de cette parole engageant la personne à la liberté et à l'amour, le christianisme en venant même par de nombreux aspects, avec cette institutionnalisation, à être une trahison du Christ, ainsi que le démontre magistralement Jacques Ellul dans son livre La Subversion du christianisme. Ce même Ellul, qui inspire des penseurs radicaux de notre temps, livre une critique sans concession de la religion chrétienne, une critique plus âpre et éminemment plus profonde que celle d'Onfray, et pourtant il était chrétien… Sans le message du Christ, les temps médiévaux auraient été encore plus ravagés par la violence, la folie, le nihilisme… Et bien des chevaliers, portés par leur foi, ont montré une ardeur admirable au combat et une noblesse d'âme qu'un Caton l'Ancien aurait saluée. Dans chaque siècle et chaque pays ont vécu des êtres dignes, valeureux et remarquables, quand bien même ils étaient discrets et ne furent pas célébrés par un Plutarque.
Une question que Michel Onfray ne traite guère et qui me semble fondamentale est celle-ci : peut-on aujourd'hui être Romain ? N'y a-t-il pas des obstacles à la réalisation d'une vie selon ces grandes valeurs, des obstacles autres qu'un manque de volonté ? La responsabilité du philosophe est d'être d'une extrême lucidité quant aux problèmes de son temps, de démasquer les mensonges et de discerner les puissances à l'oeuvre qui empêchent cet épanouissement individuel et cette constitution républicaine au sens premier du terme. Quelqu'un comme Jacques Ellul, ce chrétien anticonformiste, est précisément connu pour son analyse sociologique des phénomènes d'aliénation et de soumission, au pouvoir, à l'argent, à la propagande, à la technique, aux différents déterminismes, à tout ce qui fait que l'homme se trouve empêché de penser, d'aimer, de vivre libre. Chacun est appelé à la grandeur, et l'héroïsme consiste aussi dans la critique tranchante des idées, des institutions et des puissances qui nous rétrécissent.
L'intention première de Michel Onfray est louable : mettre en relief la philosophie romaine en tant qu'école de vertu, par l'évocation de diverses figures qui incarnent de nobles qualités, à savoir le courage, la volonté, la loyauté, la fidélité, la frugalité, la dignité, toutes les valeurs grâce auxquelles un individu peut se tenir débout, droit, en marche vers la grandeur. À la différence de la philosophie grecque, jugée plus spéculative ou métaphysique, la philosophie romaine se veut une pratique des vertus, ce dernier mot désignant en latin les qualités viriles, propres à l'homme, faisant de lui un être qui travaille à l'accomplissement de son humanité par l'exercice de ces qualités qui ne sont pas des possessions, mais des biens immatériels. Chez ce peuple de guerriers, le sens de l'honneur commande de ne pas se refuser au combat, mais d'y mettre toute son ardeur, sous peine d'être déshonoré et acculé à la honte et même au suicide. La belle vertu qu'est la fides, mot dont sont dérivés en français la foi, la fidélité et la confiance et que Cicéron place au coeur de l'amitié véritable, est une qualité hautement estimée, un lien invisible entre seuls les gens de bien, et elle n'est pas dissociable du respect de la parole donnée, car la parole engage dès lors qu'elle est expression de l'être. Les Romains dignes d'admiration sont aussi des personnes vivant dans la sobriété, non affalés sur des coussins lors de banquets à la Pétrone, et sachant manier aussi bien le glaive que les instruments utiles à la culture des champs. Il faut reconnaître à Michel Onfray une démarche qui ne manque pas de volonté de grandeur, parce que les modèles donnés restent, après deux millénaires, des exemples à méditer et imiter. En effet, rien ne forme mieux une personne que le récit de la vie d'hommes et de femmes illustres, parfois connus pour un seul geste, mais un geste qui revêt une valeur d'édification, sans moraline ni catéchisme. Il faut aussi reconnaître que l'auteur a un certain talent de conteur et d'historien lorsqu'il narre les épisodes de la vie de Caton l'Ancien, de Scaevola, des Gracques... Son ouvrage se révèle à mes yeux le plus intéressant dans ces parties narratives et historiques et dans les portraits, servant d'intermèdes, des principaux philosophes romains : Cicéron, Lucrèce, Sénèque (les pages décrivant sa « double vie » sont assez savoureuses), Marc Aurèle, Épictète, Plutarque et Lucien de Samosate (quoique ces derniers aient écrit en grec…). Aujourd'hui, comme hier, l'importance des Romains est majeure en termes de modèle de civilisation et de noblesse individuelle et devrait justifier l'étude rigoureuse de leur culture, leur droit et leur langue : ce devrait être au programme de toutes les bonnes écoles, quoi qu'en pensent nos ministres et experts en management.
Cet essai, qui débute par le souvenir de l'éruption du Vésuve en guise d'allégorie nous invitant à savoir vivre au pied d'un volcan, du péril et de la destruction, est construit en trois grandes parties, intitulées « Soi – Une éthique de la dignité », « Les Autres – Une morale de l'humanité » et « le Monde – Une écosophie des choses », parties elles-mêmes divisées en plusieurs chapitres dont les titres sont formés d'un verbe seul : « Penser », « Exister », « Contempler », « Rire », etc. Chaque chapitre s'appuie sur l'histoire d'une grande figure romaine pour donner matière à des réflexions philosophiques, par exemple le viol de Lucrèce pour mettre en exergue la vengeance en lien avec la quête d'honneur familial et de pureté retrouvée. Il peut sembler très ambitieux de vouloir traiter autant de sujets (l'amitié, l'amour, le suicide, la mort, la consolation, la croyance, l'action politique, etc.) en seulement une vingtaine de pages par thème. Si l'ambition est de dresser un vaste panorama des attributs de la sagesse, l'impression regrettable est de survoler ce qui ne peut être envisagé avec superficialité, ce qui mérite d'être approfondi pas nécessairement en noircissant des pages et en publiant cinq ou six livres par an, mais en creusant plus encore des questions essentielles avant de partager les fruits de sa recherche philosophique – et la profondeur ne dédaigne pas la concision. Michel Onfray semble avoir écrit plus pour des étudiants et des amateurs de philosophie que pour de fins lettrés et de vrais philosophes, d'où des répétitions, des explicitations didactiques et des lourdeurs de style ; et sa thèse selon laquelle le judéo-christianisme a mis fin aux vertus romaines et qu'il importe de renouer avec celles-ci pour sortir du nihilisme pourrait s'énoncer comme je viens de le faire, sans besoin de l'assener jusqu'à la rendre indigeste, d'autant qu'elle est fausse – j'y reviendrai.
Sans commenter tous les chapitres, dont certains sont convaincants, en particulier ceux sur les rapports entre maître et discipline, sur la réflexion et sur la vieillesse, je souhaite pointer quelques éléments d'une philosophie matérialiste qui suscitent chez moi de sérieuses réserves, pour ne pas dire une opposition franche. S'agissant du suicide, Michel Onfray relate les fins – en fait ordonnées par le régime – de Socrate et de Sénèque pour illustrer combien la mort volontaire peut être un acte maîtrisé par la raison, un choix d'homme libre non soumis à des passions du moment telles une rupture amoureuse ou une blessure narcissique, qu'il qualifie de « prétextes futiles » pour se suicider. Et si le suicide – non ordonné, car ce serait un meurtre – était la marque d'un échec personnel, d'un manque de courage et d'espoir ? Et si c'était une mauvaise solution dans tous les cas ? L'essayiste le présente comme une possibilité tout à fait compréhensible dès lors qu'il procède d'une « réflexion sainement conduite et mûrie avec le temps ». Quoi d'étonnant, alors, si, dans un autre chapitre, il parle d'un monde contenant plus de maux et de vices que de bien et de réjouissances, et si la procréation équivaut généralement à mettre au monde un malheureux, tiré du néant et qui retournera au néant ? « Ne pas faire d'enfant ne relève donc ni de l'égoïsme ni de l'individualisme mais de l'altruisme : il s'agit d'éviter d'infliger de la souffrance et de la douleur à autrui, de le préserver de façon radicale de la négativité du monde en ne l'y exposant jamais puisqu'on en a le choix ; il suffit de faire fonctionner sa raison et son intelligence. » Il est vrai que les philosophes ont rarement des enfants de chair ; ils mettent plus souvent leur puissance dans les oeuvres de l'esprit. Michel Onfray se veut pareillement plus éclairé sur le monde que la majorité des gens pris dans des fictions lorsqu'il regarde la passion amoureuse comme un risque de naufrage de la raison et comme une simple combinaison chimique, la fameuse ruse de la Nature dont parlait Schopenhauer en vue de la reproduction de l'espèce ; et, en homme plus intelligent, il lui préfère ce qu'il appelle le véritable amour, c'est-à-dire une construction voulue sur le long terme, après avoir pesé les qualités et les défauts du partenaire, l'important étant là encore l'acte de volonté. On ne s'étonnera donc pas que la contemplation résulte pour lui d'une faculté, chez les « âmes bien nées », à percevoir « une volonté de puissance qui fait naître une immense quiétude » et des « preuves de l'existence de soi ».
Tout est ainsi ramené à hauteur d'homme, qui s'attribue la grandeur, la force, l'intelligence… L'homme, cette poussière pensante dans l'univers, ne tolère pas que la contemplation des espaces infinis, effrayants pour certains, ne soit pas la preuve de la puissance de sa raison, l'attestation de son élan vital – une représentation comme une autre, une pure subjectivité. L'homme, dans ses fanfaronnades, veut s'attribuer la gloire d'apprécier la beauté des cieux, et il ne veut pas entendre que cette beauté est peut-être la preuve de l'existence de Dieu. Non ! s'écrie Onfray, qui revendique son athéisme et se veut, à la suite de Nietzsche dont il reprend les mêmes concepts, le pourfendeur des arrière-mondes et le destructeur des Idées platoniciennes, de la Beauté, du Bien, du Vrai… Autant de fables, dit-il ! Lui est un esprit supérieur, qui sait distinguer le vrai du faux. Il n'est pas question d'accepter que l'homme ne maîtrise pas tout, ne comprend pas tout, ne possède pas tout, et qu'au contraire la beauté ne lui appartient pas, qu'elle est d'essence immatérielle, divine diront d'aucuns, et que l'amour échappe peut-être à notre volonté et que là est sa beauté, quand il nous bouleverse radicalement et nous appelle à l'infini, nous faisant goûter à l'éternité, non par un règlement de l'imagination, mais par une expérience très sensible. Et il arrive aussi que deux personnes s'aiment suffisamment fort pour que le fruit de leur amour soit un enfant, qu'ils désirent élever en lui transmettant leur passion pour la vie, qui peut être belle, noble et merveilleuse en dépit des souffrances dans le monde et dans l'existence individuelle, la grandeur résidant alors dans le dépassement des souffrances et la poursuite d'une vie passionnée. Et cette vie peut être enrichie par l'âme d'un être cher qui s'est suicidé, parce que l'expérience de l'amour, du grand amour, fait sentir que l'âme est immortelle. Et les Romains aussi éprouvaient un désir d'éternité, ainsi qu'en témoignent Horace et Virgile, très peu évoqués dans cet ouvrage Sagesse. Et Nietzsche lui-même savait qu'il est des choses éternelles…
L'écueil d'avoir des disciples est de voir sa pensée édulcorée, déformée ou ramassée en quelques formules qui lui font perdre sa substance. Il en va ainsi de Michel Onfray, disciple de Nietzsche, qui savait qu'un philosophe a une responsabilité envers l'humanité et qu'il doit être très prudent et avisé dans ses propos, pour ne pas détruire n'importe comment, pour ne pas exercer de mauvaise influence sur des générations entières. Un philosophe comme Nietzsche reste extrêmement pertinent à bien des égards, mais il se trompe au moins dans un domaine, dans son interprétation selon laquelle le judéo-christianisme est un nihilisme, et, de là, Onfray martèle qu'il faut une morale sans dieu dans l'ère postchrétienne. Sauf qu'un monde sans dieu quel qu'il soit, sans transcendance et sans spiritualité, est un monde privé de verticalité, dans lequel l'homme ne peut pas s'élever au-delà de ses propres repères, de son petit intellect, un monde dans lequel le « surhomme » n'est pas possible et où une « haute civilisation » à la romaine est dépouillée de son énergie. Pourquoi Rome a-t-elle périclité ? La question hantait déjà les Romains avant Jésus Christ. Tite-Live écrivait, au moment des décennies de crise ayant vu la fin de la République et le début de l'Empire, que Rome en était arrivée à un stade où elle ne supportait plus même de remède à ses maux. Quels sont ces maux ? Montesquieu, par exemple, s'est intéressé à cette question fascinante sur la grandeur et la chute des Romains. Les facteurs de décadence sont multiples, ils sont notamment moraux : les moeurs se sont relâchées, l'avidité et la corruption se sont développées, les puissances mauvaises se sont propagées, parmi lesquelles le goût du pouvoir et l'égoïsme sans frein au détriment de la piété envers les ancêtres, de l'intérêt public et de la vertu comme fondement d'une République. le nihilisme est provoqué par une perte des valeurs qui constituaient le sens de la vie individuelle et collective ; il s'accompagne d'un déchaînement de « passions » mauvaises, et il fallait que les Romains se soient déjà effondrés moralement et spirituellement pour que le christianisme devienne religion d'empire, non comme un symptôme d'effondrement, mais comme un moyen de remettre un peu de vertu dans la machine et comme une subversion du message du Christ, de cette parole engageant la personne à la liberté et à l'amour, le christianisme en venant même par de nombreux aspects, avec cette institutionnalisation, à être une trahison du Christ, ainsi que le démontre magistralement Jacques Ellul dans son livre La Subversion du christianisme. Ce même Ellul, qui inspire des penseurs radicaux de notre temps, livre une critique sans concession de la religion chrétienne, une critique plus âpre et éminemment plus profonde que celle d'Onfray, et pourtant il était chrétien… Sans le message du Christ, les temps médiévaux auraient été encore plus ravagés par la violence, la folie, le nihilisme… Et bien des chevaliers, portés par leur foi, ont montré une ardeur admirable au combat et une noblesse d'âme qu'un Caton l'Ancien aurait saluée. Dans chaque siècle et chaque pays ont vécu des êtres dignes, valeureux et remarquables, quand bien même ils étaient discrets et ne furent pas célébrés par un Plutarque.
Une question que Michel Onfray ne traite guère et qui me semble fondamentale est celle-ci : peut-on aujourd'hui être Romain ? N'y a-t-il pas des obstacles à la réalisation d'une vie selon ces grandes valeurs, des obstacles autres qu'un manque de volonté ? La responsabilité du philosophe est d'être d'une extrême lucidité quant aux problèmes de son temps, de démasquer les mensonges et de discerner les puissances à l'oeuvre qui empêchent cet épanouissement individuel et cette constitution républicaine au sens premier du terme. Quelqu'un comme Jacques Ellul, ce chrétien anticonformiste, est précisément connu pour son analyse sociologique des phénomènes d'aliénation et de soumission, au pouvoir, à l'argent, à la propagande, à la technique, aux différents déterminismes, à tout ce qui fait que l'homme se trouve empêché de penser, d'aimer, de vivre libre. Chacun est appelé à la grandeur, et l'héroïsme consiste aussi dans la critique tranchante des idées, des institutions et des puissances qui nous rétrécissent.