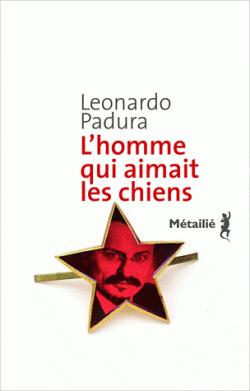>
Critique de Creisifiction
En 1968, alors que les mouvements contestataires et les manifestations contre l'establishment essaimaient à travers le monde, y compris en Amérique latine, alors que le rock, la mouvance hippie et la contreculture en général influençaient une jeunesse aspirant à plus de liberté et à un nouvel ordre sociétal, à Cuba, déjà, «the dream is over ». Les structures locales du Parti Communiste Cubain (PCC), les Comités de Défense de la Révolution (CDR), la Centrale des Travailleurs de Cuba (CTC), qui s'étaient vu transformer progressivement en organes de contrôle idéologique, dissuadent ses citoyens de se livrer à toute forme de contestation politique; de même pour ce qui est de l'Union Nationale des Écrivains et Artistes de Cuba (UNEAC), qui au départ avait largement soutenu la création artistique et l'émergence de nouveaux talents littéraires dans l'île, muée définitivement en organe de censure : n'y sont désormais publiés que les auteurs certifiés idéologiquement conformes par les éditeurs d'État.
L'année 1968 scelle ainsi la fin définitive du rêve d'une Révolution cubaine dont la réussite et le caractère singulier se devaient non seulement à une adhésion et à une mobilisation massives de la société civile cubaine, mais aussi à une volonté manifeste d'indépendance politique de la part de ses dirigeants vis-à-vis de l'impérialisme pratiqué à large échelle par l'URSS. Si, par la force des choses (et surtout depuis le blocus imposé par les américains), le régime cubain ne pouvait totalement se soustraire à l'ombre du géant soviétique, il cherchait cependant, dans la mesure du possible, à se départir d'une dépendance trop exclusive et tutélaire au Kremlin. Au mois d'août 1968, Cuba, qui avait pourtant tenu à coeur, depuis la prise de pouvoir par les forces révolutionnaires une dizaine d'années plus tôt, de jouer un rôle politique et diplomatique prépondérant au sein du groupe des pays dits non-alignés, apportera son soutien inconditionnel à l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'URSS, suite au printemps de Prague. S'en suivra rapidement la promulgation en interne d'un premier plan de développement s'inspirant directement du modèle économique soviétique, ce qui aura pour conséquence, entre autres, de soumettre irréparablement l'économie cubaine à une dépendance intégrale au bloc communiste durant les deux décennies à venir, et jusqu'à l'effondrement de l'URSS dans les années quatre-vingt-dix, contraignant alors la nation cubaine, exsangue, affamée, démunie, à subir des carences et des privations jamais connues auparavant dans l'île, et condamnant la plupart de ses citoyens à toutes sortes de renoncements, quelquefois aux pires expédients, ou bien à l'exil définitif pour pouvoir survivre.
C'est dans ce contexte, après les ruptures emblématiques survenues donc à la fin des années 60, que le personnage et alter-ego de l'auteur, Iván, après des débuts prometteurs en tant que jeune écrivain, sera profondément marqué par la motion de censure venant frapper son oeuvre. «Nous étions la générations des naïfs, des romantiques qui avaient tout accepté et tout justifié, les yeux tournés vers l'avenir, qui coupèrent la canne à sucre, convaincus qu'ils devaient le faire (…) la génération qui fut la cible des attaques de l'intransigeance sexuelle, religieuse, idéologique, culturelle et même alcoolique, qu'elle endura tout au plus avec un hochement de tête et, bien souvent, sans éprouver le ressentiment ou le désespoir qui mène à la fuite.» Démotivé, désabusé par la tournure prise par les évènements, touché personnellement par la peur qui se faisait de plus en plus présente dans les consciences de son époque et de sa génération, suite aux remontrances et les sanctions effectives dont il avait fait l'objet, Iván finit par renoncer à toute illusion de poursuivre une carrière universitaire et littéraire. Quelques temps après, il trouve un travail de rédacteur dans une revue vétérinaire, se marie, fonde une famille, se résigne.
Un soir de mars 1977, sur la plage de Santa María del Mar, Iván fait la rencontre de celui qu'il surnommera «l'homme qui aimait les chiens», titre d'une des nouvelles du recueil de Raymond Chandler (« Un tueur sous la pluie ») qu'il lisait au moment où il entendit pour la première fois, à quelques mètres de lui, l'homme appeler ses deux magnifiques lévriers russes, «ces barzoïs si prisés» qu'Iván voyait «pour la première fois ailleurs que sur les planches d'un livre ou de la revue vétérinaire». Autour des chiens, se noue un dialogue entre les deux inconnus. Impressionné par l'allure et par les propos de ce personnage atypique dont la présence même à Cuba semble entourée d'une aura de mystère qui l'intrigue de plus en plus, au fil de leurs rencontres sur la plage qu'Iván cherchera à susciter en retournant régulièrement à Santa María del Mar, «l'homme qui aimait les chiens» en viendra petit à petit à lui livrer l'histoire de Ramón Mercader, l'assassin de Trotski. Mercader, côtoyé à plusieurs reprises par Jaime López, l'homme de la plage, à qui le jeune révolutionnaire espagnol responsable de l'assassinat de Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotski, se serait confié sans réserves, finiront tous les deux par se confondre en une seule et même image dans l'esprit d'Iván. La disparition subite et inexpliquée de l'énigmatique personnage, quelques mois après leur première rencontre, le laissera pourtant sans aucune réponse claire aux questions qui continueront à le tarauder pendant plus d'une vingtaine d'années: Qu'est-il arrivé au juste à Ramón Mercader après avoir purgé sa peine de vingt ans de prison au Mexique et avoir été exfiltré vers l'URSS, où Lopez, «l'homme qui aimait les chiens » l'aurait rencontré plus tard? Mais à vrai dire, qui est qui en fin de compte? Mercader et López ne seraient-ils le seul et même homme? Dans ce cas-là, pourquoi s'être confié à lui, Iván, tout en sachant qu'il avait un passé d'écrivain et qu'il avait publié un livre? Et puis, pourquoi en même temps lui avoir fait jurer de ne jamais révéler à personne toute cette histoire?
Malgré tous les écueils concrets auxquels il devrait faire face pour tenter d'assembler les pièces de cet étrange puzzle (d'autant que le régime castriste ayant proscrit tout ce qui avait trait à Trotski, l'oeuvre, la vie même ou la mort de ce dernier étaient à ce moment totalement méconnues et inaccessibles au commun des cubains), malgré également toute l'ambiguïté d'un tel projet (comment écrire sans trahir la promesse faite à l'homme qui aimait les chiens?), malgré, last but not least, lui-même, Iván et le combat intérieur qu'il livre contre ses propres fantômes, l'écrivain sommeillant au fond de lui ne résistera, in fine, à la tentation de s'en emparer et de s'investir dans la reconstruction des parcours tragiques de Trotski et de Ramon Mercader.
Leonardo Padura, situe en 1989, au même moment où tombait le Mur de Berlin, les toutes premières fondations de cet immense édifice que constituerait L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS, qui ne serait pourtant effectivement érigé et publié qu'une vingtaine d'années après. Fruit donc d'une très longue maturation dans l'esprit de son auteur, la pierre inaugurale de ce monument dédié aux ravages abominables provoqués par la plus grandiose et la plus tragique de toutes les utopies du XXème siècle, y fut posée cette même année, à l'occasion du premier voyage au Mexique de Lenardo Padura et à la suite du « choc purement humain, que causa (sa) visite de la maison où avait vécu et était mort Léon Trotski».
Il s'agit bien, en effet, avant tout de matière vive et humaine, personnifiée, incarnée dans des individualités au-delà du rôle supra-humain auquel on avait souhaité les astreindre, mises à l'épreuve de leurs croyances et de leurs doutes face à l'imposture idéologique dont elles ont été victimes. Dans ce roman fleuve à l'architecture complexe, alternant faits historiques et spéculation fictionnelle, trois parcours sont reconstruits parallèlement pour se rejoindre dans un épilogue sublime, bouquet final de vérité et d'humanité : celui de Léon Troski, depuis son exil de l'URSS en 1929, jusqu'à son assassinat au Mexique en 1940, celui de Ramon Mercader, jeune communiste espagnol combattant au sein des forces républicaines durant la guerre civile d'Espagne, embrigadé par les services secrets soviétiques, celui, enfin, d'Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain et double fictionnel de Leonardo Padura, personnage emblématique qui, selon son créateur, «fonctionne aussi comme métaphore d'une génération et comme le résultat prosaïque d'une défaite historique».
Appuyé par un travail de reconstitution historique détaillé, strictement fidèle à la chronologie des évènements, l'auteur, à partir «de ce qui est vérifiable et de ce qui est historiquement possible ou plausible d'après le contexte» tente surtout d'approcher, d'un point de vue essentiellement subjectif, les vicissitudes, les ambigüités, les épreuves psychologiques subies par ses personnages, entraînés dans le drame collectif provoqué par les dérives totalitaires et la débâcle effroyable de trois utopies majeures du XXème siècle : les révolutions russe, espagnole et cubaine .
Le lecteur suit pas à pas, sur près de sept-cents pages, une intrigue dont, après tout, il connaît déjà le dénouement aussi dramatique qu'inutile (d'un point de vue historique, aucun meurtre ne pouvant, bien évidemment, être considéré d'«utilité»). L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS étant un quelque sorte un anti-thriller politique, un roman construit essentiellement à partir de cette atmosphère particulière qui habite l'attente, l'angoisse, la peur, et qui donne une densité particulière au passage du temps, épaisseur toujours extensible par l'alternance irrésolue entre croyance aveugle en l'avenir et clairvoyance intolérable face à l'imminence du désastre, entre sentiments de révolte et de soumission face à des injonctions qui dépassent complètement les individus.
Les longueurs tant redoutées et habituellement honnies (souvent, d'ailleurs, à priori et de manière indiscriminée...) par un grand nombre de lecteurs contemporains, semblent donc constituer ici un élément essentiel à l'approche choisie par l'auteur, un choix de narration délibéré et auquel le lecteur doit pouvoir être en mesure de se laisser porter, grâce notamment à la finesse d'analyse et à la qualité exceptionnelle de la plume déliée et alerte de Leonardo Padura.
En définitive, une lecture aussi instructive d'un point de vue historique que touchante, un récit saisissant, empreint de sensibilité, d'empathie et de compassion pour ses personnages, victimes «happées par la fatigue historique et l'utopie pervertie ». Un grand roman où le mensonge collectif le dispute à la tragédie personnelle. Un auteur doté d'un immense talent de conteur, que je découvre avec ce livre et vers lequel je vais certainement revenir ultérieurement.
L'année 1968 scelle ainsi la fin définitive du rêve d'une Révolution cubaine dont la réussite et le caractère singulier se devaient non seulement à une adhésion et à une mobilisation massives de la société civile cubaine, mais aussi à une volonté manifeste d'indépendance politique de la part de ses dirigeants vis-à-vis de l'impérialisme pratiqué à large échelle par l'URSS. Si, par la force des choses (et surtout depuis le blocus imposé par les américains), le régime cubain ne pouvait totalement se soustraire à l'ombre du géant soviétique, il cherchait cependant, dans la mesure du possible, à se départir d'une dépendance trop exclusive et tutélaire au Kremlin. Au mois d'août 1968, Cuba, qui avait pourtant tenu à coeur, depuis la prise de pouvoir par les forces révolutionnaires une dizaine d'années plus tôt, de jouer un rôle politique et diplomatique prépondérant au sein du groupe des pays dits non-alignés, apportera son soutien inconditionnel à l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'URSS, suite au printemps de Prague. S'en suivra rapidement la promulgation en interne d'un premier plan de développement s'inspirant directement du modèle économique soviétique, ce qui aura pour conséquence, entre autres, de soumettre irréparablement l'économie cubaine à une dépendance intégrale au bloc communiste durant les deux décennies à venir, et jusqu'à l'effondrement de l'URSS dans les années quatre-vingt-dix, contraignant alors la nation cubaine, exsangue, affamée, démunie, à subir des carences et des privations jamais connues auparavant dans l'île, et condamnant la plupart de ses citoyens à toutes sortes de renoncements, quelquefois aux pires expédients, ou bien à l'exil définitif pour pouvoir survivre.
C'est dans ce contexte, après les ruptures emblématiques survenues donc à la fin des années 60, que le personnage et alter-ego de l'auteur, Iván, après des débuts prometteurs en tant que jeune écrivain, sera profondément marqué par la motion de censure venant frapper son oeuvre. «Nous étions la générations des naïfs, des romantiques qui avaient tout accepté et tout justifié, les yeux tournés vers l'avenir, qui coupèrent la canne à sucre, convaincus qu'ils devaient le faire (…) la génération qui fut la cible des attaques de l'intransigeance sexuelle, religieuse, idéologique, culturelle et même alcoolique, qu'elle endura tout au plus avec un hochement de tête et, bien souvent, sans éprouver le ressentiment ou le désespoir qui mène à la fuite.» Démotivé, désabusé par la tournure prise par les évènements, touché personnellement par la peur qui se faisait de plus en plus présente dans les consciences de son époque et de sa génération, suite aux remontrances et les sanctions effectives dont il avait fait l'objet, Iván finit par renoncer à toute illusion de poursuivre une carrière universitaire et littéraire. Quelques temps après, il trouve un travail de rédacteur dans une revue vétérinaire, se marie, fonde une famille, se résigne.
Un soir de mars 1977, sur la plage de Santa María del Mar, Iván fait la rencontre de celui qu'il surnommera «l'homme qui aimait les chiens», titre d'une des nouvelles du recueil de Raymond Chandler (« Un tueur sous la pluie ») qu'il lisait au moment où il entendit pour la première fois, à quelques mètres de lui, l'homme appeler ses deux magnifiques lévriers russes, «ces barzoïs si prisés» qu'Iván voyait «pour la première fois ailleurs que sur les planches d'un livre ou de la revue vétérinaire». Autour des chiens, se noue un dialogue entre les deux inconnus. Impressionné par l'allure et par les propos de ce personnage atypique dont la présence même à Cuba semble entourée d'une aura de mystère qui l'intrigue de plus en plus, au fil de leurs rencontres sur la plage qu'Iván cherchera à susciter en retournant régulièrement à Santa María del Mar, «l'homme qui aimait les chiens» en viendra petit à petit à lui livrer l'histoire de Ramón Mercader, l'assassin de Trotski. Mercader, côtoyé à plusieurs reprises par Jaime López, l'homme de la plage, à qui le jeune révolutionnaire espagnol responsable de l'assassinat de Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotski, se serait confié sans réserves, finiront tous les deux par se confondre en une seule et même image dans l'esprit d'Iván. La disparition subite et inexpliquée de l'énigmatique personnage, quelques mois après leur première rencontre, le laissera pourtant sans aucune réponse claire aux questions qui continueront à le tarauder pendant plus d'une vingtaine d'années: Qu'est-il arrivé au juste à Ramón Mercader après avoir purgé sa peine de vingt ans de prison au Mexique et avoir été exfiltré vers l'URSS, où Lopez, «l'homme qui aimait les chiens » l'aurait rencontré plus tard? Mais à vrai dire, qui est qui en fin de compte? Mercader et López ne seraient-ils le seul et même homme? Dans ce cas-là, pourquoi s'être confié à lui, Iván, tout en sachant qu'il avait un passé d'écrivain et qu'il avait publié un livre? Et puis, pourquoi en même temps lui avoir fait jurer de ne jamais révéler à personne toute cette histoire?
Malgré tous les écueils concrets auxquels il devrait faire face pour tenter d'assembler les pièces de cet étrange puzzle (d'autant que le régime castriste ayant proscrit tout ce qui avait trait à Trotski, l'oeuvre, la vie même ou la mort de ce dernier étaient à ce moment totalement méconnues et inaccessibles au commun des cubains), malgré également toute l'ambiguïté d'un tel projet (comment écrire sans trahir la promesse faite à l'homme qui aimait les chiens?), malgré, last but not least, lui-même, Iván et le combat intérieur qu'il livre contre ses propres fantômes, l'écrivain sommeillant au fond de lui ne résistera, in fine, à la tentation de s'en emparer et de s'investir dans la reconstruction des parcours tragiques de Trotski et de Ramon Mercader.
Leonardo Padura, situe en 1989, au même moment où tombait le Mur de Berlin, les toutes premières fondations de cet immense édifice que constituerait L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS, qui ne serait pourtant effectivement érigé et publié qu'une vingtaine d'années après. Fruit donc d'une très longue maturation dans l'esprit de son auteur, la pierre inaugurale de ce monument dédié aux ravages abominables provoqués par la plus grandiose et la plus tragique de toutes les utopies du XXème siècle, y fut posée cette même année, à l'occasion du premier voyage au Mexique de Lenardo Padura et à la suite du « choc purement humain, que causa (sa) visite de la maison où avait vécu et était mort Léon Trotski».
Il s'agit bien, en effet, avant tout de matière vive et humaine, personnifiée, incarnée dans des individualités au-delà du rôle supra-humain auquel on avait souhaité les astreindre, mises à l'épreuve de leurs croyances et de leurs doutes face à l'imposture idéologique dont elles ont été victimes. Dans ce roman fleuve à l'architecture complexe, alternant faits historiques et spéculation fictionnelle, trois parcours sont reconstruits parallèlement pour se rejoindre dans un épilogue sublime, bouquet final de vérité et d'humanité : celui de Léon Troski, depuis son exil de l'URSS en 1929, jusqu'à son assassinat au Mexique en 1940, celui de Ramon Mercader, jeune communiste espagnol combattant au sein des forces républicaines durant la guerre civile d'Espagne, embrigadé par les services secrets soviétiques, celui, enfin, d'Iván Cárdenas Maturell, écrivain cubain et double fictionnel de Leonardo Padura, personnage emblématique qui, selon son créateur, «fonctionne aussi comme métaphore d'une génération et comme le résultat prosaïque d'une défaite historique».
Appuyé par un travail de reconstitution historique détaillé, strictement fidèle à la chronologie des évènements, l'auteur, à partir «de ce qui est vérifiable et de ce qui est historiquement possible ou plausible d'après le contexte» tente surtout d'approcher, d'un point de vue essentiellement subjectif, les vicissitudes, les ambigüités, les épreuves psychologiques subies par ses personnages, entraînés dans le drame collectif provoqué par les dérives totalitaires et la débâcle effroyable de trois utopies majeures du XXème siècle : les révolutions russe, espagnole et cubaine .
Le lecteur suit pas à pas, sur près de sept-cents pages, une intrigue dont, après tout, il connaît déjà le dénouement aussi dramatique qu'inutile (d'un point de vue historique, aucun meurtre ne pouvant, bien évidemment, être considéré d'«utilité»). L'HOMME QUI AIMAIT LES CHIENS étant un quelque sorte un anti-thriller politique, un roman construit essentiellement à partir de cette atmosphère particulière qui habite l'attente, l'angoisse, la peur, et qui donne une densité particulière au passage du temps, épaisseur toujours extensible par l'alternance irrésolue entre croyance aveugle en l'avenir et clairvoyance intolérable face à l'imminence du désastre, entre sentiments de révolte et de soumission face à des injonctions qui dépassent complètement les individus.
Les longueurs tant redoutées et habituellement honnies (souvent, d'ailleurs, à priori et de manière indiscriminée...) par un grand nombre de lecteurs contemporains, semblent donc constituer ici un élément essentiel à l'approche choisie par l'auteur, un choix de narration délibéré et auquel le lecteur doit pouvoir être en mesure de se laisser porter, grâce notamment à la finesse d'analyse et à la qualité exceptionnelle de la plume déliée et alerte de Leonardo Padura.
En définitive, une lecture aussi instructive d'un point de vue historique que touchante, un récit saisissant, empreint de sensibilité, d'empathie et de compassion pour ses personnages, victimes «happées par la fatigue historique et l'utopie pervertie ». Un grand roman où le mensonge collectif le dispute à la tragédie personnelle. Un auteur doté d'un immense talent de conteur, que je découvre avec ce livre et vers lequel je vais certainement revenir ultérieurement.