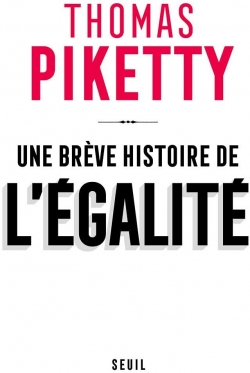>
Critique de cprevost
Thomas Piketty est un représentant typique de l'idée (ou de l'idéologie) du progrès. Il fait valoir dans sa « brève histoire » le schème d'un mouvement continu, ascendant de l'égalité, un schème qui certes donne un rôle aux crises et aux conflits mais sans qu'on sache ni la nature, ni l'importance, ni même la nécessité ou la contingence de ces derniers. Il existe pour lui un mouvement de long terme qui va vers plus d'égalité. La thèse du progrès social (de son inéluctabilité, de sa positivité) est une composante de la tradition socialiste toute entière que l'auteur fait ici sienne.
Nous vivons pourtant aujourd'hui, pour reprendre une expression de Georges Canguilhem, « la décadence de l'idée de progrès » . Antonio Gramsci et Walter Benjamin ont impitoyablement critiqué l'idée de l'histoire, à l'oeuvre dans les phases de régression du mouvement social, comme une téléologie, qui pose le temps comme linéaire, irréversible et positif. Dans les « Cahiers de prison », le premier décrivait l'économisme comme un fatalisme au moyen duquel les socialistes se forgent une vision du monde subalterne qui fait de l'émancipation la conséquence inévitable du développement des techniques ; le second, dans ses thèses de 1940, « Sur le concept d'histoire » , parlait d'un historicisme qui est la tentative vaine de reprendre au compte des opprimés la vision continue et cumulative, caractéristique des dominants ou des vainqueurs assurés de « nager dans le sens du courant ». Ces descriptions touchent incontestablement juste en ce qui concerne la « brève histoire ».
Les progrès historiques en matière de santé, d'éducation et de revenu mis en avant au début de l'ouvrage ne sauraient masquer la durable persistance des inégalités. C'est en effet un leurre. La progression d'ensemble naturellement n'implique rien de systématique en ce qui concerne les rapports entre les groupes sociaux, les pays. L'égalité suppose évidemment la comparaison entre plusieurs termes et ne serait concerner le tout. L'espérance de vie dans le monde, passée de 26 ans au début du XIXe siècle à 73 ans aujourd'hui, ne dit ainsi rien sur la disparité entre pays et entre classes sociales (notamment de l'espérance de vie en bonne santé). L'alphabétisation des plus de 15 ans, passée de 10% au début du XIXe siècle à 85% aujourd'hui, pas plus que le nombre d'années de scolarisation, passé d'à peine une année il y a deux siècle à plus de 8 ans actuellement (12 ans et accès de 50% de la jeune génération à l'université dans les seuls pays riches) ne disent d'avantage sur le maintien durable ou l'accentuation des inégalités. « La société des « trente glorieuses » n'avait pas grand-chose à voir avec une société égalitaire, elle avait cependant amélioré le sort de nombre de personnes peu ou pas diplômées en France. Sans entrer dans la compétition scolaire, on pouvait raisonnablement envisager d'apprendre un métier, percevoir un salaire décent, avoir de bonne conditions d'emploi, obtenir une promotion interne. le vrai changement, à cet égard, réside dans l'irrésistible diminution, depuis cinquante ans, des chances d'ascension professionnelle pour les peu ou pas diplômés. Conséquence directe de l'allongement des scolarités et de la massification des premiers cycles universitaires, les simples bacheliers et nombre de titulaires d'un bac plus deux n'ont guère de chances de monter en cours de carrière. Alors qu'en 1970 61 % des fils d'ouvrier âgés de 30 ans titulaires du seul bac ou du brevet (fin de collège) accédaient à un emploi de cadre moyen ou supérieur, ce n'était plus le cas que de 27 % d'entre eux à la fin des années 1990 . Pour les filles d'ouvrier trentenaires, les proportions étaient respectivement de 20 % et 12 %. Si la hausse des taux de bacheliers (65 % d'une génération en 2010, 80 % en 2019, contre 5 % en 1945) témoigne d'incontestables progrès, elle a aussi eu pour effet de condamner les moins diplômés à faire le deuil de leurs espoirs de « s'en sortir » (P. Pasquali, LMD novembre 2020). le revenu moyen dans le monde quant à lui a été multiplié par dix depuis le XIXe siècle (en € 2020, < 100 € /homme.mois contre ~1000 € /homme.mois au XXIe siècle). Les 50% les plus riches détiennent pourtant en France encore 78% des revenus (au début du XIXe siècle 86%) ; les 50% les plus pauvres en France en revanche ne détiennent que 22% des revenus (au début du XIXe siècle 14%). La part en effet des revenus du capital atteignait 45% du revenu national en France au XIXe siècle ; actuellement elle peut atteindre 50%. Les inégalités de revenu se trouvent donc, au mieux, inchangées. Les progrès historiques en matière de santé, d'éducation et de revenu semblent bien s'accompagner, non de la progression de l'égalité, mais tout au contraire de l'accentuation d'un certain nombre d'inégalités.
La lente déconcentration de la propriété serait un marqueur de ce mouvement de long terme qui va vers plus d'égalité. A partir d'une prémisse : « le mouvement continu, ascendant de l'égalité », il nous semble que Thomas Piketty tire des conclusions absolument forcées de ses recherches. Pour sa démonstration, il compare les 1% les plus riches aux 50% les plus pauvres en France. Les premiers, au début du XXe siècle détiennent 55% de la totalité de la propriété, en 1980 : 18% et en 2020 : 24,5% ; les seconds, au début du XXe siècle détiennent 1,3%, en 1980 : 8% et en 2020 : 5%. Piketty observe une très forte déconcentration des fortunes au cours du XXe siècle jusqu'au début de 1980 et une lente remontée jusqu'à aujourd'hui. Une très forte déconcentration des fortunes et une lente remontée alors que les pentes sont sensiblement identiques, voire même légèrement supérieure pour la redescente ? L'économiste insiste, « Les résultats produits […] illustrent la thèse générale présentée dans ce livre : […] il existe dans le long terme un mouvement vers l'égalité, et en l'occurrence une moindre concentration de la propriété et donc du pouvoir social et économique ». Il constate pourtant que l'inégalité continue de se situer à un niveau extrêmement élevé. En 1780, les 50% des plus pauvres détiennent 2% de la totalité de la propriété ; en 2020, ils détiennent 5% alors que la population a été multipliée par 10. Il est vrai qu'il ne semble pas apercevoir l'inexorable redescente d'aujourd'hui du patrimoine des plus pauvres qui suit la très faible montée du siècle dernier. La propriété des laissés-pour-compte, à ce rythme, devrait pourtant retrouver son niveau du XVIIIe siècle dans seulement une petite vingtaine d'années.
La lente déconcentration du pouvoir entrevue par Thomas Piketty, marqueur du soit disant mouvement de long terme qui va vers plus d'égalité, est lui aussi un leurre absolu. le patrimoine moyen détenu dans la France de 2020 par les 50% les plus pauvres est de 23 mille € par adulte . Les pauvres n'ont aucun patrimoine efficient car, en termes de pouvoir et de poids social, c'est en régime capitaliste interminablement la nature des biens possédés qui décide. Les 10% les plus fortunés séquestrent dans la France de 2020 plus de 55% de la totalité de la propriété. Pour cette fraction de la population, les biens professionnels et les actifs financiers, qui ne cessent de croître lorsque l'on s'élève dans la hiérarchie des fortunes, sont les instruments d'un pouvoir exclusif. Elle possède encore, toujours et sans partage, n'en déplaise au directeur d'étude, à l'universitaire et au patron de labo, le monde, la totalité des moyens de productions et l'État (actifs financiers, titres de la dette, médias, think tanks, etc.).
La lente « […] émergence d'une classe moyenne patrimoniale constitue, pour Thomas Piketty, en terme de réduction des inégalités, une transformation majeure, à la fois sur le plan social, économique et politique. » La réduction des inégalités pour lui s'est faite là, au détriment du pourcent le plus riche. Elle s'est faite au bénéfice de la classe moyenne patrimoniale, classe qui marque la césure entre la moitié la plus pauvres et le décile fortuné. C'est l'antienne d'un mouvement continu, ascendant de l'égalité, de la Classe sociale qui fait oublier toutes les autres. Les classes semblent pourtant aujourd'hui irréconciliables. La classe dominante insatiable qui possède les moyens de production, accapare la survaleur et défend avec une inouïe violence ses intérêts, n'est ni progressiste, ni morale, ni championne des libertés et surtout pas représentante de l'intérêt universellement humain. Les classes ne peuvent être malheureusement fondues en une seule énorme classe moyenne, sinon comme ici de manière incantatoire. La classe moyenne patrimoniale a connu en effet une progression spectaculaire de ses avoirs qui sont passés de 13% au début du XXe siècle à, pour ne plus bouger, 40% en 1980. le patrimoine moyen détenu dans la France de 2020 par la classe moyenne patrimoniale est de 230 mille € par adulte (s'étalant entre 100 mille et 400 mille €) . Mais ce patrimoine est constitué principalement par le logement et quelques autres choses insignifiantes, une propriété qui en terme de pouvoir est sans aucun poids. Sans doute la force de désir, la puissance d'agir appartient elle entièrement à cet individu néolibéral idéal-typique. Mais c'est l'exploitation passionnelle en revanche qui fixe sa puissance à un nombre extraordinairement restreint et néfaste d'objets – ceux du désir-maître. le capitalisme s'est approprié toute l'énergie du désir qui oriente la force d'exister du petit bourgeois, cet être à l'esprit empêché, rempli par trop peu de chose mais entièrement . La classe moyenne conservatrice, incapable de résister au statut de pure marchandise que lui prescrit la logique du capitalisme, n'est évidemment pas la solution mais le verrou qui empêche tous les changements nécessaires.
Une formulation de la question du progrès par Karl Marx permet d'interpréter autrement toute cette soporifique lenteur, comme d'ailleurs nous y invite Thomas Piketty lui-même : « L'histoire avance par le mauvais côté. […] c'est toujours le mauvais côté qui finit par l'emporter sur le côté beau. C'est le mauvais côté qui produit le mouvement qui fait l'histoire en constituant la lutte. » Il semble, à travers les siècles, s'adresser à l'économiste d'aujourd'hui qui, avec l'État social, l'impôt progressif sur le revenu et l'héritage, cherche à retenir de chaque catégorie ou forme sociale le « bon côté » qui ferait progresser l'égalité. Sa conception repose sur la conviction toute idéaliste que, modulo « les rapports de force [qui] ne doivent être ni négligés ni sanctifiés », les valeurs de solidarité et de liberté s'imposent en raison même de l'universalité qu'elles représentent. L'inégalité est avant tout pour Thomas Piketty une construction sociale et politique historique : « Il faut prendre en compte la question des institutions justes et de la délibération égalitaire. » Pour un même développement économique, il existe pour lui toujours de multiples façons d'organiser un régime de propriété et de frontières, un système social et politique, un système fiscal et éducatif. Mais malheureusement l'histoire ne se fait pas « par le bon côté », c'est-à-dire en raison de la force intrinsèque et de l'excellence des idéaux humaniste, moins encore par la force de conviction et l'éducation morale seulement par « la douleur du négatif », l'affrontement des intérêts, la violence des crises et des révolutions. de plus, une dialectique du mauvais côté n'est nullement la garantie de la transformation de la société capitaliste par son propre travail en son contraire, nullement la garantie de convertir circulairement la guerre, la souffrance et l'injustice en facteurs de paix, de prospérité et d'égalité. L'histoire, à contrario de ce qu'affirme Thomas Piketty dans son livre, semble avancer, pas seulement par le mauvais côté, mais aussi du mauvais côté, celui de la domination et de la ruine. Aussi longtemps que le système économique n'est pas changé en ses structures, le discours que tient l'économie politique en place, aussi généreux soit-il, ne saurait être en effet qu'illusion et mystification. L'égalité n'est pas donnée, elle n'est pas programmée, elle ne peut durablement résulter de l'atténuation passagère des contradictions du système capitaliste ; elle dépend de la « subsomption » réelle de la force de travail qui permet ou pas de porter à maturité et de supprimer les contradictions du capitalisme.
Nous vivons pourtant aujourd'hui, pour reprendre une expression de Georges Canguilhem, « la décadence de l'idée de progrès » . Antonio Gramsci et Walter Benjamin ont impitoyablement critiqué l'idée de l'histoire, à l'oeuvre dans les phases de régression du mouvement social, comme une téléologie, qui pose le temps comme linéaire, irréversible et positif. Dans les « Cahiers de prison », le premier décrivait l'économisme comme un fatalisme au moyen duquel les socialistes se forgent une vision du monde subalterne qui fait de l'émancipation la conséquence inévitable du développement des techniques ; le second, dans ses thèses de 1940, « Sur le concept d'histoire » , parlait d'un historicisme qui est la tentative vaine de reprendre au compte des opprimés la vision continue et cumulative, caractéristique des dominants ou des vainqueurs assurés de « nager dans le sens du courant ». Ces descriptions touchent incontestablement juste en ce qui concerne la « brève histoire ».
Les progrès historiques en matière de santé, d'éducation et de revenu mis en avant au début de l'ouvrage ne sauraient masquer la durable persistance des inégalités. C'est en effet un leurre. La progression d'ensemble naturellement n'implique rien de systématique en ce qui concerne les rapports entre les groupes sociaux, les pays. L'égalité suppose évidemment la comparaison entre plusieurs termes et ne serait concerner le tout. L'espérance de vie dans le monde, passée de 26 ans au début du XIXe siècle à 73 ans aujourd'hui, ne dit ainsi rien sur la disparité entre pays et entre classes sociales (notamment de l'espérance de vie en bonne santé). L'alphabétisation des plus de 15 ans, passée de 10% au début du XIXe siècle à 85% aujourd'hui, pas plus que le nombre d'années de scolarisation, passé d'à peine une année il y a deux siècle à plus de 8 ans actuellement (12 ans et accès de 50% de la jeune génération à l'université dans les seuls pays riches) ne disent d'avantage sur le maintien durable ou l'accentuation des inégalités. « La société des « trente glorieuses » n'avait pas grand-chose à voir avec une société égalitaire, elle avait cependant amélioré le sort de nombre de personnes peu ou pas diplômées en France. Sans entrer dans la compétition scolaire, on pouvait raisonnablement envisager d'apprendre un métier, percevoir un salaire décent, avoir de bonne conditions d'emploi, obtenir une promotion interne. le vrai changement, à cet égard, réside dans l'irrésistible diminution, depuis cinquante ans, des chances d'ascension professionnelle pour les peu ou pas diplômés. Conséquence directe de l'allongement des scolarités et de la massification des premiers cycles universitaires, les simples bacheliers et nombre de titulaires d'un bac plus deux n'ont guère de chances de monter en cours de carrière. Alors qu'en 1970 61 % des fils d'ouvrier âgés de 30 ans titulaires du seul bac ou du brevet (fin de collège) accédaient à un emploi de cadre moyen ou supérieur, ce n'était plus le cas que de 27 % d'entre eux à la fin des années 1990 . Pour les filles d'ouvrier trentenaires, les proportions étaient respectivement de 20 % et 12 %. Si la hausse des taux de bacheliers (65 % d'une génération en 2010, 80 % en 2019, contre 5 % en 1945) témoigne d'incontestables progrès, elle a aussi eu pour effet de condamner les moins diplômés à faire le deuil de leurs espoirs de « s'en sortir » (P. Pasquali, LMD novembre 2020). le revenu moyen dans le monde quant à lui a été multiplié par dix depuis le XIXe siècle (en € 2020, < 100 € /homme.mois contre ~1000 € /homme.mois au XXIe siècle). Les 50% les plus riches détiennent pourtant en France encore 78% des revenus (au début du XIXe siècle 86%) ; les 50% les plus pauvres en France en revanche ne détiennent que 22% des revenus (au début du XIXe siècle 14%). La part en effet des revenus du capital atteignait 45% du revenu national en France au XIXe siècle ; actuellement elle peut atteindre 50%. Les inégalités de revenu se trouvent donc, au mieux, inchangées. Les progrès historiques en matière de santé, d'éducation et de revenu semblent bien s'accompagner, non de la progression de l'égalité, mais tout au contraire de l'accentuation d'un certain nombre d'inégalités.
La lente déconcentration de la propriété serait un marqueur de ce mouvement de long terme qui va vers plus d'égalité. A partir d'une prémisse : « le mouvement continu, ascendant de l'égalité », il nous semble que Thomas Piketty tire des conclusions absolument forcées de ses recherches. Pour sa démonstration, il compare les 1% les plus riches aux 50% les plus pauvres en France. Les premiers, au début du XXe siècle détiennent 55% de la totalité de la propriété, en 1980 : 18% et en 2020 : 24,5% ; les seconds, au début du XXe siècle détiennent 1,3%, en 1980 : 8% et en 2020 : 5%. Piketty observe une très forte déconcentration des fortunes au cours du XXe siècle jusqu'au début de 1980 et une lente remontée jusqu'à aujourd'hui. Une très forte déconcentration des fortunes et une lente remontée alors que les pentes sont sensiblement identiques, voire même légèrement supérieure pour la redescente ? L'économiste insiste, « Les résultats produits […] illustrent la thèse générale présentée dans ce livre : […] il existe dans le long terme un mouvement vers l'égalité, et en l'occurrence une moindre concentration de la propriété et donc du pouvoir social et économique ». Il constate pourtant que l'inégalité continue de se situer à un niveau extrêmement élevé. En 1780, les 50% des plus pauvres détiennent 2% de la totalité de la propriété ; en 2020, ils détiennent 5% alors que la population a été multipliée par 10. Il est vrai qu'il ne semble pas apercevoir l'inexorable redescente d'aujourd'hui du patrimoine des plus pauvres qui suit la très faible montée du siècle dernier. La propriété des laissés-pour-compte, à ce rythme, devrait pourtant retrouver son niveau du XVIIIe siècle dans seulement une petite vingtaine d'années.
La lente déconcentration du pouvoir entrevue par Thomas Piketty, marqueur du soit disant mouvement de long terme qui va vers plus d'égalité, est lui aussi un leurre absolu. le patrimoine moyen détenu dans la France de 2020 par les 50% les plus pauvres est de 23 mille € par adulte . Les pauvres n'ont aucun patrimoine efficient car, en termes de pouvoir et de poids social, c'est en régime capitaliste interminablement la nature des biens possédés qui décide. Les 10% les plus fortunés séquestrent dans la France de 2020 plus de 55% de la totalité de la propriété. Pour cette fraction de la population, les biens professionnels et les actifs financiers, qui ne cessent de croître lorsque l'on s'élève dans la hiérarchie des fortunes, sont les instruments d'un pouvoir exclusif. Elle possède encore, toujours et sans partage, n'en déplaise au directeur d'étude, à l'universitaire et au patron de labo, le monde, la totalité des moyens de productions et l'État (actifs financiers, titres de la dette, médias, think tanks, etc.).
La lente « […] émergence d'une classe moyenne patrimoniale constitue, pour Thomas Piketty, en terme de réduction des inégalités, une transformation majeure, à la fois sur le plan social, économique et politique. » La réduction des inégalités pour lui s'est faite là, au détriment du pourcent le plus riche. Elle s'est faite au bénéfice de la classe moyenne patrimoniale, classe qui marque la césure entre la moitié la plus pauvres et le décile fortuné. C'est l'antienne d'un mouvement continu, ascendant de l'égalité, de la Classe sociale qui fait oublier toutes les autres. Les classes semblent pourtant aujourd'hui irréconciliables. La classe dominante insatiable qui possède les moyens de production, accapare la survaleur et défend avec une inouïe violence ses intérêts, n'est ni progressiste, ni morale, ni championne des libertés et surtout pas représentante de l'intérêt universellement humain. Les classes ne peuvent être malheureusement fondues en une seule énorme classe moyenne, sinon comme ici de manière incantatoire. La classe moyenne patrimoniale a connu en effet une progression spectaculaire de ses avoirs qui sont passés de 13% au début du XXe siècle à, pour ne plus bouger, 40% en 1980. le patrimoine moyen détenu dans la France de 2020 par la classe moyenne patrimoniale est de 230 mille € par adulte (s'étalant entre 100 mille et 400 mille €) . Mais ce patrimoine est constitué principalement par le logement et quelques autres choses insignifiantes, une propriété qui en terme de pouvoir est sans aucun poids. Sans doute la force de désir, la puissance d'agir appartient elle entièrement à cet individu néolibéral idéal-typique. Mais c'est l'exploitation passionnelle en revanche qui fixe sa puissance à un nombre extraordinairement restreint et néfaste d'objets – ceux du désir-maître. le capitalisme s'est approprié toute l'énergie du désir qui oriente la force d'exister du petit bourgeois, cet être à l'esprit empêché, rempli par trop peu de chose mais entièrement . La classe moyenne conservatrice, incapable de résister au statut de pure marchandise que lui prescrit la logique du capitalisme, n'est évidemment pas la solution mais le verrou qui empêche tous les changements nécessaires.
Une formulation de la question du progrès par Karl Marx permet d'interpréter autrement toute cette soporifique lenteur, comme d'ailleurs nous y invite Thomas Piketty lui-même : « L'histoire avance par le mauvais côté. […] c'est toujours le mauvais côté qui finit par l'emporter sur le côté beau. C'est le mauvais côté qui produit le mouvement qui fait l'histoire en constituant la lutte. » Il semble, à travers les siècles, s'adresser à l'économiste d'aujourd'hui qui, avec l'État social, l'impôt progressif sur le revenu et l'héritage, cherche à retenir de chaque catégorie ou forme sociale le « bon côté » qui ferait progresser l'égalité. Sa conception repose sur la conviction toute idéaliste que, modulo « les rapports de force [qui] ne doivent être ni négligés ni sanctifiés », les valeurs de solidarité et de liberté s'imposent en raison même de l'universalité qu'elles représentent. L'inégalité est avant tout pour Thomas Piketty une construction sociale et politique historique : « Il faut prendre en compte la question des institutions justes et de la délibération égalitaire. » Pour un même développement économique, il existe pour lui toujours de multiples façons d'organiser un régime de propriété et de frontières, un système social et politique, un système fiscal et éducatif. Mais malheureusement l'histoire ne se fait pas « par le bon côté », c'est-à-dire en raison de la force intrinsèque et de l'excellence des idéaux humaniste, moins encore par la force de conviction et l'éducation morale seulement par « la douleur du négatif », l'affrontement des intérêts, la violence des crises et des révolutions. de plus, une dialectique du mauvais côté n'est nullement la garantie de la transformation de la société capitaliste par son propre travail en son contraire, nullement la garantie de convertir circulairement la guerre, la souffrance et l'injustice en facteurs de paix, de prospérité et d'égalité. L'histoire, à contrario de ce qu'affirme Thomas Piketty dans son livre, semble avancer, pas seulement par le mauvais côté, mais aussi du mauvais côté, celui de la domination et de la ruine. Aussi longtemps que le système économique n'est pas changé en ses structures, le discours que tient l'économie politique en place, aussi généreux soit-il, ne saurait être en effet qu'illusion et mystification. L'égalité n'est pas donnée, elle n'est pas programmée, elle ne peut durablement résulter de l'atténuation passagère des contradictions du système capitaliste ; elle dépend de la « subsomption » réelle de la force de travail qui permet ou pas de porter à maturité et de supprimer les contradictions du capitalisme.