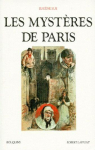Citations sur La Salamandre (17)
D'autres croyaient revoir la chaumière où ils étaient nés, leurs femmes, leurs enfants, tout ce qui leur était cher. Ils s'attendrissaient alors, baisaient leurs enfants au front, et leur promettaient de ne plus naviguer.
Mais tout cela avec le rire aux lèvres ou les larmes aux yeux, avec la meilleure foi du monde. C'était un délire qui s'exprimait par des voies si convaincues, si naturelles, qu'un aveugle eût pris les aberrations de cette fièvre pour des réalités.
C'est qu'un des symptômes de cette fièvre est de développer à l'extrême le désir culminant de chacun, de mettre en relief sa pensée fixe et habituelle, comme dans toutes les folies complètes ou passagères. De là cette vérité naïve que les malheureux mettaient dans la description de leurs rèves in- sensés.
À la vue de cet affreux délire si froid, si serein. Szaffye resta frappé de stupeur. Car, ayant, ainsi que Paul, pris quelques atomes de nourriture, il ne partageait pas cet état d'excitation comateuse, cette exaltation cérébrale dévorante, développée par un soleil ardent et par la réaction sympathique d'un estomac crispé sur un cerveau affaibli; la calenture enfin, cette espèce de mirage moral, ne lui faisait pas éclater le crâne en offrant à sa vue, comme à celle de ces malheureux, de trompeuses images de sites enchanteurs, de festins, de femmes ou de famille.
Szaffye et Paul étaient seuls de sang-froid au milieu de cette effrayante orgie intellectuelle.
Quoique affaiblis par de longues privations, ils avaient conservé assez de lucidité d'esprit pour tout voir, pour tout entendre; Paul surtout, substanté par cette parcelle de nourriture que, la veille, il avait disputée à son père.
Aussi éprouvait-il une horrible angoisse à la vue de ce spectacle qui devint plus affreux encore par l'apparition d'Alice...
D'Alice meurtrie, souillée, les cheveux en désordre, d'Alice, hâve, pâle et amaigrie, mais les joues couvertes d'un vif et éclatant incarnat, les yeux brillants et doués pour ce moment d'une force surnaturelle; d'Alice qui se leva lentement du milieu des deux barriques où elle s'était tenue jusque-là; qui se leva droite et raide comme une statue, à moitié couverte par le caban que Pierre lui avait laissé.
Elle s'avança.
Paul cacha sa tête dans ses mains.
Elle parut chercher quelqu'un des yeux; puis, son regard tombant sur Szaffye, elle repoussa avec une force surprenante les marins qui obstruaient le passage, et arriva près de Szaffye.
- Oh ! Szaffye, dit Alice d'une voix douce et faible en se penchant sur lui avec tendresse, tu es à moi, à moi mon amant, mon amant adoré que seul j'ai aimé de toute mon âme.
Ici Paul voulut s'éloigner; le misérable ne le put. Il avait assez de force morale pour entendre, mais la force physique lui manquait pour fuir.
- J'ai cru aimer Paul, pauvre ange ! Je me trompais. C'était pour moi comme une compagne, comme une sœur; c'était une amie faible et tendre, voilà tout.
Mais toi, oh toi, dit-elle en se redressant avec orgueil, tu es mon amant; chacun de tes regards est pour moi un plaisir et une torture; et puis tes caresses brûlent et enivrent... Oh ! Tes caresses, depuis ce jour où, craignant la mort, je me suis donnée à toi, toute à toi, je les ai toujours senties... Tes caresses ! L'impression m'en est restée et dure encore !
De ce jour, m'a vie n'a été qu'un long plaisir. Car tes baisers... Je les ai encore aux lèvres.
- Oh ! Oh ! Mourir ! cria Paul d'une voix déchirante.
- Qui parle de mourir ?... Vivre avec toi, Szaffye, vivre. Viens, Szaffye, viens. Ma tante est morte, je crois, comme mon père, comme ma mère, comme tout le monde est mort pour moi, du jour où je t'ai aimé. Viens ! Je suis à toi !...
Tiens, vois-tu cette chambre bleue ? C'est la mienne... Ce lit à rideaux blancs ? C'est le mien; le tien, voulais-je dire... Ces fleurs que tu aimes, c'est moi qui les ai mises dans ces vases d'albâtre.
Viens, mon amant, car tu es mon amant... Que me fait le mépris du monde ? Je n'ai pas besoin du monde pour te dire : tu es ma vie, mon âme ! Que me fait le monde ?... Le monde, c'est toi... Viens, Szaffye ! Viens mourir pour revivre et mourir encore au milieu de ces voluptés enivrantes, dont le souvenir me dévore; car depuis... Ce n'est plus le sang, c'est le désir ! Le désir qui circule et bat dans mes veines !
Les yeux de Szaffye devinrent étincelants.
Puis Alice ajouta, en feignant de se déshabiller :
- Tiens... Cette robe noire qui me rendait si blanche... Elle tombe... Que ces lacets sont cruels ! Tiens... Tiens... Ils sont brisés... Au vent, ma longue chevelure brune que tu aimes tant; qu'elle tombe sur mes épaules ! Maintenant, oh ! Viens mon amour, viens... Je t'attends... Oh ! Viens donc...
Et la malheureuse enfant fit le simulacre de monter dans un lit, enjamba le radeau et tomba dans la mer.
Paul poussa un cri terrible, se dressa sur son séant, les mains tendues en avant; mais il ne put se lever..
- Sauve-la donc, monstre ! cria-t-il en montrant Alice qui reparut un instant à la surface de l'eau en étendant les bras. Son dernier mot fut :
- Szaffye.
- Elle meurt heureuse, répondit Szaffye d'une voix sourde, et une larme brilla dans ses yeux.
Mais tout cela avec le rire aux lèvres ou les larmes aux yeux, avec la meilleure foi du monde. C'était un délire qui s'exprimait par des voies si convaincues, si naturelles, qu'un aveugle eût pris les aberrations de cette fièvre pour des réalités.
C'est qu'un des symptômes de cette fièvre est de développer à l'extrême le désir culminant de chacun, de mettre en relief sa pensée fixe et habituelle, comme dans toutes les folies complètes ou passagères. De là cette vérité naïve que les malheureux mettaient dans la description de leurs rèves in- sensés.
À la vue de cet affreux délire si froid, si serein. Szaffye resta frappé de stupeur. Car, ayant, ainsi que Paul, pris quelques atomes de nourriture, il ne partageait pas cet état d'excitation comateuse, cette exaltation cérébrale dévorante, développée par un soleil ardent et par la réaction sympathique d'un estomac crispé sur un cerveau affaibli; la calenture enfin, cette espèce de mirage moral, ne lui faisait pas éclater le crâne en offrant à sa vue, comme à celle de ces malheureux, de trompeuses images de sites enchanteurs, de festins, de femmes ou de famille.
Szaffye et Paul étaient seuls de sang-froid au milieu de cette effrayante orgie intellectuelle.
Quoique affaiblis par de longues privations, ils avaient conservé assez de lucidité d'esprit pour tout voir, pour tout entendre; Paul surtout, substanté par cette parcelle de nourriture que, la veille, il avait disputée à son père.
Aussi éprouvait-il une horrible angoisse à la vue de ce spectacle qui devint plus affreux encore par l'apparition d'Alice...
D'Alice meurtrie, souillée, les cheveux en désordre, d'Alice, hâve, pâle et amaigrie, mais les joues couvertes d'un vif et éclatant incarnat, les yeux brillants et doués pour ce moment d'une force surnaturelle; d'Alice qui se leva lentement du milieu des deux barriques où elle s'était tenue jusque-là; qui se leva droite et raide comme une statue, à moitié couverte par le caban que Pierre lui avait laissé.
Elle s'avança.
Paul cacha sa tête dans ses mains.
Elle parut chercher quelqu'un des yeux; puis, son regard tombant sur Szaffye, elle repoussa avec une force surprenante les marins qui obstruaient le passage, et arriva près de Szaffye.
- Oh ! Szaffye, dit Alice d'une voix douce et faible en se penchant sur lui avec tendresse, tu es à moi, à moi mon amant, mon amant adoré que seul j'ai aimé de toute mon âme.
Ici Paul voulut s'éloigner; le misérable ne le put. Il avait assez de force morale pour entendre, mais la force physique lui manquait pour fuir.
- J'ai cru aimer Paul, pauvre ange ! Je me trompais. C'était pour moi comme une compagne, comme une sœur; c'était une amie faible et tendre, voilà tout.
Mais toi, oh toi, dit-elle en se redressant avec orgueil, tu es mon amant; chacun de tes regards est pour moi un plaisir et une torture; et puis tes caresses brûlent et enivrent... Oh ! Tes caresses, depuis ce jour où, craignant la mort, je me suis donnée à toi, toute à toi, je les ai toujours senties... Tes caresses ! L'impression m'en est restée et dure encore !
De ce jour, m'a vie n'a été qu'un long plaisir. Car tes baisers... Je les ai encore aux lèvres.
- Oh ! Oh ! Mourir ! cria Paul d'une voix déchirante.
- Qui parle de mourir ?... Vivre avec toi, Szaffye, vivre. Viens, Szaffye, viens. Ma tante est morte, je crois, comme mon père, comme ma mère, comme tout le monde est mort pour moi, du jour où je t'ai aimé. Viens ! Je suis à toi !...
Tiens, vois-tu cette chambre bleue ? C'est la mienne... Ce lit à rideaux blancs ? C'est le mien; le tien, voulais-je dire... Ces fleurs que tu aimes, c'est moi qui les ai mises dans ces vases d'albâtre.
Viens, mon amant, car tu es mon amant... Que me fait le mépris du monde ? Je n'ai pas besoin du monde pour te dire : tu es ma vie, mon âme ! Que me fait le monde ?... Le monde, c'est toi... Viens, Szaffye ! Viens mourir pour revivre et mourir encore au milieu de ces voluptés enivrantes, dont le souvenir me dévore; car depuis... Ce n'est plus le sang, c'est le désir ! Le désir qui circule et bat dans mes veines !
Les yeux de Szaffye devinrent étincelants.
Puis Alice ajouta, en feignant de se déshabiller :
- Tiens... Cette robe noire qui me rendait si blanche... Elle tombe... Que ces lacets sont cruels ! Tiens... Tiens... Ils sont brisés... Au vent, ma longue chevelure brune que tu aimes tant; qu'elle tombe sur mes épaules ! Maintenant, oh ! Viens mon amour, viens... Je t'attends... Oh ! Viens donc...
Et la malheureuse enfant fit le simulacre de monter dans un lit, enjamba le radeau et tomba dans la mer.
Paul poussa un cri terrible, se dressa sur son séant, les mains tendues en avant; mais il ne put se lever..
- Sauve-la donc, monstre ! cria-t-il en montrant Alice qui reparut un instant à la surface de l'eau en étendant les bras. Son dernier mot fut :
- Szaffye.
- Elle meurt heureuse, répondit Szaffye d'une voix sourde, et une larme brilla dans ses yeux.
- Écoutez-moi, Paul. Supposez par la pensée un homme d'un génie immense, d'une beauté parfaite, d'une richesse royale, d'une âme sublime. Eh bien ! Paul...
- Hélas, monsieur ! Faut-il donc tout cela pour être aimé ?
- Il faut tout cela, Paul, pour se voir souvent sacrifié à un être dégradé, stupide et difforme.
- Oh ! Monsieur ! C'est une cruelle raillerie !
- Je ne raille pas, je parle vrai ! Paul, il n'est pas donné aux passions de l'homme ou de la femme de s'arrêter à un terme, tel complet qu'il soit; l'activité de l'esprit humain ne s'éteindrait pas même dans la possession d'un être idéal. Ainsi, Paul, une femme arrivant à rencontrer une perfection, ne s'en tiendra pas là. Par cela même qu'elle n'aura plus rien à chercher au-dessus, elle cherchera au-dessous, et se jettera dans les contrastes. Or, une fois aux contrastes, les plus tranchants sont les meilleurs; c'est l'histoire de la femme de Joconde : car sous un vernis de fadeur et de légèreté, il y a là une vérité bien profonde et bien vraie, soit qu'on l'applique au physique ou au moral. Avez-vous lu Joconde, Paul ?
- Non, monsieur.
- Eh bien ! Joconde était un prince riche, beau, aimable et spirituel. Il quitte sa femme pour faire un voyage; elle était encore chaude de ses baisers d'adieu qu'il revient à l'improviste, et la trouve couchée avec un laquais crétin, idiot et difforme.
C'est, comme je vous le disais, l'irrésistible besoin des contrastes. C'est encore cet ancien symbole du fruit défendu, appliqué au moral, c'est encore l'amour de l'imprévu, du bizarre, qui leur fait mettre des pagodes et des monstres sur leur cheminée ou dans leur lit.
- Oh ! C'est horrible ! Horrible ! dit Paul en cachant sa tête dans ses mains.
- Et je vous le répète, ce que je dis de la difformité physique, s'applique bien mieux encore à la difformité morale; mais c'est une recherche.
Pour en revenir à l'homme complet que nous supposons, figurez-vous, Paul, notre type idéal, notre grand homme, amant passionné d'une femme jeune et belle : mais cette femme aura mille moyens de fouler aux pieds cet homme, dont la supériorité l'écrase et la blessera toujours; et elle les emploiera. Car il n'y a chez la femme qu'un sentiment profond et inaltérable, c'est celui de l'amour-propre.
Songez donc que d'un baiser, elle pourra faire un sot, un crétin, plus grand que lui grand homme; plus grand, surtout à ses yeux à lui, qui se verra sacrifié, qui verra un crétin jouir du bonheur qu'on lui refuse.
Alors, Paul, voyez les tortures, écoutez les cris, les sanglots de ce grand homme, qui aime avec plus de frénésie encore depuis qu'on le délaisse ! Le voilà qui renie sa gloire, son nom célèbre, son génie, sa beauté, sa richesse; le voilà qui se maudit, lui Byron, lui Bonaparte, lui Dante, lui... Que sais-je, moi ? Le voilà qui s'abhorre, le voilà, par l'infernal caprice de cette femme, amené, lui si grand, à donner avec délices son sang, son âme, s'il le pouvait, pour être stupide pendant une heure, une seconde, toute sa vie ! Puisque sa maitresse aime les gens stupides, et qu'elle n'aime plus les grands hommes !
Et vous croyez, Paul, qu'il existe une femme capable de résister à la jouissance de se dire : "Par un caprice frivole, caprice né en lissant mes cheveux ou en chiffonnant une écharpe, moi, moi fémine faible, obscure et sans nom, j'ai amené l'homme qui fait l'orgueil, l'éclat et la gloire d'une nation, d'un monde, - d'un univers ! - à maudire ces dons divins, l'envie des hommes, l'admiration des autres femmes; à les maudire et à crier les mains jointes, à genoux, les yeux en larmes : Mon Dieu ! Mon Dieu ! Fais-moi donc aussi abject que tu m'as fait puissant; et elle m'aimera peut-être !" ?
Non, non, aucune fille d'Ève ne résisterait à cette tentation, jeune homme.
- Mais, au nom du ciel, que faire donc ? Que croire ?
- Un vieux vers hindou le dit : "S'attendre à tout, pour ne s'étonner de rien".
- Mais c'est le doute, cela; c'est l'incrédulité qui ronge le cœur.
- Oui, Paul; tant qu'on a un cœur. Mais après ? Mais quand on n'en a plus, de cœur; quand, flétri, desséché, il est mort, insensible et froid, on défie le monde et ses déceptions : car alors ce cœur n'est plus qu'un cadavre que l'on expose aux tortures sociales, - et l'on rit. -
- Hélas, monsieur ! Faut-il donc tout cela pour être aimé ?
- Il faut tout cela, Paul, pour se voir souvent sacrifié à un être dégradé, stupide et difforme.
- Oh ! Monsieur ! C'est une cruelle raillerie !
- Je ne raille pas, je parle vrai ! Paul, il n'est pas donné aux passions de l'homme ou de la femme de s'arrêter à un terme, tel complet qu'il soit; l'activité de l'esprit humain ne s'éteindrait pas même dans la possession d'un être idéal. Ainsi, Paul, une femme arrivant à rencontrer une perfection, ne s'en tiendra pas là. Par cela même qu'elle n'aura plus rien à chercher au-dessus, elle cherchera au-dessous, et se jettera dans les contrastes. Or, une fois aux contrastes, les plus tranchants sont les meilleurs; c'est l'histoire de la femme de Joconde : car sous un vernis de fadeur et de légèreté, il y a là une vérité bien profonde et bien vraie, soit qu'on l'applique au physique ou au moral. Avez-vous lu Joconde, Paul ?
- Non, monsieur.
- Eh bien ! Joconde était un prince riche, beau, aimable et spirituel. Il quitte sa femme pour faire un voyage; elle était encore chaude de ses baisers d'adieu qu'il revient à l'improviste, et la trouve couchée avec un laquais crétin, idiot et difforme.
C'est, comme je vous le disais, l'irrésistible besoin des contrastes. C'est encore cet ancien symbole du fruit défendu, appliqué au moral, c'est encore l'amour de l'imprévu, du bizarre, qui leur fait mettre des pagodes et des monstres sur leur cheminée ou dans leur lit.
- Oh ! C'est horrible ! Horrible ! dit Paul en cachant sa tête dans ses mains.
- Et je vous le répète, ce que je dis de la difformité physique, s'applique bien mieux encore à la difformité morale; mais c'est une recherche.
Pour en revenir à l'homme complet que nous supposons, figurez-vous, Paul, notre type idéal, notre grand homme, amant passionné d'une femme jeune et belle : mais cette femme aura mille moyens de fouler aux pieds cet homme, dont la supériorité l'écrase et la blessera toujours; et elle les emploiera. Car il n'y a chez la femme qu'un sentiment profond et inaltérable, c'est celui de l'amour-propre.
Songez donc que d'un baiser, elle pourra faire un sot, un crétin, plus grand que lui grand homme; plus grand, surtout à ses yeux à lui, qui se verra sacrifié, qui verra un crétin jouir du bonheur qu'on lui refuse.
Alors, Paul, voyez les tortures, écoutez les cris, les sanglots de ce grand homme, qui aime avec plus de frénésie encore depuis qu'on le délaisse ! Le voilà qui renie sa gloire, son nom célèbre, son génie, sa beauté, sa richesse; le voilà qui se maudit, lui Byron, lui Bonaparte, lui Dante, lui... Que sais-je, moi ? Le voilà qui s'abhorre, le voilà, par l'infernal caprice de cette femme, amené, lui si grand, à donner avec délices son sang, son âme, s'il le pouvait, pour être stupide pendant une heure, une seconde, toute sa vie ! Puisque sa maitresse aime les gens stupides, et qu'elle n'aime plus les grands hommes !
Et vous croyez, Paul, qu'il existe une femme capable de résister à la jouissance de se dire : "Par un caprice frivole, caprice né en lissant mes cheveux ou en chiffonnant une écharpe, moi, moi fémine faible, obscure et sans nom, j'ai amené l'homme qui fait l'orgueil, l'éclat et la gloire d'une nation, d'un monde, - d'un univers ! - à maudire ces dons divins, l'envie des hommes, l'admiration des autres femmes; à les maudire et à crier les mains jointes, à genoux, les yeux en larmes : Mon Dieu ! Mon Dieu ! Fais-moi donc aussi abject que tu m'as fait puissant; et elle m'aimera peut-être !" ?
Non, non, aucune fille d'Ève ne résisterait à cette tentation, jeune homme.
- Mais, au nom du ciel, que faire donc ? Que croire ?
- Un vieux vers hindou le dit : "S'attendre à tout, pour ne s'étonner de rien".
- Mais c'est le doute, cela; c'est l'incrédulité qui ronge le cœur.
- Oui, Paul; tant qu'on a un cœur. Mais après ? Mais quand on n'en a plus, de cœur; quand, flétri, desséché, il est mort, insensible et froid, on défie le monde et ses déceptions : car alors ce cœur n'est plus qu'un cadavre que l'on expose aux tortures sociales, - et l'on rit. -
Alors il commença de regarder les hommes et les femmes en grande pitié.
Car, par un singulier caprice de notre organisation, ce sont toujours les hommes qui ont le plus à se louer du monde qui exècrent le plus ce monde.
On le conçoit l'homme, supérieur surtout, a de ces moments de tristesse amère, de découragement profond dont le caractère principal est un sen- timent prononcé de mépris pour lui-même.
Et quand il vient à penser que lui, lui si dégradé à ses propres yeux, est adulé, recherché, prôné par le monde, en vérité, il doit le dédaigner ou le haïr beaucoup, ce monde !
Or, Szaffye, blasé sur tout, parce que tout lui avait réussi, tomba dans une mélancolie incurable. Ses pensées devinrent sombres et poignantes; et, pendant deux années, il monta ou descendit tous les degrés qui mènent au suicide.
Arrivé là, il réfléchit une dernière fois, fouilla encore son cœur, mais il le trouva mort, mort et insensible à tout.
Une dernière fois, il remonta des effets aux causes, et rencontra, dans le bonheur qui l'avait poursuivi, la source des maux imaginaires ou réels qui le torturaient sans relâche.
Alors, par un sentiment que l'on taxera si l'on veut de monomanie, il se prit à exécrer, à maudire ce monde qui, en le faisant si heureux, l'avait rendu si misérable.
Car, par un singulier caprice de notre organisation, ce sont toujours les hommes qui ont le plus à se louer du monde qui exècrent le plus ce monde.
On le conçoit l'homme, supérieur surtout, a de ces moments de tristesse amère, de découragement profond dont le caractère principal est un sen- timent prononcé de mépris pour lui-même.
Et quand il vient à penser que lui, lui si dégradé à ses propres yeux, est adulé, recherché, prôné par le monde, en vérité, il doit le dédaigner ou le haïr beaucoup, ce monde !
Or, Szaffye, blasé sur tout, parce que tout lui avait réussi, tomba dans une mélancolie incurable. Ses pensées devinrent sombres et poignantes; et, pendant deux années, il monta ou descendit tous les degrés qui mènent au suicide.
Arrivé là, il réfléchit une dernière fois, fouilla encore son cœur, mais il le trouva mort, mort et insensible à tout.
Une dernière fois, il remonta des effets aux causes, et rencontra, dans le bonheur qui l'avait poursuivi, la source des maux imaginaires ou réels qui le torturaient sans relâche.
Alors, par un sentiment que l'on taxera si l'on veut de monomanie, il se prit à exécrer, à maudire ce monde qui, en le faisant si heureux, l'avait rendu si misérable.
Oh ! la vie d'Orient, la vie d'Orient ! Seule existence qui ne soit pas une longue déception ! Car là ne sont point de ces bonheurs en théorie, de ces félicités spéculatives... Non ! Non ! C'est un bonheur vrai, positif, prouvé.
Et qu'on ne croie pas y trouver seulement une suite de plaisirs, purement matériels. C'est au contraire la vie du monde la plus spiritualisée, comme toutes les vies paresseuses et contemplatives. Car enfin connaissez-vous un Oriental qui ne soit pas poète ? Ne puise-t-il pas la poésie ou l'ivresse ? -car l'ivresse est de la poésie accidentelle - ne puise-t-il pas la poésie à trois sources : dans son Narguileh, dans sa tasse et dans son Taim ?
La poésie du Narguileh, poésie aérienne, diaphane et indécise comme la vapeur embaumée qui s'en exhale. C'est une harmonie confuse, un rêve léger, une pensée que l'on quitte et qu'on reprend, une gracieuse figure qui apparait quelquefois nue, quelquefois demi-voilée par la fraiche fumée du tabac levantin.
Puis la poésie du café, déjà plus forte, plus arrêtée. Les idées se nouent, s'enlacent, et développent, avec une merveilleuse lucidité, leur éclatant tissu. L'imagination déploie ses ailes de feu, et vous emporte dans les plus hautes régions de la pensée. Alors les siècles se déroulent à vos yeux, colorés et rapides, comme ces rivages qui semblent fuir quand le flot vous emporte. Alors les hautes méditations sur les hommes, sur l'âme, sur Dieu; alors tous les systèmes, toutes les croyances : on adopte tout, on éprouve tout, on croit à tout. Pendant ce sublime instant d'hallucination, on a revètu tour à tour chaque conviction; on a été le Christ, Mahomet, César, que sais-je, moi ?
Enfin, la poésie de l'opium, poésie toute fantastique, nerveuse, convulsive, âcre, dernier terme de cette vie poétique qu'elle complète. Ainsi, ce que Faust a tant cherché, ce qui a damné Manfred, l'opium vous le donne. Vous évoquez les ombres, les ombres vous apparaissent. Voulez-vous assister à d'affreux mystères ? Alors c'est un drame infernal, bizarre, surhumain, des êtres sans nom, des sons indéfinissables, une angoisse qui tuerait si elle était prolongée, et puis, toujours maître de votre faculté volitive qui sommeille. D'une pensée, vous changez ce hideux tableau en quelque ravissante vision d'amour, de femmes ou de gloire.
Et puis, après avoir plané dans ces hautes sphères et goûté ces sublimes jouissances intellectuelles, vous prenez terre dans votre harem. Là, une foule de femmes belles, soumises, aimantes; car, fussiez-vous laid et difforme, elles vous aiment : Là, des plaisirs sans nombre, variés, délicats et recherchés. C'est alors la vie matérielle qui succède à la vie intellectuelle. Alors, plongé dans l'engourdissement de la pensée qui se repose, vous devenez stupide, inerte; tous vos sens dorment, moins un, et cet un s'accroît encore de l'absence momentanée des autres, aussi êtes-vous heureux, comme un sot; et vous savez le bonheur des sots, "bone Deus !"
Et ceci n'est pas une vaine théorie, une utopie faite à plaisir.
Le tabac ne trompe pas, le café ne trompe pas, l'opium ne trompe pas; leur réaction sur notre organisme nerveux est positive et physiologiquement prouvée et déduite. Il faut que notre organisation morale cède à leur influence : tristes ou gaies, heureux ou malheureux, nos sensations intimes s'effacent devant une bouffée de tabac, dix grains de café ou un morceau d'opium.
Les femmes de votre harem ne vous trompent pas non plus. C'est un fait que leur peau fraiche et satinée, que leur chevelure noire et soyeuse, que leurs dents blanches, que leurs lèvres rouges : ce sont des faits que leurs caresses ardentes et passionnées; car, élevées au sérail, vous êtes le seul homme qu'elles aient vu et qu'elles verront jamais.
Ainsi, si votre tabac, votre café et votre opium sont de qualité supérieure, si vous êtes assez riche pour mettre six mille piastres à une Géorgienne, trouvez-moi donc une seule déception dans cette existence toute intellectuelle, dont le bonheur entier, complet, ne repose pas sur des bases fragiles et mouvantes comme le cœur d'une femme ou d'un ami, mais sur des faits matériels que l'on achète à l'once et qu'on trouve dans tous les bazars de Smyrne et de Constantinople !
Et qu'on ne croie pas y trouver seulement une suite de plaisirs, purement matériels. C'est au contraire la vie du monde la plus spiritualisée, comme toutes les vies paresseuses et contemplatives. Car enfin connaissez-vous un Oriental qui ne soit pas poète ? Ne puise-t-il pas la poésie ou l'ivresse ? -car l'ivresse est de la poésie accidentelle - ne puise-t-il pas la poésie à trois sources : dans son Narguileh, dans sa tasse et dans son Taim ?
La poésie du Narguileh, poésie aérienne, diaphane et indécise comme la vapeur embaumée qui s'en exhale. C'est une harmonie confuse, un rêve léger, une pensée que l'on quitte et qu'on reprend, une gracieuse figure qui apparait quelquefois nue, quelquefois demi-voilée par la fraiche fumée du tabac levantin.
Puis la poésie du café, déjà plus forte, plus arrêtée. Les idées se nouent, s'enlacent, et développent, avec une merveilleuse lucidité, leur éclatant tissu. L'imagination déploie ses ailes de feu, et vous emporte dans les plus hautes régions de la pensée. Alors les siècles se déroulent à vos yeux, colorés et rapides, comme ces rivages qui semblent fuir quand le flot vous emporte. Alors les hautes méditations sur les hommes, sur l'âme, sur Dieu; alors tous les systèmes, toutes les croyances : on adopte tout, on éprouve tout, on croit à tout. Pendant ce sublime instant d'hallucination, on a revètu tour à tour chaque conviction; on a été le Christ, Mahomet, César, que sais-je, moi ?
Enfin, la poésie de l'opium, poésie toute fantastique, nerveuse, convulsive, âcre, dernier terme de cette vie poétique qu'elle complète. Ainsi, ce que Faust a tant cherché, ce qui a damné Manfred, l'opium vous le donne. Vous évoquez les ombres, les ombres vous apparaissent. Voulez-vous assister à d'affreux mystères ? Alors c'est un drame infernal, bizarre, surhumain, des êtres sans nom, des sons indéfinissables, une angoisse qui tuerait si elle était prolongée, et puis, toujours maître de votre faculté volitive qui sommeille. D'une pensée, vous changez ce hideux tableau en quelque ravissante vision d'amour, de femmes ou de gloire.
Et puis, après avoir plané dans ces hautes sphères et goûté ces sublimes jouissances intellectuelles, vous prenez terre dans votre harem. Là, une foule de femmes belles, soumises, aimantes; car, fussiez-vous laid et difforme, elles vous aiment : Là, des plaisirs sans nombre, variés, délicats et recherchés. C'est alors la vie matérielle qui succède à la vie intellectuelle. Alors, plongé dans l'engourdissement de la pensée qui se repose, vous devenez stupide, inerte; tous vos sens dorment, moins un, et cet un s'accroît encore de l'absence momentanée des autres, aussi êtes-vous heureux, comme un sot; et vous savez le bonheur des sots, "bone Deus !"
Et ceci n'est pas une vaine théorie, une utopie faite à plaisir.
Le tabac ne trompe pas, le café ne trompe pas, l'opium ne trompe pas; leur réaction sur notre organisme nerveux est positive et physiologiquement prouvée et déduite. Il faut que notre organisation morale cède à leur influence : tristes ou gaies, heureux ou malheureux, nos sensations intimes s'effacent devant une bouffée de tabac, dix grains de café ou un morceau d'opium.
Les femmes de votre harem ne vous trompent pas non plus. C'est un fait que leur peau fraiche et satinée, que leur chevelure noire et soyeuse, que leurs dents blanches, que leurs lèvres rouges : ce sont des faits que leurs caresses ardentes et passionnées; car, élevées au sérail, vous êtes le seul homme qu'elles aient vu et qu'elles verront jamais.
Ainsi, si votre tabac, votre café et votre opium sont de qualité supérieure, si vous êtes assez riche pour mettre six mille piastres à une Géorgienne, trouvez-moi donc une seule déception dans cette existence toute intellectuelle, dont le bonheur entier, complet, ne repose pas sur des bases fragiles et mouvantes comme le cœur d'une femme ou d'un ami, mais sur des faits matériels que l'on achète à l'once et qu'on trouve dans tous les bazars de Smyrne et de Constantinople !
Or, maître Buyk, d'ailleurs devin fort habile et fort estimé à bord, participait, quant au moral, de la froide dureté du parquet de fer qui couvrait son plancher.
Voyez plutôt :
Sur un coffre assez bas un homme accroupi tenait sa tête dans ses mains. C'était maître Buyk.
Il portait pour tout vêtement un pantalon de toile grise, et pas de chemise, selon son habitude, vu la chaleur étouffante qui règne dans cet espace étroit et presque privé d'air et de jour.
Il paraissait d'une taille moyenne, maigre, mais merveilleusement musclé. La lueur du fanal qui éclairait la fosse ne jetait qu'une clarté douteuse et rougeâtre.
Il leva sa tête. Ses cheveux étaient gris et rares; ses yeux creux et ternes; ses pommettes saillantes; et par négligence il portait sa barbe longue.
- Misère ! cria-t-il d'une voix forte.
On ne répondit pas.
- Misère ! Misère ! Misère !...
Silence.
- Misère ! Misère ! Misère ! Misère !
À la quatrième fois, une voix faible et éloignée répondit avec un accent de terreur :
- Me voilà, me voilà, maître... Me voilà...
Et la voix approchait en répétant toujours :
- Me voilà ! Me voilà !
Enfin, un enfant de sept à huit ans sauta d'un bond dans la fosse. C'était Misère.
Maître Buyk était toujours assis. Il fit un signe de la main.
Misère sentit un léger frisson courir par tout son corps en allant prendre dans un coin de la porte une espèce de martinet fait de plusieurs houts de corde à noeuds bien serrés. Il le présenta au maître.
Puis il se mit à genoux et tendit le dos.
Et c'était pitié que ce pauvre corps maigre, chétif, souffreteux, jaune et étiolé.
Maître Buyk parla :
- Je t'ai appelé quatre fois, et tu n'es pas venu. Et quatre coups fortement appliqués fouettèrent l'enfant, qui ne poussa pas un cri, pas une plainte, se releva, prit le martinet, dont il s'essuya les yeux sans que le maître pût le voir, le remit au clou, et revint se planter debout devant le maître.
- À présent, dis-moi : Pourquoi as-tu tardé autant ?
- Maître, on me battait là-haut.
- Tu mens ! Tu jouais.
- Je jouais ! Maître... Je jouais ! Mon Dieu ! Je jouais ! Qui donc voudrait jouer avec moi ? dit le triste et chétif enfant avec un accent d'amertume indéfinissable. Les autres mousses me battent quand je leur parle; ils me prennent mon pain, ils m'appellent rat de cale; et tout à l'heure, maître, on m'a fouetté là-haut, parce qu'ils disent que dix coups de fouet à un mousse donnent du bon vent. Oh ! Maître ! Allez, vous m'avez bien nommé... Misère ajouta-t-il en soupirant, car il n'osait pleurer; et tout son corps meurtri et bleu tremblait comme la feuille; la chaleur était étouffante, et il avait froid.
- Quel temps fait-il donc ?
- Depuis hier, il vente du nord-ouest, maître.
- Et le vent du nord-ouest souffle toujours ? demande Buyk d'une voix tonnante.
- Oui, maître, dit l'enfant tout peureux.
- Il souffle du nord-ouest ! répéta le maître tout pensif.
- Oui, maître.
- Qui te parle ?
Et ces trois mots furent accompagnés d'un soufflet.
Maître Buyk tomba dans une profonde méditation qu'il n'interrompit que pour faire des figures et des signes avec des cailloux, des bouts de cordes et son couteau.
L'enfant ne bougeait; immobile, craignant de s'attirer de nouveaux coups, retenant son haleine. Et en vérité, Misère était bien à plaindre. Ce malheureux avait été embarqué à bord par pitié; sa mère était morte à l'hôpital, et maître Buyk, l'ayant pour ainsi dire adopté, en avait fait son mousse, et lui faisait bien, je vous assure, payer le pain qu'il ne mangeait pas toujours, le pauvre enfant !
Enfin Misère était si chétif, si souffrant, que, pour cet étre maladif, il eut fallu de l'air, du soleil, des jeux d'enfant, bruyants et animés, une bonne vie joyeuse et insouciante, du repos et du sommeil. Lui, au contraire, ne quittait la cale que le moins possible, tant il redoutait les autres mousses, qui le pourchassaient, le tourmentaient et le battaient. Aussi le seul plaisir du misérable, c'était la nuit, pendant que son maître dormait, de se glisser comme une couleuvre sur le pont, de monter sur les bastingages, et de là, dans les porte-haubans.
Alors, sa pauvre figure souffrante s'épanouissait, frappée, ranimée qu'elle était par ce bon air marin; il éprouvait un bonheur d'enfant à voir les lames bondir, bouillonner, et se briser sur l'avant du navire en l'inondant d'une clarté phosphorescente; à regarder les étoiles briller dans le ciel, à écouter Ja voix de la mer, et à rester une heure sans être battu.
Mais ces momens de vif plaisir étaient courts et rares, tant il craignait de ne pas répondre à la voix terrible de maître Buyk. Aussi, par instants, le faible cerveau de ce malheureux se dérangeait. Alors, pâle et livide, un affreux sourire sur les lèvres, agrandissant ses yeux d'une manière horrible, il disait de sa petite voix grêle et stridente :
- Le rat de cale a de bonnes dents, de bonnes dents, et il rongera la noix.
Et en prononçant ces paroles inintelligibles, il tournait sur lui-même avec une effrayante rapidité; puis enfin, épuisé, il tombait dans un sommeil léthargique, que son maître interrompait à grands coups de corde, le rappelant ainsi à lui-même.
Voyez plutôt :
Sur un coffre assez bas un homme accroupi tenait sa tête dans ses mains. C'était maître Buyk.
Il portait pour tout vêtement un pantalon de toile grise, et pas de chemise, selon son habitude, vu la chaleur étouffante qui règne dans cet espace étroit et presque privé d'air et de jour.
Il paraissait d'une taille moyenne, maigre, mais merveilleusement musclé. La lueur du fanal qui éclairait la fosse ne jetait qu'une clarté douteuse et rougeâtre.
Il leva sa tête. Ses cheveux étaient gris et rares; ses yeux creux et ternes; ses pommettes saillantes; et par négligence il portait sa barbe longue.
- Misère ! cria-t-il d'une voix forte.
On ne répondit pas.
- Misère ! Misère ! Misère !...
Silence.
- Misère ! Misère ! Misère ! Misère !
À la quatrième fois, une voix faible et éloignée répondit avec un accent de terreur :
- Me voilà, me voilà, maître... Me voilà...
Et la voix approchait en répétant toujours :
- Me voilà ! Me voilà !
Enfin, un enfant de sept à huit ans sauta d'un bond dans la fosse. C'était Misère.
Maître Buyk était toujours assis. Il fit un signe de la main.
Misère sentit un léger frisson courir par tout son corps en allant prendre dans un coin de la porte une espèce de martinet fait de plusieurs houts de corde à noeuds bien serrés. Il le présenta au maître.
Puis il se mit à genoux et tendit le dos.
Et c'était pitié que ce pauvre corps maigre, chétif, souffreteux, jaune et étiolé.
Maître Buyk parla :
- Je t'ai appelé quatre fois, et tu n'es pas venu. Et quatre coups fortement appliqués fouettèrent l'enfant, qui ne poussa pas un cri, pas une plainte, se releva, prit le martinet, dont il s'essuya les yeux sans que le maître pût le voir, le remit au clou, et revint se planter debout devant le maître.
- À présent, dis-moi : Pourquoi as-tu tardé autant ?
- Maître, on me battait là-haut.
- Tu mens ! Tu jouais.
- Je jouais ! Maître... Je jouais ! Mon Dieu ! Je jouais ! Qui donc voudrait jouer avec moi ? dit le triste et chétif enfant avec un accent d'amertume indéfinissable. Les autres mousses me battent quand je leur parle; ils me prennent mon pain, ils m'appellent rat de cale; et tout à l'heure, maître, on m'a fouetté là-haut, parce qu'ils disent que dix coups de fouet à un mousse donnent du bon vent. Oh ! Maître ! Allez, vous m'avez bien nommé... Misère ajouta-t-il en soupirant, car il n'osait pleurer; et tout son corps meurtri et bleu tremblait comme la feuille; la chaleur était étouffante, et il avait froid.
- Quel temps fait-il donc ?
- Depuis hier, il vente du nord-ouest, maître.
- Et le vent du nord-ouest souffle toujours ? demande Buyk d'une voix tonnante.
- Oui, maître, dit l'enfant tout peureux.
- Il souffle du nord-ouest ! répéta le maître tout pensif.
- Oui, maître.
- Qui te parle ?
Et ces trois mots furent accompagnés d'un soufflet.
Maître Buyk tomba dans une profonde méditation qu'il n'interrompit que pour faire des figures et des signes avec des cailloux, des bouts de cordes et son couteau.
L'enfant ne bougeait; immobile, craignant de s'attirer de nouveaux coups, retenant son haleine. Et en vérité, Misère était bien à plaindre. Ce malheureux avait été embarqué à bord par pitié; sa mère était morte à l'hôpital, et maître Buyk, l'ayant pour ainsi dire adopté, en avait fait son mousse, et lui faisait bien, je vous assure, payer le pain qu'il ne mangeait pas toujours, le pauvre enfant !
Enfin Misère était si chétif, si souffrant, que, pour cet étre maladif, il eut fallu de l'air, du soleil, des jeux d'enfant, bruyants et animés, une bonne vie joyeuse et insouciante, du repos et du sommeil. Lui, au contraire, ne quittait la cale que le moins possible, tant il redoutait les autres mousses, qui le pourchassaient, le tourmentaient et le battaient. Aussi le seul plaisir du misérable, c'était la nuit, pendant que son maître dormait, de se glisser comme une couleuvre sur le pont, de monter sur les bastingages, et de là, dans les porte-haubans.
Alors, sa pauvre figure souffrante s'épanouissait, frappée, ranimée qu'elle était par ce bon air marin; il éprouvait un bonheur d'enfant à voir les lames bondir, bouillonner, et se briser sur l'avant du navire en l'inondant d'une clarté phosphorescente; à regarder les étoiles briller dans le ciel, à écouter Ja voix de la mer, et à rester une heure sans être battu.
Mais ces momens de vif plaisir étaient courts et rares, tant il craignait de ne pas répondre à la voix terrible de maître Buyk. Aussi, par instants, le faible cerveau de ce malheureux se dérangeait. Alors, pâle et livide, un affreux sourire sur les lèvres, agrandissant ses yeux d'une manière horrible, il disait de sa petite voix grêle et stridente :
- Le rat de cale a de bonnes dents, de bonnes dents, et il rongera la noix.
Et en prononçant ces paroles inintelligibles, il tournait sur lui-même avec une effrayante rapidité; puis enfin, épuisé, il tombait dans un sommeil léthargique, que son maître interrompait à grands coups de corde, le rappelant ainsi à lui-même.
Oh ! N'aimez-vous pas une de ces imposantes symphonies où cent musiciens attentifs concourent à exprimer un seul son composé de mille sons, une harmonie unique composée de mille harmonies; où cent musiciens lisent enfin d'une seule et grande voix un immense poème musical tour à tour vif et triste, folâtre et passionné ?
N'aimez-vous pas à songer avec admiration que ces bruits si divers, si opposés, se perdent, se fondent en un seul, et que ces extrêmes ne se touchent que pour s'unir en une mélodie ravissante ? Car ce sont les éclats retentissants et métalliques du cuivre, et les cris doux et plaintifs du basson, les accords sourds et caverneux des instruments à cordes, et les chants purs et suaves des flûtes, les vibrations sonores de la harpe et les roulements funèbres des timbales. Quels contrastes de sons !
Et penser que tout cela a sa phrase ou son mot à dire, que tout complète l'effet général; que depuis le solo ambitieux des premières parties jusqu'au tintement modeste du triangle d'acier, tout a la même importance, le même pouvoir, pour rendre l'harmonie expressive et grandiose.
Si vous aimez tout cela, alors vous aimerez, vous admirerez l'immense et tonnante voix de l'orgie qui rugissait dans la taverne de Saint-Marcel.
Mais, je vous le jure, il n'y avait pas non plus un bruit, un son, à retrancher dans cette sauvage harmonie; car cette harmonie aussi a ses exigences et ses règles immuables; une orgie d'une belle facture, c'est si peu commun ! Il faut tant de choses pour compléter sa mélodie à elle !
Il faut de tout, depuis les rires fous jusqu'aux pleurs de rage; de tout, depuis les refrains joyeux jusqu'aux blasphèmes et aux hurlements; il faut aussi des cris de fureur aigres et perçants; il faut des voix de femmes au timbre encore pur et frais, mais qui commence à trembler. Il faut des gémis- sements sourds, des hommes qui tombent lourds et avinés. Il faut les imprécations, les injures des gens qui se querellent, des mots de défi, des bruits de soufflets et des cris de mort. Le cliquetis et le froissement d'épées qui se croisent est aussi d'un admirable effet. Mais malheur ! C'est aussi rare qu'un véritable tamtam dans un orchestre.
Que vous dirai-je ! Il faut la sonorité mordante des verres et des bouteilles qui éclatent; il faut l'aigre grincement des fourchettes que les ivres font crier sur la porcelaine.
Enfin là aussi tout est important, nécessaire, depuis les trépignements frénétiques d'une ronde en délire qui tourne et bondit, jusqu'au doux bruis- sement d'un baiser pris et rendu dans l'ombre; il faut de tout, vous dis-je !
N'aimez-vous pas à songer avec admiration que ces bruits si divers, si opposés, se perdent, se fondent en un seul, et que ces extrêmes ne se touchent que pour s'unir en une mélodie ravissante ? Car ce sont les éclats retentissants et métalliques du cuivre, et les cris doux et plaintifs du basson, les accords sourds et caverneux des instruments à cordes, et les chants purs et suaves des flûtes, les vibrations sonores de la harpe et les roulements funèbres des timbales. Quels contrastes de sons !
Et penser que tout cela a sa phrase ou son mot à dire, que tout complète l'effet général; que depuis le solo ambitieux des premières parties jusqu'au tintement modeste du triangle d'acier, tout a la même importance, le même pouvoir, pour rendre l'harmonie expressive et grandiose.
Si vous aimez tout cela, alors vous aimerez, vous admirerez l'immense et tonnante voix de l'orgie qui rugissait dans la taverne de Saint-Marcel.
Mais, je vous le jure, il n'y avait pas non plus un bruit, un son, à retrancher dans cette sauvage harmonie; car cette harmonie aussi a ses exigences et ses règles immuables; une orgie d'une belle facture, c'est si peu commun ! Il faut tant de choses pour compléter sa mélodie à elle !
Il faut de tout, depuis les rires fous jusqu'aux pleurs de rage; de tout, depuis les refrains joyeux jusqu'aux blasphèmes et aux hurlements; il faut aussi des cris de fureur aigres et perçants; il faut des voix de femmes au timbre encore pur et frais, mais qui commence à trembler. Il faut des gémis- sements sourds, des hommes qui tombent lourds et avinés. Il faut les imprécations, les injures des gens qui se querellent, des mots de défi, des bruits de soufflets et des cris de mort. Le cliquetis et le froissement d'épées qui se croisent est aussi d'un admirable effet. Mais malheur ! C'est aussi rare qu'un véritable tamtam dans un orchestre.
Que vous dirai-je ! Il faut la sonorité mordante des verres et des bouteilles qui éclatent; il faut l'aigre grincement des fourchettes que les ivres font crier sur la porcelaine.
Enfin là aussi tout est important, nécessaire, depuis les trépignements frénétiques d'une ronde en délire qui tourne et bondit, jusqu'au doux bruis- sement d'un baiser pris et rendu dans l'ombre; il faut de tout, vous dis-je !
Les longues mèches de ses cheveux châtains, se déroulant capricieuses sur son col frèle et satin, voilaient le visage de la jeune fille; car on ne voyait que son petit menton rose, arrondi et couvert d'une peau si transparente et si fraiche qu'elle laissait paraitre un réseau de veines d'azur.
Par un brusque tressaillement, elle redressa la tête, poussa un long soupir, étendit les bras; puis regardant une montre d'or suspendue à son alcôve, près d'une croix d'ivoire ombragée d'un rameau de buis béni, elle s'écria.
- Seulement deux heures... Deux heures... Oh ! Quelle nuit !... Quelle nuit !... Jamais le temps ne m'avait paru si long. Et puis, je ne sais, mais j'ai chaud, j'étouffe; j'ai beau respirer, l'air me manque; et mes mains sont brûlantes. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Qu'ai-je donc ?
Et d'assise qu'elle était, se couchant brusquement, elle croisa ses deux bras sur le bord de son lit, et y laissa tomber sa tête.
Ses traits alors se dessinèrent vaporeux et confus, à la lumière incertaine de la lampe; c'était quelque chose d'aérien, d'insaisissable; on eut dit que cette lueur tremblante, qui, tantôt dorée, brillait d'un vif éclat, tantôt obscure, ne jetait plus qu'un pale reflet, donnait tour à tour à ce charmant visage une expression de douce sérénité ou de profonde amertume.
Mais étaient-ce bien des ombres et des lumières factices qui éclairaient ou assombrissaient ce jeune front ? N'était-ce pas plutôt cette âme de vierge mobile et changeante, qui s'y reflétait tour à tour sombre ou gaie, heureuse ou souffrante ?
Car qui saura jamais le cœur d'une jeune fille, abîme mille fois plus profond que le cœur d'une femme ? Entre elles deux, c'est la différence de l'idéal au vrai. Chez une femme, l'avenir est fait, arrêté, presque prévu; chez une jeune fille tout parait voilé, tout est incertitude, désirs vagues, espoir et frayeur, joie et chagrin. Cette âme, c'est une harpe éolienne, vibrant au moindre souffle qui vient effleurer ses cordes sonores; c'est une harmonie confuse, bizarre, sans suite, incomplète, et qui pourtant ravit et attriste, fait pleurer et sourire.
- Oh ! dit Alice, que je voudrais ne pas penser, être fleur, arbre, oiseau, m'envoler dans l'air, ou fleurir au bord d'un ruisseau ! Oui, je voudrais être fleur ! Fleur qui se flétrit et tombe sans regretter sa mère. Mais pourtant qu'une fleur doit être isolée ! Et quand le soleil se couche donc, quelle tristesse pour elle !
Par un brusque tressaillement, elle redressa la tête, poussa un long soupir, étendit les bras; puis regardant une montre d'or suspendue à son alcôve, près d'une croix d'ivoire ombragée d'un rameau de buis béni, elle s'écria.
- Seulement deux heures... Deux heures... Oh ! Quelle nuit !... Quelle nuit !... Jamais le temps ne m'avait paru si long. Et puis, je ne sais, mais j'ai chaud, j'étouffe; j'ai beau respirer, l'air me manque; et mes mains sont brûlantes. Mon Dieu ! Mon Dieu ! Qu'ai-je donc ?
Et d'assise qu'elle était, se couchant brusquement, elle croisa ses deux bras sur le bord de son lit, et y laissa tomber sa tête.
Ses traits alors se dessinèrent vaporeux et confus, à la lumière incertaine de la lampe; c'était quelque chose d'aérien, d'insaisissable; on eut dit que cette lueur tremblante, qui, tantôt dorée, brillait d'un vif éclat, tantôt obscure, ne jetait plus qu'un pale reflet, donnait tour à tour à ce charmant visage une expression de douce sérénité ou de profonde amertume.
Mais étaient-ce bien des ombres et des lumières factices qui éclairaient ou assombrissaient ce jeune front ? N'était-ce pas plutôt cette âme de vierge mobile et changeante, qui s'y reflétait tour à tour sombre ou gaie, heureuse ou souffrante ?
Car qui saura jamais le cœur d'une jeune fille, abîme mille fois plus profond que le cœur d'une femme ? Entre elles deux, c'est la différence de l'idéal au vrai. Chez une femme, l'avenir est fait, arrêté, presque prévu; chez une jeune fille tout parait voilé, tout est incertitude, désirs vagues, espoir et frayeur, joie et chagrin. Cette âme, c'est une harpe éolienne, vibrant au moindre souffle qui vient effleurer ses cordes sonores; c'est une harmonie confuse, bizarre, sans suite, incomplète, et qui pourtant ravit et attriste, fait pleurer et sourire.
- Oh ! dit Alice, que je voudrais ne pas penser, être fleur, arbre, oiseau, m'envoler dans l'air, ou fleurir au bord d'un ruisseau ! Oui, je voudrais être fleur ! Fleur qui se flétrit et tombe sans regretter sa mère. Mais pourtant qu'une fleur doit être isolée ! Et quand le soleil se couche donc, quelle tristesse pour elle !
Certes ! Si le bonheur existe, il existait ce jour-là à bord de la Salamandre.
Le bonheur ! Être fantastique et réel que chacun évoque sous une apparence si diverse.
Ainsi au déclin du jour, quand le soleil, semant l'atmosphère de toutes les couleurs du prisme, inonde l'horizon de sa chaude lumière, qui se dégrade depuis le blanc le plus éblouissant jusqu'au rouge sombre et violacé, vous voyez quelquefois un nuage aux contours fugitifs et dorés, que la brise du soir balance encore au milieu des vapeurs de ce ciel brûlant.
Ce nuage n'a qu'un aspect, et il en a mille... Pour l'un, c'est une colonnade gothique, élégante et grêle, avec ses vitraux chatoyants... Celui-là y admire un arbre aux branches d'or et aux feuilles de pourpre. L'autre y voit une figure largement drapée, puissante comme Jehovah; et celui-ci, les lignes délicates et aériennes d'une ravissante tète de jeune fille au cou de cygne.
Ainsi est-il du bonheur ! Être idéal en positif, vrai comme la lumière et le son, et insaisissable comme eux ! Le bonheur, qui revêt tour à tour les formes les plus opposées, et n'en garde aucune !
Le bonheur ! Être fantastique et réel que chacun évoque sous une apparence si diverse.
Ainsi au déclin du jour, quand le soleil, semant l'atmosphère de toutes les couleurs du prisme, inonde l'horizon de sa chaude lumière, qui se dégrade depuis le blanc le plus éblouissant jusqu'au rouge sombre et violacé, vous voyez quelquefois un nuage aux contours fugitifs et dorés, que la brise du soir balance encore au milieu des vapeurs de ce ciel brûlant.
Ce nuage n'a qu'un aspect, et il en a mille... Pour l'un, c'est une colonnade gothique, élégante et grêle, avec ses vitraux chatoyants... Celui-là y admire un arbre aux branches d'or et aux feuilles de pourpre. L'autre y voit une figure largement drapée, puissante comme Jehovah; et celui-ci, les lignes délicates et aériennes d'une ravissante tète de jeune fille au cou de cygne.
Ainsi est-il du bonheur ! Être idéal en positif, vrai comme la lumière et le son, et insaisissable comme eux ! Le bonheur, qui revêt tour à tour les formes les plus opposées, et n'en garde aucune !
On blasphèmerait la justice de Dieu, en disant qu'il frappe ici-bas.
Et si l'on m'objecte que le tableau du crime malheureux et de la vertu heureuse sur la terre est moral, je répondrai que non; et qu'à mon sens, de tous les paradoxes, le plus immoral, le plus faux, le plus révoltant d'égoisme, est celui-ci : Un bienfait n'est jamais perdu.
Un bienfait n'est jamais perdu ! - Si, un bienfait est perdu, croyez-le, il le faut, c'est d'ailleurs facile. Considérez l'ingratitude comme le seul creuset où viennent s'épurer tant de vertus, tant de dévouements intéressés. Soyez trompé cent fois, faites du bien la cent-unième, et je vous tiendrai pour un homme vertueux pour la vertu, bienfaisant pour la bienfaisance; mais si vous comptez sur la reconnaissance, c'est un calcul, c'est de l'usure.
Car il n'y a rien de plus abject que ce placement d'une action vertueuse en viager et à intérêt. C'est faire des bonnes mœurs une bonne affaire.
Aussi, si les hommes ingrats devenaient jamais plus rares, on devrait en conserver précieusement le type, par but d'utilité morale, comme pierres de touche des qualités vraies; car il y a un curieux livre à faire sur la nécessité des vices.
Montrez-moi donc, avant tout, non pas des utopies, des rêves, mais du vrai, mais ce qui est vrai, mais de ces vérités qui courent les salons et les emplois. Montrez-moi donc le vice tel qu'il est, beau, hardi, heureux, insolent, gai, voluptueux, usant sa vie et celle des autres jusqu'à la trame, vivant vieux, honoré, et descendant en paix dans un riche mausolée de marbre au bruit de l'orgue, des chants funèbres, des bénédictions et des sanglots... Car il laisse une succession presque royale.
Montrez-moi donc la vertu honteuse, laide, mendiante, humiliée, méconnue, have et maigre, mourant de faim sur sa paille infecte, et jetée dans la fosse sans prières, sans regret et sans larmes : car la vertu ne laisse jamais de successions royales.
Alors une grande et profonde leçon jaillira de ces contrastes; alors l'homme le plus sceptique, le plus endurci, aura une larme pour la vertu si tou- chante dans ses douleurs, un mépris ou une haine pour le crime si insolemment heureux.
Et si l'on m'objecte que le tableau du crime malheureux et de la vertu heureuse sur la terre est moral, je répondrai que non; et qu'à mon sens, de tous les paradoxes, le plus immoral, le plus faux, le plus révoltant d'égoisme, est celui-ci : Un bienfait n'est jamais perdu.
Un bienfait n'est jamais perdu ! - Si, un bienfait est perdu, croyez-le, il le faut, c'est d'ailleurs facile. Considérez l'ingratitude comme le seul creuset où viennent s'épurer tant de vertus, tant de dévouements intéressés. Soyez trompé cent fois, faites du bien la cent-unième, et je vous tiendrai pour un homme vertueux pour la vertu, bienfaisant pour la bienfaisance; mais si vous comptez sur la reconnaissance, c'est un calcul, c'est de l'usure.
Car il n'y a rien de plus abject que ce placement d'une action vertueuse en viager et à intérêt. C'est faire des bonnes mœurs une bonne affaire.
Aussi, si les hommes ingrats devenaient jamais plus rares, on devrait en conserver précieusement le type, par but d'utilité morale, comme pierres de touche des qualités vraies; car il y a un curieux livre à faire sur la nécessité des vices.
Montrez-moi donc, avant tout, non pas des utopies, des rêves, mais du vrai, mais ce qui est vrai, mais de ces vérités qui courent les salons et les emplois. Montrez-moi donc le vice tel qu'il est, beau, hardi, heureux, insolent, gai, voluptueux, usant sa vie et celle des autres jusqu'à la trame, vivant vieux, honoré, et descendant en paix dans un riche mausolée de marbre au bruit de l'orgue, des chants funèbres, des bénédictions et des sanglots... Car il laisse une succession presque royale.
Montrez-moi donc la vertu honteuse, laide, mendiante, humiliée, méconnue, have et maigre, mourant de faim sur sa paille infecte, et jetée dans la fosse sans prières, sans regret et sans larmes : car la vertu ne laisse jamais de successions royales.
Alors une grande et profonde leçon jaillira de ces contrastes; alors l'homme le plus sceptique, le plus endurci, aura une larme pour la vertu si tou- chante dans ses douleurs, un mépris ou une haine pour le crime si insolemment heureux.
Le 17 juin 1815... le navire qui se balançait dans la rade n'était ni une tartane aux voiles latines, ni un both avec ses deux focs légers et flottants comme le fichu d'une femme, ni un dogre avec son hunier immense, ni une mulette aux sept voiles triangulaires, ni une gondole vénitienne blanche et or, avec des rideaux de pourpre, ni un heu qui déploie ses deux vastes antennes comme les ailes du Léviathan, ni un padouan fier de sa voilure étagée en damier. Ce n'était enfin ni un prahau-plary de Macassar, ni un balour des îles de la Sonde, ni un piahap du Magellan, ni un Gros-bois des Antilles, ni un yacht anglais, ni un catimarou, ni une hourque, ni une palme, ni une prame, ni une biscayenne, ni une bécasse, ni un mulet, ni une balancelle, ni une chelingue, ni un champan, ni un houari, ni un dinga, ni une prague, ni une cague, ni une yole, ni... Enfin, c'était... c'était.., LA SALAMANDRE !
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Eugène Sue (95)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Les Chefs-d'oeuvre de la littérature
Quel écrivain est l'auteur de Madame Bovary ?
Honoré de Balzac
Stendhal
Gustave Flaubert
Guy de Maupassant
8 questions
11155 lecteurs ont répondu
Thèmes :
chef d'oeuvre intemporels
, classiqueCréer un quiz sur ce livre11155 lecteurs ont répondu