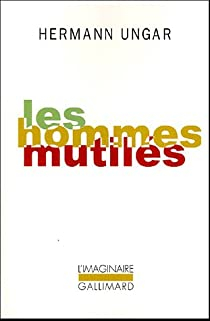>
Critique de queloz_pascal
© le Matricule des Anges et ses rédacteurs
Sophie Deltin
Les Hommes mutilés
Stefan Zweig trouvait ce roman rebutant, Thomas Mann le portait aux nues. Hermann Ungar, écrivain tchèque, nous abîme dans les miasmes d'une humanité tyrannisée par des désirs terrifiants.
Quand Hermann Ungar succombe à une crise d'appendicite aiguë le 29 octobre 1929, à seulement 36 ans, la littérature avait pourtant fini par devenir une nécessité vitale pour ce fils d'une famille d'industriels juifs, grièvement blessé durant la Première Guerre mondiale, et lancé plus tôt dans une carrière diplomatique. Peu considéré par les représentants du milieu littéraire pragois comme Max Brod ou Willy Haas, il vécut à Berlin et y fréquenta Joseph Roth, Alfred Döblin, et Franz Werfel. Auteur principalement de nouvelles, Enfants et meurtriers (1920), et de deux romans, Les Hommes mutilés (1923) traduit en France une première fois chez Gallimard sous le titre Les Sous-hommes (1928) puis aux éditions Ombres sous le titre Les Mutilés et La Classe (1927), cet écrivain, à l'étrangeté prodigieuse et rare, fut malheureusement et de façon incompréhensible méconnu pendant un demi-siècle par la postérité.
Les récits d'Hermann Ungar, blocs d'effroi et de terreur, vous prennent durablement au corps. À quoi ce choc peut-il tenir, sinon au décalage entre un style singulièrement puissant, ramassé, dont les mots simples, les phrases courtes ont le tranchant de l'observation impitoyable, et la répugnance du propos un univers de déchéance dans lequel des figures ravagées se laissent furieusement assujettir, aux autres comme à leur propre chaos ? À moins que ce ne soit surtout cette fascination abjecte que suscite tout regard fixé sur le mal.
Franz Polzer, le héros, est un misérable et frustré employé de bureau un double littéraire de Joseph K. Fétichiste de l'ordre et paranoïaque invétéré, il tombe sous la coupe de sa logeuse, la veuve et vile Clara Porges, qui finit par le contraindre à devenir son amant. de même que plus jeune, il était battu par son père, il ne parvient pas à se défendre de cette relation perverse. Comme si par honte de soi, il " fallait " se venger de lui-même en se mortifiant par des attitudes d'auto-flagellation. Cette disposition masochiste semble remonter au traumatisme d'une scène originelle, où, découvrant les liens incestueux entre son père et sa tante, il retient de celle-ci la vision redoutable de sa raie " entre les cheveux noirs à droite et à gauche ". Depuis lors, le sexe féminin, cette " raie " d'un genre particulier, provoque chez lui non seulement une " répulsion amère " (rien que " la pensée de ce corps nu qui n'était pas fermé, de son affreuse cavité béante comme de la chair ouverte " le tourmente) mais aussi l'idée fixe qu'il répète l'inceste de son père. À cette obsession, mêlée d'avidité, d'une nudité dont Ungar excelle à en distiller çà et là les détails crus et repoussants s'ajoute une homosexualité latente notamment envers son ami d'enfance, le juif et riche Carl Fanta.
Chez Carl précisément, cette image de la haine de soi est poussée à son paroxysme elle lui ronge littéralement la chair. Cul-de-jatte bientôt amputé d'un bras, il s'acharne à exhiber ses atrophies, et à harceler Dora, sa femme, dont l'abnégation de " sainte " le répugne. Car ce qui reste de lui dans la putréfaction (mais " Que lui restera-t-il ? " s'inquiète-t-elle à juste titre), c'est la hargne désespérée de " demeurer en vie, ne fût-ce que par méchanceté ". L'univers ungarien est là, dans la perte définitive de l'intégrité humaine. À l'image du " tronçon ", l'homme n'y est plus entier, mais gangrené. Avec ce paradoxe que ce résidu d'homme ce déchet, on peut l'endurer et l'être encore. " Je suis couché là comme un réservoir de purin et je pue. Mais je ne meurs pas " ricane Carl. Et pour dégoûter Dora autant qu'il se dégoûte, il la force à s'avilir et impose la présence de Sonntag, personnage mystique qui va accélérer la décomposition de ces êtres estropiés. Cet ancien boucher d'abattoir ne s'est-il vraiment reconverti en infirmier que pour se repentir de la mort qu'il donnait aux veaux ? Et si sa volonté de rédemption dissimulait plutôt le désir sadique de punition qui doit transformer en bêtes expiatoires ceux qui sont " coupables " cupidité, prostitution, imposture et chantages en tous genres ? C'est en tout cas l'ambiguïté de ce " découpeur de viande " pénitent qui, en prêchant le châtiment perpétuel, reste pourtant prêt à " toujours recommencer (la faute, le crime), pour souffrir à nouveau cet acte ".
Alors, dans ce cercle infernal où " chacun doit accomplir son destin jusqu'à la fin ", qui de tous fera le mieux " le veau " ? À l'instar de Carl, la " charogne ", ou de Carla, flasque comme une " truie " et vénale comme du " bétail ", tous témoignent de ce processus de dégradation de l'humanité à l'état de bête. D'ailleurs, qu'a-t-on fait des membres amputés de Carl ? se demande Franz, horrifié. Telle est bien la hantise qui suinte de ce roman sanguinaire : finir comme " les entrailles malodorantes des animaux abattus " que " les bouchers jettent dans une fosse ". Au rebut.
Les Hommes mutilés
Hermann Ungar
Traduit de l'allemand
par Guy Fritsch-Estrangin
L'Imaginaire/Gallimard
Sophie Deltin
Les Hommes mutilés
Stefan Zweig trouvait ce roman rebutant, Thomas Mann le portait aux nues. Hermann Ungar, écrivain tchèque, nous abîme dans les miasmes d'une humanité tyrannisée par des désirs terrifiants.
Quand Hermann Ungar succombe à une crise d'appendicite aiguë le 29 octobre 1929, à seulement 36 ans, la littérature avait pourtant fini par devenir une nécessité vitale pour ce fils d'une famille d'industriels juifs, grièvement blessé durant la Première Guerre mondiale, et lancé plus tôt dans une carrière diplomatique. Peu considéré par les représentants du milieu littéraire pragois comme Max Brod ou Willy Haas, il vécut à Berlin et y fréquenta Joseph Roth, Alfred Döblin, et Franz Werfel. Auteur principalement de nouvelles, Enfants et meurtriers (1920), et de deux romans, Les Hommes mutilés (1923) traduit en France une première fois chez Gallimard sous le titre Les Sous-hommes (1928) puis aux éditions Ombres sous le titre Les Mutilés et La Classe (1927), cet écrivain, à l'étrangeté prodigieuse et rare, fut malheureusement et de façon incompréhensible méconnu pendant un demi-siècle par la postérité.
Les récits d'Hermann Ungar, blocs d'effroi et de terreur, vous prennent durablement au corps. À quoi ce choc peut-il tenir, sinon au décalage entre un style singulièrement puissant, ramassé, dont les mots simples, les phrases courtes ont le tranchant de l'observation impitoyable, et la répugnance du propos un univers de déchéance dans lequel des figures ravagées se laissent furieusement assujettir, aux autres comme à leur propre chaos ? À moins que ce ne soit surtout cette fascination abjecte que suscite tout regard fixé sur le mal.
Franz Polzer, le héros, est un misérable et frustré employé de bureau un double littéraire de Joseph K. Fétichiste de l'ordre et paranoïaque invétéré, il tombe sous la coupe de sa logeuse, la veuve et vile Clara Porges, qui finit par le contraindre à devenir son amant. de même que plus jeune, il était battu par son père, il ne parvient pas à se défendre de cette relation perverse. Comme si par honte de soi, il " fallait " se venger de lui-même en se mortifiant par des attitudes d'auto-flagellation. Cette disposition masochiste semble remonter au traumatisme d'une scène originelle, où, découvrant les liens incestueux entre son père et sa tante, il retient de celle-ci la vision redoutable de sa raie " entre les cheveux noirs à droite et à gauche ". Depuis lors, le sexe féminin, cette " raie " d'un genre particulier, provoque chez lui non seulement une " répulsion amère " (rien que " la pensée de ce corps nu qui n'était pas fermé, de son affreuse cavité béante comme de la chair ouverte " le tourmente) mais aussi l'idée fixe qu'il répète l'inceste de son père. À cette obsession, mêlée d'avidité, d'une nudité dont Ungar excelle à en distiller çà et là les détails crus et repoussants s'ajoute une homosexualité latente notamment envers son ami d'enfance, le juif et riche Carl Fanta.
Chez Carl précisément, cette image de la haine de soi est poussée à son paroxysme elle lui ronge littéralement la chair. Cul-de-jatte bientôt amputé d'un bras, il s'acharne à exhiber ses atrophies, et à harceler Dora, sa femme, dont l'abnégation de " sainte " le répugne. Car ce qui reste de lui dans la putréfaction (mais " Que lui restera-t-il ? " s'inquiète-t-elle à juste titre), c'est la hargne désespérée de " demeurer en vie, ne fût-ce que par méchanceté ". L'univers ungarien est là, dans la perte définitive de l'intégrité humaine. À l'image du " tronçon ", l'homme n'y est plus entier, mais gangrené. Avec ce paradoxe que ce résidu d'homme ce déchet, on peut l'endurer et l'être encore. " Je suis couché là comme un réservoir de purin et je pue. Mais je ne meurs pas " ricane Carl. Et pour dégoûter Dora autant qu'il se dégoûte, il la force à s'avilir et impose la présence de Sonntag, personnage mystique qui va accélérer la décomposition de ces êtres estropiés. Cet ancien boucher d'abattoir ne s'est-il vraiment reconverti en infirmier que pour se repentir de la mort qu'il donnait aux veaux ? Et si sa volonté de rédemption dissimulait plutôt le désir sadique de punition qui doit transformer en bêtes expiatoires ceux qui sont " coupables " cupidité, prostitution, imposture et chantages en tous genres ? C'est en tout cas l'ambiguïté de ce " découpeur de viande " pénitent qui, en prêchant le châtiment perpétuel, reste pourtant prêt à " toujours recommencer (la faute, le crime), pour souffrir à nouveau cet acte ".
Alors, dans ce cercle infernal où " chacun doit accomplir son destin jusqu'à la fin ", qui de tous fera le mieux " le veau " ? À l'instar de Carl, la " charogne ", ou de Carla, flasque comme une " truie " et vénale comme du " bétail ", tous témoignent de ce processus de dégradation de l'humanité à l'état de bête. D'ailleurs, qu'a-t-on fait des membres amputés de Carl ? se demande Franz, horrifié. Telle est bien la hantise qui suinte de ce roman sanguinaire : finir comme " les entrailles malodorantes des animaux abattus " que " les bouchers jettent dans une fosse ". Au rebut.
Les Hommes mutilés
Hermann Ungar
Traduit de l'allemand
par Guy Fritsch-Estrangin
L'Imaginaire/Gallimard