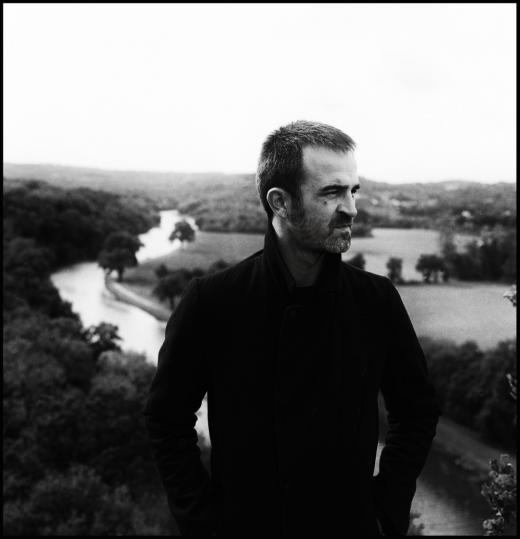Citations de Nicolas Legendre (60)
Le vent, qui s'était considérablement renforcé depuis la veille, faisait tourbillonner un crachin "mouillant", à moins que ce ne fût une pluie brumeuse, ou bien une bruine sournoise, ou peut-être une brouillasse... Bref. Il pleuvait du brouillard.
Les temps ont changé. En ce début de XXIe siècle, marais, bois et talus ont davantage la cote. Jadis symboles d'un monde rural perçu comme arrièré, crasseux voire pouilleux, ils sont désormais les étendards d'une nature à retrouver, à protéger, éventuellement à restaurer, et d'un univers échappant à la fureur des mégapoles. On s'est mis à aimer ce qu'on a longtemps, au mieux ignoré.
Je n'étais pas seul.
C'était l'heure de la balade dominicale. Les familles venaient digérer le poulet-frites en regardant au loin. Je m'interrogeai sur cette manie de l'être humain : s'arrêter là où la géologie crée des belvédères et regarder au loin. Position debout, regard circulaire, air pénétré" : l'être humain observe. Il scrute. Admire. Cela ne lui sert à rien, mais il le fait quand même.
Voir d'en haut donne du sens.
Au paysage ? A l'espace ? A la vie ?
A tout cela peut-être.
C'était l'heure de la balade dominicale. Les familles venaient digérer le poulet-frites en regardant au loin. Je m'interrogeai sur cette manie de l'être humain : s'arrêter là où la géologie crée des belvédères et regarder au loin. Position debout, regard circulaire, air pénétré" : l'être humain observe. Il scrute. Admire. Cela ne lui sert à rien, mais il le fait quand même.
Voir d'en haut donne du sens.
Au paysage ? A l'espace ? A la vie ?
A tout cela peut-être.
Les sommets armoricains ne conviennent pas aux acharnés de la prouesse instagrammable, aux drogués des sports dits extrêmes, aux amateurs du "toujours plus" (plus haut, plus loin, plus vite), avatars du consumérisme qui applique aux loisirs, aux corps et aux territoires la même équation qu'il impose à tant d'autres aspects de la vie : la quantité plutôt que la qualité, l'abondance à défaut de sens.
Je ne souscris qu'à moitié. Nous sommes certes, nous les Bretons, quelque peu déraisonnables lorsqu’il s'agit de chanter les louanges de nos villages, falaises, chemins creux, plages, chapelles, galettes-saucisses et crachins de toutes sortes. Mais je ne puis laisser dire qu'ils n'existe pas de montagne dans ce pays. C'est méconnaître la Bretagne que d'affirmer cela.
Zourat a-t-il passé le balai depuis la chute de l’URSS ? Si l’on se réfère aux standards occidentaux, mon hôte vit dans un taudis. Si l’on prend comme étalons les standards ex-soviétiques, il s’agit aussi d’un taudis.
Le productivisme a démarré juste après la guerre ? Je m’insurge : c’est faux, archi-faux ! L’Inra a été créé en 1946 avec des ingénieurs de haut niveau, des grands chercheurs qui n’avaient qu’un objectif : sortir le monde rural de sa pauvreté. Il y a eu dans le même temps la création des Ceta, qui a entraîné un mouvement extraordinaire. Les chercheurs de l’Inra et les paysans des Ceta vont collaborer, les uns apportant la pratique, les autres la théorie. On avançait ! On invente à cette époque un modèle basé sur la prairie, mais une prairie économe, sans besoin d’azote de synthèse. Voilà comment je suis devenu célèbre. Et là, on est en 1956-1957, donc AVANT le productivisme, car le rouleau compresseur n’a commencé qu’en 1962, avec l’arrivée de la Pac 84. Avant le productivisme, l’Inra préconisait la polyculture-élevage, le système herbager et le porc sur paille. Le lait écrémé produit par les vaches de la ferme servait à nourrir les porcs de la ferme. C’était un fonctionnement circulaire et ça nous a sortis de la misère. Dès la fin des années 1950, on avait d’excellents résultats et on gagnait de l’argent. Quand la Pac arrive, elle instaure des prix garantis. À partir de là, on peut produire n’importe quoi, n’importe où, n’importe comment, on est sûrs d’être payés. Ça a tout bousculé, même au sein de mon Ceta. Jusque-là, on faisait à la fois des vaches laitières et des porcs 85. Et là, on s’est dit : pourquoi s’emmerder à faire trente-six productions, on en fait une seule, ce sera beaucoup plus simple puisque les prix sont garantis.
Pochon et sa bande ne font que réactualiser et moderniser, à l’aune des nouvelles connaissances agronomiques, des pratiques séculaires. Leur approche, pourtant, est révolutionnaire. Ils « font » de l’agroécologie et du développement durable quarante ans avant que ces concepts ne deviennent à la mode. Ils utilisent les ressources disponibles localement (l’herbe pousse furieusement bien dans leur pays mouillé) pour allier respect du milieu, autonomie des fermes et qualité de vie des paysans. André Pochon a souvent recours à la même image : les vaches ont « une barre de coupe à l’avant » et « une unité d’épandage à l’arrière ». Comprendre : un ruminant effectue à la fois le travail d’une ensileuse, engin motorisé destiné à récolter le maïs ou l’herbe, et d’un épandeur d’engrais, machine attelée à l’arrière d’un tracteur destinée à éparpiller les fertilisants de synthèse dans les champs. « Si vous la mettez dans un pré, la vache fait le travail toute seule ! » s’exclame-t-il. L’avantage, c’est que les animaux n’ont besoin ni de chauffeur, ni de pétrole, ni d’investissements lourds pour fonctionner, contrairement à l’ensileuse et à l’épandeur d’engrais. D’où ce leitmotiv : « Gagner plus en travaillant moins. »
Corps svelte, regard océan, sourire de gosse : le voici, « Dédé » Pochon, pétulant nonagénaire, sorte de Jean d’Ormesson rural, les manières bourgeoises en moins, le bon sens paysan en plus. La légende vivante de l’agroécologie me fait face, en ce lundi après-midi, dans son salon, à Trégueux, près de Saint-Brieuc. André Pochon et son épouse ont transmis leur ferme à leur fille au début des années 1990. Ils coulent leur retraite dans un petit pavillon dont le style néobreton est devenu aussi familier, localement, que le gémissement des goélands. André Pochon ne court plus les conférences en France et à l’étranger comme il le faisait jadis (Brésil, Pays-Bas, Cuba, Belgique, Autriche, etc.) mais il continue de suivre l’actualité, d’intervenir ponctuellement devant les étudiants de la prestigieuse école AgroParisTech, d’écrire des tribunes… et de rencontrer des journalistes.
Parmi les pontes de l’agrobusiness breton figurent des capitaines d’industrie riches et discrets. Les plus emblématiques sont Jean-Paul Bigard et sa famille, numéro trois européen de la viande, le clan Roullier, géant mondial des engrais, et Louis Le Duff, numéro un mondial des cafés-boulangeries. Réunis, ces empires pèsent 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et représentent près de soixante mille emplois en Bretagne et dans le monde. Tous font partie, en 2022, des cent cinquante plus importantes fortunes professionnelles du pays d’après le classement du magazine Challenges. Par ailleurs, les fabricants et vendeurs de machines agricoles, grossistes, transformateurs, patrons de laiteries privées et concepteurs de logiciels pour l’« agriculture de précision » forment une galaxie hétéroclite, employant plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la péninsule. Les ténors de la grande distribution ne sont pas en reste, comme je l’ai déjà évoqué 4. Deux des plus célèbres enseignes françaises sont nées en Bretagne à partir du milieu du XXe siècle : Leclerc et Intermarché.
Ce jour-là, les cinq dirigeants des chambres d’agriculture bretonnes, tous éleveurs et élus de la FNSEA, présentent le Plan stratégique 2019-2025 élaboré avec leurs services. Ils jettent un pavé dans la mare. « C’est toute l’agriculture bretonne qui doit évoluer, affirment-ils. On ne peut plus continuer à produire de gros volumes non payés. Nous ne voulons plus ça : ce qui veut dire une baisse de l’élevage, davantage de prairies, la baisse des phytos, etc. La Bretagne va rester une terre d’élevage, la première de France, c’est notre socle. Mais avec moins de volumes produits, plus de lien au sol, plus de compétitivité et plus de transition environnementale. »
Dans l’assistance, certains journalistes manquent de tomber de leur chaise. Les chambres d’agriculture furent longtemps des relais de l’idéologie productiviste. Les voilà qui prônent une révolution copernicienne : moins d’animaux, moins de pesticides et d’engrais de synthèse, plus d’autonomie dans les fermes, une diversification des cultures et un « verdissement » massif des pratiques. C’est, peu ou prou, ce que réclament depuis quarante ans un certain nombre de militants écologistes, ennemis jurés de la FNSEA. C’est ce qu’André Pochon, pionnier breton de l’agroécologie, a préconisé et expérimenté, avec d’autres, à partir des années 1950.
Longtemps, André Pochon, éleveur dans les Côtes-d’Armor, a prêché dans un désert. On ne compte plus les réunions publiques durant lesquelles il a été moqué par le « camp d’en face ». Et voilà que ce même « camp » vante ses préceptes ! « Virage à 180 degrés pour l’agriculture bretonne ? », peut-on lire, le lendemain, dans Ouest-France. Le point d’interrogation n’est pas de trop. Parce que les chambres d’agriculture n’ont pas de pouvoir contraignant et que ce « virage », en coulisse, n’est pas du goût de tout le monde…
Dans l’assistance, certains journalistes manquent de tomber de leur chaise. Les chambres d’agriculture furent longtemps des relais de l’idéologie productiviste. Les voilà qui prônent une révolution copernicienne : moins d’animaux, moins de pesticides et d’engrais de synthèse, plus d’autonomie dans les fermes, une diversification des cultures et un « verdissement » massif des pratiques. C’est, peu ou prou, ce que réclament depuis quarante ans un certain nombre de militants écologistes, ennemis jurés de la FNSEA. C’est ce qu’André Pochon, pionnier breton de l’agroécologie, a préconisé et expérimenté, avec d’autres, à partir des années 1950.
Longtemps, André Pochon, éleveur dans les Côtes-d’Armor, a prêché dans un désert. On ne compte plus les réunions publiques durant lesquelles il a été moqué par le « camp d’en face ». Et voilà que ce même « camp » vante ses préceptes ! « Virage à 180 degrés pour l’agriculture bretonne ? », peut-on lire, le lendemain, dans Ouest-France. Le point d’interrogation n’est pas de trop. Parce que les chambres d’agriculture n’ont pas de pouvoir contraignant et que ce « virage », en coulisse, n’est pas du goût de tout le monde…
Y en a qui aimeraient voir un hiatus idéologique dans cette affaire des pesticides. Mais c’est pas idéologique. C’est une réalité sanitaire ! On met des intrants qui appauvrissent la terre, puis des produits pour « rebooster » les cultures. La terre est morte et ça contribue à la tuer un peu plus. Nous, à la boîte, on était à peu près tous convaincus du cynisme de ce système. Quand vous faites tous les jours des livraisons de récipients sur lesquels vous avez des petits pictogrammes morbides, si vous prenez pas conscience du problème, c’est que ça va pas dans votre tête. Les collègues ne mettaient jamais ces trucs-là dans leur jardin ! Ils faisaient du bio. Ça allait jusqu’au mal-être. La mauvaise conscience… Devoir gagner sa croûte en vendant du poison… La majorité des collègues en préparation de commandes faisaient leur boulot à contrecœur, écœurés par tout ce qui était balancé dans les fermes. Ce job, c’est purement alimentaire. Cette boîte ne paye pas trop, mais suffisamment pour qu’on n’ait pas vraiment envie de partir. Y a le fatalisme… Et la routine. On parle de tout ça au boulot… On se rend compte qu’on en avait parlé la veille et l’avant-veille aussi, et chacun sait bien qu’on en reparlera… Y a une pollution de l’image de soi qui s’opère au contact du produit. Les gars voient les pictogrammes. Ils voient que c’est un système qui continue de faire gagner du fric à certains alors qu’eux sont encore en bas du panier. La grande question, chez nous, c’est : est-ce que je vais être malade ? On a la « salle de la mort » où sont stockés tous les phytos… Quelqu’un qui n’est pas habitué à l’odeur, il fait demi-tour direct… Alors la question se pose : que respire-t-on vraiment ? On se demande : quand est-ce que je vais être touché, comme les autres collègues qu’ont eu des brûlures, des allergies…
Jean-François et Olivier Glinec incarnent bien cet attachement qui, d’ailleurs, n’est pas que sentimental. Leur approche est pragmatique : il s’agit de préserver le milieu qui les entoure voire de le « réparer » pour qu’il demeure vivable à long terme, sans jamais perdre de vue la nécessité de produire des aliments et de dégager des revenus. Les frères Glinec travaillent avec le reste du vivant, autant que possible. Pas contre lui. Le temps dira s’ils sont les pionniers parmi d’autres d’un nouveau rapport au monde ou bien s’ils sont les vaines sentinelles d’un combat perdu d’avance.
Toujours dans les sixties, l’État français se fixe comme objectif d’assurer aux consommateurs l’accès permanent à des aliments peu onéreux. L’enjeu principal n’est pas de « nourrir la France à la sortie de la guerre », comme on l’entend trop souvent. Et pour cause : le dernier ticket de rationnement est distribué dans l’Hexagone en 1949. Des crises de surproduction surviennent dès les années 1950. La France est donc largement « nourrie » au début des années 1960, quand le productivisme est mis sur orbite. Le but, en fait, est de nourrir le pays à pas cher – ce qui ne revient pas tout à fait au même. Il s’agit notamment de rendre disponible une alimentation bon marché pour les nouveaux prolétaires des villes… parmi lesquels figurent beaucoup d’anciens paysans partis travailler à l’usine, qui ont perdu en autonomie alimentaire ce qu’ils ont gagné en confort domestique.
Dans ce contexte, il n’est pas anodin de noter que les territoires bretons les plus marqués par l’influence du clergé, de la Jeunesse agricole catholique ou du corporatisme agrarien (pays de Lamballe et de Pontivy, Léon, Marches de Bretagne, etc.) sont aussi ceux qui ont connu la plus importante intensification des exploitations. Ils se distinguent par l’ampleur des arrachages de haies et des arasements de talus qui y ont eu lieu, par les hauts niveaux de nitrates ou de pesticides dans leurs masses d’eau et/ou par l’importance des proliférations d’algues vertes sur leurs côtes.
Quarante-cinq ans plus tard, alors que la puissance publique tente (en vain, jusqu’à présent) de juguler l’hémorragie des effectifs paysans, cette déclaration résonne comme une profession de foi. Car l’élimination de ceux que le système considérait comme des « minables » a bel et bien eu lieu : l’édifice bancaire, étatique et industriel a privilégié l’agrandissement des fermes et l’intensification des productions, au détriment de ceux –nombreux– que Gourvennec qualifiait de « boulets ». Ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas se conformer aux dogmes du productivisme.
Ce jour-là, en quatre phrases, Gourvennec a résumé une philosophie : la production d’aliments serait une « bataille » dont les Bretons seraient les champions. Cette bataille ne pourrait être livrée que par des soldats d’élite, dotés des meilleures armes (machines, infrastructures, engrais, pesticides). Les tire-au-flanc devraient laisser place à des fantassins plus efficaces. L’État ferait office de voitures-balais ou, au besoin, d’équarrisseur.
Ce jour-là, en quatre phrases, Gourvennec a résumé une philosophie : la production d’aliments serait une « bataille » dont les Bretons seraient les champions. Cette bataille ne pourrait être livrée que par des soldats d’élite, dotés des meilleures armes (machines, infrastructures, engrais, pesticides). Les tire-au-flanc devraient laisser place à des fantassins plus efficaces. L’État ferait office de voitures-balais ou, au besoin, d’équarrisseur.
Gabriel, éleveur de porcs
- Le choix, pour certains, c’est la faillite, le servage ou le suicide. C’est dur, ce que je dis, hein ? Mais c’est la vérité. C’est un champ de ruines, l’agriculture. J’ai toujours cru dans le développement industriel de mon métier. J’ai été le plus gros producteur du coin. On a investi tous les ans pour maintenir l’outil au top. On a été près de la faillite, deux fois. Un jour, ma femme m’a trouvé avec mon fusil posé sur le bureau. À cause des dettes.
- Le choix, pour certains, c’est la faillite, le servage ou le suicide. C’est dur, ce que je dis, hein ? Mais c’est la vérité. C’est un champ de ruines, l’agriculture. J’ai toujours cru dans le développement industriel de mon métier. J’ai été le plus gros producteur du coin. On a investi tous les ans pour maintenir l’outil au top. On a été près de la faillite, deux fois. Un jour, ma femme m’a trouvé avec mon fusil posé sur le bureau. À cause des dettes.
Christian a longtemps travaillé comme commercial pour un groupe agroalimentaire, avant de reprendre la ferme de ses parents, dans les années 1990. D’abord de façon « conventionnelle » : maïs, soja, engrais, pesticides. Progressivement, il a modifié son assolement jusqu’à passer en « système herbager ». Il nourrit ses cent soixante-cinq vaches laitières principalement avec l’herbe de la ferme. Cette approche, qui demande du savoir-faire, un climat adéquat ainsi qu’un parcellaire adapté, lui a permis de gagner en autonomie et en revenus.
- Pour faire bien, en agriculture, il faut faire simple, dit-il. Mais beaucoup de paysans sont pollués par des gens qui viennent leur vendre des services, des prestations, des produits, etc. Le but de ces gens, bien souvent, c’est pas que ça aille mieux dans ton exploitation ! Je les connais. J’en ai fait partie. Leur but, pour certains, c’est de gagner leur vie avec ce que tu leur achètes. Le bien-être du paysan ? Pfffuiiiii…
- Pour faire bien, en agriculture, il faut faire simple, dit-il. Mais beaucoup de paysans sont pollués par des gens qui viennent leur vendre des services, des prestations, des produits, etc. Le but de ces gens, bien souvent, c’est pas que ça aille mieux dans ton exploitation ! Je les connais. J’en ai fait partie. Leur but, pour certains, c’est de gagner leur vie avec ce que tu leur achètes. Le bien-être du paysan ? Pfffuiiiii…
À plusieurs reprises, je reste bouche bée.
Je n’étais pas naïf, pourtant. Les embrouilles paysannes avaient bercé mon enfance. Je connaissais les scandales de la vache folle, du poulet à la dioxine, du cartel des yaourts, des salariés de coopératives intoxiqués aux pesticides, etc. Je recueillais depuis plusieurs années la parole de paysans désemparés. J’avais la conviction, fréquemment exprimée en off par des gens du milieu, que le système agro-industriel avait entraîné des dérives que l’on pourrait qualifier de mafieuses.
Mais cela, pour moi, demeurait flou et sujet à caution.
Le puzzle était incomplet.
En ce lundi d’hiver, mes interlocuteurs esquissent des chaînons manquants. Ils évoquent les cas de paysans victimes de représailles parce qu’ils ne se soumettent pas aux injonctions de leur coopérative ou du « syndicat », les avantages en nature destinés à ceux qui jouent le jeu, la vente de denrées alimentaires « au noir » vers des pays sous embargo, la falsification de rapports sanitaires, l’intimidation voire le flingage (symbolique) d’élus récalcitrants, le trafic d’influence à tous les étages…
Je n’étais pas naïf, pourtant. Les embrouilles paysannes avaient bercé mon enfance. Je connaissais les scandales de la vache folle, du poulet à la dioxine, du cartel des yaourts, des salariés de coopératives intoxiqués aux pesticides, etc. Je recueillais depuis plusieurs années la parole de paysans désemparés. J’avais la conviction, fréquemment exprimée en off par des gens du milieu, que le système agro-industriel avait entraîné des dérives que l’on pourrait qualifier de mafieuses.
Mais cela, pour moi, demeurait flou et sujet à caution.
Le puzzle était incomplet.
En ce lundi d’hiver, mes interlocuteurs esquissent des chaînons manquants. Ils évoquent les cas de paysans victimes de représailles parce qu’ils ne se soumettent pas aux injonctions de leur coopérative ou du « syndicat », les avantages en nature destinés à ceux qui jouent le jeu, la vente de denrées alimentaires « au noir » vers des pays sous embargo, la falsification de rapports sanitaires, l’intimidation voire le flingage (symbolique) d’élus récalcitrants, le trafic d’influence à tous les étages…
Certains de leurs alter ego ont plongé dans le bain du « toujours plus » : plus d’hectares, plus de machines, plus d’animaux, plus de pesticides, plus de maïs, plus de dettes. Chacun avait ses raisons. Chacun pensait bien faire. La banque, l’État, la coopérative, la chambre d’agriculture et le « syndicat » conseillaient de tirer dans ce sens. Les plus exaltés fonçaient tête baissée, sans trop réfléchir à qui tirait les marrons du feu, à qui était l’esclave de qui, ou de quoi. À l’époque, dans le monde rural, remettre en cause cette logique, même timidement, revenait à blasphémer contre les dieux du productivisme – cette religion dont on ne disait jamais le nom.
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Ecrivains Paysans
Azallee92
80 livres
Auteurs proches de Nicolas Legendre
Quiz
Voir plus
La bonne blague ! Chez Balzac ou chez Zola ?
— Eh ! diable ! il est fin, le bonhomme. Je me suis trompé, pensa Gaudissart. Il faut que je domine mon homme par de plus hautes considérations, par ma blague numéro 1 — Du tout, monsieur, s’écria Gaudissart à haute voix, pour vous qui…
Zola
Balzac
10 questions
122 lecteurs ont répondu
Créer un quiz sur cet auteur122 lecteurs ont répondu