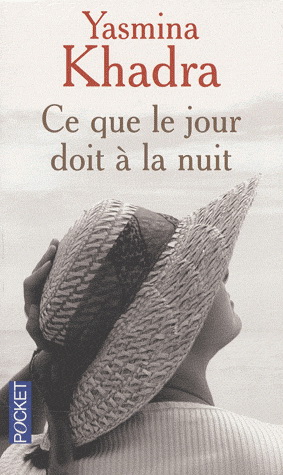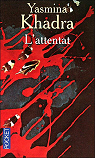Des années 1930 à aujourd'hui, l'itinéraire chaotique de Jonas, un garçon algérien marqué dans l'enfance par une tragédie familiale. Son père ayant fait faillite, Jonas est recueilli par son oncle et sa tante, qui n'ont pas d'enfant. Il perdra définitivement sa mère et sa soeur de vue. Un roman sur l'Algérie coloniale et la dislocation entre deux communautés amoureuses d'un même pays. Prix roman France Télévisions 2008. Un récit de vie émouvant sur fond de tragédie historique.
Avec son écriture limpide Yasmina Khadra nous amène dans les entrailles de l'histoire de l'Algérie. La vie d'un être déchiré, comme son pays, Younes ou Jonas, Jonas ou Younes, comprendre et exister, en glissant des deux cotés du miroir.. C'est beau, poignant, vrai,
Une grande sensibilité intelligente éclate dans un livre d'un grande beauté,
Merci Monsieur Khadra
Une grande sensibilité intelligente éclate dans un livre d'un grande beauté,
Merci Monsieur Khadra
Younes et sa famille doivent abandonner l'exploitation familiale pour cause de mauvaises récoltes. COmme des centaines d'autres, ils vont grossir les rangs de la population pauvre d'Oran. Mais le père est décidé à s'en sortir. Sauf qu'il ne connait pas la ville et ses pièges. Très vite, il accepte que son frère prenne Younes avec lui pour pouvoir l'envoyer à l'école.
Younes devient Jonas et perd de vue ses parents.
Une malencontreuse affaire oblige l'oncle, sa femme et Younes-Jonas à quitter Oran pour aller habiter la petite ville de Rio Salado. Younes s'y fait des amis, mais très vite, la guerre d'indépendance et sa violence frappe à la porte, séparant les amis d'enfance.
Une belle lecture où l'on perçoit les parfums de l'Algérie française, mais aussi ses inégalités.
Un Younes un peu trop passif à mon goût, et une fin trop "romancée".
Lien : http://motamots.canalblog.co..
Younes devient Jonas et perd de vue ses parents.
Une malencontreuse affaire oblige l'oncle, sa femme et Younes-Jonas à quitter Oran pour aller habiter la petite ville de Rio Salado. Younes s'y fait des amis, mais très vite, la guerre d'indépendance et sa violence frappe à la porte, séparant les amis d'enfance.
Une belle lecture où l'on perçoit les parfums de l'Algérie française, mais aussi ses inégalités.
Un Younes un peu trop passif à mon goût, et une fin trop "romancée".
Lien : http://motamots.canalblog.co..
Et bien, pas encore vu le reste des parutions de la rentrée littéraire, mais du moment qu'il y a un nouveau Khadra, comme d'habitude, je ne vais pas pouvoir y résister !
blog de l'auteur :
http://www.yasmina-khadra.com/
L'histoire se passe en Algérie coloniale (1936-1962) avec un saut d'après-guerre (2008).
Quatre garçons ( un Arabe, un Juif et deux Français – dont un Corse –) évoluent tranquillement à Rio Salado, un village cossu à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Oran.
Les chamboulements du monde (Guerre 39-45, nationalisme arabe) effleurent à peine leur camaraderie jusqu'au jour où une fille arrive au village.
L'amitié résistera-t-elle à l'amour ?... à la guerre de l'indépendance ?
*
Mon oncle me disait : « Si une femme t'aimait, et si tu avais la présence d'esprit de mesurer l'étendue de ce privilège, aucune divinité ne t'arriverait à la cheville. »
Oran retenait son souffle en ce printemps 1962. La guerre engageait ses dernières folies. Je cherchais Emilie. J'avais peur pour elle. J'avais besoin d'elle. Je l'aimais et je revenais le lui prouver. Je me sentais en mesure de braver les ouragans, les tonnerres, l'ensemble des anathèmes et les misères du monde entier.
Yasmina Khadra nous offre ici un grand roman de l'Algérie coloniale (entre 1936 et 1962) une Algérie torrentielle, passionnée et douloureuse et éclaire d'un nouveau jour, dans une langue splendide et avec la générosité qu'on lui connaît, la dislocation atroce de deux communautés amoureuses d'un même pays.
blog de l'auteur :
http://www.yasmina-khadra.com/
L'histoire se passe en Algérie coloniale (1936-1962) avec un saut d'après-guerre (2008).
Quatre garçons ( un Arabe, un Juif et deux Français – dont un Corse –) évoluent tranquillement à Rio Salado, un village cossu à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'Oran.
Les chamboulements du monde (Guerre 39-45, nationalisme arabe) effleurent à peine leur camaraderie jusqu'au jour où une fille arrive au village.
L'amitié résistera-t-elle à l'amour ?... à la guerre de l'indépendance ?
*
Mon oncle me disait : « Si une femme t'aimait, et si tu avais la présence d'esprit de mesurer l'étendue de ce privilège, aucune divinité ne t'arriverait à la cheville. »
Oran retenait son souffle en ce printemps 1962. La guerre engageait ses dernières folies. Je cherchais Emilie. J'avais peur pour elle. J'avais besoin d'elle. Je l'aimais et je revenais le lui prouver. Je me sentais en mesure de braver les ouragans, les tonnerres, l'ensemble des anathèmes et les misères du monde entier.
Yasmina Khadra nous offre ici un grand roman de l'Algérie coloniale (entre 1936 et 1962) une Algérie torrentielle, passionnée et douloureuse et éclaire d'un nouveau jour, dans une langue splendide et avec la générosité qu'on lui connaît, la dislocation atroce de deux communautés amoureuses d'un même pays.
EXTRAIT : CHAPITRE 8
J'ai beaucoup aimé Rio Salado – Fluman Sulsum, pour les Romains ; El Mellah, de nos jours. D'ailleurs, je n'ai pas cessé de l'aimer, incapable de m'imaginer en train de vieillir sous un ciel qui ne soit pas le sien ou de mourir loin de ses fantômes. C'était un superbe village colonial aux rues verdoyantes et aux maisons cossues. La place, où s'organisaient les bals et défilaient les troupes musicales les plus prestigieuses, déroulait son tapis dallé à deux doigts du parvis de la mairie, encadrée de palmiers arrogants que reliaient les uns aux autres des guirlandes serties de lampions. Se produiront sur cette place Aimé Barelli, Xavier Cugat avec son fameux chihuahua caché dans la poche, Jacques Hélian, Perez Prado, des noms et des orchestres de légende qu'Oran, avec son chiqué et son statut de capitale de l'Ouest, ne pouvait s'offrir. Rio Salado adorait taper dans l'oeil, prendre sa revanche sur les pronostics qui l'avaient donné perdant sur toute la ligne. Les manoirs, qu'il arborait avec une insolence zélée le long de l'avenue principale, étaient sa façon de signifier aux voyageurs qui transitaient par là que l'ostentation est une vertu quand elle consiste à damer le pion aux sentences arbitraires, à recenser les chemins de croix qu'il avait fallu braver pour décrocher la lune. Jadis, c'était un territoire sinistré, livré aux lézards et aux cailloux, où de rares bergers s'aventuraient une fois par hasard et n'y remettaient plus les pieds ; un territoire de broussailles et de rivières mortes, où les hyènes et les sangliers régnaient en maîtres absolus – bref, une terre reniée par les hommes et les anges que les pèlerins traversaient en coup de vent comme s'il s'agissait de cimetières maudits... Puis, des laissés-pour-compte et des trimardeurs en fin de parcours, en majorité des Espagnols, avaient jeté leur dévolu sur cette contrée teigneuse qui ressemblait à leur misère. Ils retroussèrent leurs manches et entreprirent de dompter les plaines fauves, n'arrachant un lentisque que pour le remplacer par un cep, ne sarclant un terrain vague que pour y tracer les contours d'une ferme. Et Rio Salado naquit de ces gageures faramineuses comme éclosent les pousses sur les charniers.
*
Assis en tailleur au milieu de ses vignes et caves viticoles – il en comptait une centaine – Rio se laissait déguster à la manière de ses crus, guettant, entre deux vendanges, l'ivresse des lendemains qui chantent. Malgré un mois de janvier plutôt frileux, avec son ciel battu en neige, il émanait de ses recoins une perpétuelle senteur estivale. Les gens vaquaient à leurs occupations, la foulée gaillarde, quand les échoppes ne les rassemblaient pas, au coucher du soleil, autour d'un verre ou d'un fait divers ; on pouvait les entendre s'esclaffer ou s'indigner à des lieues à la ronde.
– Tu vas te plaire dans ce village, me promit mon oncle en nous accueillant, Germaine et moi, sur le seuil de notre nouvelle demeure.
La majorité des habitants de Rio Salado étaient des Espagnols et des Juifs fiers d'avoir bâti de leurs mains chaque édifice et arraché à une terre criblée de terriers des grappes de raisin à soûler les dieux de l'Olympe. C'étaient des gens agréables, spontanés et entiers ; ils adoraient s'interpeller de loin, les mains en entonnoir autour de la bouche. On les aurait crus issus d'une même fonderie tant ils avaient l'air de se connaître sur le bout des doigts. Rien à voir avec Oran où l'on passait d'un quartier à un autre avec le sentiment de remonter les âges, de changer de planète. Rio Salado fleurait bon la convivialité, festif jusque derrière les vitraux de son église debout à droite de la mairie, un tantinet en retrait pour ne pas indisposer les noceurs.
Mon oncle avait vu juste. Rio Salado était un bon endroit pour se reconstruire. Notre maison s'élevait sur le flanc est du village, assortie d'un jardin magnifique et d'un balcon donnant sur un océan de vignes. C'était une grande maison, vaste et aérée, avec un rez-de-chaussée au plafond haut réaménagé en pharmacie que prolongeait une arrière-boutique mystérieuse truffée d'étagères et de placards secrets. Un escalier en colimaçon menait à l'étage et débouchait sur un immense salon autour duquel s'articulaient trois grandes chambres et une salle de bain recouverte de faïences dont la baignoire en fonte reposait sur des pieds en bronze représentant des pattes de lion. Je m'étais senti dans mon élément à l'instant où, penché sur la balustrade inondée de soleil, mon regard fut happé par le vol d'une perdrix et faillit ne plus revenir.
J'étais ébloui. Né au coeur des champs, je retrouvais un à un mes repères d'antan, l'odeur des labours et le silence des tertres. Je renaissais dans ma peau de paysan, heureux de constater que mes habits de citadin n'avaient pas dénaturé mon âme. Si la ville était une illusion, la campagne serait une émotion sans cesse grandissante ; chaque jour qui s'y lève rappelle l'aube de l'humanité, chaque soir s'y amène comme une paix définitive. J'ai aimé Rio d'emblée. C'était un pays de grâce. On aurait juré que les dieux et les titans avaient trouvé en ces lieux de l'apaisement. Tout paraissait rasséréné, délivré de ses vieux démons. Et la nuit, lorsque les chacals venaient chahuter le sommeil des hommes, ils donnaient envie de les suivre aux fins fond des forêts. Il m'arrivait parfois de sortir sur le balcon pour tenter d'entrevoir leurs silhouettes furtives parmi les feuillages frisés des vignobles. Je m'oubliais des heures durant à tendre l'oreille aux moindres bruissements et à contempler la lune à l'effleurer de mes cils...
… Puis, il y eut Emilie.
La première fois que je l'avais vue, elle était assise dans la porte cochère de notre pharmacie, la tête dans le capuchon de son manteau, les doigts triturant les lacets de ses bottines. C'était une belle petite fille aux yeux craintifs, d'un noir minéral. Je l'aurais volontiers prise pour un ange tombé du ciel si sa frimousse, d'une pâleur marmoréenne, ne portait l'empreinte d'une méchante maladie.
Bonjour, lui fis-je. Je peux t'aider ?
– J'attends mon père, dit-elle en se poussant sur le côté pour me céder le passage.
– Tu peux l'attendre à l'intérieur. Il gèle dans la rue.
Elle fit non de la tête.
Quelques jours après, elle revint, escortée par un colosse taillé dans un menhir. C'était son père. Il la confia à Germaine et attendit devant le comptoir, à l'intérieur de la pharmacie, aussi droit et impénétrable qu'une balise. Germaine conduisit la fille dans l'arrière-boutique puis la rendit à son père quelques minutes plus tard. L'homme posa un billet de banque sur le comptoir, prit la fille par la main et ils sortirent tous les deux dans la rue.
– Qu'est-ce que tu lui as fait ? demandai-je à Germaine.
– Sa piqûre… comme tous les mercredis.
– C'est grave, sa maladie ?
– Dieu seul le sait.
Le mercredi d'après, je fis exprès de me dépêcher à la sortie de l'école pour la revoir. Et elle était là, dans la pharmacie, assise sur le banc en face du comptoir encombré de fioles et de boîtiers. Elle feuilletait distraitement un livre à la couverture cartonnée.
– Qu'est-ce que tu lis ?
– Un illustré sur la Guadeloupe.
– C'est quoi, la Guadeloupe ?
– Une grande île française dans les Caraïbes.
Je m'approchai d'elle, sur la pointe des pieds pour ne pas l'incommoder. Elle paraissait tellement fragile et vulnérable.
– Je m'appelle Younes.
– Moi, Emilie.
– J'aurai treize ans dans trois semaines.
– J'ai fêté mes neuf ans en novembre dernier.
– Tu souffres beaucoup ?
– Pas trop, mais c'est gênant.
– Qu'est-ce que tu as ?
– Je ne sais pas. A l'hôpital, ils ne comprennent pas. Les médicaments qu'on m'a prescrits ne donnent rien.
Germaine vint la chercher pour la piqûre. Emilie laissa son illustré sur le banc. Il y avait un pot en fleurs sur la commode à côté ; j'en cueillis une rose et la glissai à l'intérieur du livre avant de monter dans ma chambre.
A mon retour, Emilie était partie.
Le mercredi suivant, Emilie ne revint pas pour la piqûre. Les mercredis d'après, non plus.
– On l'a sûrement gardée à l'hôpital, supposa Germaine.
Au bout de quelques semaines, Emilie ne donnant plus de signe de vie, je perdis l'espoir de la revoir.
Ensuite, j'ai rencontré Isabelle, la nièce de Pépé Rucillio, la plus grosse fortune de Rio. Isabelle était un joli brin de fille avec de grands yeux pervenche et des longs cheveux raides qui lui arrivaient au fessier. Mais Dieu ! Ce qu'elle était sophistiquée. Elle prenait son monde de haut. Pourtant, quand elle posait les yeux sur moi, elle devenait toute menue, et malheur à l'imprudente qui oserait me coller de près. Isabelle me voulait pour elle seule. Ses parents, de redoutables négociants en vin, travaillaient pour le compte de Pépé qui était un peu leur patriarche. Ils habitaient une vaste villa non loin du cimetière israélite, dans une rue aux façades cascadant de bougainvilliers.
Isabelle n'avait pas hérité grand-chose de sa mère, une Française compliquée – qu'on disait issue d'une famille désargentée et qui ne manquait aucune occasion pour rappeler à ses détracteurs qu'elle avait du sang bleu dans les veines – sauf peut-être un goût prononcé pour l'ordre et la discipline ; par contre, elle était le portrait craché de son père – un Catalan au teint hâlé, presque basané. Elle avait son visage aux pommettes saillantes, sa bouche incisive et un regard qui vous traverserait de part et d'autre rien qu'en fronçant les sourcils. A treize ans, le nez haut perché et le geste souverain, elle savait exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir, veillant sur ses fréquentations avec autant de rigueur que sur l'image qu'elle voulait donner d'elle-même. Elle me confia que, dans une vie antérieure, elle avait été châtelaine.
C'est elle qui m'avait repéré sur la place un jour de fête patronale. Elle s'était approchée de moi et m'avait demandé : « C'est vous, Jonas ? ». Elle vouvoyait tout le monde, grand et petit, et tenait à ce que l'on se conduise de même avec elle... Sans attendre de réponse, elle avait ajouté sur un ton ferme : « Jeudi, c'est mon jour d'anniversaire. Vous y êtes cordialement invité ». Difficile de savoir s'il s'agissait d'une prière ou d'un ordre. le jeudi, dans un patio effervescent de cousins et de cousines, alors que je me sentais un peu perdu dans le charivari, Isabelle m'avait saisi par le coude et présenté aux siens : « C'est mon camarade préféré ! ».
Mon premier baiser, c'est à elle que je le dois. Nous étions dans le grand salon, chez elle, au fond d'une alcôve coincée entre deux portes-fenêtres. Isabelle jouait du piano, le dos roide et le menton droit. Assis à côté d'elle sur le banc, je contemplais ses doigts fuselés qui couraient comme des feux follets sur les touches du clavier. Elle avait un talent fou. Soudain, elle s'était arrêtée et, avec infiniment de délicatesse, avait rabattu le couvercle sur le clavier. Après une courte tergiversation, ou bien une courte méditation, elle s'était retournée vers moi, m'avait pris le visage entre ses mains et avait posé ses lèvres sur les miennes en fermant les yeux d'un air inspiré.
Le baiser m'avait paru interminable.
Isabelle avait rouvert les yeux avant de se retirer.
– Vous avez senti quelque chose, monsieur Jonas ?
– Non, lui répondis-je.
– Moi, non plus. C'est curieux, au cinéma, ça m'a semblé grandiose... Je suppose qu'il faudrait attendre d'être adultes pour ressentir vraiment les choses.
Plongeant son regard dans le mien, elle avait décrété :
– Qu'importe ! Nous attendrons le temps qu'il faudra.
Isabelle avait la patience de ceux qui sont persuadés que les lendemains se font pour eux. Elle disait que j'étais le plus beau garçon de la terre, que j'avais été à coup sûr un prince charmant dans une autre vie et que si elle m'avait choisi pour fiancé, c'était parce que j'en valais la chandelle.
Nous ne nous étions plus embrassés, mais nous nous retrouvions presque tous les jours pour échafauder, à l'abri du mauvais oeil, des projets pharaoniques.
Et d'un coup, sans crier gare, notre amourette rompit comme sous l'effet d'un sortilège. C'était un dimanche matin ; je me morfondais à la maison. Mon oncle, qui s'était remis à s'enfermer dans sa chambre, faisait le mort, et Germaine était allée à l'église. Je n'arrêtais pas de tourner en rond, sautant sans enthousiasme d'un jeu solitaire à un livre. Il faisait beau. le printemps s'annonçait lustral. Les hirondelles étaient en avance, et Rio, célèbre pour ses fleurs, sentait le jasmin à tout bout de champ.
Je sortis traîner dans la rue, les mains derrière le dos et la tête ailleurs. Sans m'en rendre compte, je me surpris devant la maison des Rucillio. J'appelai Isabelle par la fenêtre. Comme d'habitude. Isabelle ne descendit pas m'ouvrir. Après m'avoir longuement épié à travers les persiennes, elle ouvrit les volets dans un claquement courroucé et me cria :
– Menteur !
Je compris, à la sécheresse de son ton et à l'incandescence de son regard, qu'elle m'en voulait à mort. Isabelle usait toujours de ce ton et de ce regard quand elle s'apprêtait à déployer ses inimitiés.
Ignorant ce qu'elle me reprochait et ne m'attendant pas à être accueilli à froid de cette façon, je restai sans voix.
– Je ne veux plus te revoir, lâcha-t-elle sentencieusement.
C'était la première fois que je l'entendais tutoyer quelqu'un.
– Pourquoi ? … s'écria-t-elle, horripilée par ma perplexité. Pourquoi m'as-tu menti ?...
– Je ne vous ai jamais menti.
– Ah oui ?... Ton nom est Younes, n'est-ce pas ? You-nes ?... Alors pourquoi tu te fais appeler Jonas ?
– Tout le monde m'appelle Jonas… Qu'est-ce que ça change ?
– Tout ! hurla-t-elle en manquant de s'étouffer...
Son visage congestionné frétillait de dépit :
– Ca change tout !...
Après avoir repris son souffle, elle me dit, sans appel :
– Nous ne sommes pas du même monde, monsieur Younes. Et le bleu de tes yeux ne suffit pas.
Avant de me claquer les volets de la fenêtre au nez, elle émit un hoquet de mépris et dit :
– Je suis une Rucillio, as-tu oubliée ?... Tu m'imagines mariée à un Arabe ?... Plutôt crever !
A un âge où l'éveil est aussi douloureux que les premiers saignements chez une fille, ça vous stigmatise au fer rouge. J'étais choqué, troublé comme au sortir d'un sommeil artificiel. Désormais, je n'allais plus percevoir les choses de la même façon. Certains détails, que la naïveté de l'enfance atténue au point de les occulter, reprennent du poil de la bête et se mettent à vous tirer vers le bas, à vous harceler sans répit, à se substituer à vos hantises si bien qu'en fermant solidement vos paupières, elles ressurgissent dans votre esprit, tenaces et voraces, semblables à des remords.
Isabelle m'avait sorti d'une cage dorée pour me jeter dans un puits.
Adam éjecté de son paradis n'aurait pas été aussi dépaysé que moi, et sa pomme moins dure que le caillot qui m'était resté en travers de la gorge.
A partir de ce rappel à l'ordre, je me mis à faire plus attention où je mettais les pieds. Je remarquai surtout qu'aucun haïk de Mauresque ne flottait dans les rues de notre village, que les loques enturbannées, qui galéraient dans les vergers des aurores à la tombée de la nuit, n'osaient même pas s'approcher de la périphérie d'un Rio jalousement colonial où seul mon oncle – que beaucoup prenaient pour un Turc de Tlemcen – avait réussi, à la faveur d'on ne sait quelle mégarde, à se greffer.
Isabelle m'avait terrassé.
Plusieurs fois, nos chemins s'étaient croisés. Elle passait devant moi sans me voir, le nez aussi haut qu'une esse de boucher, et faisait comme si je n'avais jamais existé… Et ça ne s'arrêtait pas là. Isabelle avait le défaut d'imposer aux autres ses goûts et ses aigreurs. Quand elle ne portait pas quelqu'un dans son coeur, elle exigeait que tout son entourage le vomisse. Je vis alors mes aires de jeu rétrécir, mes camarades de classe m'éviter ostensiblement... Ce fut d'ailleurs pour la venger que Jean-Christophe Lamy me chercha noise dans la cour scolaire et m'arrangea copieusement le portrait.
Jean-Christophe était mon aîné d'un an. Fils d'un couple de concierges, sa condition sociale ne lui permettait pas de plastronner, mais il était follement épris de l'inexpugnable nièce de Pépé Rucillio. S'il m'avait cogné dur et juste, c'était pour lui montrer combien il l'aimait et jusqu'où il était capable d'aller pour elle.
Horrifié par ma figure ratatinée, l'instituteur me fit monter sur l'estrade et m'intima l'ordre de lui montrer le « sauvageon » qui m'avait dérouillé de la sorte. N'obtenant pas d'aveu, il m'esquinta les doigts avec sa règle et me mit au piquet jusqu'à la fin du cours. En me gardant en classe après le départ des élèves, il espérait m'arracher le nom de la brute. Au bout de quelques menaces, il comprit que je ne cèderais pas et me congédia en me promettant d'en toucher deux mots à mes parents.
Germaine faillit choper une attaque en me voyant rentrer de l'école avec la bouille en marmelade. Elle aussi voulut savoir qui m'avait mis en mauvais état et n'obtint de moi qu'un mutisme résigné. Elle décida de me ramener sur-le-champ à l'école afin de tirer au clair cette histoire. Mon oncle, qui s'étiolait dans un coin du salon, l'en dissuada : « Tu ne l'emmèneras nulle part. Il est grand temps, pour lui, d'apprendre à se défendre ».
Quelques jours plus tard, tandis que je flânais à la lisière des vignes, Jean-Christophe Lamy en compagnie de Simon Benyamin et Fabrice Scamaroni, ses deux inséparables comparses, coupèrent à travers champ pour m'intercepter. Leur allure n'était pas agressive, mais je pris peur. Ils ne venaient jamais traîner à cet endroit, préférant de loin le chahut de la place municipale et les clameurs des terrains vagues où ils jouaient au foot. Leur présence dans les parages ne me disait rien de bon. Je connaissais un peu Fabrice, qui me dépassait d'une classe et que je voyais dans la cour de récréation régulièrement plongé dans un livre illustré. C'était un garçon sans histoires, sauf qu'il se tenait prêt à servir d'alibi à son chenapan de Jean-Christophe. Il n'était pas exclu qu'il lui prêtât main forte en cas de coup dur. Jean-Christophe n'avait pas besoin de renfort ; il savait cogner et esquiver les coups avec adresse ; comme personne ne l'avait jeté à terre, je n'étais pas sûr que son compagnon s'abstînt d'intervenir si les choses tournaient à son désavantage. Simon, lui, ne m'inspirait pas confiance du tout. Imprévisible, il pouvait sans crier gare donner un coup de boule à un camarade, juste pour couper court à un débat barbant. Il était dans ma classe, lui, à faire le pitre au dernier rang et à enquiquiner les bûcheurs et les élèves trop sages. Il était l'un des rares cancres à protester lorsque l'instituteur lui collait une mauvaise note et cultivait une franche aversion pour les filles, surtout lorsqu'elles étaient jolies et travailleuses. J'ai eu affaire à lui à mon arrivée à l'école. Il avait rassemblé les cancres autour de moi et s'était ouvertement gaussé de mes genoux pelés, de ma bouille de « fillette stupide » et de mes chaussures pourtant neuves et auxquelles il trouvait quelque chose de batracien. Comme je n'avais pas réagi à ses moqueries, il m'avait traité de « frimoussette » et m'avait ignoré.
Jean-Christophe portait un paquet sous l'aisselle. Je surveillais son regard, à l'affût d'un signe codé en direction de ses compagnons. Il n'avait pas l'air malin que je lui connaissais, ni cette tension qui prononçait ses traits quand il s'apprêtait à tabasser quelqu'un.
– On ne te veut pas de mal, me rassura de loin Fabrice.
Jean-Christophe s'approcha de moi. D'un pas timide. Il était confus, voire contrit, et ses épaules semblaient écrasées sous un fardeau invisible.
Il me tendit le paquet d'un geste humble.
– Je te demande pardon, me dit-il.
Comme j'hésitai à prendre le paquet, red
J'ai beaucoup aimé Rio Salado – Fluman Sulsum, pour les Romains ; El Mellah, de nos jours. D'ailleurs, je n'ai pas cessé de l'aimer, incapable de m'imaginer en train de vieillir sous un ciel qui ne soit pas le sien ou de mourir loin de ses fantômes. C'était un superbe village colonial aux rues verdoyantes et aux maisons cossues. La place, où s'organisaient les bals et défilaient les troupes musicales les plus prestigieuses, déroulait son tapis dallé à deux doigts du parvis de la mairie, encadrée de palmiers arrogants que reliaient les uns aux autres des guirlandes serties de lampions. Se produiront sur cette place Aimé Barelli, Xavier Cugat avec son fameux chihuahua caché dans la poche, Jacques Hélian, Perez Prado, des noms et des orchestres de légende qu'Oran, avec son chiqué et son statut de capitale de l'Ouest, ne pouvait s'offrir. Rio Salado adorait taper dans l'oeil, prendre sa revanche sur les pronostics qui l'avaient donné perdant sur toute la ligne. Les manoirs, qu'il arborait avec une insolence zélée le long de l'avenue principale, étaient sa façon de signifier aux voyageurs qui transitaient par là que l'ostentation est une vertu quand elle consiste à damer le pion aux sentences arbitraires, à recenser les chemins de croix qu'il avait fallu braver pour décrocher la lune. Jadis, c'était un territoire sinistré, livré aux lézards et aux cailloux, où de rares bergers s'aventuraient une fois par hasard et n'y remettaient plus les pieds ; un territoire de broussailles et de rivières mortes, où les hyènes et les sangliers régnaient en maîtres absolus – bref, une terre reniée par les hommes et les anges que les pèlerins traversaient en coup de vent comme s'il s'agissait de cimetières maudits... Puis, des laissés-pour-compte et des trimardeurs en fin de parcours, en majorité des Espagnols, avaient jeté leur dévolu sur cette contrée teigneuse qui ressemblait à leur misère. Ils retroussèrent leurs manches et entreprirent de dompter les plaines fauves, n'arrachant un lentisque que pour le remplacer par un cep, ne sarclant un terrain vague que pour y tracer les contours d'une ferme. Et Rio Salado naquit de ces gageures faramineuses comme éclosent les pousses sur les charniers.
*
Assis en tailleur au milieu de ses vignes et caves viticoles – il en comptait une centaine – Rio se laissait déguster à la manière de ses crus, guettant, entre deux vendanges, l'ivresse des lendemains qui chantent. Malgré un mois de janvier plutôt frileux, avec son ciel battu en neige, il émanait de ses recoins une perpétuelle senteur estivale. Les gens vaquaient à leurs occupations, la foulée gaillarde, quand les échoppes ne les rassemblaient pas, au coucher du soleil, autour d'un verre ou d'un fait divers ; on pouvait les entendre s'esclaffer ou s'indigner à des lieues à la ronde.
– Tu vas te plaire dans ce village, me promit mon oncle en nous accueillant, Germaine et moi, sur le seuil de notre nouvelle demeure.
La majorité des habitants de Rio Salado étaient des Espagnols et des Juifs fiers d'avoir bâti de leurs mains chaque édifice et arraché à une terre criblée de terriers des grappes de raisin à soûler les dieux de l'Olympe. C'étaient des gens agréables, spontanés et entiers ; ils adoraient s'interpeller de loin, les mains en entonnoir autour de la bouche. On les aurait crus issus d'une même fonderie tant ils avaient l'air de se connaître sur le bout des doigts. Rien à voir avec Oran où l'on passait d'un quartier à un autre avec le sentiment de remonter les âges, de changer de planète. Rio Salado fleurait bon la convivialité, festif jusque derrière les vitraux de son église debout à droite de la mairie, un tantinet en retrait pour ne pas indisposer les noceurs.
Mon oncle avait vu juste. Rio Salado était un bon endroit pour se reconstruire. Notre maison s'élevait sur le flanc est du village, assortie d'un jardin magnifique et d'un balcon donnant sur un océan de vignes. C'était une grande maison, vaste et aérée, avec un rez-de-chaussée au plafond haut réaménagé en pharmacie que prolongeait une arrière-boutique mystérieuse truffée d'étagères et de placards secrets. Un escalier en colimaçon menait à l'étage et débouchait sur un immense salon autour duquel s'articulaient trois grandes chambres et une salle de bain recouverte de faïences dont la baignoire en fonte reposait sur des pieds en bronze représentant des pattes de lion. Je m'étais senti dans mon élément à l'instant où, penché sur la balustrade inondée de soleil, mon regard fut happé par le vol d'une perdrix et faillit ne plus revenir.
J'étais ébloui. Né au coeur des champs, je retrouvais un à un mes repères d'antan, l'odeur des labours et le silence des tertres. Je renaissais dans ma peau de paysan, heureux de constater que mes habits de citadin n'avaient pas dénaturé mon âme. Si la ville était une illusion, la campagne serait une émotion sans cesse grandissante ; chaque jour qui s'y lève rappelle l'aube de l'humanité, chaque soir s'y amène comme une paix définitive. J'ai aimé Rio d'emblée. C'était un pays de grâce. On aurait juré que les dieux et les titans avaient trouvé en ces lieux de l'apaisement. Tout paraissait rasséréné, délivré de ses vieux démons. Et la nuit, lorsque les chacals venaient chahuter le sommeil des hommes, ils donnaient envie de les suivre aux fins fond des forêts. Il m'arrivait parfois de sortir sur le balcon pour tenter d'entrevoir leurs silhouettes furtives parmi les feuillages frisés des vignobles. Je m'oubliais des heures durant à tendre l'oreille aux moindres bruissements et à contempler la lune à l'effleurer de mes cils...
… Puis, il y eut Emilie.
La première fois que je l'avais vue, elle était assise dans la porte cochère de notre pharmacie, la tête dans le capuchon de son manteau, les doigts triturant les lacets de ses bottines. C'était une belle petite fille aux yeux craintifs, d'un noir minéral. Je l'aurais volontiers prise pour un ange tombé du ciel si sa frimousse, d'une pâleur marmoréenne, ne portait l'empreinte d'une méchante maladie.
Bonjour, lui fis-je. Je peux t'aider ?
– J'attends mon père, dit-elle en se poussant sur le côté pour me céder le passage.
– Tu peux l'attendre à l'intérieur. Il gèle dans la rue.
Elle fit non de la tête.
Quelques jours après, elle revint, escortée par un colosse taillé dans un menhir. C'était son père. Il la confia à Germaine et attendit devant le comptoir, à l'intérieur de la pharmacie, aussi droit et impénétrable qu'une balise. Germaine conduisit la fille dans l'arrière-boutique puis la rendit à son père quelques minutes plus tard. L'homme posa un billet de banque sur le comptoir, prit la fille par la main et ils sortirent tous les deux dans la rue.
– Qu'est-ce que tu lui as fait ? demandai-je à Germaine.
– Sa piqûre… comme tous les mercredis.
– C'est grave, sa maladie ?
– Dieu seul le sait.
Le mercredi d'après, je fis exprès de me dépêcher à la sortie de l'école pour la revoir. Et elle était là, dans la pharmacie, assise sur le banc en face du comptoir encombré de fioles et de boîtiers. Elle feuilletait distraitement un livre à la couverture cartonnée.
– Qu'est-ce que tu lis ?
– Un illustré sur la Guadeloupe.
– C'est quoi, la Guadeloupe ?
– Une grande île française dans les Caraïbes.
Je m'approchai d'elle, sur la pointe des pieds pour ne pas l'incommoder. Elle paraissait tellement fragile et vulnérable.
– Je m'appelle Younes.
– Moi, Emilie.
– J'aurai treize ans dans trois semaines.
– J'ai fêté mes neuf ans en novembre dernier.
– Tu souffres beaucoup ?
– Pas trop, mais c'est gênant.
– Qu'est-ce que tu as ?
– Je ne sais pas. A l'hôpital, ils ne comprennent pas. Les médicaments qu'on m'a prescrits ne donnent rien.
Germaine vint la chercher pour la piqûre. Emilie laissa son illustré sur le banc. Il y avait un pot en fleurs sur la commode à côté ; j'en cueillis une rose et la glissai à l'intérieur du livre avant de monter dans ma chambre.
A mon retour, Emilie était partie.
Le mercredi suivant, Emilie ne revint pas pour la piqûre. Les mercredis d'après, non plus.
– On l'a sûrement gardée à l'hôpital, supposa Germaine.
Au bout de quelques semaines, Emilie ne donnant plus de signe de vie, je perdis l'espoir de la revoir.
Ensuite, j'ai rencontré Isabelle, la nièce de Pépé Rucillio, la plus grosse fortune de Rio. Isabelle était un joli brin de fille avec de grands yeux pervenche et des longs cheveux raides qui lui arrivaient au fessier. Mais Dieu ! Ce qu'elle était sophistiquée. Elle prenait son monde de haut. Pourtant, quand elle posait les yeux sur moi, elle devenait toute menue, et malheur à l'imprudente qui oserait me coller de près. Isabelle me voulait pour elle seule. Ses parents, de redoutables négociants en vin, travaillaient pour le compte de Pépé qui était un peu leur patriarche. Ils habitaient une vaste villa non loin du cimetière israélite, dans une rue aux façades cascadant de bougainvilliers.
Isabelle n'avait pas hérité grand-chose de sa mère, une Française compliquée – qu'on disait issue d'une famille désargentée et qui ne manquait aucune occasion pour rappeler à ses détracteurs qu'elle avait du sang bleu dans les veines – sauf peut-être un goût prononcé pour l'ordre et la discipline ; par contre, elle était le portrait craché de son père – un Catalan au teint hâlé, presque basané. Elle avait son visage aux pommettes saillantes, sa bouche incisive et un regard qui vous traverserait de part et d'autre rien qu'en fronçant les sourcils. A treize ans, le nez haut perché et le geste souverain, elle savait exactement ce qu'elle voulait et comment l'obtenir, veillant sur ses fréquentations avec autant de rigueur que sur l'image qu'elle voulait donner d'elle-même. Elle me confia que, dans une vie antérieure, elle avait été châtelaine.
C'est elle qui m'avait repéré sur la place un jour de fête patronale. Elle s'était approchée de moi et m'avait demandé : « C'est vous, Jonas ? ». Elle vouvoyait tout le monde, grand et petit, et tenait à ce que l'on se conduise de même avec elle... Sans attendre de réponse, elle avait ajouté sur un ton ferme : « Jeudi, c'est mon jour d'anniversaire. Vous y êtes cordialement invité ». Difficile de savoir s'il s'agissait d'une prière ou d'un ordre. le jeudi, dans un patio effervescent de cousins et de cousines, alors que je me sentais un peu perdu dans le charivari, Isabelle m'avait saisi par le coude et présenté aux siens : « C'est mon camarade préféré ! ».
Mon premier baiser, c'est à elle que je le dois. Nous étions dans le grand salon, chez elle, au fond d'une alcôve coincée entre deux portes-fenêtres. Isabelle jouait du piano, le dos roide et le menton droit. Assis à côté d'elle sur le banc, je contemplais ses doigts fuselés qui couraient comme des feux follets sur les touches du clavier. Elle avait un talent fou. Soudain, elle s'était arrêtée et, avec infiniment de délicatesse, avait rabattu le couvercle sur le clavier. Après une courte tergiversation, ou bien une courte méditation, elle s'était retournée vers moi, m'avait pris le visage entre ses mains et avait posé ses lèvres sur les miennes en fermant les yeux d'un air inspiré.
Le baiser m'avait paru interminable.
Isabelle avait rouvert les yeux avant de se retirer.
– Vous avez senti quelque chose, monsieur Jonas ?
– Non, lui répondis-je.
– Moi, non plus. C'est curieux, au cinéma, ça m'a semblé grandiose... Je suppose qu'il faudrait attendre d'être adultes pour ressentir vraiment les choses.
Plongeant son regard dans le mien, elle avait décrété :
– Qu'importe ! Nous attendrons le temps qu'il faudra.
Isabelle avait la patience de ceux qui sont persuadés que les lendemains se font pour eux. Elle disait que j'étais le plus beau garçon de la terre, que j'avais été à coup sûr un prince charmant dans une autre vie et que si elle m'avait choisi pour fiancé, c'était parce que j'en valais la chandelle.
Nous ne nous étions plus embrassés, mais nous nous retrouvions presque tous les jours pour échafauder, à l'abri du mauvais oeil, des projets pharaoniques.
Et d'un coup, sans crier gare, notre amourette rompit comme sous l'effet d'un sortilège. C'était un dimanche matin ; je me morfondais à la maison. Mon oncle, qui s'était remis à s'enfermer dans sa chambre, faisait le mort, et Germaine était allée à l'église. Je n'arrêtais pas de tourner en rond, sautant sans enthousiasme d'un jeu solitaire à un livre. Il faisait beau. le printemps s'annonçait lustral. Les hirondelles étaient en avance, et Rio, célèbre pour ses fleurs, sentait le jasmin à tout bout de champ.
Je sortis traîner dans la rue, les mains derrière le dos et la tête ailleurs. Sans m'en rendre compte, je me surpris devant la maison des Rucillio. J'appelai Isabelle par la fenêtre. Comme d'habitude. Isabelle ne descendit pas m'ouvrir. Après m'avoir longuement épié à travers les persiennes, elle ouvrit les volets dans un claquement courroucé et me cria :
– Menteur !
Je compris, à la sécheresse de son ton et à l'incandescence de son regard, qu'elle m'en voulait à mort. Isabelle usait toujours de ce ton et de ce regard quand elle s'apprêtait à déployer ses inimitiés.
Ignorant ce qu'elle me reprochait et ne m'attendant pas à être accueilli à froid de cette façon, je restai sans voix.
– Je ne veux plus te revoir, lâcha-t-elle sentencieusement.
C'était la première fois que je l'entendais tutoyer quelqu'un.
– Pourquoi ? … s'écria-t-elle, horripilée par ma perplexité. Pourquoi m'as-tu menti ?...
– Je ne vous ai jamais menti.
– Ah oui ?... Ton nom est Younes, n'est-ce pas ? You-nes ?... Alors pourquoi tu te fais appeler Jonas ?
– Tout le monde m'appelle Jonas… Qu'est-ce que ça change ?
– Tout ! hurla-t-elle en manquant de s'étouffer...
Son visage congestionné frétillait de dépit :
– Ca change tout !...
Après avoir repris son souffle, elle me dit, sans appel :
– Nous ne sommes pas du même monde, monsieur Younes. Et le bleu de tes yeux ne suffit pas.
Avant de me claquer les volets de la fenêtre au nez, elle émit un hoquet de mépris et dit :
– Je suis une Rucillio, as-tu oubliée ?... Tu m'imagines mariée à un Arabe ?... Plutôt crever !
A un âge où l'éveil est aussi douloureux que les premiers saignements chez une fille, ça vous stigmatise au fer rouge. J'étais choqué, troublé comme au sortir d'un sommeil artificiel. Désormais, je n'allais plus percevoir les choses de la même façon. Certains détails, que la naïveté de l'enfance atténue au point de les occulter, reprennent du poil de la bête et se mettent à vous tirer vers le bas, à vous harceler sans répit, à se substituer à vos hantises si bien qu'en fermant solidement vos paupières, elles ressurgissent dans votre esprit, tenaces et voraces, semblables à des remords.
Isabelle m'avait sorti d'une cage dorée pour me jeter dans un puits.
Adam éjecté de son paradis n'aurait pas été aussi dépaysé que moi, et sa pomme moins dure que le caillot qui m'était resté en travers de la gorge.
A partir de ce rappel à l'ordre, je me mis à faire plus attention où je mettais les pieds. Je remarquai surtout qu'aucun haïk de Mauresque ne flottait dans les rues de notre village, que les loques enturbannées, qui galéraient dans les vergers des aurores à la tombée de la nuit, n'osaient même pas s'approcher de la périphérie d'un Rio jalousement colonial où seul mon oncle – que beaucoup prenaient pour un Turc de Tlemcen – avait réussi, à la faveur d'on ne sait quelle mégarde, à se greffer.
Isabelle m'avait terrassé.
Plusieurs fois, nos chemins s'étaient croisés. Elle passait devant moi sans me voir, le nez aussi haut qu'une esse de boucher, et faisait comme si je n'avais jamais existé… Et ça ne s'arrêtait pas là. Isabelle avait le défaut d'imposer aux autres ses goûts et ses aigreurs. Quand elle ne portait pas quelqu'un dans son coeur, elle exigeait que tout son entourage le vomisse. Je vis alors mes aires de jeu rétrécir, mes camarades de classe m'éviter ostensiblement... Ce fut d'ailleurs pour la venger que Jean-Christophe Lamy me chercha noise dans la cour scolaire et m'arrangea copieusement le portrait.
Jean-Christophe était mon aîné d'un an. Fils d'un couple de concierges, sa condition sociale ne lui permettait pas de plastronner, mais il était follement épris de l'inexpugnable nièce de Pépé Rucillio. S'il m'avait cogné dur et juste, c'était pour lui montrer combien il l'aimait et jusqu'où il était capable d'aller pour elle.
Horrifié par ma figure ratatinée, l'instituteur me fit monter sur l'estrade et m'intima l'ordre de lui montrer le « sauvageon » qui m'avait dérouillé de la sorte. N'obtenant pas d'aveu, il m'esquinta les doigts avec sa règle et me mit au piquet jusqu'à la fin du cours. En me gardant en classe après le départ des élèves, il espérait m'arracher le nom de la brute. Au bout de quelques menaces, il comprit que je ne cèderais pas et me congédia en me promettant d'en toucher deux mots à mes parents.
Germaine faillit choper une attaque en me voyant rentrer de l'école avec la bouille en marmelade. Elle aussi voulut savoir qui m'avait mis en mauvais état et n'obtint de moi qu'un mutisme résigné. Elle décida de me ramener sur-le-champ à l'école afin de tirer au clair cette histoire. Mon oncle, qui s'étiolait dans un coin du salon, l'en dissuada : « Tu ne l'emmèneras nulle part. Il est grand temps, pour lui, d'apprendre à se défendre ».
Quelques jours plus tard, tandis que je flânais à la lisière des vignes, Jean-Christophe Lamy en compagnie de Simon Benyamin et Fabrice Scamaroni, ses deux inséparables comparses, coupèrent à travers champ pour m'intercepter. Leur allure n'était pas agressive, mais je pris peur. Ils ne venaient jamais traîner à cet endroit, préférant de loin le chahut de la place municipale et les clameurs des terrains vagues où ils jouaient au foot. Leur présence dans les parages ne me disait rien de bon. Je connaissais un peu Fabrice, qui me dépassait d'une classe et que je voyais dans la cour de récréation régulièrement plongé dans un livre illustré. C'était un garçon sans histoires, sauf qu'il se tenait prêt à servir d'alibi à son chenapan de Jean-Christophe. Il n'était pas exclu qu'il lui prêtât main forte en cas de coup dur. Jean-Christophe n'avait pas besoin de renfort ; il savait cogner et esquiver les coups avec adresse ; comme personne ne l'avait jeté à terre, je n'étais pas sûr que son compagnon s'abstînt d'intervenir si les choses tournaient à son désavantage. Simon, lui, ne m'inspirait pas confiance du tout. Imprévisible, il pouvait sans crier gare donner un coup de boule à un camarade, juste pour couper court à un débat barbant. Il était dans ma classe, lui, à faire le pitre au dernier rang et à enquiquiner les bûcheurs et les élèves trop sages. Il était l'un des rares cancres à protester lorsque l'instituteur lui collait une mauvaise note et cultivait une franche aversion pour les filles, surtout lorsqu'elles étaient jolies et travailleuses. J'ai eu affaire à lui à mon arrivée à l'école. Il avait rassemblé les cancres autour de moi et s'était ouvertement gaussé de mes genoux pelés, de ma bouille de « fillette stupide » et de mes chaussures pourtant neuves et auxquelles il trouvait quelque chose de batracien. Comme je n'avais pas réagi à ses moqueries, il m'avait traité de « frimoussette » et m'avait ignoré.
Jean-Christophe portait un paquet sous l'aisselle. Je surveillais son regard, à l'affût d'un signe codé en direction de ses compagnons. Il n'avait pas l'air malin que je lui connaissais, ni cette tension qui prononçait ses traits quand il s'apprêtait à tabasser quelqu'un.
– On ne te veut pas de mal, me rassura de loin Fabrice.
Jean-Christophe s'approcha de moi. D'un pas timide. Il était confus, voire contrit, et ses épaules semblaient écrasées sous un fardeau invisible.
Il me tendit le paquet d'un geste humble.
– Je te demande pardon, me dit-il.
Comme j'hésitai à prendre le paquet, red
Mon avis: coup de coeur. Dans ce très beau roman, Yasmina Khadra nous raconte avec une écriture sublime l'histoire de Younes. Déchiré entre la misère et l'aisance, entre deux communautés qui se cotoient, entre l'amour et l'amitié, le personnage de Younes/jonas cristallise toutes les questions existentielles de la vie. Sur une trame de fond historique, l'auteur nous donne à voir avec une grande finesse sans tomber dans les préjugés les enjeux et toute la complexité de la guerre d'Algérie opposant des individus qui partagent le même amour pour ce pays. Khadra nous livre un roman dont la trame et l'écriture sont remarquables, dressant le portrait d'un personnage complexe et attachant, et rendant hommage à ce pays magnifique qu'est l'Algérie. On est transporté dans ce pays, dans cette période avec pour guide Younes, en pleine déroute, torturé par ses choix et ses émotions.
A lire vraiment!
PS: et voici le premier coup de coeur de l'année 2009, j'espère que c'est un bon présage pour une année riche en lectures! :)
Lien : http://laboitealectures.cana..
A lire vraiment!
PS: et voici le premier coup de coeur de l'année 2009, j'espère que c'est un bon présage pour une année riche en lectures! :)
Lien : http://laboitealectures.cana..
Très belle oeuvre littéraire. Vraiment très bien écrit. le roman nous fait vivre de belles émotions. Nous suivons, à travers un journal, la vie d'un Algérien dans les plus forts moments de sa vie. C'est le premier roman de Yasmina Khadra que je lis et j'avoue que ça me donne le goût d'en lire d'autres.
premier livre lu de la rentrée littéraire... et un peu déçue.
De plus, lu les plaintes de Yasmina Khadra lorsqu'il c'est aperçu qu'il ne figurait pas sur les listes des "grands" prix... pas vraiment aimé cet "ego" demeusuré... et pourtant j'étais plutôt fan de cet auteur...
Lien : http://mazel-livres.blogspot..
De plus, lu les plaintes de Yasmina Khadra lorsqu'il c'est aperçu qu'il ne figurait pas sur les listes des "grands" prix... pas vraiment aimé cet "ego" demeusuré... et pourtant j'étais plutôt fan de cet auteur...
Lien : http://mazel-livres.blogspot..
Merveilleusement bien écrit, ce livre nous fait vivre des moments forts. Les images évoquées tout au court de la lecture nous font rêver... des centaines de passages pourraient être cités tellement ils sont évocateurs.
Superbe roman où le drame des personnages est décrit intensément. J'ai apprécié les références à la période coloniale en Algérie et à la guerre d'indépendance, un contexte que je connaissais peu. Magnifiquement écrit!!!
Les Dernières Actualités
Voir plus
Autres livres de Yasmina Khadra (46)
Voir plus
Quiz
Voir plus
Livres de Yasmina Khadra
Comment s'appelle le personnage principal de "Ce que le jour doit à la nuit" ?
Malik
Yousef
Younes
Mehdi
5 questions
230 lecteurs ont répondu
Thème :
Yasmina KhadraCréer un quiz sur ce livre230 lecteurs ont répondu