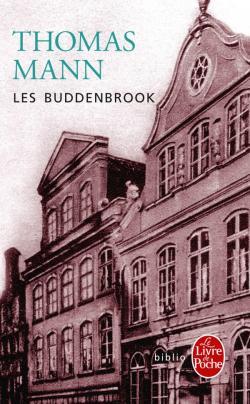>
Critique de Gustave
"La valeur n'attend point le nombre des années". Tel se présente un des plus fameux vers du Cid de Pierre Corneille...Quelques siècles plus tard, c'est au jeune Thomas Mann d'en administrer la preuve magistrale.
William Faulkner aurait dit des Buddenbrook qu'il s'agissait du plus grand roman du 20ème siècle. Toujours est-il qu'il avait un exemplaire dédicacé par la main de Mann lui-même se trouvait dans sa bibliothèque.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les Buddenbrook m'ont rappelé...Tendre est la nuit, de Francis Scott Fitzgerald. Bien évidemment, le second n'était encore qu'un enfant quand quand Mann eut achevé ce premier roman, de sorte qu'il ne saurait être question de dire que l'Américain aurait influencé l'Allemand...
Non, ce qu'il y a d'assez frappant, c'est cette même représentation saisissante de la déchéance, dans ce qu'elle possède d'insidieuse et d'irréversible, par l'incapacité qu'ont les individus d'en reconnaître à temps les prémices, au-delà des différences abyssales séparant ces deux écrivains.
La conscience de la décadence est toujours une conscience tragique, en ce sens que c'est souvent lorsque toute action visant à la contrecarrer est désormais vaine qu'elle survient.
De ce fait, ce n'est pas par hasard que le roman accorde une place croissante à des tempéraments contemplatifs, davantages tournés vers la dimension intellectuelle et esthétique de l'homme (d'abord Christian Buddenbrook, puis son frère aîné Thomas, enfin son fils Hanno, qui clôt la lignée) que vers l'action pratique propre à cette lignée de commerçants (les deux premiers Buddenbrook, Johann père et fils).
Cette succession progressive d'hommes d'action vers des individus dominés par l'intellect épouse en effet la trajectoire descendante des destinées de la famille, comme si le caractère vain de toute action se manifestait de la sorte. Plus les générations avancent, et plus la conscience de l'inanité de l'action se manifeste chez les Buddenbrook. Hanno en est l'illustration la plus accomplie, lorsque la commotion esthétique éprouvée devant la représentation de Lohengrin, un des chefs-d'oeuvre de Wagner se traduit dans son esprit par un écoeurement absolu envers toute forme de vie pratique (dont le commerce) face à l'intensité de la contemplation esthétique face à l'oeuvre d'art.
Mais là où ce roman se montre d'une ambiguïté fondamentale, c'est qu'il peut apparaître par moments difficile de déterminer si l'arrivée de ces hommes de moins en moins aptes à l'action et au sens pratique qu'impose la direction d'une entreprise est la cause ou la conséquence de cette décadence familiale.
Le roman ne semble pas aussi tranché qu'on pourrait le croire en faveur de la première hypothèse. le mariage malheureux d'Antonie avec Bendrix Grunlich, son premier mari, a bien eu lieu avec l'assentiment de Johann Buddenbrook fils (le second du nom), un homme tout entier tourné vers le commerce, qui croyait faire là une affaire fructueuse...
A vrai dire, c'est essentiellement à travers des natures duales, ni tout à fait aptes à l'action qu'implique la vie de chef d'entreprise, ni assez talentueuses pour pouvoir entreprendre une carrière artistique ou intellectuelle que se manifeste la chute lente de la famille.
La troisième génération de Buddenbrook en est l'illustration même, à travers les personnages de Thomas et de Christian. le premier, chef de la firme familiale, profondément lettré et cultivé, n'en demeure pas moins attaché à un rôle auquel sa nature profonde ne le destinait pas: le second, un dilettante amateur prodigieux de théâtre, n'aura jamais ni le courage, ni le talent nécessaire pour tenter d'accomplir une vie d'artiste comme sa nature semblait le prédisposer. Hanno, de la quatrième génération, semble être le premier à se révéler être une pure nature d'artiste, à travers son talent de musicien: mais sa mort prématurée marque l'extinction de la lignée de Buddenbrook.
Ce qui semble paradoxalement marquer une forme de victoire de la contemplation sur l'action, c'est précisément l'écriture de ce roman par Thomas Mann lui-même. L'on se rappellera utilement à cette fin que la matière de ce roman est largement autobiographique, le jeune auteur qu'il était ayant alors puisé amplement dans l'histoire de sa propre famille, des commerçants semblables à bien des points aux Buddenbrook. L'écriture transfigure la vacuité de l'action et la déchéance d'une famille en l'intégrant dans le caractère intemporel d'un roman où l'échec et la tragédie même font sens en tant qu'ils contribuent à la mise en forme du récit.
William Faulkner aurait dit des Buddenbrook qu'il s'agissait du plus grand roman du 20ème siècle. Toujours est-il qu'il avait un exemplaire dédicacé par la main de Mann lui-même se trouvait dans sa bibliothèque.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, les Buddenbrook m'ont rappelé...Tendre est la nuit, de Francis Scott Fitzgerald. Bien évidemment, le second n'était encore qu'un enfant quand quand Mann eut achevé ce premier roman, de sorte qu'il ne saurait être question de dire que l'Américain aurait influencé l'Allemand...
Non, ce qu'il y a d'assez frappant, c'est cette même représentation saisissante de la déchéance, dans ce qu'elle possède d'insidieuse et d'irréversible, par l'incapacité qu'ont les individus d'en reconnaître à temps les prémices, au-delà des différences abyssales séparant ces deux écrivains.
La conscience de la décadence est toujours une conscience tragique, en ce sens que c'est souvent lorsque toute action visant à la contrecarrer est désormais vaine qu'elle survient.
De ce fait, ce n'est pas par hasard que le roman accorde une place croissante à des tempéraments contemplatifs, davantages tournés vers la dimension intellectuelle et esthétique de l'homme (d'abord Christian Buddenbrook, puis son frère aîné Thomas, enfin son fils Hanno, qui clôt la lignée) que vers l'action pratique propre à cette lignée de commerçants (les deux premiers Buddenbrook, Johann père et fils).
Cette succession progressive d'hommes d'action vers des individus dominés par l'intellect épouse en effet la trajectoire descendante des destinées de la famille, comme si le caractère vain de toute action se manifestait de la sorte. Plus les générations avancent, et plus la conscience de l'inanité de l'action se manifeste chez les Buddenbrook. Hanno en est l'illustration la plus accomplie, lorsque la commotion esthétique éprouvée devant la représentation de Lohengrin, un des chefs-d'oeuvre de Wagner se traduit dans son esprit par un écoeurement absolu envers toute forme de vie pratique (dont le commerce) face à l'intensité de la contemplation esthétique face à l'oeuvre d'art.
Mais là où ce roman se montre d'une ambiguïté fondamentale, c'est qu'il peut apparaître par moments difficile de déterminer si l'arrivée de ces hommes de moins en moins aptes à l'action et au sens pratique qu'impose la direction d'une entreprise est la cause ou la conséquence de cette décadence familiale.
Le roman ne semble pas aussi tranché qu'on pourrait le croire en faveur de la première hypothèse. le mariage malheureux d'Antonie avec Bendrix Grunlich, son premier mari, a bien eu lieu avec l'assentiment de Johann Buddenbrook fils (le second du nom), un homme tout entier tourné vers le commerce, qui croyait faire là une affaire fructueuse...
A vrai dire, c'est essentiellement à travers des natures duales, ni tout à fait aptes à l'action qu'implique la vie de chef d'entreprise, ni assez talentueuses pour pouvoir entreprendre une carrière artistique ou intellectuelle que se manifeste la chute lente de la famille.
La troisième génération de Buddenbrook en est l'illustration même, à travers les personnages de Thomas et de Christian. le premier, chef de la firme familiale, profondément lettré et cultivé, n'en demeure pas moins attaché à un rôle auquel sa nature profonde ne le destinait pas: le second, un dilettante amateur prodigieux de théâtre, n'aura jamais ni le courage, ni le talent nécessaire pour tenter d'accomplir une vie d'artiste comme sa nature semblait le prédisposer. Hanno, de la quatrième génération, semble être le premier à se révéler être une pure nature d'artiste, à travers son talent de musicien: mais sa mort prématurée marque l'extinction de la lignée de Buddenbrook.
Ce qui semble paradoxalement marquer une forme de victoire de la contemplation sur l'action, c'est précisément l'écriture de ce roman par Thomas Mann lui-même. L'on se rappellera utilement à cette fin que la matière de ce roman est largement autobiographique, le jeune auteur qu'il était ayant alors puisé amplement dans l'histoire de sa propre famille, des commerçants semblables à bien des points aux Buddenbrook. L'écriture transfigure la vacuité de l'action et la déchéance d'une famille en l'intégrant dans le caractère intemporel d'un roman où l'échec et la tragédie même font sens en tant qu'ils contribuent à la mise en forme du récit.