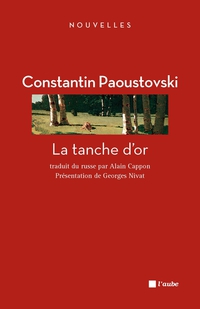>
Critique de fulmar
« Je dirai le visage de ce pays qui dort
Entre le lac tranquille et les montagnes bleues,
Je dirai les blés murs et les avoines d'or
Et les chemins couchés près des talus poudreux,
Je dirai les sentiers qui courent en forêt,
Les fleurs pâles qui s'ouvrent dans des ronds de lumière,
La mousse humide et sombre, et les étangs secrets
Cachés dans les roseaux à l'orée des clairières ».
D'or / dort, m'est tout de suite revenue cette chanson de Michel Buhler.
Tanche d'or, chante et dort, je suis encore enveloppé de ouate après la lecture des onze nouvelles qui composent ce recueil de Constantin Paoustovski.
Douceur, quiétude, harmonie. S'il ne restait que trois mots, ce serait ceux-là.
Peinture du paysage et des éléments qui le composent, faune, flore, humains, la fraternité des grands espaces qui côtoie l'intimité de la description.
J'ai passé un court mais magnifique moment avec les phrases de cet auteur russe. Elles sont simples mais se suffisent à elles-mêmes.
Me vient à l'esprit d'autres écrivains qui ont raconté leur environnement.
Louis Pergaud a utilisé de longues phrases pour décrire les bêtes sauvages du Jura dans « De Goupil à Margot », Maurice Genevoix a poétisé les animaux dans ses trois « Bestiaires », Henri Vincenot a exalté les saveurs de la vie rustique en Bourgogne dans « Récits des friches et des bois », Hermann Hesse a magnifié l'état d'âme intérieur dans « Description d'un paysage », Iouri Kazakov a sublimé les sens dans « La petite gare ».
Le début du vingtième siècle fut propice aux aventuriers de la proximité, aux narrateurs de la minutie des détails en lien avec la nature. Plus près de nous, je pense également à Jacques Lacarrière et « Le pays sous l'écorce » où l'imaginaire a côtoyé le réel.
Là, avec Paoustovski, je parlerai de simplicité et de délicatesse. C'est peut-être imparfait, mais ça dit le passé simple de la plus belle façon. Et ces deux temps constamment employés rendent à merveille une certaine douceur nostalgique.
« Le vent arrachait les feuilles humides et parfumées des bouleaux. Assis près du feu, j'avais l'impression que, derrière moi, quelqu'un fixait son regard sur ma nuque. Puis j'entendis distinctement un bruit de pas dans le bois mort : on marchait dans un fourré ».
Parfois, des phrases sans verbe, ou l'une déclinée au présent.
« Du haut du remblai jusqu'à l'horizon, la forêt, rien d'autre. Au-dessus, mangeant la moitié du ciel, un immense nuage noir immobile. Un vol d'oiseaux blancs qui passent, pareils à des semences de pissenlit ».
L'alternance entre description et récit est bien marquée, sans compter les dialogues du cru qui pimentent les situations.
« - Alors, mon p'tit pigeon, ricana l'une d'elles, où on va comme ça ? T'as beau être un as… elle s'ra vide, ta nasse !!! »
Et je ne trouve pas que ces nouvelles soient juste mignonnes ou charmantes. Elles relatent la vie rurale de la Russie de l'époque, après la grande guerre et la révolution bolchevique. Une sorte de sublimation de la nature, face à l'oppression politique et militaire. Une simplicité désarmante et directe, sans à priori, qui se savoure avec authenticité. Sans aller vers le fantastique, l'auteur met les animaux et les objets au même rang que les humains, pour montrer la fraternité qui se dégage des relations entre toutes les composantes de l'environnement.
« Tous les matins, nous disposions des miettes de pain et du gruau sur la table en planches du jardin. D'habiles mésanges venaient s'y poser par dizaines et, lorsqu'elles picoraient les miettes toutes ensemble, leurs joues blanches et duveteuses donnaient l'illusion de dizaines de petits marteaux s'abattant sur la table. Les mésanges se disputaient, piaillaient, et leurs cris qui rappelaient de petits coups d'ongle rapides contre un verre se transformaient en une joyeuse mélodie. On aurait cru entendre une boîte à musique vivante gazouiller sur la vieille table du jardin ».
Un blaireau curieux qui se brûle le museau, un chat roux chapardeur qui passe de maraudeur à gendarme, un diable de pélican qui fait des siennes sans ménagerie, un chien turbulent qui se fait mener en bateau, une énorme tanche à qui on tend la perche, un lièvre à l'oreille cassée qui sauve un papy de l'incendie, une boîte à musique qui se montre récalcitrante, un vieil hongre qui bat en retraite, voilà tout un panel de personnages qui apparaissent au fil des pages. Certains se retrouvent dans plusieurs nouvelles, ce qui donne une certaine cohérence au récit et un ensemble moins disparate.
Avec comme fil rouge l'immensité des paysages, l'eau et la sève sources de vie. L'eau des lacs et de la Volga, les forêts qui souffrent « déjà » de la sécheresse, deux milieux naturels à préserver d'urgence.
Le Constantin s'affirme comme l'empereur de la description.
« Une chaleur inouïe pesait sur les forêts cet été-là. Des bourrasques brûlantes soufflaient sans interruption depuis maintenant deux semaines. La résine coulait le long des pins et formait des pierres d'ambre jaune. Chauffée à blanc par le soleil, la forêt semblait se consumer lentement et, même, exhaler un désagréable effluve de brûlé ».
Puis vint l'orage salvateur. Il était temps...
« Tel l'hercule qui, à son réveil, détend ses robustes épaules, le tonnerre s'étirait paresseusement derrière l'horizon et, sans le vouloir, faisait trembler la terre. Des rides grises apparurent à la surface de la rivière. Sans bruit, de violents éclairs fondirent sournoisement sur les prairies ; bien au-delà de la ville, ils avaient déjà embrasé une meule de foin. de grosses gouttes de pluie s'abattirent sur le chemin qui ressembla bientôt au sol lunaire, chaque goutte creusant un petit cratère dans la poussière ».
J'éprouve le besoin de sentir le pétrichor, ce sang de pierre qui s'exhale après l'orage estival. Je le sens imprégner mes narines, je suis devenu un des personnages, je pense à tous ces pays du Nord qui se croyaient à l'abri des dévastations de la canicule. Sibérie, Suède, Canada, même combat.
« Don't it always seem to go
That you don't know what you've got till it's gone »
Cela n'a-t-il pas l'air de toujours se passer ainsi :
Vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce que vous l'ayez perdu !
Ces mots de la Canadienne Joni Mitchell datent de 1970. Huit ans après « Le printemps silencieux » de Rachel Carson. La préservation de l'environnement n'était encore qu'à ses balbutiements.
Je ne vous ai pas parlé de ce jeune bouleau donné en cadeau, mis en pot pour passer l'hiver à l'abri afin qu'il puisse garder ses feuilles pour que les habitants du lieu se croient encore en été. Mais l'arbrisseau, qui ne l'était pas sot, perdit son feuillage pour ne pas faire du tort à ces collègues restés dehors.
« C'est la loi de la nature. Si les arbres ne perdaient pas leurs feuilles avant l'hiver, mille morts les guetteraient : le poids de la neige qui s'accumulerait et finirait par briser les branches les plus solides ; une multitude de sels, toxiques pour l'arbre, qui s'insinuerait dans ses feuilles jusqu'à l'automne ; la vapeur d'eau, enfin, que le feuillage continuerait à rejeter même au coeur de l'hiver alors que les racines ne peuvent plus en puiser dans la terre gelée. Ce serait pour les arbres une mort inexorable, la sécheresse de l'hiver les ferait périr de soif ».
Quelle belle leçon de choses, la science assortie de mots simples, la connaissance apprise par l'observation, le bon sens paysan.
Ce recueil est pétri d'amour, de bienveillance, d'empathie. Une sorte de médecine du coeur contre les aberrations du monde actuel.
Qu'est-ce qu'il m'a fait comme bien !
Et comme dirait encore Michel, l'Helvète chanteur, qui a mangé la terre et bu l'air :
« C'est votre simple histoire, et c'est toute une vie ».
Entre le lac tranquille et les montagnes bleues,
Je dirai les blés murs et les avoines d'or
Et les chemins couchés près des talus poudreux,
Je dirai les sentiers qui courent en forêt,
Les fleurs pâles qui s'ouvrent dans des ronds de lumière,
La mousse humide et sombre, et les étangs secrets
Cachés dans les roseaux à l'orée des clairières ».
D'or / dort, m'est tout de suite revenue cette chanson de Michel Buhler.
Tanche d'or, chante et dort, je suis encore enveloppé de ouate après la lecture des onze nouvelles qui composent ce recueil de Constantin Paoustovski.
Douceur, quiétude, harmonie. S'il ne restait que trois mots, ce serait ceux-là.
Peinture du paysage et des éléments qui le composent, faune, flore, humains, la fraternité des grands espaces qui côtoie l'intimité de la description.
J'ai passé un court mais magnifique moment avec les phrases de cet auteur russe. Elles sont simples mais se suffisent à elles-mêmes.
Me vient à l'esprit d'autres écrivains qui ont raconté leur environnement.
Louis Pergaud a utilisé de longues phrases pour décrire les bêtes sauvages du Jura dans « De Goupil à Margot », Maurice Genevoix a poétisé les animaux dans ses trois « Bestiaires », Henri Vincenot a exalté les saveurs de la vie rustique en Bourgogne dans « Récits des friches et des bois », Hermann Hesse a magnifié l'état d'âme intérieur dans « Description d'un paysage », Iouri Kazakov a sublimé les sens dans « La petite gare ».
Le début du vingtième siècle fut propice aux aventuriers de la proximité, aux narrateurs de la minutie des détails en lien avec la nature. Plus près de nous, je pense également à Jacques Lacarrière et « Le pays sous l'écorce » où l'imaginaire a côtoyé le réel.
Là, avec Paoustovski, je parlerai de simplicité et de délicatesse. C'est peut-être imparfait, mais ça dit le passé simple de la plus belle façon. Et ces deux temps constamment employés rendent à merveille une certaine douceur nostalgique.
« Le vent arrachait les feuilles humides et parfumées des bouleaux. Assis près du feu, j'avais l'impression que, derrière moi, quelqu'un fixait son regard sur ma nuque. Puis j'entendis distinctement un bruit de pas dans le bois mort : on marchait dans un fourré ».
Parfois, des phrases sans verbe, ou l'une déclinée au présent.
« Du haut du remblai jusqu'à l'horizon, la forêt, rien d'autre. Au-dessus, mangeant la moitié du ciel, un immense nuage noir immobile. Un vol d'oiseaux blancs qui passent, pareils à des semences de pissenlit ».
L'alternance entre description et récit est bien marquée, sans compter les dialogues du cru qui pimentent les situations.
« - Alors, mon p'tit pigeon, ricana l'une d'elles, où on va comme ça ? T'as beau être un as… elle s'ra vide, ta nasse !!! »
Et je ne trouve pas que ces nouvelles soient juste mignonnes ou charmantes. Elles relatent la vie rurale de la Russie de l'époque, après la grande guerre et la révolution bolchevique. Une sorte de sublimation de la nature, face à l'oppression politique et militaire. Une simplicité désarmante et directe, sans à priori, qui se savoure avec authenticité. Sans aller vers le fantastique, l'auteur met les animaux et les objets au même rang que les humains, pour montrer la fraternité qui se dégage des relations entre toutes les composantes de l'environnement.
« Tous les matins, nous disposions des miettes de pain et du gruau sur la table en planches du jardin. D'habiles mésanges venaient s'y poser par dizaines et, lorsqu'elles picoraient les miettes toutes ensemble, leurs joues blanches et duveteuses donnaient l'illusion de dizaines de petits marteaux s'abattant sur la table. Les mésanges se disputaient, piaillaient, et leurs cris qui rappelaient de petits coups d'ongle rapides contre un verre se transformaient en une joyeuse mélodie. On aurait cru entendre une boîte à musique vivante gazouiller sur la vieille table du jardin ».
Un blaireau curieux qui se brûle le museau, un chat roux chapardeur qui passe de maraudeur à gendarme, un diable de pélican qui fait des siennes sans ménagerie, un chien turbulent qui se fait mener en bateau, une énorme tanche à qui on tend la perche, un lièvre à l'oreille cassée qui sauve un papy de l'incendie, une boîte à musique qui se montre récalcitrante, un vieil hongre qui bat en retraite, voilà tout un panel de personnages qui apparaissent au fil des pages. Certains se retrouvent dans plusieurs nouvelles, ce qui donne une certaine cohérence au récit et un ensemble moins disparate.
Avec comme fil rouge l'immensité des paysages, l'eau et la sève sources de vie. L'eau des lacs et de la Volga, les forêts qui souffrent « déjà » de la sécheresse, deux milieux naturels à préserver d'urgence.
Le Constantin s'affirme comme l'empereur de la description.
« Une chaleur inouïe pesait sur les forêts cet été-là. Des bourrasques brûlantes soufflaient sans interruption depuis maintenant deux semaines. La résine coulait le long des pins et formait des pierres d'ambre jaune. Chauffée à blanc par le soleil, la forêt semblait se consumer lentement et, même, exhaler un désagréable effluve de brûlé ».
Puis vint l'orage salvateur. Il était temps...
« Tel l'hercule qui, à son réveil, détend ses robustes épaules, le tonnerre s'étirait paresseusement derrière l'horizon et, sans le vouloir, faisait trembler la terre. Des rides grises apparurent à la surface de la rivière. Sans bruit, de violents éclairs fondirent sournoisement sur les prairies ; bien au-delà de la ville, ils avaient déjà embrasé une meule de foin. de grosses gouttes de pluie s'abattirent sur le chemin qui ressembla bientôt au sol lunaire, chaque goutte creusant un petit cratère dans la poussière ».
J'éprouve le besoin de sentir le pétrichor, ce sang de pierre qui s'exhale après l'orage estival. Je le sens imprégner mes narines, je suis devenu un des personnages, je pense à tous ces pays du Nord qui se croyaient à l'abri des dévastations de la canicule. Sibérie, Suède, Canada, même combat.
« Don't it always seem to go
That you don't know what you've got till it's gone »
Cela n'a-t-il pas l'air de toujours se passer ainsi :
Vous ne savez pas ce que vous avez jusqu'à ce que vous l'ayez perdu !
Ces mots de la Canadienne Joni Mitchell datent de 1970. Huit ans après « Le printemps silencieux » de Rachel Carson. La préservation de l'environnement n'était encore qu'à ses balbutiements.
Je ne vous ai pas parlé de ce jeune bouleau donné en cadeau, mis en pot pour passer l'hiver à l'abri afin qu'il puisse garder ses feuilles pour que les habitants du lieu se croient encore en été. Mais l'arbrisseau, qui ne l'était pas sot, perdit son feuillage pour ne pas faire du tort à ces collègues restés dehors.
« C'est la loi de la nature. Si les arbres ne perdaient pas leurs feuilles avant l'hiver, mille morts les guetteraient : le poids de la neige qui s'accumulerait et finirait par briser les branches les plus solides ; une multitude de sels, toxiques pour l'arbre, qui s'insinuerait dans ses feuilles jusqu'à l'automne ; la vapeur d'eau, enfin, que le feuillage continuerait à rejeter même au coeur de l'hiver alors que les racines ne peuvent plus en puiser dans la terre gelée. Ce serait pour les arbres une mort inexorable, la sécheresse de l'hiver les ferait périr de soif ».
Quelle belle leçon de choses, la science assortie de mots simples, la connaissance apprise par l'observation, le bon sens paysan.
Ce recueil est pétri d'amour, de bienveillance, d'empathie. Une sorte de médecine du coeur contre les aberrations du monde actuel.
Qu'est-ce qu'il m'a fait comme bien !
Et comme dirait encore Michel, l'Helvète chanteur, qui a mangé la terre et bu l'air :
« C'est votre simple histoire, et c'est toute une vie ».