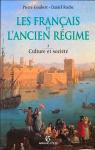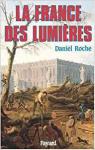Nationalité : France
Né(e) à : Paris , le 26/07/1935
Mort(e) à : Paris , le 19/02/2023
Ajouter des informations
Né(e) à : Paris , le 26/07/1935
Mort(e) à : Paris , le 19/02/2023
Biographie :
Daniel Roche est un historien français.
Il intègre l'École normale supérieure de Saint-Cloud en 1956. Sur le conseil de Pierre Goubert, alors enseignant à l'école, il réalise son mémoire de maîtrise sous la direction d'Ernest Labrousse, qui lance à cette époque une grande enquête sur la bourgeoisie.
Il est reçu à l'agrégation d'histoire. De 1960 à 1962, il est professeur au lycée de Châlons-sur-Marne. Il fréquente les archives municipales et départementales, où il se prend d'intérêt pour les académies provinciales du XVIIIe siècle.
À partir de 1962, et jusqu'en 1965, il est caïman à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, tout en étant chargé de recherches au CNRS. Il décide de consacrer sa thèse aux académies provinciales du XVIIIe siècle siècle, sous la direction d'Alphonse Dupront. De ses premiers travaux avec Ernest Labrousse, alors figure majeure et très influente des études historiques, Daniel Roche conserve un positionnement épistémologique influencé par un marxisme nuancé.
Il prend notamment une part active dans les débats épistémologiques, mais aussi politiques, qui opposaient l'école labroussienne, partisane d'une approche de la société d'Ancien Régime en termes de classes sociales, à l'école de Roland Mousnier qui défendait quant à elle la primauté des ordres socio-juridiques.
Sa carrière se déroule ensuite à l'Université Paris VII (1973-1977), puis à Paris I, où il est professeur de 1978 à 1989. Il est aussi professeur à l'Institut européen de Florence (1985-1989). En 1989, il devient directeur d'études à l'EHESS, avant d'être nommé, en 1998, professeur au Collège de France, où il devient titulaire de la Chaire d'histoire de la France des Lumières. Il est désormais professeur honoraire.
En tant que professeur d'université, mais aussi comme directeur de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine (1990-2000), ou comme directeur (avec Pierre Milza) de la "Revue d'histoire moderne et contemporaine", il a joué un grand rôle dans l'organisation et l'animation de la recherche historique.
+ Voir plusDaniel Roche est un historien français.
Il intègre l'École normale supérieure de Saint-Cloud en 1956. Sur le conseil de Pierre Goubert, alors enseignant à l'école, il réalise son mémoire de maîtrise sous la direction d'Ernest Labrousse, qui lance à cette époque une grande enquête sur la bourgeoisie.
Il est reçu à l'agrégation d'histoire. De 1960 à 1962, il est professeur au lycée de Châlons-sur-Marne. Il fréquente les archives municipales et départementales, où il se prend d'intérêt pour les académies provinciales du XVIIIe siècle.
À partir de 1962, et jusqu'en 1965, il est caïman à l'École normale supérieure de Saint-Cloud, tout en étant chargé de recherches au CNRS. Il décide de consacrer sa thèse aux académies provinciales du XVIIIe siècle siècle, sous la direction d'Alphonse Dupront. De ses premiers travaux avec Ernest Labrousse, alors figure majeure et très influente des études historiques, Daniel Roche conserve un positionnement épistémologique influencé par un marxisme nuancé.
Il prend notamment une part active dans les débats épistémologiques, mais aussi politiques, qui opposaient l'école labroussienne, partisane d'une approche de la société d'Ancien Régime en termes de classes sociales, à l'école de Roland Mousnier qui défendait quant à elle la primauté des ordres socio-juridiques.
Sa carrière se déroule ensuite à l'Université Paris VII (1973-1977), puis à Paris I, où il est professeur de 1978 à 1989. Il est aussi professeur à l'Institut européen de Florence (1985-1989). En 1989, il devient directeur d'études à l'EHESS, avant d'être nommé, en 1998, professeur au Collège de France, où il devient titulaire de la Chaire d'histoire de la France des Lumières. Il est désormais professeur honoraire.
En tant que professeur d'université, mais aussi comme directeur de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine (1990-2000), ou comme directeur (avec Pierre Milza) de la "Revue d'histoire moderne et contemporaine", il a joué un grand rôle dans l'organisation et l'animation de la recherche historique.
Ajouter des informations
étiquettes
Citations et extraits (17)
Voir plus
Ajouter une citation
Dans la société préindustrielle, avant la généralisation des tissus à bon marché, avant la standardisation de la confection vestimentaire, le vêtement doit satisfaire les exigences fonctionnelles mais, en même temps, il permet d'afficher un paraître, c'est-à-dire la confection d'une identité qui mêle convenances et usages sociaux, appropriations individualisées et recherches d'effets distinctifs.
Pour l'administration royale comme pour les encyclopédistes, la modernisation de l'État, l'amélioration des ressources empruntent un itinéraire obligé : il faut connaître pour agir, connaître le royaume, connaître les peuples, évaluer – pour accroître – les hommes et les ressources. (...)
La connaissance du royaume est une connaissance abstraite et elle fait peu de place encore à la découverte spontanée du tourisme, même si le voyage intérieur se développe et s'organise. Le nombre des récits de voyageurs dans le royaume s'accroît : Boucher de La Richarderie, qui ne recense pas tout, en compte une vingtaine pour le XVIIe siècle, et plus de 150 pour le XVIIIe, majoritairement publiés après 1750. Le témoignage individuel gagne du terrain, son sens et son organisation se complexifient, mais il reste en arrière-plan d'une prise de connaissance où la géographie et la cartographie sont encore les principaux instruments de l'évaluation des espaces. L'emprise de l'État s'affirme à travers ces moyens.
Première partie
Chapitre premier. La connaissance de la France
La connaissance du royaume est une connaissance abstraite et elle fait peu de place encore à la découverte spontanée du tourisme, même si le voyage intérieur se développe et s'organise. Le nombre des récits de voyageurs dans le royaume s'accroît : Boucher de La Richarderie, qui ne recense pas tout, en compte une vingtaine pour le XVIIe siècle, et plus de 150 pour le XVIIIe, majoritairement publiés après 1750. Le témoignage individuel gagne du terrain, son sens et son organisation se complexifient, mais il reste en arrière-plan d'une prise de connaissance où la géographie et la cartographie sont encore les principaux instruments de l'évaluation des espaces. L'emprise de l'État s'affirme à travers ces moyens.
Première partie
Chapitre premier. La connaissance de la France
A la géographie des manuels, des descriptions à succès et des recherches académiques, on devrait ajouter celle des dictionnaires et des répertoires. L'Encyclopédie, de la première édition aux remaniements des suivantes, y tient sa place : elle participe à la volonté de comprendre les différences plutôt que les identités, en même temps qu'elle joue avec délectation du dépaysement, voire de l'exotisme, comme révélateur de soi et des préjugés à combattre. Simultanément, cet intérêt rejoint le « dessein de savoir » qui pousse gouvernants et gouvernements à multiplier les enquêtes. Les nouveaux regards sur le monde qui caractérisent le dernier tiers du siècle procèdent de cet accord. Ils élargissent la curiosité de l'élite cultivée aux dimensions du monde, tout en la mobilisant sur l'Europe et le royaume. L'utilitarisme des descriptions est incontestable et anime naturalistes, économistes, agronomes, voyageurs et observateurs.
Première partie.
Chapitre premier.La connaissance de la France
Première partie.
Chapitre premier.La connaissance de la France
Le clocher du village est pour tout paysan un symbole de solidarité, c'est l'expansion de la communauté forgée par les malheurs; les guetteurs montés dans les clochers tentaient de prévenir. Quant aux démonstrations de joie, les cloches sonnantes et carillonnantes les exprimaient encore il y a peu de temps.
Montesquieu, dans ses Pensées, rappelle « que les États sont gouvernés par cinq choses différentes : par la religion, par les maximes générales du gouvernement, par les lois particulières, par les mœurs et par les manières. Ces choses ont toutes un rapport mutuel les unes aux autres. Si vous en changez une, les autres ne suivent que lentement ; ce qui met partout une espèce de dissonance. » C'est l'histoire de ces dissonances qu'il faut entendre pour comprendre « comment se forme un esprit général et ce qui en résulte », ainsi que le reformulera plus clairement L'Esprit des lois avant 1743, en rajoutant au catalogue des interrogations « le climat et l'exemple des choses passées ».
Première partie
Chapitre premier. La connaissance de la France
Première partie
Chapitre premier. La connaissance de la France
(...) connaître le royaume, c'est en dresser la carte et – au terme d'une procédure analogue à celle des classifications de la botanique, de la minéralogie et bientôt de la chimie transformée par Lavoisier – disposer d'un instrument, non seulement d'un miroir où contempler le royaume dans son étendue, sa mesure et sa diversité, mais aussi d'un moyen d'action. La géographie, ça sert à faire la guerre, disait-on il y a peu, et plus encore la cartographie qui enregistre les conflits et aide à les préparer. On voit là à quel point on ne peut séparer l'interrogation des outils – la carte et ses discours – de la manière dont ils ont été conçus et pour quelle finalité.
Première partie
Chapitre premier. La connaissance de la France
Première partie
Chapitre premier. La connaissance de la France
Les pratiques épurées récupèrent les traditions érotiques ancestrales et tentent de les spiritualiser : la bénédiction du lit nuptial, vieux rite de fécondité propice à la gauloiserie, devient cérémonie célébratoire de la pureté conjugale, l'enlèvement de la mariée, promenée de part et d'autre du terroir par la jeunesse excitée, afin de lui conférer l'adhésion de tous et la possession de l'espace commun, devient acte furtif, les prières et les exorcismes pour protéger des sorts sont surveillés par les officiaux diocésains.
La distinction s'impose entre livres contrefaits et livres interdits, même si la saisie policière est leur lot commun. La contrefaçon est une défense économique contre le monopole parisien, elle ne fait que reprendre les succès autorisés, à l'usage des provinciaux et des étrangers: c'est une manière de défendre le libéralisme. Le livre prohibé, lui, met en cause la sûreté de la société, il en enfreint les tabous et il en conteste les visions. Depuis les origines, c'est un instrument de combat.
Le désir d'apprendre et de comprendre qui anime tant de témoignages et de discussions n'est pas réservé aux élites, il mobilise également quantité de petites gens pratiques et réalistes. C'est une façon de voir les Français, mais aussi les Françaises, car cet éveil, dont témoignent les autobiographies populaires, se joue sans conteste dans la sphère familiale et domestique, le groupe d'existence.
Première partie
Chapitre premier. La connaissance de la France
Première partie
Chapitre premier. La connaissance de la France
Après la géographie générale descriptive et des notions sur la formation du monde, les enfants royaux découvrent progressivement l'étude régionale – l'Europe et ses royaumes, l'Allemagne, l'Italie, la France –, avec des explications sur les climats, l'organisation politique, l'économie, les productions, le passé historique et monumental.
Première partie.
Chapitre premier.La connaissance de la France
Première partie.
Chapitre premier.La connaissance de la France
Les Dernières Actualités
Voir plus
Listes avec des livres de cet auteur

Histoire des mentalités
GabySensei
81 livres
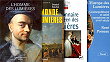
Le siècle des Lumières
Sauveterre
48 livres
Auteurs proches de Daniel Roche
Lecteurs de Daniel Roche (78)Voir plus
Quiz
Voir plus
Richard Coeur de lion
Richard devint roi d'Angleterre en 1189, mais qui était son prédécesseur ?
Henri II Plantagenêt
Edouard le Confesseur
Guillaume II le Roux
Henri Ier Beauclerc
10 questions
23 lecteurs ont répondu
Thèmes :
histoire médiévale
, chevalerie
, Rois et souverainsCréer un quiz sur cet auteur23 lecteurs ont répondu