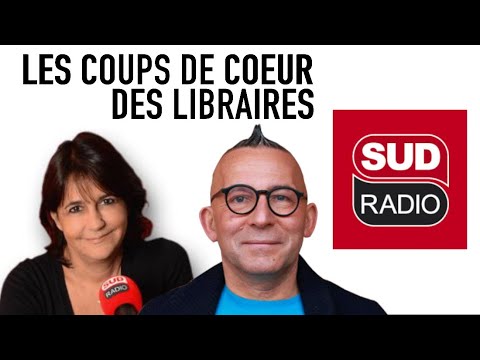Né(e) à : Saumur, Maine-et-Loire , le 25/01/1915
Mort(e) à : Issy-les-Moulineaux , le 16/01/2012
Pierre Goubert est un historien français, spécialiste du XVIIe siècle.
Né dans une famille modeste (son père est jardinier), il entre à l'École Normale d'Instituteurs d'Angers en 1931. Il intègre en 1935 l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud qui forme, à cette époque, les professeurs d'École Normale. Il reçoit alors les cours de Marc Bloch, rencontre marquante qui le détermine à choisir l'histoire comme discipline de recherche. A la sortie de ce stage en 1937, Pierre Goubert enseigne cette dernière matière ainsi que les lettres à l'EN de Périgueux.
Mobilisé en 1939, il fait la campagne de France dans la troupe - avec le grade de caporal - échappe à la captivité et devient professeur de "collège moderne" au lycée de Pithiviers puis à Beauvais. Il est autorisé, par dérogation, à préparer la licence qu'il passe, selon ses propres termes,"par morceaux" et réussit en 1948 l'agrégation d'histoire. Il se lance aussitôt après dans la rédaction d'un doctorat d'État sur le Beauvaisis, région qu'il a retrouvée après un court séjour comme professeur au lycée Turgot.
Membre du CNRS depuis 1951, Pierre Goubert est nommé en 1956 directeur d'études de l'EPHE (VI° section), puis deux ans plus tard, obtient un poste de professeur d'histoire moderne à l'université de Rennes. Cette année 1958, il a 43 ans, est celle de la soutenance de sa thèse (qui sera publiée en 1960), "Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730". Pierre Goubert devient ensuite Professeur dans la toute nouvelle Université de Paris X-Nanterre.
Nommé à la Sorbonne en 1969 (retraité en 1978), il présente des conférences dans le monde entier (en Europe mais aussi à Princeton, Montréal, Kingston, au Japon, en Côte d'Ivoire, à Madagascar) et publie de nombreux ouvrages d'histoire moderne.
Ajouter des informations
Attention !!! Nouvel horaire pour l'émission "Le coup de coeur des libraires" sur les Ondes de Sud Radio. Valérie Expert et Gérard Collard vous donnent rendez-vous chaque samedi à 14h00 pour vous faire découvrir leurs passions du moment ! • Retrouvez leurs dernières sélections de livres ici ! • • • Ce que je sais de toi de Eric Chacour aux éditions Philippe Rey https://www.lagriffenoire.com/ce-que-je-sais-de-toi.html • La promesse de l'aube de Romain Gary, Hervé Pierre aux éditions Folio https://www.lagriffenoire.com/la-promesse-de-l-aube-premiere-partie.html • le jongleur de Agata Tuszynska aux éditions Stock https://www.lagriffenoire.com/le-jongleur.html • a fille d'elle-même (Romans contemporains) de Gabrielle Boulianne-Tremblay aux éditions JC Lattès https://www.lagriffenoire.com/la-fille-d-elle-meme.html • Les muses orphelines de Michel Marc Bouchard et Noëlle Renaude aux éditions Théatrales 9782842602161 • Oum Kalsoum - L'Arme secrète de Nasser de Martine Lagardette et Farid Boudjellal aux éditions Oxymore https://www.lagriffenoire.com/oum-kalsoum-l-arme-secrete-de-nasser.html • le pied de Fumiko - La complainte de la sirène de Junichirô Tanizaki , Jean-Jacques Tschudin aux éditions Folio https://www.lagriffenoire.com/le-pied-de-fumiko-la-complainte-de-la-sirene.html • Amour et amitié de Jane Austen et Pierre Goubert aux éditions Folio https://www.lagriffenoire.com/amour-et-amitie-1.html • L'homme qui vivait sous terre de Richard Wright et Claude-Edmonde Magny aux éditions Folio https://www.lagriffenoire.com/l-homme-qui-vivait-sous-terre.html • Maximes et autres textes de Oscar Wilde et Dominique Jean aux éditions Folio https://www.lagriffenoire.com/maximes-et-autres-textes.html • • Chinez & découvrez nos livres coups d'coeur dans notre librairie en ligne lagriffenoire.com • Notre chaîne Youtube : Griffenoiretv • Notre Newsletter https://www.lagriffenoire.com/?fond=n... • Vos libraires passionnés, Gérard Collard & Jean-Edgar Casel • • • #editionsphilipperey #editionsfolio #editionsstock #editionsjclattes #editionstheatrales #editionsoxymore
Est-elle seulement un État ? Si un État, ce sont des ministres, des bureaux, des percepteurs, des porteurs d’hermine et des traîneurs de sabre, alors oui, la France est un État… Mais qu’est un État où la désobéissance, selon le mot de Lavisse, tempère encore l’absolutisme ? Qu’est un État où les manières d’asseoir, de répartir et de percevoir l’impôt, où la nature même de cet impôt change d’une province à l’autre ? Où, dans la multiplicité des coutumes et des tribunaux, en l’absence de loi générale, de code digne de ce nom, le premier souci, lorsqu’on doit soutenir un procès, consiste à trouver le tribunal compétent, et la loi — ensemble de dispositions sibyllines recouvertes de gloses — selon laquelle on plaidera ? Où la justice s’achète, se revend, se monnaie, se dénonce ? Est-ce un État, ce pays où l’on refuse habituellement le service militaire, où les familles et les paroisses conspirent pour sauver les recrues de la milice et entretenir les déserteurs ?
Tout sur one piece (difficile)
quel est le 1er homme de l équipage de Gold Roger ?
3590 lecteurs ont répondu